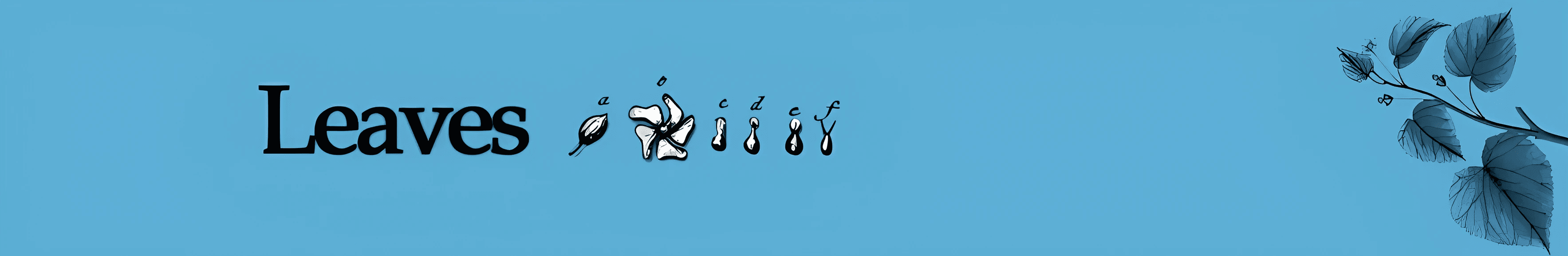
Four Species of Suspectacle
Résumé
C’est leur préoccupation commune pour le visuel qui permet d’associer représentation et suspicion au « suspectacle » du titre. Cet article se propose d’analyser l’importance du visuel dans le langage (et le discours) sur le soupçon. Ma méthode repose sur l’étymologie et la philologie, ce qui implique de faire peser le soupçon sur l’apparence des mots comme d’explorer leurs significations profondes. Quatre provocations sont ainsi proposées et dans chaque cas le soupçon porte sur un point différent. Le premier suspect, qui fait l’objet de la première provocation, est ce qu’on appelle en anglais credit clause : elle s’applique aux performances rhétoriques sur le mode « croyez-moi » ou « faites-moi confiance ». La deuxième est qualifiée de calling out et décrit des performances du genre « ne les croyez pas » ou « il ne faut pas croire ce qu’ils vous disent ». La troisième, countenance, concerne le masque social. Quant à la quatrième, cargo, elle porte sur la relation entre suspicion et poids. Il ne s’agit pas de proposer une lecture d’un texte littéraire, mais une stratégie de lecture de la performance rhétorique dans le discours de persuasion. La plupart des exemples retenus sont empruntés aux performances politiques et, en particulier, aux discours de Donald Trump. Cependant, on peut étudier de la même façon les œuvres de fiction littéraire.
