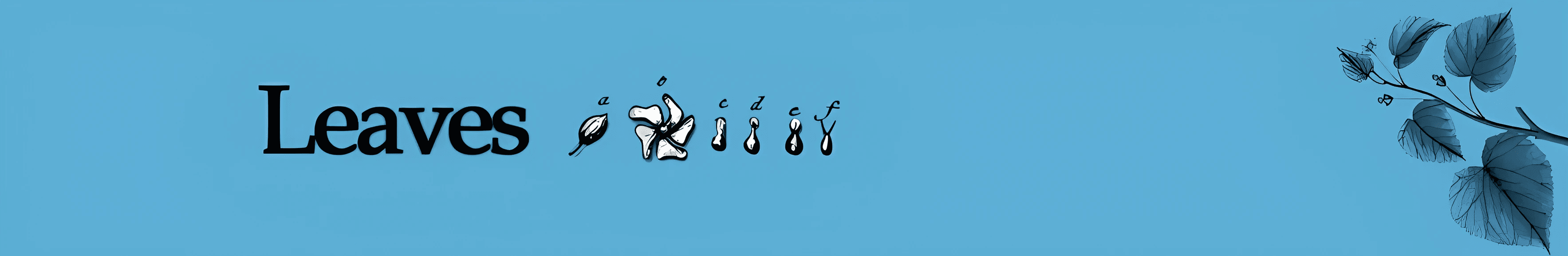
L’apparition de la contre-culture dite « hippie » des années 1960 et 1970 semble être une réponse à l’avènement d’une culture états-unienne consumériste et d’une modernité technocratique, alors perçues comme aliénantes et artificielles. Dans un contexte de militarisme et d’impérialisme, face à des crises sociales, raciales et écologiques de plus en plus évidentes, les jeunes membres de la contre-culture en sont venus à souligner la dimension profondément inauthentique de la culture états-unienne moderne et à construire, par contraste, des idéaux d’authenticité. Cet article démontre ainsi que le désir d’authenticité des hippies a orienté leur perception des peuples autochtones des États-Unis, donnant lieu à des phénomènes d’appropriation des cultures autochtones. À travers l’analyse des choix vestimentaires, iconographiques, spirituels et sociaux de la contreculture, l’article suggère que le jeu Indien (pour reprendre l’expression de P. Deloria) aura été central dans la constitution des identités contre-culturelles en recherche d’authenticité. Du fait de leur intérêt sélectif, de l’absence de contact avec des personnes autochtones et de leur préférence pour les sources textuelles, les membres de la contre-culture semblent par ailleurs avoir promu une version générique, occidentalisée et inauthentique des cultures autochtones. Cet article s’interroge donc sur la possibilité même de déterminer l’authenticité d’expressions culturelles données, à un moment où les peuples autochtones des États-Unis eux-mêmes redéfinissent leur héritage culturel à travers la redécouverte des religions traditionnelles.