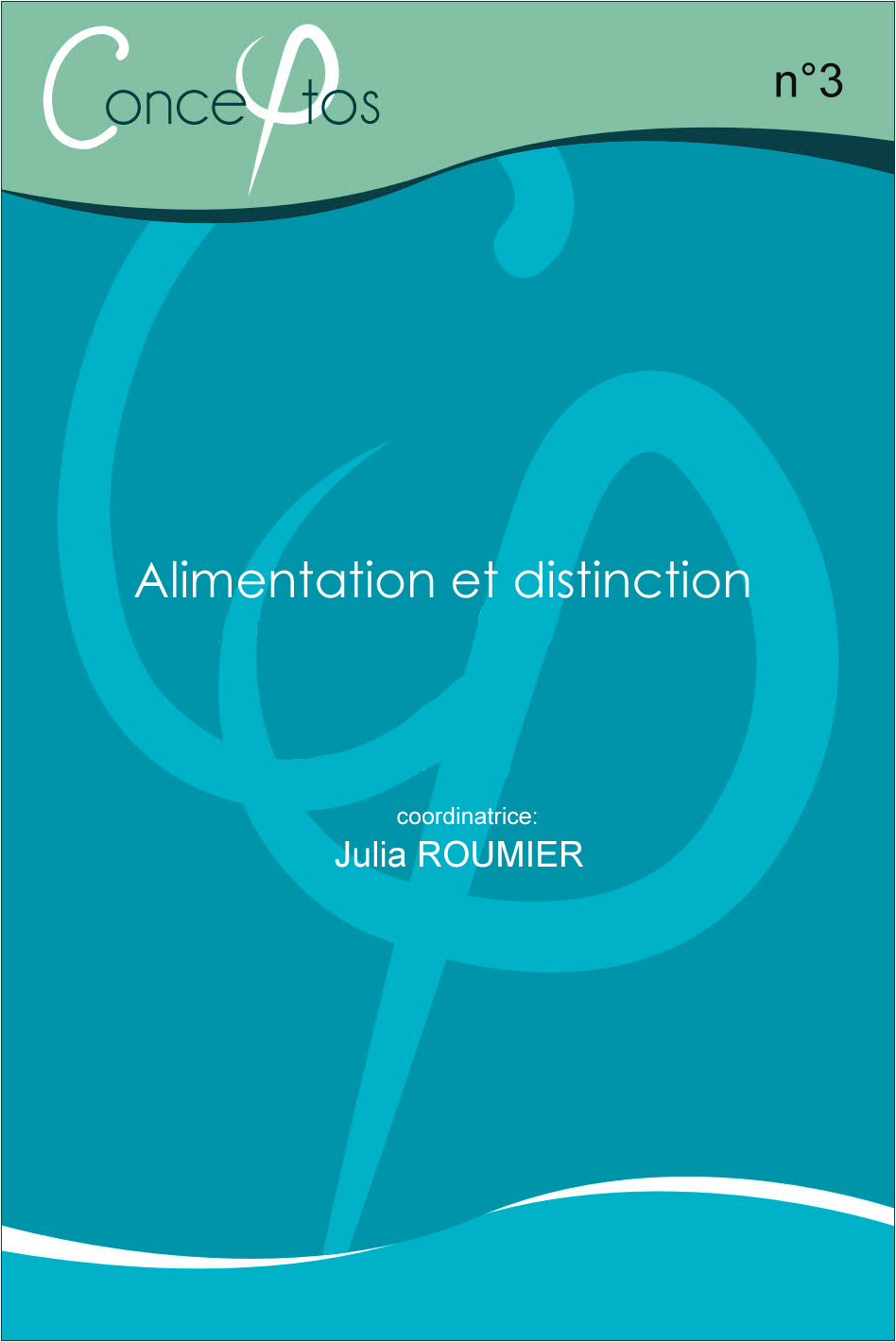Le Natif Relatif1
Préface de l’auteur
L’être humain, tel que nous l’imaginons, n’existe pas
Nelson Rodrigues
Les pages qui suivent ont été adaptées de l’argumentaire introductif d’un livre en préparation, où je développe des analyses ethnographiques préalablement esquissées. La principale l’a été dans article publié dans Mana, « Les Pronoms Cosmologiques et le Perspectivisme Amérindien » (Viveiros de Castro, 1996), dont les présupposés méta-théoriques, dira-t-on, sont à présent explicités. Bien que le présent texte puisse être lu sans aucune familiarité préalable avec l’article de 1996, le lecteur doit avoir en tête que les références à des notions telles que la « perspective » et le « point de vue », ainsi que l’idée d’une « pensée indigène », renvoient à cet article.
Les règles du jeu
L’anthropologue est celui qui élabore son discours sur celui d’un « natif ». Le natif n’a pas besoin d’être particulièrement sauvage, ou profondément ancré dans une tradition. Il n’a pas besoin non plus d’être originaire du lieu où l’anthropologue le rencontre. L’anthropologue, à son tour, n’a pas besoin d’être trop déterminé par la civilisation moderne2, ni même étranger vis-à-vis du peuple sur lequel il discourt. Les discours, celui de l’anthropologue et surtout celui du natif, ne sont pas forcément des textes : ce sont des « pratiques de sens » de différentes natures3. L’essentiel est que le discours de l’anthropologue (« l’observateur ») établisse une certaine relation avec le discours du natif (« l’observé »). Cette relation est une relation de sens, ou, comme l’on dit lorsque le discours a une visée scientifique, une relation de connaissance. Mais la connaissance anthropologique est immédiatement une relation sociale, car elle est l’effet des relations qui constituent réciproquement le sujet qui connaît et le sujet qu’il connaît, et la cause d’une transformation (toute relation est une transformation) des prédispositions relationnelles des deux4.
Cette (méta)relation n’est pas une relation d’identité : l’anthropologue dit toujours et, par conséquent, fait toujours autre chose que ce que dit et fait le natif, y compris quand son intention est d’uniquement reproduire « textuellement » le discours de ce dernier, ou encore d’essayer de dialoguer – notion douteuse – avec lui. Cet écart est ce qu’on appelle « l’effet de connaissance » du discours de l’anthropologue, la relation entre le sens de son discours et le sens du discours du natif.5
L’altérité discursive s’appuie, de façon certaine, sur un présupposé de ressemblance. L’anthropologue et le natif sont des entités de même espèce et condition : ils sont tous les deux humains, et ils sont tous les deux situés dans leurs cultures respectives, qui peuvent, éventuellement, être les mêmes. Or c’est justement ici que le jeu commence à devenir intéressant, ou encore mieux, étrange. Même quand l’anthropologue et le natif partagent la même culture, la relation de sens entre les deux discours crée une distinction au sein de cette supposée communauté : la relation de l’anthropologue avec sa culture et la relation du natif avec la sienne ne sont pas exactement les mêmes. Ce qui fait d’un natif un natif, c’est la présupposition, de la part de l’anthropologue, que la relation du premier avec sa culture est naturelle, c’est-à-dire intrinsèque et spontanée, et, si possible, non-réflexive ; et c’est encore mieux si elle est inconsciente. Le natif exprime sa culture au travers de son discours ; l’anthropologue aussi, mais s’il souhaite être autre chose qu’un natif, il doit exprimer sa culture culturellement, autrement dit, d’une façon réflexive, conditionnée et consciente. Sa culture est comprise, aux deux sens du terme, dans la relation de sens que son discours établit avec le discours du natif. En revanche, le discours du natif est de façon univoque circonscrit par sa propre culture. L’anthropologue met nécessairement à son service sa culture ; le natif est d’une certain façon instrumentalisé par la sienne.
Cette différence, nous n’avons même pas besoin de le dire, ne réside pas dans ce qu’on appelle traditionnellement la nature des choses ; elle est propre à unjeu de langage6 que nous instruisons, et elle définit les personnages désignés comme l’ « anthropologue » et le « natif ». Considérons encore d’autres règles de ce jeu.
L’idée anthropologique de culture place l’anthropologue en position d’équivalence avec le natif, dans la mesure où cela implique que toute connaissance anthropologique d’une autre culture est culturellement médiée. Cette égalité est, néanmoins, dans un premier temps, simplement empirique ou de fait : elle a trait à la condition culturelle commune (au premier sens du terme) de l’anthropologue et du natif. La relation différentielle de l’anthropologue et du natif avec leur culture respective, et, partant, avec leur culture réciproque, est telle que l’égalité de fait n’implique pas une égalité de droit – une égalité dans le domaine de la connaissance. L’anthropologue a normalement un avantage épistémologique sur le natif. Le discours du premier ne se situe pas sur le même plan que celui du second : le sens que l’anthropologue établit dépend du sens natif mais c’est lui qui détient « le sens » de ce sens – c’est lui qui explique et interprète, traduit et introduit, transforme en texte et contextualise, justifie et instruit ce sens. La matrice relationnelle du discours anthropologique est hylémorphique : le sens produit par l’anthropologue est indissociable de sa forme ; celui du natif, indissociable de sa matière. Le discours du natif ne détient pas le sens de son propre sens. En effet, comme dirait Geertz, nous sommes tous des natifs ; mais de droit, certains sont toujours plus natifs que d’autres.
Le présent article va ainsi s’attacher à poser les questions suivantes : quelle serait la conséquence si nous refusions au discours de l’anthropologue son avantage stratégique sur le discours du natif ? Que se passe-t-il lorsque le discours du natif est intégré, dans le discours de l’anthropologue, de manière à produire un effet de connaissance mutuellement réciproque sur ce discours ? Quand est-ce que la forme intrinsèque du premier modifie la matière implicite de la forme du deuxième ? Traduttore, traditore7, dit-on ; mais que se passe-t-il si le traducteur décide de trahir sa propre langue ? Quelle est la conséquence si nous, insatisfaits par l’idée d’une égalité passive, ou de fait, entre les sujets de ces discours, revendiquons une égalité active, ou de droit, entre les discours eux-mêmes ? Si la disparité entre les sens instruits par l’anthropologue et le natif, loin d’être neutralisée par telle équivalence, était internalisée, introduite dans les deux discours et ainsi rendue plus puissante ? Si, au lieu d’admettre paisiblement que nous sommes tous des natifs, nous considérions jusqu’à ses conséquences les plus radicales l’hypothèse inverse – que nous sommes tous des « anthropologues » (Wagner 1981 : 36), et pas certains plus anthropologues que d’autres, mais juste chacun à sa propre façon, c’est-à-dire, de manières très différentes ? Qu’est-ce qui change, en somme, lorsque l’anthropologie est appréhendée en tant que pratique de sens sans solution de continuité épistémique avec les pratiques sur lesquelles elle discourt, comme équivalente à elles ? Autrement dit, lorsque nous appliquons la notion « d’anthropologie symétrique » (Latour 1991) à l’anthropologie elle-même, non pas pour la détruire comme un colon/colonisateur, ni exorciser ses exotismes, ou affaiblir sa portée intellectuelle, mais plutôt pour lui faire dire autre chose ? Quelque chose de différent non seulement du discours du natif, car c’est ce que l’anthropologie ne peut s’abstenir de faire, mais également différent du discours, en général chuchoté, que l’anthropologue tient sur lui-même lorsqu’il élabore un discours sur celui du natif ?8
Si nous faisions tout cela, je dirais que nous ferions ce qui a toujours été appelé « anthropologie », au lieu de, par exemple, « sociologie » ou « psychologie ». J’utilise le conditionnel ici parce qu’une grande partie de ce qui a été accompli, et continue à l’être, sous l’obédience de ce nom suppose, au contraire, que l’anthropologue occupe une position d’éminence – inconnue de la raison du natif – rationnelle. Il a la science des doses précises d’universalité et de particularité caractérisant le natif, ainsi que des illusions que celui-ci entretient sur lui-même – parfois, il manifeste sa culture native en croyant manifester la nature humaine (le natif idéologise sans savoir) ; d’autres fois, il manifeste la nature humaine en croyant manifester sa culture native (il cognitise9 inconsciemment)10. La relation de connaissance est conçue ici comme unilatérale. L’altérité entre le sens des discours de l’anthropologue et du natif est résolue par absorption. L’anthropologue connaît de jure le natif, même s’il peut le méconnaître de facto. En revanche, lorsque l’on va du natif vers l’anthropologue, c’est le contraire qui se produit : même si le natif connaît de facto l’anthropologue (souvent mieux que celui-ci ne connaît celui-là), il ne le connaît pas de jure, car le natif n’est justement pas anthropologue comme l’anthropologue. La science de l’anthropologue est d’un ordre différent de celle du natif, et elle a besoins de l’être : la condition de possibilité de la première est la délégitimation des prétentions de la deuxième, son « épistemocide », pour utiliser l’expression marquante de Bob Scholte (1984 : 964). La connaissance du sujet exige l’ignorance de l’objet.
Or nous n’avons pas besoin ici de dramaturgie. Comme en témoigne l’histoire de cette discipline, ce jeu discursif, aux règles si dissymétriques, a dit beaucoup de choses instructives sur les natifs. La tentative menée dans cet article, toutefois, consiste précisément à le refuser. Non pas parce qu’un tel jeu produit des résultats objectivement faux, au sens où il dépeint de manière erronée la nature du natif ; le concept de vérité objective (comme ceux de représentation et de nature) fait partie des règles de ce jeu, qui n’est pas celui auquel nous allons nous livrer ici. Du reste, une fois posés les objets que le jeu classique se donne à lui-même, ses résultats sont fréquemment convaincants, ou au moins, comme aiment bien dire les adeptes de ce jeu, « plausibles ».11 Refuser ce jeu signifie seulement considérer d’autres objets, compatibles avec les règles esquissées ci-dessus.
Ce que je suggère, en quelques mots, c’est l’incompatibilité entre deux conceptions de l’anthropologie, et la nécessité d’en choisir une. D’un côté, nous avons une image de la connaissance anthropologique comme résultat de l’implication de concepts extrinsèques à l’objet : nous savons, préalablement, ce que sont les relations sociales, la cognition, la parenté, la religion, la politique, etc., et ainsi nous analysons comment ces concepts jouent dans tel ou tel contexte ethnographique. D’autre côté (et c’est ce jeu-là que nous pratiquerons), nous avons une idée de la connaissance anthropologique fondée sur la prémisse que les procédures qui caractérisent les enquêtes sont conceptuellement du même ordre que les procédures sur lesquelles on enquête12. Cette équivalence en termes de procédures, insistons-y, implique une non-équivalence radicale de tout le reste. Car si la première conception d’anthropologie imagine chaque culture ou société comme incarnant une solution spécifique à un problème générique – ou comme déterminant une forme universelle (le concept anthropologique) avec un contenu particulier –, la deuxième, au contraire, soupçonne que les problèmes eux-mêmes sont radicalement divers ; surtout, elle part du principe que l’anthropologue ne sait pas à l’avance quels sont ces problèmes. Ce que l’anthropologie, dans ce cas, met en relation sont des problèmes différents les uns des autres, pas un problème unique (« naturel ») et ses différentes solutions (« culturelles »). « L’art de l’anthropologie » (Gell 1999) est à mon sens l’art de déterminer les problèmes posés par chaque culture et non pas celui de trouver des solutions pour des problèmes posés par la nôtre. C’est exactement la raison pour laquelle le postulat de la continuité des procédures est un impératif épistémologique.13
Des procédures, je le répète, et non pas des personnes qui les mènent jusqu’à leur terme. Car il ne s’agit pas de condamner le jeu classique en l’accusant de produire des résultats subjectivement faussés, en ne reconnaissant pas au natif sa condition de Sujet : en l’observant avec un regard éloigné et dépourvu d’empathie, en le construisant comme un objet exotique, en l’amoindrissant en tant qu’il serait un primitif et non un contemporain de l’observateur, en lui niant le droit fondamental des humains à l’interlocution –la litanie est bien connue. Rien de tout cela. Bien au contraire, je pense. C’est juste parce que l’anthropologue prend trop facilement le natif pour un autre sujet qu’il n’arrive pas à voir comme un autre sujet, comme un Autrui qui, avant d’être sujet ou objet, est l’expression d’un monde possible. C’est parce qu’il ne parvient pas à accepter la condition de « non-sujet » (au sens de « quelque chose d’autre qu’un sujet ») du natif que l’anthropologue crée les conditions, sous couvert d’une proclamée égalité de fait avec celui-ci, de son avantage sournois de droit. Il en sait trop sur le natif avant même le début de la partie ; il prédéfinit et circonscrit les mondes possibles exprimés par cet autrui ; l’altérité d’autrui a été radicalement séparée de sa capacité de changement. L’authentique animiste est l’anthropologue, et l’observation participante est la vraie (c’est-à-dire fausse) participation primitive.
Il ne s’agit pas alors de defender14 une forme d’idéalisme intersubjectif, ni de faire valoir les droits de la raison communicationnelle ou du consensus dialogique. Je m’appuie sur le concept évoqué ci-dessus, celui d’Autrui comme structure a priori. Il est proposé dans le célèbre commentaire de Gilles Deleuze au Vendredi de Michel Tournier15.En lisant le livre de Tournier comme la description fictionnelle d’une expérience métaphysique – qu’est-ce qu’un monde sans autrui ? –, Deleuze procède à une induction des effets de la présence de cet autrui à partir des effets causés par son absence. Autrui apparaît donc comme la condition du champ perceptif : le monde hors de la portée de la perception actuelle a sa possibilité d’existence garantie par la présence virtuelle d’un autrui par qui il est perçu; l’invisible pour moi subsiste comme réel par sa visibilité pour autrui.16 L’absence d’autrui entraîne la disparition de la catégorie du possible ; sans celle-ci , le monde s’effondre et se voit réduit à la pure surface de l’immédiat ; le sujet dissous commence à coïncider avec les choses-en-soi (en même temps que celles-ci se déplient dans des doubles fantasmatiques). Autrui, néanmoins, n’est personne, ni sujet ni objet, mais une structure ou relation, la relation absolue qui détermine l’occupation des positions relatives de sujet et d’objet par des personnages concrets, aussi bien que son alternance : autrui me désigne pour l’autre Je et l’autre je pour moi. Autrui n’est pas un élément du champ perceptif ; il est le principe qui le construit, lui et ses contenus. Autrui n’est donc pas un point de vue particulier, relatif au sujet (le « point de vue de l’autre » par rapport à mon point de vue ou vice-versa), mais la possibilité qu’il y ait un point de vue – autrement dit, c’est le concept même de point de vue. Il est le point de vue qui permet au Je et l’Autrui d’accéder à un point de vue.17
Deleuze prolonge ici de façon critique la célèbre analyse de Sartre sur le « regard », en affirmant l’existence d’une structure antérieure à la réciprocité de perspectives du regard18 sartrien. Qu’est que cette structure ? C’est une structure du possible : Autrui est l’expression d’un monde possible. Un possible qui existe réellement mais qui n’existe pas actuellement hors de son expression en autrui. Le possible exprimé est engagé ou impliqué dans l’exprimant (qui lui est néanmoins hétérogène), et se trouve effectué dans le langage ou dans le signe, qui est la réalité du possible en tant que telle – le sens. Le Je apparaît alors comme explication de cet impliqué, actualisation de ce possible, lorsqu’il prend sa place de droit (celle du « je ») dans le jeu de langage. Le sujet est ainsi effet et pas cause ; il est le résultat de l’intériorisation d’une relation qui lui est extérieure – ou plutôt, d’une relation à laquelle il est intérieur : les relations sont originairement extérieures aux termes parce que les termes y sont intérieurs. « Il y a plusieurs sujets parce qu’il y a autrui, non pas l’inverse » (Deleuze et Guattari 1991 : 22).
Le problème n’est pas alors de voir le natif comme un objet, et la solution ne consiste pas à le promouvoir au rang de sujet. Que le natif soit un sujet, il n’y a pas de doute ; mais ce qui peut être un sujet, voilà précisément ce que le natif contraint l’anthropologue à poser comme question. Telle est la « cogitation » spécifiquement anthropologique ; elle permet seulement à l’anthropologie d’assumer la présence virtuelle d’Autrui qui est sa condition – la condition de passage d’un monde possible à un autre –, et qui détermine les positions dérivées et alternatives du sujet et de l’objet.
Le physicien interroge le neutrino et ne peut pas être en désaccord avec lui ; l’anthropologue répond pour le natif, qui peut seulement (de droit et, souvent, de fait) être d’accord avec lui. Le physicien a besoin de s’associer au neutrino, de penser avec son objet récalcitrant ; l’anthropologue associe le natif à lui-même, pensant que son objet procède aux mêmes associations que lui – c’est-à-dire que le natif pense comme lui. Le problème est que le natif, certainement, pense – comme l’anthropologue – ; mais, très probablement, il ne pense pas comme l’anthropologue. Le natif est, sans doute, un objet spécial, un objet qui pense ou un sujet. Mais s’il est objectivement un sujet alors ce qu’il pense est une pensée objective, l’expression d’un monde possible, au même titre que ce que pense l’anthropologue. C’est pour cette raison que la différence malinowskienne entre ce que le natif pense (ou fait) et ce qu’il pense penser (ou faire) est une fausse différence. C’est précisement par là, par cette bifurcation de la nature de l’autre que l’anthropologue (qui ferait ce qu’il pense19) ambitionne de passer. La bonne différence, ou la différence réelle, se situe entre ce que pense (ou fait) le natif et ce que l’anthropologue pense que le natif pense – ou ce qu’il fait avec la pensée du natif. Ce sont ces deux pensées (ou actions) qui s’affrontent. Ce conflit n’a pas besoin de se réduire à la même équivocité de chaque partie – l’erreur n’est jamais la même, si les parties ne sont pas les mêmes non plus (en outre, qui définirait la bonne univocité ?). Il n’a pas besoin non plus de se contenter d’être un dialogue édifiant. Le conflit doit pouvoir produire l’implication réciproque, la commune altération des discours en jeu car il ne s’agit pas d’aboutir au consensus, mais au concept.
J’ai évoqué la distinction criticiste entre le quid facti et le quid juri. Elle m’a semblé utile parce que le premier problème que l’on doit résoudre consiste dans l’évaluation de la prétention à la connaissance implicite dans le discours anthropologique. Ce problème n’est pas cognitif, c’est-à-dire psychologique ; il ne concerne pas à la possibilité empirique de la connaissance d’une autre culture20. Il est épistémologique, c’est-à-dire politique. Il concerne à la question proprement transcendantale de la légitimité attribuée aux discours qui entrent en relation de connaissance et, en particulier, aux relations d’ordre sur lesquelles on décide de statuer entre ces discours. Ces relations ne sont certainement pas innées, et leurs pôles d’énonciation non plus. Personne n’est né anthropologue, et encore moins, curieusement, natif.
Dans la limite
Ces derniers temps, nous, les anthropologues, avons manifesté une grande inquiétude concernant l’identité et le destin de notre discipline : qu’est-elle ? est-elle encore ? que doit-elle être ? a-t-elle le droit d’être ? quel est son objet spécifique, sa méthode, sa mission, etc. ? (voir par exemple Moore 1999). Restons avec la question de l’objet, qui implique les autres. Correspond-il à la culture, comme dans la tradition anthropologique américaine ? À l’organisation sociale, comme dans la tradition britannique ? À la nature humaine, comme dans la tradition française ? Je pense que la bonne réponse est : à la fois toutes et aucune des options envisagées ci-dessus. Culture, société et nature reviennent au même : ces notions ne désignent pas l’objet de l’anthropologie, son sujet, mais plutôt son problème, ce qu’elle ne peut justement pas assumer (Latour 1991 : 109-110, 130) parce qu’il y a une « tradition » supplémentaire dont on doit tenir compte, celle qui importe le plus : la tradition du natif.
Admettons, car il faut bien commencer d’une façon déterminée, que la matière privilégiée de l’anthropologie soit la société humaine, c’est-à-dire ce que nous appelons les « relations sociales ». Acceptons, en outre, la pondération suivante : la « culture », par exemple, n’a pas d’existence indépendante de son actualisation au sein de ces relations21. Finalement, et il est important de le dire, ces relations varient dans l’espace et dans le temps ; et, si la culture n’existe pas hors de son expression relationnelle, alors la variation relationnelle est aussi une variation culturelle, autrement dit, « culture » est le nom que l’anthropologie donne à la variation relationnelle.
Mais cette variation relationnelle – ne nous obligerait-elle pas à assumer un sujet, un substrat invariant à partir duquel elle est prédiquée ? Cette question est toujours latente, et insistante dans sa soi-disant évidence ; il s’agit surtout d’une question mal formulée. Car ce qui varie crucialement n’est pas le contenu des relations, mais leur idée même : ce qui compte comme relation dans telle ou telle culture. Ce ne sont pas les relations qui varient, ce sont les variations qui entrent en relation. Si cela fonctionne de cette façon, alors le substrat supposé des variations, la « nature humaine » – si l’on passe au concept cher à la troisième grande tradition anthropologique –, change complètement de fonction, ou pour le dire plus précisément, elle cesse d’être une substance et devient une vraie fonction. La nature cesserait d’être une espèce de dénominateur commun maximal des cultures (un maximum bien minimal, une humanitas minima), une sorte de toile de fond de ressemblance obtenue par l’annulation des différences afin de pouvoir postuler un sujet constant, un émetteur-référent stable des signifiés culturels variables (comme si les différences n’étaient pas également naturelles !). Elle deviendrait quelque chose comme un plus petit multiplicateur commun des différences – plus grand que les cultures et non pas plus petit qu’elles –, ou quelque chose comme l’intégrale partielle des différentes configurations relationnelles que nous appelons « cultures ».22 Le « minimum » est, dans ce cas, la multiplicité commune à l’humain – humanitas multiplex. La nature mentionnée ne serait plus une substance semblable à elle-même, située en un endroit naturel privilégié (le cerveau, par exemple), et assumerait elle-même le statut d’une relation différentielle, disposée entre les termes qu’elle « naturalise » ; elle deviendrait l’ensemble des transformations requises pour décrire les variations entre les différentes configurations relationnelles connues. Ou, pour utiliser une autre image, elle deviendrait ici une pure limite – mais non pas au sens géométrique de la limitation, c’est-à-dire au sens d’un périmètre ou terme qui contraint et définit une forme substantielle (on rappelle l’idée, si récurrente dans le vocabulaire anthropologique, des enceintes mentales23), mais plutôt au sens mathématique d’un point vers lequel tend une série ou une relation : limite-tension, plutôt que limite-contour24. La nature humaine, dans ce cas, serait une opération théorique de « franchissement de la limite », qui indique ce dont les êtres humains sont virtuellement capables, et non pas une limitation qui les détermine « actuellement25 » à ne pas être autre chose26. Si la culture est un système de différences, comme aimaient à le dire les structuralistes, alors la nature en est un aussi : différences de différences.
Le motif (caractéristiquement kantien, cela va sans dire) de la limite-contour, si présent dans notre discipline, est particulièrement remarquable lorsque l’horizon ainsi délimité définit la-ditenature humaine, comme c’est le cas des orientations naturelles-universalistes telle que la sociologie ou la psychologie évolutionnaire, et, dans une très large mesure, le structuralisme lui-même. Mais il est présent aussi dans les discours sur les cultures humaines, où il révèleles limites – si je puis m’exprimer ainsi – de la posture culturelle-relativiste classique. On rappelle l’idée popularisée par la phrase d’Evans-Pritchard sur la sorcellerie zandée – « les Zandés ne peuvent pas penser que leur pensée est erronée »–, ou l’image anthropologique courante de la culture comme prothèse oculaire (ou crible classificatoire) qui permet seulement de « voir les choses » d’une certaine façon (ou qui occulte certaines parties de la réalité) ; ou encore, pour citer un exemple plus récent, la métaphore du « bocal27 » dans lequel chaque époque historique serait enfermée (Veyne 1983)28. Soit par rapport à la nature, soit par rapport aux cultures, le motif me semble également « limité ». Si l’on voulait être pervers, on dirait que sa neutralité stratégique, sa co-présence dans les champs des ennemis de l’universalisme et du relativisme, est une preuve éloquente que la notion d’enceinte mentale est l’une des enceintes mentales caractéristiques de notre « bocal » commun historique. Dans tous les cas, elle montre bien que la soi-disant opposition entre universalisme naturaliste et relativisme culturaliste est, à tout le moins, très relative (et parfaitement culturelle), car elle se réduit à une question consistant à choisir les dimensions du bocal, la taille de la prison dans laquelle nous gisons comme des prisonniers : la cellule inclurait-elle catholiquement toute l’espèce humaine, ou serait-elle faite spécifiquement pour chaque culture ? Y aurait-il peut-être une seule grande prison « naturelle », englobant les différents secteurs « culturels », certains avec des cellules peut-être plus grandes que d’autres ?29
L’objet de l’anthropologie serait ainsi la variation des relations sociales. Non pas des relations sociales prises comme une province ontologique distante, mais de tous les phénomènes possibles en tant que relations sociales, ou en tant qu’ils impliquent des relations sociales : de toutes les relations entendues comme sociales. Mais cela à partir d’une perspective qui n’est pas totalement dominée par la doctrine occidentale des relations sociales ; une perspective donc prête à admettre que le traitement de toutes les relations comme sociales peut conduire à une reconceptualisation radicale de ce qu’est le social. Disons alors que l’anthropologie se différencie des autres discours sur la sociabilité humaine non pas parce qu’elle dispose d’une doctrine particulièrement solide sur la nature des relations sociales, mais, au contraire, parce qu’elle n’a qu’une vague idée initiale de ce qu’est une relation. Car son problème caractéristique consiste moins à déterminer quelles sont les relations sociales qui constituent son objet qu’à s’interroger sur ce que son objet constitue comme relation sociale, ce qui est une relation sociale dans les termes de son objet, ou alors, dans les termes formulables par la relation (sociale, naturellement, et constitutive) entre « l’anthropologue » et le « natif ».
De la conception au concept
Tout cela ne signifierait-il pas simplement que le point de vue ici défendu, et exemplifié dans mon travail sur le perspectivisme amérindien (Viveiros de Castro 1996), est « le point de vue du natif », comme les anthropologues le professent depuis longtemps ? En effet, il n’y a rien de particulièrement original dans le point de vue adopté ; l’originalité qui compte est celle du point de vue indigène, et non pas celle de mon commentaire. Mais, à propos de la question quant à savoir si le but est de faire valoir le point de vue du natif, la réponse est oui, et non. Oui, et même plus que cela, parce que mon problème, dans l’article cité, était de savoir ce qu’est un « point de vue » pour un natif, autrement dit, quel est le concept de point de vue à l’oeuvre dans les cultures amazoniennes : quel est le point de vue natif sur le point de vue. Non, d’autre part, car le concept natif de point de vue ne coïncide pas avec le concept de point de vue du natif ; aussi parce que mon point de vue ne peut pas être celui du natif, mais celui de ma relation avec le point de vue natif. Ce qui nous oblige à introduire une dimension fictionnelle fondamentale car il s’agit de mettre en résonance interne deux points de vue complètement hétérogènes.
Ce que j’ai proposé dans mon article sur le perspectivisme était une expérience de pensée et un exercice de fiction anthropologique. L’expression « expérience de pensée » n’a pas ici le sens usuel d’entrée imaginaire dans l’expérience par la pensée (en propre), mais plutôt celui d’entrée dans la pensée (de l’autre) par l’expérience du réel : il ne s’agit pas d’imaginer une expérience, mais d’expérimenter une dimension imaginaire30. L’expérience, dans ce cas, est la mienne, en tant qu’ethnographe et en tant que lecteur de la bibliographie ethnologique sur l’Amazonie indienne, et l’expérimentation, une fiction contrôlée par cette expérience. C’est-à-dire que la fiction est anthropologique, mais son anthropologie n’est pas fictive.
En quoi consiste une telle fiction ? Elle consiste à considérer les idées indigènes comme des concepts, et à dériver de cette décision ses conséquences : déterminer le fondement pré-conceptuel ou le plan d’immanence que tels concepts présupposent, les personnages conceptuels qu’ils édifient, et la matière du réel qu’ils introduisent. Traiter ces idées comme des concepts ne signifie pas, j’y insiste, qu’elles soient objectivement déterminées comme étant autre chose, comme un autre genre d’objet actuel. Car les traiter comme des items cognitifs individuels, des représentations collectives, des attitudes propositionnelles, des croyances cosmologiques, des schémas inconscients, des dispositions incorporées, etc., reviendrait à produire d’autres fictions théoriques, ce que que j’ai simplement décidé de ne pas faire.
Ainsi, le type de travail que je promeus ici n’est ni une étude de « mentalité primitive » (si l’on suppose qu’une telle notion a encore du sens), ni une analyse des « processus cognitifs » indigènes (si l’on suppose que ceux-ci sont accessibles dans l’état actuel de la connaissance psychologique et ethnographique). Mon objet est moins la manière indigène de penser que les objets de cette pensée ; le monde possible projeté par ses concepts. Il ne s’agit pas non plus de réduire l’anthropologie à une série d’essais ethnosociologiques sur des visions du monde. D’abord parce qu’il n’y a pas un monde configuré pour être vu, un monde avant la vision, ou même, avant la division entre le visible (ou pensable) et l’invisible (ou présupposé) qui institue l’horizon d’une pensée. Deuxièmement, parce que considérer les idées comme des concepts, c’est refuser leur explication par le biais de la notion transcendante de contexte (écologique, économique, politique, etc.), au profit de la notion immanente de problème, de champ problématique où les idées sont impliquées. Il ne s’agit pas, finalement, de proposer une interprétation de la pensée amérindienne mais de réaliser une expérimentation avec elle, et partant avec la nôtre. Dans l’anglais difficilement traduisible de Roy Wagner : « every understanding of another culture is an experiment with one’s own » (1981: 12).
Considérer les idées indigènes comme des concepts est une déclaration d’intention antipsychologiste car ce que l’on recherche alors est une image de jure de la pensée, irréductible à la cognition empirique, ou à l’analyse empirique de la cognition faite en termes psychologiques. La juridiction du concept est extraterritoriale aux facultés cognitives et aux états internes des sujets : les concepts sont des objets ou des événements intellectuels et non pas des états ou des attributs spirituels. Il est certain qu’ils « traversent l’esprit » (ou, comme l’on dirait en anglais, ils « croisent l’esprit ») : mais ils n’y restent pas, et surtout, ils n’y préexistent pas – ils sont inventés. Mettons les choses au point. Je ne crois pas que les amérindiens « cognitisent » différemment de nous, c’est-à-dire que leurs processus ou catégories de « l’esprit » sont différents de ceux de tout autre être humain. Il est non avenu d’imaginer les indiens comme doués d’une neurophysiologie particulière qui traiterait différemment le divers. Pour ma part, je crois qu’ils pensent exactement « comme nous » ; mais je crois aussi que ce qu’ils pensent, autrement dit, les concepts qu’ils donnent d’eux-mêmes, les « descriptions » qu’ils produisent, sont très différents des nôtres – et donc le monde décrit par ces concepts est très différent du nôtre31. Par rapport aux indiens, je crois – si mes analyses du perspectivisme sont correctes – qu’ils pensent que tous les humains, et au-delà de ceux-ci, plusieurs sujets non-humains, pensent exactement « comme eux », mais que cela, loin de produire (ou résulter d’) une convergence référentielle universelle, est exactement la raison des divergences de perspectives.
L’idée de concept suppose une image de la pensée comme activité distincte de la cognition, et comme autre chose qu’un système de représentations. Ainsi, ce qui m’intéresse de la pensée du natif américain, ce n’est pas le savoir local et ses représentations plus ou moins vraies sur le réel – le « indgenous knowledge » si débattu sur le marché global des représentations –, ni la cognition indigène et ses catégories de l’esprit dont les sciences de l’esprit ambitionnent d’exploiter la représentativité, du point de vue des facultés de l’espèce. Ni des représentations, individuelles ou collectives, rationnelles ou (« apparemment ») irrationnelles, qui exprimeraient partiellement des états de choses qui leur seraient antérieurs et extérieurs ; ni des catégories et des processus cognitifs, universels ou particuliers, innés ou acquis, qui manifesteraient certaines propriétés d’une chose dans le monde, qu’elle soit l’esprit ou la société. Mon objet, ce sont les concepts indigènes, les mondes qu’ils constituent (des mondes qu’alors les expriment), le fond virtuel d’où ils procèdent et qu’ils présupposent. Les concepts, c’est-à-dire les idées et les problèmes de la « raison » indigène, et non pas leurs catégories de « l’entendement ».
Comme on l’aura compris, la notion de concept a, ici, un sens bien déterminé. Considérer les idées indigènes comme des concepts signifie les considérer douées d’une signification proprement philosophique, ou comme potentiellement susceptibles d’un usage philosophique.
Une décision irresponsable, dira-t-on, d’autant plus que les Indiens ne sont pas des philosophes et, insistons-y fortement, l’auteur de ces lignes non plus. Comment appliquer, par exemple, la notion de concept à une pensée qui, apparemment, n’a jamais jugé nécessaire de se pencher sur elle-même ; et qui renverrait plutôt au schématisme fluide et panaché du symbole, de la figure et de la représentation collective qu’à l’architecture rigoureuse de la raison conceptuelle ? N’y a-t-il pas là un abîme historique et psychologique bien connu, une « rupture décisive » entre l’imagination mythique pan-humaine et l’univers de la rationalité hellénico-occidentale (Vernant 1996 : 229) ? Entre le bricolage du signe et l’ingénierie du concept (Lévi-Strauss 1962) ? Entre la transcendance paradigmatique de la Figure et l’immanence syntagmatique du Concept (Deleuze et Guattari 1991) ? Entre une économie intellectuelle du genre pictural-monstratifet une autre du genre doctrinal-démonstratif (Whitehouse 2000) ? Par rapport à tout ce qui vient d’être dit, qui se situe plus ou moins directement dans le sillage de Hegel, quelques questions se posent pour moi. Mais je préciserai avant de le faire que j’ai mes raisons pour parler de concept. Je vais juste m’en tenir à la première qui découle de la décision de considérer les idées natives comme étant situées sur le même plan que les idées anthropologiques.
L’expérience proposée ici, ainsi que je viens de le spécifier, commence par postuler l’équivalence de droit entre les discours de l’anthropologue et celui du natif, ainsi que la condition mutuellement constitutive de ces discours, qui n’accèdent à l’existence, qu’en tant que discours, lorsqu’ils deviennent l’un des termes d’une relation de connaissance. Ce sont les concepts anthropologiques qui actualisent cette relation, et on peut, de ce fait, tout à fait les qualifier de relationnels tant pour ce qui est de leur expression que de leur contenu. Ils ne sont pas des réflexes authentiques de la culture du natif (le rêve positiviste), ni des projections illusoires de la culture de l’anthropologue (le cauchemar constructionniste). Ce qu’ils reflètent est une certaine relation d’intelligibilité entre les deux cultures, et ce qu’ils projettent ce sont les deux cultures comme leurs présupposés imaginés. Ils opèrent, ainsi, un double déracinement : ce sont comme des vecteurs pointant systématiquement en sens inverse, des interfaces transcontextuelles dont la fonction est de représenter, au sens diplomatique du terme, l’autre dans son propre contexte, et vice-versa.
Les concepts anthropologiques, en somme, sont relatifs parce qu’ils sont relationnels – et ils sont relationnels parce qu’ils ont pour fonction de rapporter (tout à la fois relater et créer des rapports). Cette origine et cette fonction sont généralement marquées par la « signature » caractéristique de ces concepts à travers des mots étranges : mana, totem, kula, potlatch, tabou, gumsa/gumlao… D’autres concepts, tout aussi authentiques, ont une signature étymologique qui évoque plutôt les analogies entre la tradition culturelle d’où la discipline a émergé et les traditions qui constituent son objet d’analyse : don, sacrifice, parenté, personne… D’autres, enfin, également légitimes, sont des créations lexicales qui cherchent à généraliser des dispositifs conceptuels imputés aux peuples étudiés – animisme, opposition segmentaire, échange restreint, schismogenèse… –tandis que parfois, à l’inverse, et plus problématiquement, d’autres créations lexicales chercheront à plaquer sur une économie théorique donnée certaines notions pourtant elles-mêmes déjà sujettes à débat au sein de notre tradition – la prohibition de l’inceste, le genre, le symbole, la culture… – avec l’objectif de les universaliser.32
Nous voyons ainsi que des nombreux concepts, problèmes, entités et agents manipulés par les théories anthropologiques ont leur origine dans l’effort imaginatif des sociétés mêmes qu’elles veulent expliquer. L’originalité de l’anthropologie ne serait-elle pas ici, dans cette synergie entre les conceptions et les pratiques issues des mondes du « sujet » et de « l’objet » ? Reconnaître cela aiderait, entre autres, à atténuer notre complexe d’infériorité vis-à-vis des « sciences naturelles ». Comme observe Latour :
La description de la kula est comparable à celle des trous noirs. Les systèmes complexes d’alliances sont tout autant des œuvres d’imagination que les scénarios complexes conçus pour les gènes égoïstes. Comprendre la théologie des aborigènes australiens est aussi important que de cartographier les failles des fonds marins. Le système du régime foncier des îles Trobriand est un objectif scientifique aussi intéressant que le forage des calottes glaciaires. Si nous débattons à propos de ce qui compte pour la définition de la science – fait nouveau dans les organismes spécialisés par-devers le monde –, alors l’anthropologie pourrait être proche du sommet de la hiérarchie disciplinaire. (1996a : 5)33
L’analogie est dans ce passage établie entre les conceptions indigènes et les objets des sciences dites naturelles. C’est une perspective envisageable, et même, indispensable : on doit pouvoir produire une description scientifique des idées et des pratiques indigènes, comme si elles étaient des objets du monde, ou plutôt, pour qu’elles soient des objets du monde. (Il faut remarquer que les objets scientifiques de Latour sont tout sauf des entités « objectives » et indifférentes, attendant patiemment d’être décrites). Une autre stratégie possible est de comparer les conceptions indigènes avec les théories scientifiques, comme le fait Horton, selon sa « thèse de similitude » (1993 : 348-354), qui préfigure certains aspects de l’anthropologie symétrique de Latour. C’est une stratégie encore distincte de ces dernières qui sera ici défendue. Je pense que l’anthropologie a toujours été trop obsédée par la « Science », non seulement pour ce qui la concerne – si elle est ou pas, si elle peut ou ne peut pas, si elle doit ou ne doit pas être une science –, mais surtout, et là est bien le problème réel, par rapport aux conceptions des peuples qu’elle étudie : soit pour les disqualifier en tant qu’erreur, rêve, illusion, et ensuite expliquer scientifiquement comment et pourquoi les « autres » n’arrivent pas à s’expliquer eux-mêmes scientifiquement ; soit pour les promouvoir en tant qu’ils seraient plus ou moins homogènes à la science, produits d’une même volonté de savoir consubstantielle à l’humanité. La similitude d’Horton et la science du concret de Lévi-Strauss (Latour 1991 : 131-134) en sont deux exemples. L’image de la science, cette espèce d’étalon d’or de la pensée, n’est pas pourtant le seul terrain, ni nécessairement le meilleur, où nous pouvons entretenir des relations avec l’activité intellectuelle des peuples étrangers à la tradition occidentale.
Imaginons une autre analogie que celle de Latour, ou une autre similitude que celle d’Horton. Une analogie où, au lieu de considérer les conceptions indigènes comme des entités semblables aux trous noirs ou aux plaques tectoniques, nous les considérions comme quelque chose du même ordre que le Cogito ou que la monade leibnizienne. Nous dirions alors, en paraphrasant la citation antérieure, que le concept mélanésien de la personne comme « dividu » (Strathern 1988) est tout autant une œuvre d’imagination que l’individualisme possessif de Locke ; que comprendre la « philosophie de la chefferie amérindienne » (Clastres 1974) est aussi important que de commenter la doctrine hegelienne de l’État ; que la cosmogonie maorie a la même valeur que les paradoxes éléatiques et que les antinomies kantiennes (Schrempp 1992) ; que le perspectivisme amazonien est un objectif philosophique aussi intéressant que la compréhension du système de Leibniz… Et si la question est de savoir ce qui compte dans l’évaluation d’une philosophie – sa capacité de créer des nouveaux concepts –, alors l’anthropologie, sans ambitionner de se substituer la philosophie, demeure un puissant instrument philosophique, capable d’élargir un peu les horizons si ethnocentriques de notre philosophie, et de nous débarrasser, au passage, de l’anthropologie dite « philosophique ». Selon la définition marquante de Tim Ingold (1992 : 696), qu’il vaut mieux citer en version originale, « anthropology is philosophy with the people in ». Par « people », Ingold entend ici les « ordinary people », les personnes ordinaires (Ingold 1992 : 696) ; mais il joue aussi avec la signification de « people » comme « peuple », et plus encore, comme « peuples ». Une philosophie avec d’autres peuples dedans, alors : la possibilité d’une activité philosophique qui maintienne une relation avec la non-philosophie – la vie – d’autres peuples de la planète, au-delà de la nôtre34.Non seulement, donc, les personnes ordinaires, mais surtout les peuples « inhabituels », ceux en dehors de notre sphère de « communication ». Si la philosophie « réelle » abonde en sauvages imaginaires, la géophilosophie visée par l’anthropologie produit une philosophie « imaginaire » avec des sauvages réels. Real toads in imaginary gardens, comme le dit la poétesse Marianne Moore.
On notera que, dans la paraphrase à laquelle nous nous livrons ci-dessus, c’est le déplacement d’accent qui compte. Il ne s’agit plus, seulement, de la description anthropologique de la kula (en tant que forme mélanésienne de socialité) mais de la kula en tant que description mélanésienne (de la « socialité » comme forme anthropologique) ; ou encore, il serait nécessaire de continuer à appréhender la « théologie australienne », mais en tant à présent qu’elle constitue elle-même un dispositif d’appréhension. Il en est de même pour les complexes systèmes d’alliance ou de possession de terre qui doivent être vus comme des œuvres d’imagination sociologiques indigènes. Il est certain qu’il sera toujours nécessaire de décrire la kula comme une description, d’appréhenderla religion aborigène comme une appréhension, d’imaginer l’imagination indigène : il faut savoir transformer les conceptions en concepts, extraire les seconds et les soumettre à nouveau aux premiers. Et un concept est une relation complexe entre des conceptions, un agencement d’intuitions pré-conceptuelles ; dans le cas de l’anthropologie, les conceptions mises en relation impliquent, avant tout, celles de l’anthropologue et celles du natif – relation de relations. Les concepts natifs sont les concepts de l’anthropologue ; en théorie en tout cas.
Ni expliquer, ni interpréter : multiplier et expérimenter
Roy Wagner, depuis son ouvrage The Invention of Culture, a été l’un des premiers anthropologues ayant su radicaliser le constat d’une équivalence entre l’anthropologue et le natif procédant de leur condition culturelle commune. Du fait que l’approche d’une autre culture ne peut se faire que dans les termes de celle de l’anthropologue, Roy Wagner conclut que la connaissance anthropologique est définie par son « objectivité relative » (1981 : 2). Cela n’implique pas une objectivité déficiente, c’est-à-dire subjective ou partiale, mais une objectivité intrinsèquement relationnelle, comme le montre le passage qui suit :
L’idée de culture […] place le chercheur dans une position d’égalité avec celui qu’il étudie : chacun « appartient à une culture ». Parce que chaque culture peut être comprise comme une manifestation spécifique… du phénomène humain, et parce qu’aucune méthode infaillible n’a jamais été découverte pour « classer » des différentes cultures et les trier en fonction de leurs types naturels, nous considérons que chaque culture, en tant que telle, est équivalent à toutes les autres. Cette hypothèse a pour nom la « relativité culturelle » … La combinaison de ces deux implications de l’idée de culture, le fait que nous-mêmes appartenons à une culture (objectivité relative) et que nous devons considérer toutes les cultures comme équivalentes (relativité culturelle), conduit à une proposition générale concernant l’étude de la culture. Comme la répétition de l’idée de « relatif » le suggère, la compréhension d’une autre culture instruit une relation entre deux variétés du phénomène humain ; elle vise la création d’une relation intellectuelle entre elles, ainsi qu’une compréhension qui inclut les deux. L’idée de relation est importante ici parce qu’elle convient mieux au rapprochement de deux entités équivalentes, ou points de vue, que des notions comme « analyse » ou « examen », avec leurs prétentions d’objectivité absolue. (Wagner 1981 : 2-3)
Ou, comme le dirait Deleuze : il ne s’agit pas d’affirmer la relativité du vrai, mais la vérité du relatif. Il est à noter que Wagner associe la notion de relation à celle de point de vue (les termes associés sont des points de vue), et que cette idée d’une vérité du relatif définit justement ce que Deleuze appelle le « perspectivisme ». Car le perspectivisme – celui de Leibniz et de Nietzsche comme celui des Tukano ou Juruna – n’est pas un relativisme, c’est-à-dire une affirmation d’une relativité du vrai, mais un relationnisme par lequel il est dit que la vérité du relatif est la relation.
J’ai demandé ce qui arriverait si l’on niait l’avantage épistémologique du discours de l’anthropologue sur celui du natif ; si l’on comprenait les relations comme provoquant une modification, nécessairement réciproque, au sein des termes qui y sont liés, c’est-à-dire actualisés. Cela équivaut à demander : que se passe-t-il lorsqu’on prend au sérieux la pensée du natif ? Lorsque le but de l’anthropologue cesse d’être celui d’expliquer, d’interpréter, de contextualiser et de rationaliser cette pensée, et commence à être celui de l’utiliser, d’en extraire les conséquences, de vérifier les effets qu’elle peut produire sur la nôtre ? Qu’est-ce que penser la pensée du natif ? Penser, je veux dire, sans penser si ce que nous pensons (l’autre pensée) est « apparemment irrationnel »35, ou pire encore, naturellement rationnel36 ; mais au contraire le penser comme quelque chose que l’on ne pense pas dans les termes de cette alternative, comme quelque chose d’étranger à ce jeu ?
En premier lieu, prendre au sérieux, c’est refuser de neutraliser. C’est, par exemple, mettre entre parenthèses la question de savoir si et comment telle pensée illustre des universaux cognitifs de l’espèce humaine, si elle s’explique par certaines formes de transmission sociale de la connaissance, si elle exprime une vision de monde culturellement particulière, si elle valide fonctionnellement la distribution du pouvoir politique, et tant d’autres manières de neutraliser la pensée de l’autre. Mettre en suspens cette question ou, du moins, éviter d’y enfermer l’anthropologie, ce sera, par exemple, décider de penser l’autre pensée seulement, disons, comme une actualisation de virtualités insoupçonnées de l’acte de penser.
Prendre au sérieux signifierait-il alors « croire » en ce qui disent les indiens, considérer leur pensée comme exprimant une vérité sur le monde ? Pas du tout ; car il s’agit d’une question mal posée. Pour croire ou ne pas croire en une pensée, il faut d’abord l’imaginer comme un système de croyance. Mais les problèmes authentiquement anthropologiques ne se posent jamais dans les termes psychologistes de la croyance, ni dans les termes logicistes de la valeur de vérité, car il ne s’agit pas de considérer la pensée de l’autre comme une opinion, à savoir le seul objet possible de la croyance ou de l’incrédulité, ou comme un ensemble de propositions, à savoir les seuls objets possibles des jugements de vérité. Nous savons bien les dégâts causés par l’anthropologie lorsqu’elle définit la relation des natifs avec leur discours en termes de croyance – la culture devient une espèce de théologie dogmatique (Viveiros de Castro 1993) –, ou encore, lorsqu’elle traite ce discours comme une opinion ou comme un ensemble de propositions – la culture devient une tératologie épistémique : une erreur, une illusion, de la folie, de l’idéologie…37 Comme l’observe Latour (1996b : 15), «la croyance n’est pas un état mental, mais un effet de la relation entre les peuples » – et le genre même d’effet que je ne veux pas produire.
Prenons par exemple l’animisme, sur lequel j’avais déjà écrit (Viveiros de Castro 1996). Le Vocabulaire de Lalande qui ne semble pas, à cet égard, très décalé par rapport à celui des études psycho-anthropologiques récentes sur ce thème, définit l’ « animisme » dans ces termes exacts : comme un « état mental ». Mais l’animisme amérindien peut être tout, sauf cela. C’est une image de la pensée qui sépare le fait et le droit, ce qui appartient de jure à la pensée et ce qui renvoie de manière contingente aux états de choses ; c’est, plus spécifiquement, une convention d’interprétation (Strathern 1999a : 239) qui présuppose la « personnitude38 » formelle de ce qui permet de connaître, faisant de la pensée une activité et un effet de la relation (« sociale ») entre le penseur et l’objet pensé. Serait-il approprié de dire que, par exemple, le positivisme ou le jusnaturalisme sont des états mentaux ? Le même raisonnement s’applique à l’animisme amazonien : ce n’est pas un état mental des sujets individuels, mais un dispositif intellectuel trans-individuel qui considère, d’ailleurs, les « états mentaux » des êtres du monde comme l’un de ses objets. Ce n’est pas une condition de l’esprit du natif, mais une « théorie de l’esprit » appliquée par le natif, une manière de résoudre, d’ailleurs – ou plutôt de dissoudre –, le problème éminemment philosophique des « autres esprits ».
S’il ne s’agit pas de décrire la pensée amérindienne en termes de croyance, alors il n’est pas non plus question de s’y rapporter sous le mode de croyance – que ce soit en suggérant avec bienveillance sa « part de vérité » allégorique (une allégorie sociale, comme pour les durkheimiens, ou naturelle, comme pour les matérialistes culturels) ; que ce soit, pire encore, en imaginant qu’elle donnerait accès à l’essence intime et ultime des choses, détentrice qu’elle serait d’une science ésotérique infuse. « Une anthropologie qui… réduit le sens (meaning) à la croyance, au dogme et à la certitude, tombe forcement dans le piège de devoir croire soit aux sens natifs, soit aux nôtres. » (Wagner 1981 : 30). Mais le plan du sens n’est pas peuplé par des croyances psychologiques ou des propositions logiques, et l’ « arrière-plan » contient d’autres choses que des vérités. N’étant ni une forme de la doxa, ni une figure de la logique – ni opinion, ni proposition –, la pensée native est ici comprise comme une activité de symbolisation ou de pratique de sens : comme un dispositif autoréférentiel ou tautégorique de production de concepts, c’est-à-dire de « symboles qui se représentent eux-mêmes » (Wagner 1986).
Refuser de poser la question en termes de croyance me semble un trait crucial de la décision anthropologique. Pour le confirmer, évoquons à nouveau l’Autrui deleuzien. Autrui est l’expression d’un monde possible ; mais ce monde doit toujours, dans le cadre habituel des interactions sociales, être actualisé par un Je : l’implication du possible chez autrui est expliquée par moi. Cela signifie que le possible passe par un processus de vérification qui dissipe de manière entropique sa structure. Lorsque j’envisage un monde exprimé par autrui, c’est pour le valider comme réel, et y entrer ; ou alors pour le démentir comme irréel : l’ « explication » introduit, ainsi, l’élément de la croyance. En décrivant ce processus, Deleuze indique la condition-limite qui lui a permis de déterminer le concept d’Autrui :
« Ces relations de développement, qui forment aussi bien nos communautés que nos contestations avec autrui, dissolvent sa structure, et le réduisent dans un cas à l’état d’objet, dans l’autre cas le portent à l’état de sujet. C’est pourquoi, pour saisir autrui comme tel, nous étions en droit de réclamer des conditions d’expérience spéciales, si artificielles fussent-elle : le moment où l’exprimé n’a pas encore (pour nous) d’existence hors de ce qui l’exprime. – Autrui comme expression d’un monde possible. » (1969b : 335).
Et il conclut en rappelant une maxime fondamentale de sa réflexion : « La règle que nous invoquions précédemment : ne pas trop s’expliquer, signifiait avant tout ne pas trop s’expliquer avec autrui, ne pas trop expliquer autrui, maintenir ses valeurs implicites, multiplier notre monde en le peuplant de tous ces exprimés qui n’existent pas hors de leurs expressions. » (Deleuze 1969b : 335).
L’anthropologie peut profiter de cette leçon. Laisser les valeurs d’autrui à l’état
implicite n’implique pas la célébration de quelque mystère qu’elles renfermeraient ;
mais plutôt le refus d’actualiser les possibles exprimés par la pensée indigène, la
résolution de les garder indéfiniment comme possibles, ni en les déracinant comme des fantaisies des autres, ni en les
imaginant comme étant actuels pour nous. L’expérience anthropologique, dans ce cas, dépend de
l’intériorisation formelle des « conditions spéciales et artificielles » dont parle
Deleuze : le moment où le monde d’autrui n’existe pas hors de son expression devient
une détermination pérenne, c’est-à-dire interne à la relation anthropologique, qui
réalise ce possible comme virtuel.39 S’il y a quelque chose qui relève de droit de l’anthropologie , ce n’est certainement
pas la tâche d’expliquer le monde d’autrui, mais celle de multiplier notre monde, « en le peuplant de tous ces exprimés qui n’existent pas hors de leurs expressions ».
De porcs et corps40
Faire des possibles natifs des virtualités revient à traiter les idées natives comme des concepts. Deux exemples.
1. Les porcs des indiens.
On trouve souvent dans l’ethnographie américaine l’idée que, pour les indiens, les animaux sont [des41] humains. Cette formulation condense une nébuleuse de conceptions subtilement variées, que nous n’allons pas détailler ici : tous les animaux ne sont pas humains, et ils ne sont pas les seuls qui le sont; les animaux ne sont pas humains tout le temps ; ils ont été humains mais ils ne le sont plus ; ils deviennent humains lorsqu’ils sont hors de nos vues ; ils pensent exclusivement qu’ils sont humains ; ils se voient comme humains ; ils ont une âme humaine dans un corps animal ; ce sont des gens comme les humains, mais ils ne sont pas humains exactement de la même façon que nous, etc. En outre, « animal » et « humain » sont des traductions équivoques de certains mots indigènes – et n’oublions pas que nous sommes confrontés à des centaines de langues différentes, où dans la plupart d’entre elles, soit dit en passant, la copule n’est normalement pas marquée par un verbe. Mais peu importe, pour le moment. Supposons que des énoncés tels que « les animaux sont humains » ou « certains animaux sont des personnes » aient du sens, et un sens qui n’a rien de « métaphorique », pour un groupe indigène donné. Qu’ils aient aussi le sens, disons (mais pas exactement le même genre de sens), que l’affirmation apparemment inverse (et aujourd’hui si peu scandaleuse) – « les humains sont animaux » – a pour nous. Supposons alors que le premier énoncé ait du sens pour, par exemple, les Ese Eja de l’Amazonie bolivienne : « L’affirmation, que j’ai fréquemment entendu, que ‘tous les animaux sont Ese Eja’ […] » (Alexiades 1999 : 179)42.
Et bien. Isabella Lepri, étudiante d’anthropologie qui aujourd’hui travaille, par une heureuse coïncidence, auprès de ces mêmes Ese Eja, m’a demandé (en mai 1998, je pense) si je croyais que les pécaris sont humains, comme disent les indiens. J’ai dit non – et je l’ai fait parce que je soupçonnais (sans aucune raison) qu’elle croyait que, si les indiens disaient une telle chose, alors cela devait être vrai. J’ai ajouté, de manière perverse et plutôt mensongère, que je ne « croyais » qu’aux atomes et aux gènes, à la théorie de la relativité et à l’évolution des espèces, à la lutte de classes et à la logique du capital, enfin, à ce genre de chose ; mais que, en tant qu’anthropologue, je prenais tout à fait au sérieux l’idée que les pécaris sont humains. Ella m’a répondu : « Comment pouvez-vous soutenir que vous prenez au sérieux ce que disent les indiens ? Ce n’est pas seulement une manière d’être poli avec vos informateurs ? Comment pouvez-vous les prendre au sérieux si vous faites seulement semblant de croire à ce qu’ils disent ?
Cette accusation d’hypocrisie m’a obligé, évidement, à y réfléchir. Je suis convaincu que la question d’Isabella est absolument cruciale, que toute anthropologie digne de ce nom doit y répondre, et que ce n’est pas facile de bien y répondre.
Une réponse possible, naturellement, est celle contenue dans une réplique acérée de Lévi-Strauss à l’herméneutique my(s)thique de Ricœur : « Il faut en prendre son parti : les mythes ne disent rien qui nous instruise sur l’ordre du monde, la nature du réel, l’origine de l’homme ou sa destinée » (1971 : 571). En revanche, continue l’auteur, les mythes nous apprennent beaucoup sur les sociétés dont ils proviennent, et, surtout, sur certains modes fondamentaux (et universaux) d’opération de l’esprit humain (Lévi-Strauss 1971 : 571). On oppose, ainsi, à la vacuité référentielle du mythe, sa plénitude diagnostique : dire que les pécaris sont humains ne nous « dit » rien sur les pécaris, mais beaucoup sur les humains que le disent.
La solution n’a rien de spécifiquement lévi-straussien ; elle est la posture canonique de l’anthropologie, depuis Durkheim ou les intellectualistes à nos jours. Une grande partie de l’anthropologie appelée cognitive, par exemple, peut être vue comme une élaboration systématique de cette attitude, qui consiste à réduire le discours indigène à un ensemble de propositions, à sélectionner celles qui sont fausses (ou alternativement, « vides ») et à produire une explication de pourquoi les êtres humains y croient, étant donné qu’elles sont fausses et vides. Une explication, par exemple, peut être celle qui conclut que telles propositions font l’objet d’un enchâssement ou d’une citation de ses énonciateurs (Sperber 1974 ; 1982) ; elles renvoient donc non pas au monde, mais à la relation des énonciateurs avec leur propre discours. Cette relation est également le thème privilégié des anthropologies dites « symbolistes », de type sémantique ou pragmatique : des énoncés comme celui sur les pécaris disent (ou font), « en vrai », quelque chose sur la société, et non pas sur ce dont ils parlent. Ils ne nous apprendraient rien, et aux indiens non plus, sur l’ordre du monde et la nature du réel. Prendre au sérieux une affirmation telle que « les pécaris sont humains », dans ce cas, consisterait à montrer comment certains humains peuvent la prendre au sérieux, voire y croire, sans que cela les rende irrationnels – et naturellement, sans que les pécaris se montrent humains. On sauve le monde : on sauve les pécaris, les natifs et, surtout, l’anthropologue.
Cette solution ne me satisfait pas. Au contraire, elle me dérange profondément. Elle semble impliquer que, pour prendre les indiens au sérieux, lorsqu’ils affirment des choses comme « les pécaris sont humains », il faut s’interdire de croire en ce qu’ils disent, étant donné que, si nous le faisions, nous ne nous prendrions pas au sérieux. Il faut trouver une autre solution. Compte tenu du fait que je n’ai pas le temps ici ni, surtout et évidement, la compétence nécessaire pour passer en revue la vaste littérature philosophique sur la grammaire de la croyance, la certitude, les attitudes propositionnelles, etc., je me contenterai de présenter certaines considérations suscitées, de façon plus intuitive que réflexive, par mon expérience d’ethnographe.
Je suis anthropologue, pas porcinologue. Les pécaris (ou, comme l’a dit un autre anthropologue à propos des Nuer, les vaches) ne m’intéressent pas beaucoup, les humains oui. Mais les pécaris intéressent énormément ces humains qui disent que les pécaris sont humains. Alors, l’idée que les pécaris sont humains m’intéresse aussi car elle « dit » quelque chose sur les humains qui disent cela. Mais non parce qu’elle dit, hypothétiquement, quelque chose que ces humains ne sont pas capables de dire eux-mêmes, mais parce que, dans cette idée, ces humains sont en train de dire non seulement une chose sur les pécaris, mais aussi sur ce que c’est d’être « humain ». (Pourquoi les Nuer, au contraire et par exemple, ne disent pas que le bétail est humain ?) L’énoncé sur l’humanité des pécaris, s’il dévoile certainement – à l’anthropologue – quelque chose sur l’esprit humain, fait en réalité plus que cela – pour les indiens : il affirme quelque chose sur le concept d’humain. Il affirme, inter alia, que la notions d’ « esprit humain », et le concept indigène de socialité, incluent dans leur extension les pécaris – et cela modifie radicalement l’intention de ces concepts par rapport aux nôtres.
La croyance du natif ou l’incrédulité de l’anthropologue n’ont pas de place ici. (Se)Demander si l’anthropologue doit croire au natif est un category mistake qui équivaut à demander si le numéro deux est grand ou vert. Voici les premiers éléments de ma réponse à Isabella. Lorsqu’un anthropologue entend un interlocuteur indigène (ou lorsqu’il lit dans la production ethnographique d’un collègue) quelque chose comme « les pécaris sont humains », l’affirmation, sans doute, l’intéresse parce qu’il « sait » que les pécaris ne sont pas humains. Mais ce savoir – un savoir essentiellement arbitraire, pour ne pas dire stupide – doit s’arrêter là : le seul intérêt consiste à avoir éveillé l’intérêt de l’anthropologue. Il ne faut rien lui demander de plus. Il ne faut surtout pas l’incorporer implicitement dans l’économie du commentaire anthropologique, comme s’il fallait expliquer (comme si l’essentiel était d’expliquer) pourquoi les indiens croient que les pécaris sont humains alors que, de facto, ils ne le sont pas. Il est inutile de se demander si les indiens ont ou n’ont pas raison à ce sujet : car ne nous le « savons » déjà ? Mais ce qu’il faut savoir c’est justement ce que nous ne savons pas – à savoir ce que les indiens sont en train de dire lorsqu’ils disent que les pécaris sont humains.
Une telle idée est loin d’être évidente. Le problème qu’elle pose n’est pas dans la copule de la proposition, comme si « pécari » et « humain » étaient des notions communes partagées par l’anthropologue et par le natif, et la seule différence était dans l’équation bizarre entre les deux termes. Il est tout à fait possible, d’ailleurs, que le sens lexical ou l’interprétation sémantique de « pécari » et « humain » soient plus ou moins les mêmes pour les deux interlocuteurs ; il ne s’agit pas d’un problème de traduction, ou de décider si les indiens et nous avons les mêmes naturalkinds (peut-être, peut-être). Le problème est que l’idée que les pécaris sont humains fait partie du sens des « concepts » de pécari et d’humain dans cette culture, ou mieux encore, c’est cette idée qui est le vrai concept en puissance – le concept qui détermine la manière dont les idées de pécari et d’humain sont liées. Car il n’y a pas de « d’abord » les pécaris et les humains, chacun de son côté, et « puis » l’idée que les pécaris sont humains : au contraire, les pécaris, les humains et leur relation sont donnés simultanément43.
L’étroitesse intellectuelle qui caractérise l’anthropologie, dans des cas comme celui-ci, consiste en la réduction exclusive des notions de pécari et d’humain à des variables indépendantes d’une proposition, alors qu’elles doivent être vues – si nous voulons prendre les Indiens au sérieux – comme des variations indissociables d’un concept. Dire que les pécaris sont humains, comme j’ai déjà fait observer, ce n’est pas seulement dire quelque chose sur les pécaris, comme si « humain » était un prédicat passif et pacifique (par exemple, le genre dans lequel s’insère l’espèce pécari) ; ce n’est pas non plus donner une simple définition verbale de « pécari », du type « ‘surubim’ est (le nom d’) un poisson ». Dire que les pécaris sont humains, c’est dire quelque chose sur les pécaris et sur les humains, c’est dire quelque chose sur ce qui peut être l’humain : les pécaris ont l’humanité en puissance, alors les humains auraient, peut-être, une puissance-pécari ? En effet, si les pécaris peuvent être conçus comme humains, alors il doit être possible de concevoir les humains comme pécaris : qu’est-ce qu’être humain, lorsqu’on est « pécari », et qu’est-ce qu’être pécari, lorsqu’on est « humain » ? Quelles en sont les conséquences ? Quel concept peut-on extraire d’un énoncé comme « les pécaris sont humains » ? Comment transformer la conception exprimée par une proposition de ce genre en concept ? Telle est la vraie question.
Ainsi, lorsque ses interlocuteurs indigènes lui disent (dans des conditions qu’il faut, comme toujours, spécifier) que les pécaris sont humains, ce que l’anthropologue doit se demander n’est pas s’il « croit ou pas » que les pécaris sont humains, mais ce qu’une telle idée lui apprend sur les notions indigènes d’humanité et de « pécaritude ». Ce qu’une telle idée, notons-le bien, lui apprend sur ces notions et sur d’autres choses : sur les relations entre lui et son interlocuteur, les situations dans lesquelles un tel énoncé est produit « spontanément », les types de parole et le jeu de langage dans lequel il s’insère, etc. Ces autres choses, toutefois – et je voudrais insister sur ce point – sont très loin d’épuiser le sens de l’énoncé. Le réduire à un discours qui ne « parle » que de son énonciateur, c’est nier à celui-ci son intentionnalité et, de plus, c’est l’obliger à troquer son pécari contre notre humain. Ce qui est une très mauvaise affaire pour le chasseur de pécari.
Et dans ces termes, il est évident que l’ethnographe doit croire en (au sens de faire confiance à) son interlocuteur : car si celui-ci n’est pas en train de lui exprimer une opinion, mais plutôt de lui apprendre ce que sont les pécaris et les humains, de lui expliquer comment l’humain est impliqué dans le pécari…, alors la question, encore une fois, doit être : à quoi sert cette idée ? Dans quels agencements peut-elle entrer ? Quelles en sont les conséquences ? Par exemple : que mangeons-nous, lorsque nous mangeons un pécari, si les pécaris sont humains ?
Et plus encore : il reste à voir si le concept élaboré à partir d’énoncés comme celui-ci s’exprime de manière réellement adéquate par la forme « X est Y ». Car il ne s’agit pas tout à fait d’un problème de prédication ou d’attribution, mais plutôt d’un problème de définition d’un ensemble virtuel d’événements et de séries dans lequel entrent les cochons sauvages de notre exemple : les pécaris marchent en troupeau… ils ont un chef… ils sont bruyants et agressifs… leur apparition est soudaine et imprévisible… ils sont des mauvais beaux-frères… ils mangent de l’açaï… ils vivent sous la terre… ils sont des incarnations des morts…etc. Il ne s’agit pas alors d’identifier les attributs des pécaris aux attributs des humains, mais de quelque chose de très différent. Les pécaris sont pécaris et humains, ils sont humains en ce que les humains ne sont pas pécaris ; les pécaris impliquent les humains, en tant qu’idée, par leur distance même vis-à-vis des humains. Ainsi, lorsqu’on dit que les pécaris sont humains, ce n’est pas pour les identifier aux humains, mais pour les différencier d’eux-mêmes – et nous de nous-mêmes.
J’ai dit précédemment que l’idée que les pécaris sont humains est loin d’être évidente. Il est certain qu’aucune idée intéressante n’est évidente. Celle-ci, en particulier, n’est pas non-évidente parce qu’elle est fausse ou invérifiable (les Indiens disposent de plusieurs manières de la vérifier), mais parce qu’elle dit quelque chose de non-évident sur le monde. Les pécaris ne sont pas évidemment humains, ils en sont non-évidement. Cela voudrait-il dire qu’une telle idée est « symbolique », dans le sens que Sperber a donné à cet adjectif ? Je ne le pense pas. Sperber conçoit les concepts indigènes comme des propositions, et pire encore, comme des propositions de seconde classe, des « représentations semi-propositionnelles » qui prolongent le « savoir encyclopédique » sous un mode non-référentiel [não-referencializável] : une confusion de la positivité44 avec le référentiellement vide, du virtuel avec le fictionnel, de l’immanence avec la clôture… Mais il est possible de voir le « symbolisme » d’une autre façon que celle de Sperber, d’une façon qui le considère comme quelque chose de logiquement et de chronologiquement postérieur à l’encyclopédie ou à la sémantique, comme quelque chose qui marque les limites de la connaissance du vrai et du vérifiable, le point où les choses se transforment en illusion. Les concepts indigènes peuvent être dit symboliques, mais en un sens très différent ; ils ne sont pas sous-propositionnels, ils sont sur-propositionnels, car ils présupposent les propositions encyclopédiques mais ils en définissent également la signification vitale, le sens ou la valeur. Ce sont les propositions encyclopédiques qui sont semi-conceptuelles ou sous-symboliques, pas le contraire. Le symbolique n’est pas le demi-véritable, mais le pré-véritable, c’est-à-dire l’important ou pertinent : il ne concerne pas à « ce qu’est le cas », mais à ce qui compte dans ce qu’est le cas. Que vaut un pécari ? Voici une question, littéralement, intéressante.45
« Profond : une autre façon de dire semi-propositionnel », a ironisé, une fois, Sperber (1982 : 173). Mais alors il serait approprié de répliquer – banal : une autre façon de dire propositionnel. Ils sont profonds, en effet, les concepts indigènes, car ils projettent un fond, un plan d’immanence peuplé d’intensités, ou, si le lecteur préfère le langage de Wittgenstein, un Weltbild saturé de « pseudo-propositions » de base qui ignorent et précèdent le partage entre le vrai et le faux, « tissant un filet qui, lancé sur le chaos, peut lui donner certaine consistance » (Prado Jr. 1998 : 317). Ce fond est une « base sans fondement » qui n’est ni rationnelle/raisonnable ni irrationnelle/insensée, mais « qui est là tout simplement – comme notre vie. » (Prado Jr. 1998 : 319).
2. Les corps des indiens.
Mon collègue Peter Gow m’a raconté, un jour, la scène suivante, dont il avait été témoin lors de l’un de ses séjours chez les Piro de l’Amazonie péruvienne :
Une professeure dans la mission (dans le village de) Santa Clara essayait de convaincre une femme piro de préparer la nourriture de son jeune fils avec de l’eau bouillie. La femme lui a répliqué : « si nous buvons de l’eau bouillie, nous aurons la diarrhée ». La professeure, en se moquant de la réponse, lui a expliqué que la diarrhée infantile traditionnelle est causée justement par l’ingestion d’eau non-bouillie. Sans se laisser décourager, la femme piro lui a répondu : « Peut-être que, pour le peuple de Lima, cela est vrai. Mais pour nous, des gens natifs d’ici, l’eau bouillie provoque la diarrhée. Nos corps sont différents de vos corps » (Gow, communication personnelle, 12/10/00).
Qu’est-ce qu’un anthropologue peut faire de la réponse de cette femme indigène ? Plusieurs choses. Gow, par exemple, a tiré de cette anecdote des commentaires empreints de sagesse, dans un article en préparation :
« Ce simple énoncé (« nos corps sont différents ») capture avec élégance ce que Viveiros de Castro (1996) a appelé le perspectivisme cosmologique, ou multi-naturalisme : ce qui distingue les différents types d’individus, ce sont leurs corps, et non pas leurs cultures. On doit remarquer, toutefois, que cet exemple de cosmologie perspectiviste n’a pas été forgé au cours d’une discussion ésotérique sur le monde occulte des esprits, mais dans le cadre d’une conversation autour de préoccupations éminemment pratiques : quelles sont les causes de la diarrhée infantile ? il serait tentant de considérer les positions de la professeure et de la femme piro comme représentant deux cosmologies distinctes, le multiculturalisme et le multi-naturalisme, et d’imaginer la discussion comme un choc de cosmologies ou cultures. Ce serait une erreur, je pense. Les deux cosmologies/cultures, dans le cas, sont en contact depuis longtemps, et leur imbrication précède de loin les processus ontogénétiques à travers lesquels la professeure et la femme piro les ont formulé comme auto-évidentes. Mais surtout, cette interprétation traduirait le dialogue dans les termes généraux de l’une de ces parties, à savoir, le multiculturalisme. Les coordonnées de la position de la femme piro seraient systématiquement violées par l’analyse. Cela ne veut pas dire, bien sûr, que je croie que les enfants doivent boire de l’eau non-bouillie. Mais cela veut dire que l’analyse ethnographique ne peut pas avancer si la décision du sens général a déjà été prise au préalable. »46
Je suis d’accord avec une grande partie de l’argument ci-dessus. L’anecdote racontée par Gow est, en effet, une merveilleuse illustration, notamment du fait qu’elle est le produit d’un incident banalement quotidien, de la divergence irréductible entre ce que j’ai appelé le « multiculturalisme » et le « multi-naturalisme ». Mais l’analyse suggérée par mon correspondant ne me semble pas la seule possible. Ainsi, sur la question de la traduction de la discussion dans les termes généraux d’une des parties – en l’espèce, ceux de la professeure –, ne serait-il pas également possible, et surtout nécessaire, de la traduire dans les termes généraux de l’autre partie ? Car il n’y a pas de troisième position, une position absolue de survol qui montrerait le caractère relatif des deux autres. Il faut prendre position.
Pourrions-nous dire, par exemple, que chaque femme est « en train de culturaliser » l’autre dans cette discussion, c’est-à-dire que chacune attribue la bêtise de l’autre à la « culture » de l’autre, tandis que chacune « interprète » sa propre position comme « naturelle » ? Serait-il opportune de dire que l’argument avancé par la femme piro sur le « corps » est déjà une espèce de concession aux présupposés de la professeure ? Peut-être ; mais il n’y a pas eu de concession réciproque. La femme piro était d’accord pour être en désaccord, mais la professeure, pas du tout. La première n’a pas contesté le fait que les personnes de la ville de Lima (« peut-être ») doivent boire de l’eau bouillie, tandis que la deuxième a refusé péremptoirement l’idée que les personnes du village de Santa Clara ne doivent pas en boire.
Le « relativisme » de la femme piro – un relativisme « naturel », pas « culturel », il faut le noter – pourrait être interprété à partir de certaines hypothèses concernant l’économie cognitive des sociétés non-modernes, ou sans écriture, ou traditionnelles, etc. Dans les termes de la théorie de Robin Horton (1993 : 379-ss.), par exemple. Horton diagnostique ce qu’il a appelé le « paroissialisme de la vision de monde » (world-view parochialism) comme quelque chose de propres à ces sociétés : contrairement à l’exigence implicite de l’universalisation contenue dans les cosmologies rationalisées de la modernité occidentale, les cosmologies des peuples traditionnels semblent marquées par un esprit de grande tolérance, qui est cependant, en réalité, une indifférence à la concurrence de visions de monde discordantes. Le relativisme apparent des Piro ne manifesterait pas, ainsi, sa largeur de vues, mais, au contraire, sa myopie : ils ne se soucient pas de comment les choses sont ailleurs47.
Il y a plusieurs raisons pour réfuter une lecture comme celle d’Horton ; entre autres, celle qui soutiennent l’idée que le soi-disant relativisme primitif n’est pas seulement interculturel, mais intraculturel et « autoculturel » et qu’il n’exprime ni de la tolérance, ni de l’indifférence, mais plutôt de l’extériorité absolue à l’idée crypto-théologique de « culture » comme un ensemble de croyances (Tooker 1992 ; Viveiros de Castro 1993). La raison principale, néanmoins, est parfaitement préfigurée dans les commentaires de Gow, à savoir que cette idée de « paroissialisme » traduit le débat de Santa Clara dans les termes de la position de la professeure, avec son universalisme naturel et son différentialisme (plus au moins tolérant) culturel. Il y a plusieurs visions de monde, mais il n’y a qu’un monde – un monde où tous les enfants doivent boire de l’eau bouillie (s’ils se trouvent, bien sûr, dans une partie du monde où la diarrhée infantile est une menace).
À la place de cette lecture, je vous en propose une autre. L’anecdote des corps différents invite à un effort de détermination du monde possible exprimé par le jugement de la femme piro. Un monde possible dans lequel les corps humains seraient différents à Lima et à Santa Clara – dans lequel il serait nécessaire que les corps des blancs et des Indiens soient différents. Et bien, déterminer ce monde, ce n’est pas inventer un monde imaginaire, un monde déterminé, disons, par une autre physique ou une autre biologie, où l’univers ne serait pas isotrope et les corps se comporteraient selon des lois différentes dans des lieux distincts. Cela serait de la (mauvaise) science-fiction. En fait, il s’agit de trouver le problème réel qui rend possible le monde impliqué dans la réplique de la femme piro. L’argument que « nos corps sont différents » n’exprime pas une théorie biologique alternative, et, naturellement, erronée, ou une biologie objective imaginairement non-standard.48 Ce que l’argument piro manifeste est une idée non-biologique du corps, idée qui fait que des questions, comme celle de diarrhée infantile, ne sont pas traitées comme objets d’une théorie biologique. L’argument affirme que nos « corps » respectifs sont différents, et non pas que nos « biologies » sont diverses. L’anecdote de l’eau piro ne reflète pas une autre vision du même corps, mais un autre concept de corps, dont la dissonance sous-jacente à son « homonymie » avec le nôtre est, justement, le problème. Ainsi, par exemple, le concept piro de corps n’est peut-être pas, contrairement au nôtre, dans l’âme, c’est-à-dire dans l’esprit, sous la forme d’une représentation d’un corps qui lui est extérieur. Il est peut-être inscrit, au contraire, dans le corps lui-même comme perspective (Viveiros de Castro 1996). Il ne s’agit donc pas d’un concept comme représentation d’un corps extra-conceptuel, mais d’un corps comme perspective interne du concept : le corps comme impliqué dans le concept de perspective. Et si, comme le disait Spinoza, nous ne savons pas « ce que peut un corps », nous savons encore moins ce que peut ce corps. Pour ne pas parler de son âme.