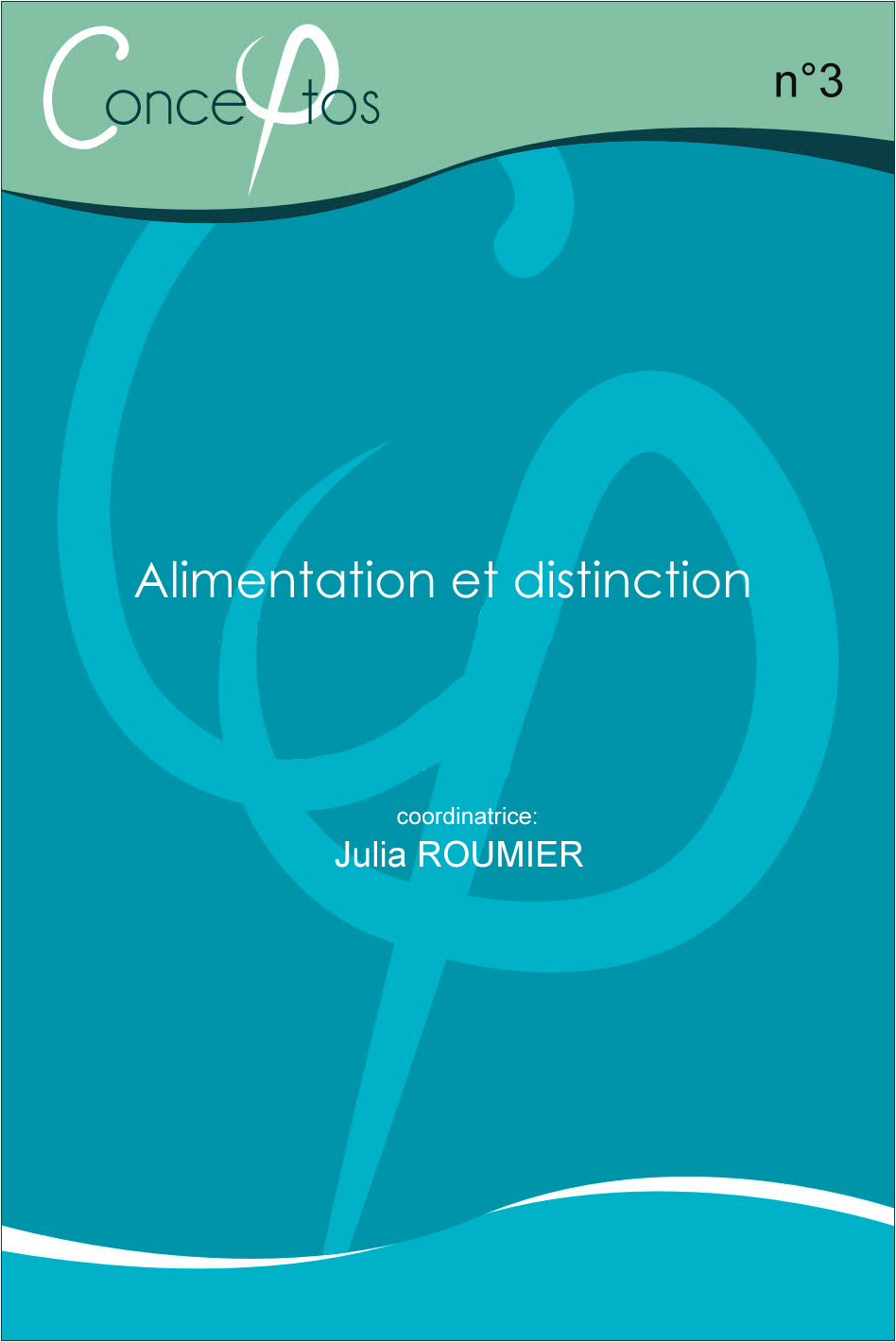L'imaginaire naturel de Miguel Delibes : Une vision non moderne1
Même si la relation entre la narration de Miguel Delibes (1920-2010) et la nature semble aller de soi et a déjà été étudiée (Handelsman, 1975), la cosmovision du monde naturel de l’auteur n’a pas été évaluée sous l’angle écocritique, perspective très présente actuellement au sein du milieu académique. Dans cet article, j’analyserai l’imaginaire narratif autour de l’environnement naturel chéri par Miguel Delibes (1920-2010) et je le circonscrirai à l’analyse des romans El camino (Le chemin) (1950), Diario de un cazador (Journal d’un chasseur) (1955), Las ratas (Les rats) (1963) et, par extension thématique, Los santos inocentes (Les saints innocents) (1981)2. Je placerai cet imaginaire narratif en dialogue avec l’écocritique ou, plus concrètement, avec les théories que Bruno Latour expose dans Nous n’avons jamais été modernes, Essai d’anthropologie symétrique. On comprendra ainsi le caractère pleinement actuel des perspectives de Delibes autour de la nature dans son discours de réception à la Real Academia Española (Delibes, 2013), même s’il s’agit d’une narration qui se construit totalement dans un milieu urbain (Gámez, 2021, p. 2), celui de la Valladolid de province que l’auteur habite.
La cosmovision de Delibes sur la nature
J’analyserai la cosmovision de l’auteur sur la nature sous trois perspectives : a) sa conception du progrès, b) la biopolitique qui émane de son point de vue dans ses romans ruraux et c) sa conception de ce qui devrait être la connaissance de la nature, que j’appellerai science populaire.
a. Le sens du progrès chez Delibes
L’idée de progrès développée par l’auteur peut être perçue facilement dès la première page de El camino. Le tout jeune personnage principal, Daniel, conçoit le progrès depuis la perspective de son père : un exemple de l’ascension sociale qui lui permettra de ne pas être fromager comme son géniteur, pour se convertir en quelqu’un de plus important dans la société, par le biais de ce que Louis Althuser considère comme un des appareils idéologiques de l’Etat : l’école (1970, p. 3). En effet,3 « el marcharse a la ciudad a iniciar el bachillerato constituía, sin duda, la base de ese progreso » (Delibes, 2018, p. 79).4 Il s’agit d’une vision illustrée du progrès que Delibes critique quand, quelques lignes plus bas, il place dans la bouche de son personnage la phrase suivante : « habrá quien, al cabo de catorce años de estudio, no acierte a distinguir un rendajo de un jilguero o una boñiga de un cagajón » (Delibes, 2018, p. 80).5 Cette phrase introduit une autre idée très commune chez Delibes, à savoir que la connaissance de la nature devrait faire partie du savoir académique. On perçoit de nouveau cette vision erronée du progrès dans la décision de Quino qui, malgré son penchant naturel, choisit pour épouse la mince Mariuca, car « En las ciudades, los señoritos se casan con las hembras flacas. Algo especial tendrán las flacas cuando los señoritos que tienen estudios y talento las prefieren así » (Delibes, 2018, p. 162).6 De fait, ces commentaires que des personnages du roman font sur des gens de la ville reflètent une idée de plus grande sophistication, non de position de progrès plus important. Comme lorsque Roque, l’ami de Daniel, affirme : « En las capitales hay muchas mujeres que lo tienen [cutis]. En los pueblos, no, porque el sol les quema el pellejo o el agua se lo arruga » (Delibes, 2018, p. 187).7 C’est du fait de cette sophistication que Daniel accepte l’idée de progrès social à travers l’école, idée transmise par son père dès le moment où Daniel tombe amoureux de La Mica (Delibes, 2018, p. 191) et jusqu’à ce que le promis de celle-ci fasse son apparition.
L’idée de progrès comme ascenseur social et le progrès technologique auquel il est associé ne sont pourtant pas chers à Delibes. Mais cela ne veut pas dire que la technologie ne soit pas présente dans le monde qu’il décrit. Le train est un élément récurrent, aussi bien dans El camino que dans le roman suivant à thématique champêtre, Diario de un cazador. Et il évolue en harmonie avec la nature, comme on peut l’observer dans la comparaison que Daniel fait entre les locomotives et les grillons (Delibes, 1978, p. 96). Il s’agit néanmoins d’un élément distant. Daniel observe de loin la sortie des trains du tunnel, mais quand approche le matin où il doit prendre celui qui l’emmènera à la ville, l’image de ce train s’assombrit. Lorenzo, le personnage principal de Diario de un cazador, entend le sifflement du train de loin dans le matin, les nuits où il ne trouve pas le sommeil. C’est, de plus, une technologie au service de l’homme, qui la soumet à son intérêt, comme on le voit dans l’admiration que Cuco, le contrôleur, éveille chez Daniel : « admiraba su carácter, sus conocimientos y la simplicidad con que manejaba y controlaba la salida, entrada y circulación de los trenes por el valle. Todo esto implicaba una capacidad; la ductilidad y el talento de organización de un factor no se improvisan » (Delibes, 2018, p. 135).8 Ceci montre bien que Delibes n’est pas contre l’instruction ni l’apprentissage, mais contre le fait que ceux-ci éloignent les gens de leur envirronement naturel. On le voit aussi à travers le personnage de Gerardo, l’Indien, qui «había progresado, y bien, sin necesidad de estudiar catorce años y a pesar de que su madre, la Micaela, decía de él que era “el más tímido de todos” » (Delibes, 2018, p. 146),9 ce qui malmène l’équilibre entre ascenseur social et instruction publique.
La machine, cependant, n’est jamais un élément appartenant à l’essence des personnages bien que, tant Lorenzo, le narrateur de Diario de un cazador (Delibes, 1956, p. 84) que l’auteur lui-même qui, selon Gracia y Ródenas (Mainer, 2010, p. 434), se voit reflété dans ce personnage, souhaitent ardemment posséder une automobile (Delibes, 2002, p. 116), vive image du désir consumériste qui conduira au « desarrollismo » franquiste des dix années suivantes. Mais, tant pour l’un que pour l’autre, il s’agit plus d’une question de confort que de nécessité. En effet, lorsqu’on en a besoin, la technologie reste hors de portée du milieu rural, comme on le voit dans la mort de Germán le « Tiñoso ». Quand son frère arrive de la ville avec une ambulance pour le secourir, la mère lui dit : « llegas tarde. Tu hermano acaba de morir » (Delibes, 2018, p. 245).10
Il s’agit de la représentation d’une technologie où il est clair que le milieu environnemental doit rester comme une arcadie, loin des excès du progrès, comme le précise le narrateur à travers la pensée de Daniel dans le chapitre final (Delibes, 2018, p. 260) :11
No le interesaba el progreso. El progreso, en verdad, no le importaba un ardite. Y, en cambio, le importaban los trenes diminutos en la distancia y los caseríos blancos y los prados y los maizales parcelados; y la Poza del Inglés, y la gruesa y enloquecida corriente del Chorro; y el corro de bolos; y los tañidos de las campanas parroquiales; y el gato de la Guindilla; y el agrio olor de las encellas sucias; y la formación pausada y solemne y plástica de una boñiga; y el rincón melancólico y salvaje donde su amigo Germán, el Tiñoso, dormía el sueño eterno; y el chillido reiterado y monótono de los sapos bajo las piedras en las noches húmedas; y las pecas de la Uca—uca y los movimientos lentos de su madre en los quehaceres domésticos; y la entrega confiada y dócil de los pececillos del río; y tantas y tantas otras cosas del valle.
Ce point de vue a été jugé rétrograde à son époque, au moment de la parution du roman, comme l’indique Romero (1978, p. 10), parce qu’on l’a associé avec le discours prononcé par le prêtre don José à l’enterrement de Germán. Pour les critiques, le message du roman tenait dans le fait que le chemin de chacun est marqué par Dieu, et non qu’il se trace nécessairement à travers le progrès et l’ascension sociale (Delibes, 2018, p. 227-228). Mais Romero cite Janet W. Díaz (1978, p. 11) et fait une interprétation plus large de cette idée. Et Marisa Solano, dans le prologue de l’édition de 2010 de Planeta, utilise l’interprétation du discours du curé mais, en s’appuyant sur des déclarations de Delibes lui-même, souligne que le message qui sous-tend le discours montre l’existence d’une vocation rurale claire chez certaines personnes, et « esto no debe interpretarse como una actitud reaccionaria ante el progreso » (Delibes, 2018, p. 37).12
Delibes cite ces critiques dans son discours de réception comme membre académique de la RAE le 25 mai 1974. Il rappelle en effet que, après avoir publié El camino, « algunos me tacharon de reaccionario. No querían admitir que a lo que renunciaba Daniel, el Mochuelo, era a convertirse en cómplice de un progreso de dorada apariencia pero absolutamente irracional » (Delibes, 2013, p. 22).13 Delibes affirme ensuite que son « oposición al sentido moderno del progreso y a las relaciones Hombre-Naturaleza » (Delibes, 2013, p. 22)14 s’était renforcée peu à peu, et plus encore avec les années, après avoir exhorté à protester « contra la brutal agresión a la Naturaleza que las sociedades llamadas civilizadas vienen perpetrando mediante una tecnología desabrida » (Delibes, 2013, p. 22).15
b. La cosmovision biopolitique de Delibes
La biopolitique que Delibes élabore sur base de la relation de l’homme avec l’environnement, et que l’on retrouve dans ses œuvres, spécialement dans Diario de un cazador,16 est une cosmovision transversale traversant toute son œuvre. Comme Gámez le démontre (2021), Diario de un cazador présente un discours sur l’environnement compris comme un milieu dans lequel les acteurs, vivants (animaux, végétaux) ou inertes (l’eau d’une rivière, un lever de soleil, les réserves de chasse, le terrain) font partie d’un tout englobant les êtres humains dans un biopouvoir où la zoé (ou « vie nue »)se voit élargie, permettant d’assimiler le milieu naturel et la société comme un tout.
C’est une cosmovision dans laquelle, dans les moments tragiques, les animaux et les gens se retrouvent au même niveau. Dans El camino, le corps de l’enfant mort se décompose de la même manière que la grive que son ami a introduite dans le cercueil, et ceci oblige le personnage principal à « admitir como un suceso vulgar y cotidiano que los huesos del Tiñoso se transformasen en cenizas junto a los huesos de un tordo; que los gusanos agujereasen ambos cuerpos simultáneamente, sin predilecciones ni postergaciones » (Delibes, 2018, p. 254).17 Dans Diario de un cazador, Doly, la chienne de Melecio, l’ami du héros, s’émeut autant que n’importe quel être humain devant la perte de « Mele », le fils de Melecio, dans la scène la plus dramatique du livre (Delibes, 1956, p. 170). Il s’agit de comportements et de symboles que parfois les hommes ne comprennent pas, pollués par les habitudes dénaturées de la vie à la ville. En effet, Tomàs, le frère de Germán, ne comprend pas l’apparition d’une grive morte dans le cercueil de son frère (Delibes, 2018, p. 250), et Zacarías, un ami de Lorenzo, donne un coup de pied à la chienne quand elle s’approche de la tombe de Mele (Delibes, 1956, p. 171).
Cependant, dans cette cosmovision, l’exploitation et le bénéfice économique dans la gestion sont à l’ordre du jour, non seulement pour la chasse obtenue, mais aussi pour la gestion et l’exploitation des terrains de chasses et des cultures, ce qui nous permet de parler de biopouvoir. On y fait allusion dans El camino, mais c’est clairement souligné dans Diario de un cazador. Et dans Las ratas, il s’agit du détonateur du drame rural qui nous est raconté. Les réflexions de Lorenzo, le narrateur, jeune concierge de lycée et grand amateur de chasse, se penchent spécialement sur la gestion et l’exploitation ainsi que sur les aspects économiques de l’environnement et du patrimoine naturel. Les citations sont nombreuses où il est question de l’exploitation et la gestion privée des terrains de chasse (Delibes, 1956, p. 54, p. 67-68, p. 87-88). Lorenzo ne formule que deux plaintes par rapport à cette organisation de la campagne, l’une poétique : « El que hizo esa ley no vio volar las perdices de lo de Miranda con la cellisca » (Delibes, 1956, p. 80),18 l’autre en relation avec la décision arbitraire de postposer la fermeture de la chasse (Delibes, 1956, p. 183-184).
La chasse, et tout ce qui l’entoure, est aussi présentée comme un soutien économique important pour ceux qui la pratiquent. Elle apporte en effet un complément à l’économie domestique (Delibes, 1956, p. 30, p. 60, p. 117). Dans Las ratas, cette préoccupation pour les affaires économiques et le biopouvoir qui régit les sociétés rurales s’étend à l’exploitation des campagnes et à leur lutte pour la survie face à un pouvoir prétendant mettre en place des politiques transformatrices afin d’augmenter la productivité sans pourtant y arriver (Delibes, 2020, p. 89-90). C’est la raison pour laquelle la sagesse accumulée autour de l’agriculture et l’élevage apparaît comme fondamentale (Delibes, 2020, p. 32, p. 54, p. 119, p. 153), et révèle toute l’importance des conseils de Nini (Delibes, 2020, p. 15, p. 27-28, p. 111, p. 130, p. 155, p. 159, p. 174).
Tout ce biopouvoir, bien que régi par les ordonnances et les lois du pouvoir politique, et parfois par certains tripatouillages, comme ceux du maire dans Las ratas, est néanmoins soumisàun ordre moral supérieur, capitalisé par Dieu, qui préside les relations éthiques entre les personnages et l’harmonie du monde. On le voit dans la scène du Diario de un cazador où le héros contemple la lune en silence : « Así, como nosotros, debió de sentirse Dios al terminar de crear el mundo » (Delibes, 1956, p. 136).19
Dans le cadre de cette cosmovision, la science a peu de pouvoir face au malheur. Quand le médecin va voir Tiñoso, il part en disant : « Tiene fracturada la base del cráneo. Está muy grave. Pidan una ambulancia a la ciudad » (Delibes, 2018, p. 245).20 Ce qui est fait, mais elle arrive trop tard. Pour Delibes, il y a une autre force, plus puissante, qui régit les destins des gens. Il admet différentes interprétations, mais toutes ont un caractère surnaturel : « Y la luz del día se hizo pálida y macilenta. Y temblaba en el aire una fuerza aún mayor que la de Paco. Pancho, el Sindiós, dijo de aquella fuerza que era el Destino, pero la Guindilla dijo que era la voluntad del Señor » (Delibes, 2018, p. 245).21 Et ce caractère est nettement supérieur à l’être humain : « la muerte se empeñó en llevárselo y contra ella, si se ponía terca, no se conocía remedio » (Delibes, 2018, p. 247).22 Une série de réflexions autour de la mort sont alors placées dans la bouche du narrateur, imbriquées dans le contexte naturel, marquant profondément l’enfant (Delibes, 2018, p. 248-9) :23
El pueblo asumía a aquella hora una quietud demasiado estática, como si todo él se sintiera recorrido y agarrotado por el tremendo frío de la muerte. Y los árboles estaban como acorchados. Y el quiquiriquí de los gallos resultaba fúnebre, como si cantasen con sordina o no se atreviesen a mancillar el ambiente de duelo y recogimiento que pesaba sobre el valle. Y las montañas enlutaban, bajo un cielo plomizo, sus formas colosales. Y hasta en las vacas que pastaban en los prados se acentuaba el aire cansino y soñoliento que en ellas era habitual.
La seule façon de survivre dans ce contexte, amène mais régi par une force surhumaine, passe par l’expérience mêlée, de manière harmonieuse, à une certaine connaissance de la nature.
c. Science populaire
Nous en avons plusieurs témoins. Lorenzo, le personnage principal de Diario de un cazador, mais surtout,les personnages de l’enfance : Daniel le « Mochuelo », et Germán le « Tiñoso », qui possède une impressionnante connaissance ornithologique et pour cela « distinguía como nadie a las aves por la violencia o los espasmos del vuelo o por la manera de gorjear; adivinaba sus instintos; conocía, con detalle, sus costumbres; presentía la influencia de los cambios atmosféricos en ellas y se diría que, de haberlo deseado, hubiera aprendido a volar » (Delibes, 2018, p. 122).24 Par extension, nous avons aussi son père, Andrès, le cordonnier, qui élève des oiseaux (Delibes, 2018, p. 119). Mais le principal témoin est Nini, dans Las ratas, cet enfant qui possède la sagesse, comme le définit Delibes dans le prologue du livre (2020, p. 8). Nini partage tant de choses avec un auteur qui a appris à connaître l’environnement rural : « sin ningún título científico, sino como hombre de campo, como simple cazador » (Delibes, 2013, p. 68).25 Tous ces personnages sont, pour moi, les représentants de ce que j’appelle “la science populaire”. S’il s’agit d’une connaissance qui s’acquiert par une expérience quotidienne de du milieu rural et des personnes qui l’habitent.
C’est cette connaissance, partagée avec Roque, qui permet à Daniel et Germán de découvrir la véritable nature de la fécondation humaine (Delibes, 2018, p. 131-132). Cette façon d’appréhender le savoir n’est pas exempte d’expérimentation. C’est justement Germán qui apparaît un jour à l’école avec une loupe de son père avec laquelle les gamins font toutes sortes d’expériences (Delibes, 2018, p. 195) jusqu’à brûler un peu du pelage du chat des « Guindillas ».
C’est un savoir qui repose sur la tradition. Celui de Germán lui venait de son père. Et, dans le cas de Nini, il se trouve un passage où Pruden, le paysan prudent qui fait appel à lui pour augmenter sa production, lui demande : « los cuervos no me dejan quietos los sembrados; escarban la tierra y se llevan la simiente. ¿Cómo me las arreglaré para ahuyentarlos? » (Delibes, 2020, p. 15).26 Et Nini se rappelle du grand-père Román « que para espantar los pájaros de los sembrados colgaba boca abajo un cuervo muerto » (Delibes, 2020, p. 15).27 De la même manière, pour la prévision du temps, Nini consulte le vieux qu’on appelle Le Centenaire. (Delibes, 2020, p. 78).
Au départ, il semble exister une composante surnaturelle dans cette connaissance, non pas positivemais révélée, qui ferait écho aux croyances de l’auteur, du moins pour ceux qui reçoivent cette connaissance, comme Pruden, qui finit par affirmer : « Digo que el Nini ese todo lo sabe. Parece Dios » (Delibes, 2020, p. 19),28 ou comme madame Resu qui « afirmaba que la sabiduría del Nini no podía provenir más que del díablo » (Delibes, 2020, p. 29).29 Mais cette affirmation est completée par le narrateur, lorsqu’il dit que « lo que sabía se lo debía el Nini únicamente a su espíritu observador » (Delibes, 2020, p. 29),30 affirmation confirmée aussi par l’histoire, qui montre clairement les sources auxquelles s’abreuve l’enfant : « El Nini, cada vez que le asaltaba alguna duda sobre los hombres, o sobre los animales, o sobre las nubes, o sobre las plantas, o sobre el tiempo, acudía al Centenario » (Delibes, 2020, p. 78-79).31 Maintenant, cette connaissance est plus que positive ; c’est un produit de l’expérience et de l’émotion humaines : « en las percepciones del Centenario jugaba un papel preferente la edad, la huella que produjeron en él, a determinada edad, las nubes, el sol, el viento o el polvo dorado de la trilla » (Delibes, 2020, p. 79).32 Si on tient compte de ce conditionnement à l’environnement, ce savoir est supérieur à la pensée positive, qui prétend faire la révolution dans les campagnes :« Pero llegó el sol de agosto y abrasó los tiernos brotes y los cerros siguieron mondos como calaveras » (Delibes, 2020, p. 89),33 bien que ce savoir ne partage pas sa grandiloquence ni sa prétendue autosuffisance, car il est humble, ilse sait à la merci de forces supérieures. C’est pourquoi Nini refuse la connaissance positive qui peut être acquise à l’école – comme la refusait Daniel, le personnage principal de El Camino – et ne maîtrise pas non plus le fonctionnement des machines (Delibes, 2020, p. 96-97).
À partir des trois idées exposées dans les différentes rubriques de cette section, il est possible de synthétiser la cosmovision de Delibes du milieu naturel et, par extension, de la société. Les nuances qu’il apporte à l’idée de progrès, sa foi en l’existence d’une biopolitique régissant le monde naturel et le monde social dans leur ensemble, ainsi que sa conviction que la connaissance du milieu doit venir de l’expérience et de la tradition, mais dans la communion et le respect de celui-ci, tout cela démontre une vision du monde où la connaissance humaine doit s’élaborer en harmonie avec l’environnement, sans envisager de perspective destructrice comme celle qu’implique, selon Delibes, le développement technologique. Et cette vision s’impose en respect de l’ordre harmonique qui régit le destin des gens, des animaux et des terres, ordre en lequel croit l’auteur. In nous incombe à présent de présenter la pensée de Bruno Latour, et voir en quoi elle entre en dialogue avec la cosmovision de Delibes.
Bruno Latour et la critique de la modernité
L’œuvre de Bruno Latour est étendue et initialement centrée sur la sociologie de la science et sur la méthodologie qui y est associée. Mais avec les années, le penseur français a développé tout une série de travaux autour de la pensée contemporaine, où la préoccupation pour l’environnement et les problèmes liés au changement climatique sont très présents.34 Cependant, dans son essai Nous n’avons jamais été modernes. Essai d’anthropologie symétrique (1991), Latour définit sa relation avec la connaissance positive, la modernité, le milieu rural et le milieu social, et ce sera cet ouvrage que j’utiliserai pour soutenir ma comparaison. Dans cet essai, à partir du fameux livre d’histoire de la science : Leviathan and the Air-Pump, de Simon Schaffer et Steve Shapin (1985) racontant la relation entre Thomas Hobbes et Robert Boyle dans l’Angleterre révolutionnaire, Latour décrit la genèse de la modernité à partir de la séparation artificielle entre nature et société qui se produisit dans l’Angleterre puritaine.
L’hypothèse principale de l’essai, d’où découle ce que Latour définit comme la Constitution moderne, sur laquelle se base cette division (Latour 1991, 20-21) est que le mot « moderne » désigne deux ensembles de pratiques entièrement différentes qui, pour rester efficaces, doivent demeurer distinctes mais qui ont cessé récemment de l’être. Le premier ensemble de pratiques crée par « traduction », des mélanges entre genres d’êtres entièrement nouveaux, hybrides de nature et de culture. Le second, crée par « purification », deux zones ontologiques entièrement distinctes, celle des humains d’une part, celle des non-humains de l’autre.
À partir de cette séparation, il définit comme modernes ceux qui acceptent et appliquent cette division de la connaissance de façon systématique, comme prémodernes ou Anciens ceux dont la conception épistémologique est antérieure à la dualité traduction/purification, et comme postmodernes ceux qui vivent sous la Constitution moderne mais ne croient plus aux garanties qu’elle offre (Latour 1991, 68). Enfin, les non modernes sont ceux qui considèrent que cette division n’a jamais existé et est épistémologiquement artificielle : « Est non-moderne celui que considère à la fois la Constitution des modernes et les peuplements d’hybrides qu’elle dénie » (Latour 1991, 69).
Précisément, Latour critique la division épistémologique entre monde naturel et monde social, et est à la recherche d’une connaissance qui permettrait d’affronter, depuis de multiples points de vue, des problèmes pressants, comme le changement climatique, sur lequel il ouvre son livre.
Le penseur français réclame une rupture avec l’épistémologie moderne, de là le titre de son livre. Il suggère pour cela une extrapolation de l’anthropologie à tous les domaines de la connaissance, y compris la science et la technologie, une fois dépassée la dichotomie nature/société, impliquant la dissolution des frontières conceptuelles existant entre le naturel et le social, l’humain et le non humain, l’occidental et le non occidental.
Le dialogue entre Delibes et Latour
La classification de l’œuvre de Delibes selon les catégories de Latour par rapport à la modernité (moderne, antimoderne, prémoderne, postmoderne, non-moderne), semble conflictuelle, entre autres parce que l’idée même de modernité, son apparition en Espagne, ainsi que les influences dans la littérature espagnole (Gámez, 2018) ont toujours été conflictuelles dans l’historiographie ibérique. Cependant, le regard de Delibes sur une conception du progrès qu’il considère comme « irrationnelle » donne des pistes. Ceci le rend incapable de percevoir que « le temps forme un flux continu et progressif, dont les modernes se proclament l’avant-garde et les antimodernes l’arrière-garde » (Latour, 1991, p. 99).
Comme l’affirme Solano dans le prologue de El camino, Delibes installe dans ses œuvres une « íntima comunión entre el hombre y la naturaleza » (Delibes, 2018, p. 54).35 Si, en plus, comme il l’affirme, il s’oppose aux relations Homme-Nature, c’est parce qu’il ne croit pas en ce que Latour définit comme « la constitution moderne » (Latour, 1991, p. 23).On peut dire qu‘il est contre la troisième des garanties de cette constitution, que Latour définit comme « la séparation complète entre le monde naturel – pourtant construit par l’homme – et le monde social – pourtant tenu par les choses » (1991, p. 49) et ne serait pas moderne mais a-moderne. Cependant, ce regard a-moderne contient des éléments prémodernes, basés sur la vision chrétienne du monde développée par l’auteur, comme on l’observe dans La sombra del ciprés es alargada (L’ombre du cyprès est allongée) (Mainer, 2010, p. 381). Même si cette conception est très certainement influencée par son profond christianisme et le poids prémoderne de celui-ci, l’idéologie libérale qui a toujours accompagné l’auteur sur le plan socio-économique fait que son regard, bien que critique à l’égard du progrès technologique, jugé irrationnel, se construise selon une perspective biopolitique englobant la société, l’écosystème et même le milieu physique. Il s’agit du recueil unissant individualités humaines et éléments non humains.
Précisément, une des recettes proposées par Latour pour combler le fossé entre société et nature est de construire un espace de médiation entre les deux mondes : « Nous devons dessiner un espace qui n’est déjà plus celui de la Constitution moderne puisqu’il remplit la zone médiane qu’elle prétendait vider. À la pratique de purification […] il convient d’ajouter les pratiques de médiation » (Latour, 1991, p. 74). Pour cela, Latour parle de multiplier les intermédiaires entre ces deux mondes non connectés (1991, p. 108). C’est, de mon point de vue, ce que fait Delibes avec ses personnages : construire des consciences capables d’assimiler le naturel comme non éloigné du social, bien avant que Latour énonce ses théories. En effet, Lorenzo, Daniel, Germán et Nini, à partir de leur connaissance du milieu naturel obtenu par la tradition et d’autres stratégies, facilitent l’interaction entre le milieu social et le milieu naturel proposés par Delibes. Ils sont une sorte d’agents qui permettent d’accumuler de précieuses connaissances sur l’environnement à partir de pratiques sociales. Ce savoir n’est pas prémoderne, il contient des traces de pensée positive car il se base sur l’observation, il est issu de l’expérience quotidienne des paysans et des agents humains du milieu naturel. Il est, de plus, un savoir très respectueux de l’environnement, car il naît de l’expérience personnelle de l’interaction avec celui-ci dans le respect et la coexistence harmonieuse, ce qui montre l’actualité des postulats éthiques de Delibes, qui dépasse la critique de Latour. Il s’agit donc d’une connaissance non académique du milieu naturel qui dialogue avec le milieu social dans lequel il est engendré, comme le prescrit Latour.
Précisément, dans un passage de son raisonnement, le penseur français affirme que « nous sommes encore à l’enfance du monde » (Latour, 1991, p. 116). D’une certaine manière, Delibes l’avait pressenti en faisant des enfants les dépositaires d’une tradition de la connaissance naturelle émanant de l’expérience des gens qui habitent ce monde. Et tous ces personnages, Nini, Gabriel ou même Azarías dans Los santos inocentes, sont des esprits ingénus qui sillonnent l’imaginaire de Delibes mais qui se convertissent en intermédiaires entre la nature et la société, ce qui permet de sauver les récoltes et extraire un meilleur rendement de l’environnement sans l’abîmer. Dans un passage de son raisonnement, Latour affirme : « nous n’avons jamais été modernes […]. La modernité n’a jamais commencé. Il n’y a jamais eu de monde moderne » (1991, p. 68-69). Qu’un écrivain comme Delibes postule, de manière intuitive, des idées similaires dans ses romans ruraux permet d’englober la pensée de Latour dans un courant plus large, venant de plus loin, de toutes les personnes qui se sont révélées sensibles à l’environnement et à sa relation harmonieuse avec la société, un courant dont le penseur français est le fer de lance, la personne capable d’élaborer et de verbaliser l’épistémologie de cette perspective. Ce courant est très présent dans l’œuvre de Delibes, tant dans sa représentation de la nature que dans la connaissance qu’il nous en donne. Ainsi, Delibes serait, à ce titre également, le marqueur d’une tendance spécifique de la littérature espagnole.