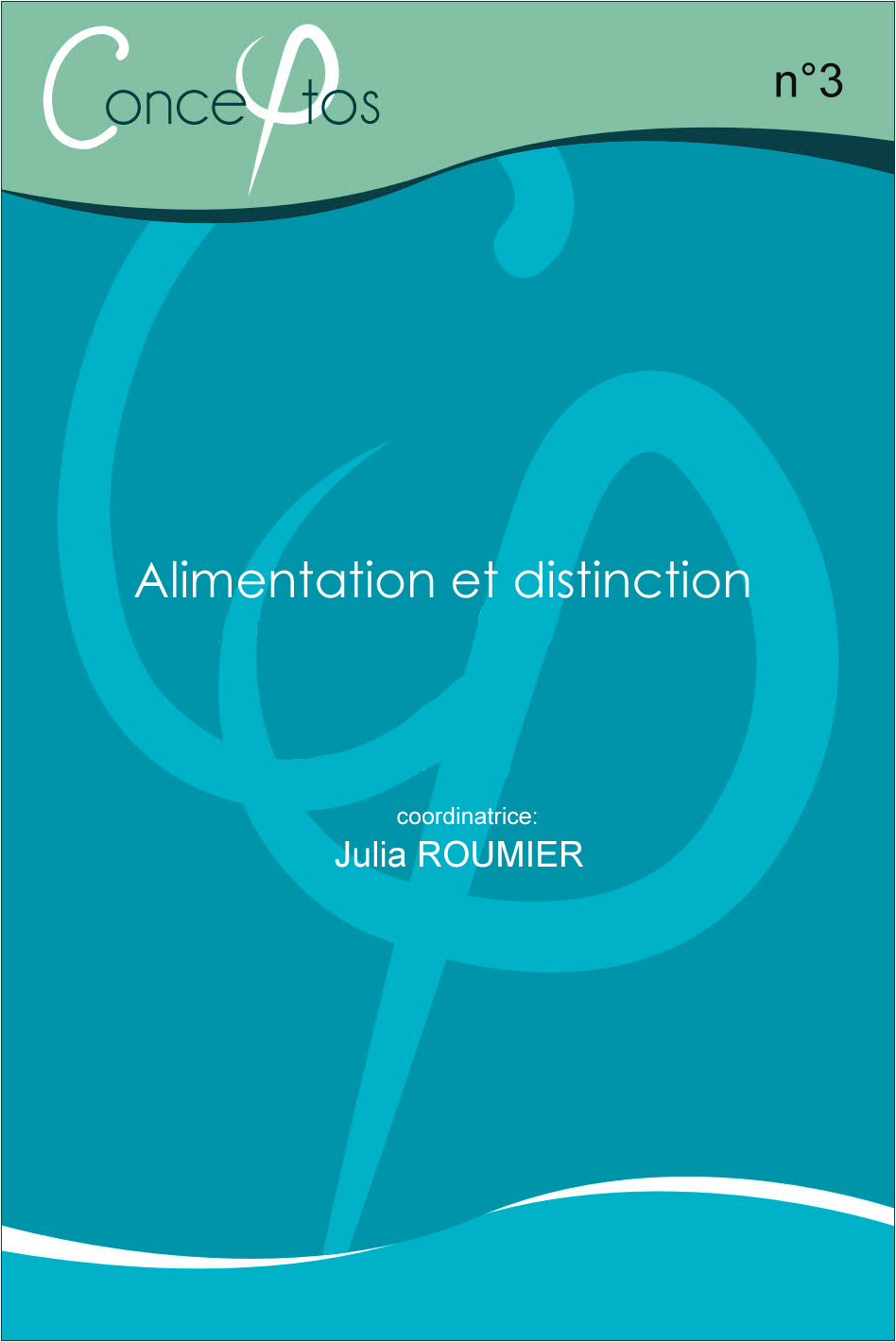Le rubb : les Almohades ou les promoteurs du merveilleux
Les califes almohades ont imposé leur hégémonie sur la quasi-totalité de l’Occident musulman des années 1150 aux années 1230. Ces souverains berbères étaient les tenant d’un pouvoir qui leur était âprement contesté. Le don de nourriture et de boisson leur permettait de s’assurer le soutien de partisans qui dépendaient pour leur survie des bonnes grâces du souverain. En tant que maître des stocks, le calife assurait également aux Almohades et à ceux qui leur étaient associés une vie de luxe, du moins il leur était offert la possibilité de se prémunir des crises de subsistance, si récurrentes au Maghreb. Les cuisiniers des membres de l’élite au pouvoir surent réinterpréter le legs abbasside et même le dépasser. Au-delà de cette élévation et de cette diversification des plats apprêtés, le souverain, loin du fonctionnement relativement égalitariste des communautés villageoises, apparaissait comme un roi nourricier absent de ce moment de convivialité par excellence qu’était la prise du repas en commun. La prise de distance heurta manifestement la sensibilité des sujets maghrébins et alimenta l’opposition de la plupart des soufis.
Ce faisant, les califes almohades devaient apparaître comme les promoteurs du merveilleux, à travers leur cuisine, au risque de déroger de leur rang, mais en même temps, ils ne pouvaient pas trop s’exposer, et ils voulurent entretenir l’image de monarque tempérant, respectueux de la légalité islamique. En fin de compte, c’était là le critère qui primait quand les chroniqueurs esquissaient le portrait d’un souverain jugé vertueux. Les califes almohades devaient ainsi tenir la gageure d’être de munificents mécènes tout en étant les garants d’un ordre basé sur une stricte interprétation de la loi religieuse. Nulle part ailleurs, on ne retrouve ce paradoxe aussi bien mis en lumière que dans le cas du ar-rubb qui apparaît mainte fois dans les sources relatives aux Almohades sans que, toutefois, ne soit dissipé le flou terminologique que recouvre cette appellation.
Rubb, un terme flou
On traduit généralement ce terme arabe en français par « jus de raisin cuit », qui a donné dans cette même langue le mot « rob », par le truchement du castillan arrope. Voici, in extenso, la définition qu’en donne François Clément : « Les grappes destinées au pressurage étaient versées dans le sihrîj ou cuveau de foulage. On recueillait ainsi un premier moût (mustâr). Ce liquide, réduit par la chaleur, donnait le rob1. »
Tel était au Maroc, au moins jusqu’au Protectorat, le nom usuel servant à désigner en arabe dialectal le vin2, sous toutes ses formes. Or à l’époque almohade, l’arabe n’était pas l’idiome usuel de la majorité de la population mais l’une des langues berbères. Il existe donc un décalage important entre la langue de l’écrit issue d’une matrice andalouse et le Maghreb où l’écrit restait peu diffusé. De ce fait, les auteurs ne sont que peu intéressés à des réalités qui relevaient de réalités anthropologiques qui leur demeuraient étrangères ou qui les indifféreraient. Il semblerait pourtant que la consommation de vin était courante au Maghreb. De toutes les sources dont nous disposons, le géographe al-Idrīsī (m. 1166) reste sans conteste celui qui donna le plus d’indications sur la consommation d’une boisson issue du raisin par les populations du Maġrib al-aqṣā3, de même que sur sa dénomination vernaculaire :
Ils [les habitants du Sūs] ont une boisson appelée Anzīr. C’est un breuvage sucré qui donne une grande ivresse, plus forte que celle du vin, tellement il est consistant et concentré. Pour le préparer, ils prennent du jus de raisin sucré qu’ils font bouillir au feu jusqu’à qu’il s’en évapore un tiers. Alors ils le retirent du feu et le laissent refroidir avant de le boire. Ils ne peuvent le boire que coupé d’eau à quantité égale. Les gens du Sūs al-aqṣā pensent que sa consommation est licite, tant qu’elle n’entraine pas d’ivresse4
Cet extrait est remarquable, car il donne la terminologie dans sa dénomination originelle, anzīr. Ce terme est formé à partir de la même racine servant, en berbère, à désigner la pluie (anzar). Il renvoie donc probablement à l’idée d’aspersion. Loin de rester un cas isolé, al-Idrīsī mentionne, à plusieurs reprises, des termes berbères pour désigner des mets ou des condiments spécifiques du sud du Maġrib al-aqṣā (asalū, anzīr, argān, yardan n’tazwaw, etc.). Ces précisions, à l’exception de l’huile d’arganier, dans le contexte de la littérature géographique connexe à la description du Maġrib al-aqṣā, sont exceptionnelles. La consommation de boissons enivrantes était – semble-t-il – tout à fait courante, les sociétés de cette région étant régies par des normes très éloignées de celles en vigueur dans le reste du monde musulman, à commencer par al-Andalus. Cet éloignement par rapport aux normes en vigueur dans le monde arabo-musulman est confirmé par des consultations juridiques du ve/xie siècle qui indiquent la conduite à tenir si un voyageur est amené à se rendre dans le Pays des Maṣmūda, car, disent les jurisconsultes, le droit musulman (fiqh) est inconnu dans ces contrées5. Nombre d’indications issues des corpus hagiographiques et des dictionnaires biographiques6 rédigés au viie/xiiie siècle amènent à penser que le fiqh était un produit d’importation récente, en voie d’enracinement au Maġrib al-aqṣā.
Ce processus était une résultante de l’unité territoriale entre al-Andalus et le Maghreb initiée par les Almoravides et la venue de réfugiés lettrés en provenance de l’Ifrīqiya, suite aux désordres provoqués par l’irruption des tribus bédouines Banū Hilāl dans les années 1050. Paradoxalement, le Nafīs, vallée du Haut-Atlas occidental était simultanément réputée pour ses cépages7 et pour avoir été un centre actif dans le processus de conversion à l’islam des populations du sud du Maġrib al-aqṣā8. On peut supposer que dans un premier temps la cohabitation entre un cépage renommé et la mosquée attribuée au conquérant arabe et saint martyre, ʿUqba b. Nāfīʿ (m. 683), ne posait pas problème.
Seule une autre source mentionne ce breuvage sous sa dénomination originelle, anzīr dans un ouvrage littéraire de la fin de la période almoravide. Il s’agit d’al-Maqamāt al-luzūmiyya d’un auteur originaire des environs de Saragosse, Ibn al-Aštarkūnī (m. 1143). Au moment où enfin son personnage ingénu met pied à terre en al-Andalus à Algésiras, il découvre, à sa grande stupéfaction, des agapes d’hommes voilés s’enivrant avec une boisson nommée anzīr. À l’instar de la version arabe originelle, le traducteur espagnol a laissé en suspens ce nom9, à la différence du traducteur anglais de l’ouvrage, James Monroe, qui l’a rapproché de celui donné par al-Idrīsī10.
Dans cette maqāma, le narrateur est confronté à des hommes étranges s’exprimant dans un langage absolument incompréhensible ; sans aucun doute, l’auteur fait référence aux Almoravides. La dénomination originelle nous est donnée dans l’objectif de souligner le caractère étrange de ces barbares et de leur langage qui est assimilé à un galimatias informe. La consonance même du mot, du point de vue adopté par l’auteur, celui d’une oreille orientale ainsi que la présence de la consonne alvéolaire sonore et emphatique [z], phonème propre au berbère, vient rappeler leur statut de non arabe. De fait, la structure narrative du récit donne à voir le monde à partir du regard d’as-Sā’ib b. Tammām, un poète oriental chevronné qui énonce les maqāmāt. Ce procédé vise à mettre en lumière l’écart séparant le personnage as-Sā’ib b. Tammām des maîtres d’al-Andalus qui sont, à ce moment-là, des Berbères. Néanmoins, la connaissance de la dénomination berbère par Ibn al-Aštarkūnī, lui-même originaire des environs de Saragosse, est en soi remarquable, puisqu’elle met en lumière ce mouvement complexe d’acculturation mutuelle qui était alors à l’œuvre en Occident musulman11 ; ce mouvement se caractérisant, entre autres, par une connaissance accrue du berbère par les Andalous.
Cette maqāma, en plus de sa visée littéraire et politique12, n’en demeure pas moins d’un intérêt exceptionnel car elle évoque des agapes d’hommes s’assemblant pour consommer des boissons et un mets identifié comme étant un mélange de panade et de couscous. Elle témoigne de l’importance du banquet et du rôle qui lui était conféré : en effet, al-Andalus restant une terre étrangère pour les Almoravides, ils se devaient de trouver un moyen leur permettant de conserver leur esprit de corps (‘aṣabiyya), voire de l’affermir. La dissolution ou l’amollissement de cette ‘aṣabiyya représentait pour eux un danger mortel, ainsi qu’un signe indubitable de déclin13. Or la consommation d’un mets (du ṯarīd mélangé avec du couscous) et d’une boisson (anzīr) distinctement identifiés comme originaires du sud du Détroit de Gibraltar pouvait jouer ce rôle de marqueur d’une identité, assimilée à celle des gouvernants. Leur consommation pouvait donc contribuer à affermir les liens entre Berbères membres de l’élite au pouvoir installés en al-Andalus.
Du moment où les Almoravides exerçaient sur le plan de la violence légitime un monopole de fait et qu’ils se montraient suffisamment solidaires, en arborant le même vêtement (liṯām) semblable à celui des Touaregs contemporains et assez unis pour s’assembler devant les mêmes plats et boissons les distinguant des gouvernés, ils pouvaient, dès lors, se permettre d’inviter des non-berbères à rejoindre cette assemblée. Ils souhaitaient ainsi les inclure dans leur dispositif, alors que du côté andalou, se mettre à table revenait à rendre hommage à ces étrangers en reconnaissant leur position de gouvernants. À l’inverse, les dirigeants berbères escomptaient distinguer un sujet en lui conférant l’insigne honneur de s’attabler avec ses maîtres. Cet empressement à convier un lettré arabe est à mettre en relation avec l’impérieux besoin, jamais démenti, des autorités almoravides et almohades de trouver des collaborateurs locaux lettrés sur qui s’appuyer. Faisant preuve d’habileté, Ibn al-Aštarkūnī retourne la situation en plaçant les « Voilés » du côté du grotesque et en taisant la dimension toute politique de ce genre d’assemblées organisées par les membres de l’élite au pouvoir.
Nous ne trouvons plus, par la suite, trace de l’anzīr ; cependant, il est probable que les Maghrébins qui commencèrent à rédiger des ouvrages en arabe, à partir du xiie siècle, traduisirent anzīr par rubb. Tel est sans doute le cas du petit-fils du cheikh Abū Muḥammad Ṣāliḥ (m. 1230), le saint tutélaire de Safi, qui déconseillait fortement la consommation du rubb. À cet effet, il développa une argumentation complexe, n’hésitant pas à faire état des rêves de son aïeul14 conversant en songe de ce grave sujet avec le Prophète de l’islam en personne. Cet exemple, associé au développement consacré à cette thématique, indique que l’auteur accorde la plus extrême attention à ce qui représente un premier pas en direction du péché et de la perdition. Or sa vie durant, Abū Muḥammad Ṣāliḥ, qui était d’origine berbère15, se consacra à une confirmation de la foi de la société dans laquelle il vivait, notamment en organisant tout un réseau facilitant pour les Maghrébins l’accès aux lieux saints de Médine et La Mecque. C’est en vertu de cette logique qu’il faut comprendre sa condamnation du rubb, qui était pourtant un produit de consommation courante perçu, dorénavant, comme peu conforme avec un dessein d’islamiser les mœurs des Maghrébins.
Toutefois, cette traduction constitue une distorsion faite au sens berbère ; si sans nul doute anzīr est un alcool, la dénomination ar-rubb laisse planer une incertitude sur la nature du breuvage. C’est ainsi que dans le livre de recette du début du XIIIe siècle, le Kitāb aṭ-ṭabīḫ, il est fait mention de trois recettes de rubb16 : une au coing, une autre à la grenade et une dernière à la figue, toutes ont en commun d’être accommodées à partir de jus tiré de ces fruits, ensuite porté à ébullition. En revanche, à aucun moment il n’est précisé que ce procédé entraîne une fermentation et constitue au final une boisson alcoolisée. L’indétermination sur la nature de la boisson est plutôt singulière, si l’on prend en compte le fait qu’une recette de coq au vin figure dans le livre de recettes précité17. Cependant, la recette du rubb de coing rejoint, quasi à la lettre, la définition donnée par le Littré du rob en ne précisant pas s’il s’agit d’un alcool : « Suc épuré d’un fruit cuit, épaissi jusqu’à consistance de miel. »
Le rubb : un nectar réservé à une élite
En plus de la volonté de rendre un mot berbère par un mot arabe, il se pourrait que ce flou sémantique soit à attribuer à un raidissement des autorités almohades face à la consommation de boissons alcoolisées résultant d’une volonté claire de suivre les préceptes rigoristes du fondateur du mouvement almohade, Ibn Tūmart (m. 1128), qui en la matière, comptait bien infléchir la donne dans le sens d’un rapprochement avec les canons en vigueur dans le reste du monde arabo-musulman18. Dissimuler cette situation peu avouable pour qui se réclamait de cet intransigeant censeur des mœurs qu’était Ibn Tūmart passait par le fait de jouer sur l’ambigüité du mot rubb. C’est cette ambigüité qui ne permet pas, pour cette époque, de rendre de façon satisfaisante rubb par le français rob. On peut également ajouter que les deux seuls auteurs faisant mention du anzīr vécurent la totalité de leur vie, ou presque, à un moment où les Almoravides dominaient l’Occident musulman. En conséquence, ils ne firent pas usage de terminologies ayant cours dans les cercles gravitant autour des Almohades, le temps et le lieu où ils rédigèrent leurs ouvrages expliquant leur particularité sur ce point précis. A contrario, c’est bien le rubb qui était la terminologie officielle faisant autorité chez les Almohades. On peut par exemple trouver, dans les missives rédigées par la chancellerie de cette même dynastie, un ordre édicté par le propre ‘Abd al-Mu’min : « J’ordonne de vérifier et de trier les robs [rubūb], d’opérer des descentes chez ceux qui vendent, qui s’adonnent à la boisson, ou qui en utilisent. On répandra le moût par terre et on le fera disparaître19. »
Ce type d’injonction permettait aux califes mu’minides de recentrer leur pouvoir en le situant dans le droit fil de la geste d’Ibn Tūmart, lequel loin de s’être contenté d’exhorter les musulmans à adhérer aux préceptes coraniques qui enjoignaient à tous « la prescription du bien et la proscription du mal (al-amr bi-l-ma‘rūf wa n-nahy ‘an al-munkar) », passa à l’acte en détruisant les récipients vinaires20.
Par la suite, l’acclimatation d’une logique royale et dynastique amena les Mu’minides à s’écarter de la voie tracée par le fondateur du mouvement almohade. Dans la chronique qu’il conçut comme un instrument au service de la propagande politique almohade21, le thuriféraire du régime prend bien soin de préciser que lors des réceptions solennelles organisées par les Almohades, il était servi des boissons en conformité avec la loi musulmane (mašrūbāt ḥalāl)22. Ce souci du détail est tout à fait singulier. Car si cet auteur se donne la peine de préciser la nature exacte du breuvage, cela laisse supposer qu’il n’en était pas toujours de même.
À l’inverse, tout semble indiquer que la consommation de breuvages alcoolisés était, pour les Almohades de haut rang, tout à fait courante. Elle pouvait servir le cas échéant à confondre tel ou tel notable que l’on cherchait ainsi à compromettre. L’exemple le plus représentatif de ce genre de pratiques reste le cas du propre fils de ‘Abd al-Mu’min (r. 1132-1163), héritier présomptif du trône, qui, alors qu’il était accompagné du vizir ‘Abd as-Salām al-Gūmī, fut prévenu juste à temps que le calife ayant pris connaissance du fait qu’ils s’adonnaient à la boisson comptait venir en personne le vérifier. Si les deux personnages les plus éminents de l’État après le calife en furent quittes pour un coup de semonce, cet incident n’en marque pas moins le début du déclin de leur parti et le triomphe prochain d’un autre clan, celui d’Abū Ya‘qūb et d’Abū Ḥafṣ, eux-mêmes soutenus par une majorité de cheikhs almohades.
De ces indications, on constate une normalisation des pratiques du pouvoir par rapport aux normes orientales ; la consommation d’alcool devenant l’apanage des puissants et le signe manifeste de leur pouvoir. En agissant ainsi, les Almohades se conformèrent au modèle en place dans le monde arabo-musulman depuis au-moins les Omeyyades de Syrie23, c’est-à-dire depuis le temps où s’était imposée une logique royale et dynastique, à la nuance près que jamais il n’est fait allusion à des califes almohades en train de boire. Cela aurait constitué une transgression et une déviance par rapport à leur base, celle des enseignements d’Ibn Tūmart, les privant de cette instance de légitimation porteuse de force et cohésion. La consommation d’alcool était désormais à apprécier en fonction de la norme qui s’imposa alors. L’interdit valait aussi pour l’élite au pouvoir, mise en demeure de le respecter ; elle ne pouvait se soustraire au verdict prononcé par ce censeur des mœurs en chef qu’était alors le calife. En effet, pour être déclaré en état d’ivresse, un Almohade devait être confondu par le souverain en personne, par exemple les cheikhs almohades sommèrent ʿAbd al-Mu’min de venir constater l’ébriété de son fils Abū ʿAbd Allāh Muḥammad et du vizir ʿAbd as-Salām al-Gūmī.
Pour donner la mesure de l’équivoque entretenue autour du rubb, il faut comprendre que plus ce pouvoir était affaibli plus il éprouvait le besoin de se mettre en scène et, de la sorte, faire sortir le calife de son huis-clos palatial. C’est que l’on trouve tout particulièrement mis en évidence par le thuriféraire de la dynastie almohade, Ibn Ṣāhib as-Salāt (m. après 1190). En effet, cet auteur originaire d’Evora, en tant que témoin oculaire des scènes qu’il rapporte, fit état de plusieurs grandes manifestations où tout le faste califal était déployé afin de consolider le pouvoir du souverain. C’est, entre autres, le cas des événements qui firent suite à la maladie invalidante du calife Abū Yaʿqūb (r. 1163-1184) qui avait mis à mal tout l’édifice. Le système reposait, en effet, sur le charisme et le volontarisme politico-guerrier du calife et sa propension à triompher de ses ennemis. Suite à la guérison du calife en 1171, l’objectif était d’organiser une armée capable de repousser les chrétiens au Levant, mais aussi de faire rentrer dans le rang des membres de la famille royale, qui bien souvent n’étaient pas disposés à se soumettre et représentaient un danger potentiel pour le calife. On peut trouver là une illustration du caractère duel de la guerre24, en externe contre les chrétiens et en interne contre les autres princes almohades.
La venue en 1171 à Marrakech des deux frères d’Abū Ya‘qūb, respectivement gouverneurs de Tunis et de Tlemcen, est symptomatique car elle vise en même temps à renforcer le corps expéditionnaire en partance pour al-Andalus et témoigne de la soumission de ces deux Mu’minides au calife. De surcroît, en raison de la minutie avec laquelle sont dépeints les événements, ce récit reste inégalé ; la précision de la description résulte du fait qu’Ibn Ṣāḥib aṣ-Ṣalāt les rapporte en tant que témoin oculaire, alors que les autres auteurs n’en rendent compte que post festum. De surcroît, le parti pris de l’auteur, manifestement pro almohade, le conduisit à souligner la propension du calife à créer le merveilleux à travers une rivière de rubb qui représente une réminiscence du paradis dans sa conception coranique. La capacité de réalisation du calife, véritable promoteur du merveilleux, était ainsi magnifiée alors même qu’Abū Yaʿqūb entreprenait, au sortir de sa maladie, une entreprise risquée tant de par les difficultés de l’expédition à venir que de l’adhésion problématique des princes.
Le Vendredi du 22 du second Rabī‘ (2 Janvier 1171) après la prière du Vendredi, le Prince des croyants sortit dans le Jardin d’apparat (al-Buḥayra) des environs de Marrakech. Il donna un banquet aux Arabes, ainsi qu’aux membres de la délégation et à d’autres pendant quinze jours. Quotidiennement c’étaient plus de trois mille hommes qui pénétraient dans al-Buḥayra. On y faisait, comme il était d’usage, une rivière (nahr) de jus de raisin cuit / vin cuit (rubb) mélangé avec de l’eau. Quand un groupe avait achevé de manger et se levait, il se rendait là où se tenait le calife. Puis il le saluait et invoquait Dieu en sa faveur. Enfin, ils se dirigeaient vers la rivière de jus de raisin cuit pour boire et se divertir. Les gens (an-nās) virent dans ces banquets ce qu’ils n’avaient encore jamais vu comme bienfaits (al-in‘ām) et sollicitude (al-intihām). La célébration se déroula pendant le nombre de jours précité25.
Par la suite, le pouvoir almohade chercha à pérenniser ce dispositif en lui donnant une traduction dans la pierre. À l’occasion de la construction d’un nouveau complexe palatial dans les années 1180-90, la porte d’entrée principale de cet ensemble prit le nom de Bāb ar-Rubb.
Bāb ar-Rubb : La Porte du complexe palatial de Marrakech
Au niveau de la représentation, la propension à constituer un paradis terrestre était de façon exclusive et absolue le seul contexte où le vin avait droit de citer. Ainsi il rejoignait une partie du programme almohade. En effet depuis le début, ce mouvement se caractérisait par une forte dimension eschatologique26, dont le propos était d’annoncer le jour du jugement dernier (yawm al-qiyāma) et l’avènement du Royaume de Dieu sur terre. Cette tension entre la nécessaire censure des mœurs et les velléités d’imposer hic et nunc un paradis terrestre, ou tout du moins une ébauche de paradis, explique pourquoi jusqu’à aujourd’hui, il est difficile de déterminer la nature exacte du ruisseau de rubb mentionné par Ibn Ṣāḥib aṣ-Ṣalāt, même si les raisons invoquées inclinent à penser qu’il s’agissait de vin. Toujours dans le cadre de cette équivoque, savamment entretenue, la porte principale qui ouvrait sur l’ensemble palatial édifié dans les années 580/118027 portait le nom de Bāb ar-Rubb. Dans une notice biographique consacrée à celui qui fut choisi par le calife al-Manṣūr (r. 1184-99) pour devenir le premier imām de la mosquée adjacente à la nouvelle résidence califale, il est clairement exposé qu’elle était la porte de ce complexe connu aujourd’hui sous le nom d’al-Qaṣba : « Ils [l’imām et un dignitaire almohade] entrèrent par la porte du palais (Bāb al-Qaṣr), bien connue sous le nom de Bāb ar-Rubb28. »
Les précisions données par Ibn ʿAbd al-Malik et que l’on retrouve également chez Ibn Abī Zar‘ indiquent que telle était dès l’origine sa dénomination et infirment l’hypothèse avancée par Gaston Deverdun d’une origine mérinide29. Pour le fonctionnaire mamelouk, al-‘Umarī, son nom proviendrait des taxes prélevées par les autorités almohades à cette porte sur ar-rubb, explication qui sous-tend qu’il s’agissait d’un produit de consommation courante : « Bāb ar-Rubb est la porte par laquelle entre ce produit ; car il serait possible qu’il entrât en ville en fraude30. » En effet, elle faisait face au Haut-Atlas occidental et tout particulièrement à la vallée du Nafīs, dont les cépages jouissaient d’une grande renommée31. Cependant, il faudrait s’interroger sur la dénomination de cette porte en vertu des informations données par Ibn Ṣāḥib aṣ-Ṣalāt sur la rivière de rubb qui fut creusée à l’occasion des préparatifs de l’expédition de 1171. Cette rivière était localisée par le chroniqueur à proximité immédiate du lieu où allait être construite cette nouvelle porte. Dans un espace qui était situé en face des deux principaux jardins monumentaux de facture almohade et sur le trajet emprunté par le souverain, sa cour et son armée, quand ils sortaient du lieu d’invisibilité que constituait, pour les sujets, le palais.
En plus du rôle qui lui était imparti de contrôler les flux de population et de marchandises, il se pourrait que la porte résonnât aux oreilles du commun comme un avant-goût du jardin céleste. De surcroît, si l’on met en résonance les noms des différentes portes, les unes avec les autres, on s’aperçoit que tous, à une exception près, étaient des noms relevant de la volonté d’établir une hiérarchisation de l’espace (la Porte dévolue au commun : Bāb al-Kaḥl, la Porte réservée aux Mu’minides : Bāb as-Sādāt, la porte où était administrée la peine capitale : à Bāb aš-Šarī‘a, etc.). À y regarder de plus près, le point nodal de cette structuration était constitué par les deux portes principales ouvrant sur la demeure du calife, or toutes les deux portaient des noms renvoyant clairement à l’idée de jardin, Bāb ar-Riyāḍ32 et Bāb al-Bustān33. À ce propos, il n’est pas impossible que Bāb ar-Rubb leur ait fait écho en tant que premier sas d’accès au saint des saints, la demeure du calife. Cette porte aurait par conséquent procédé du dessein de matérialiser dans l’espace un idéal visant à instaurer un ordre, le seul ordre conforme à la volonté divine à l’exclusion de tous les autres. Ainsi dans la description du complexe aulique almohade transmise par al-‘Umarī, Bāb ar-Rubb était l’élément premier du Tamrrākušt34 signifiant en berbère le Pays de Dieu.
Conclusion
On peut imaginer que l’institutionnalisation du terme de rubb contribua à pérenniser l’emploi de ce vocable ambigu et, au-delà, à éradiquer les anciens usages relatifs à la consommation d’alcool ou à la restreindre. Ainsi, la consommation du anzīr / rubb relevait sans doute originellement de pratiques communautaires destinées à affermir l’esprit de corps des différents clans lignagers. Suite au volontarisme almohade en la matière, la disparition de cette pratique de la sphère publique, entraina le repli de la consommation d’alcool dans le huis-clos des murs des maisons, des palais et des jardins à l’abri des regards indiscrets. Si tel a été le cas, les Almohades auraient réussi à parachever l’action réformatrice entreprise par Ibn Tūmart. La disparition des pratiques liées à l’anzīr provoqua aussi la disparition de ce terme qui n’est plus attesté après le xiie siècle. En outre, l’appellation actuelle qui sert à désigner le vin en tachelḥit, littéralement « eau de raisin » (aman n’waḍil), est tout à fait neutre et ne renvoie à aucune une pratique communautaire ou politique.
Les Almohades œuvrèrent dans le sens d’une islamisation en profondeur des sociétés du Maghreb. Ils eurent un impact réel sur la trajectoire historique de ces contrées en y acclimatant un modèle de gouvernement qui avait vu le jour en Irak sous les Abbassides avant d’être importé, en al-Andalus, sous les Omeyyades. Entre prohibition du vin et nécessité d’affirmer son rang en se distinguant de ses sujets, les califes almohades firent savoir qu’ils avaient la propension de consommer du rubb soit un terme suffisamment ambigu. Plus encore, ils étaient en mesure de faire couler des rivières de rubb et de rappeler qu’ils pouvaient faire entrevoir à leurs affidés un éden terrestre que seuls ils étaient à même de réaliser. Somme toute, cette propension à se présenter comme les promoteurs du merveilleux constituait la clef de voûte de leur cérémonial et au-delà de leur légitimité à régner. Aujourd’hui encore, le nom de la porte menant à l’ancien complexe palatial de Marrakech, Bāb ar-Rubb, porte la trace de cette politique ambiguë qui tout en se réclamant d’un islam rigoriste se présenta comme capable de faire advenir le merveilleux.