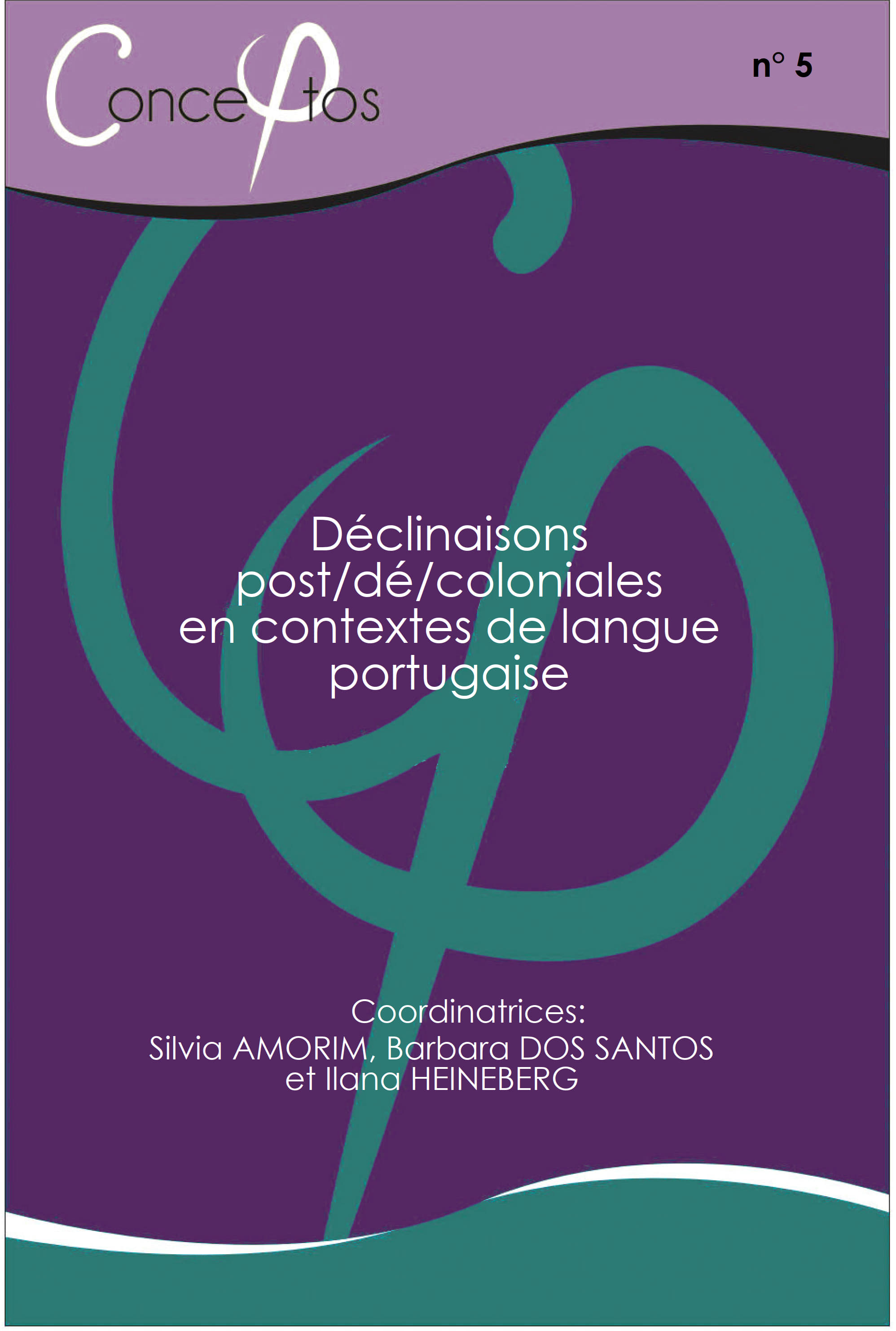L’entre-lieu du discours latino-américain1
Note préliminaire2
L’auteur dit adieu à son manuscrit lorsqu’il le voit transformé en livre. Il le met entre les mains de tiers, ses lecteurs, qui l’activent et en deviennent responsables. Ou pas. Lorsque les lecteurs déposent l’imprimé dans l’enfer d’une bibliothèque ou dans les limbes d’un bouquiniste, ils disent également adieu au manuscrit.
Quarante ans après la publication de Uma literatura nos trópicos [Une littérature dans les tropiques], cinq de ses lecteurs le remettent en circulation. Étonné, je les nomme en les remerciant : Élide Rugai Bastos, Eneida Leal Cunha, André Botelho, Frederico Coelho et Schneider Carpeggiani. C’est comme si le bras amputé d’un corps redevenait organisme vivant par une manipulation diabolique de Gutenberg, ou de Picasso. Je me dois donc d’adresser ce livre aux nouvelles générations. J’espère que cela aura encore du sens !
Le corps de l’auteur se souvient encore de l’année 1978, lorsqu’il a subi dans sa chair le bistouri de la maison d’édition Perspectiva. Pendant la chirurgie, cinq essais écrits à l’étranger et l’étude d’un poème3 se sont égarés de l’ensemble et se seraient perdus ici et là, dans des pages de revues universitaires. Je ramène les enfants prodigues au manuscrit original. Comment les relier aux anciens ? Je ne sais pas. J’essaie de les racommoder discrètement en les (re)présentant au lecteur sous la forme d’un supplément4, un hommage légitime au sang-froid du nouvel et intrépide label de la maison d’édition de Pernambouc.
L’essayiste scrutait alors l’émergence de la littérature africaine en territoire français et expérimentait d’autres approches du texte littéraire. Il osait envahir le territoire colonial presque vierge pour – à l’aide de la production textuelle correspondante, dont le premier exemple constitue La Lettre, de Pêro Vaz de Caminha – présenter la littérature brésilienne non comme une discipline illuministe, mais plutôt comme un discours culturel – celui de l’entre-lieu – en quête de son début dans la Terre de Sainte-Croix. La langue portugaise, le christianisme et l’homme européen se déployaient sous les tropiques indigènes.
Je souhaite mettre en avant seulement un trait stylistique qui passa inaperçu lors de la réception brésilienne. Sans le soutien d’une lecture canonique, je voulus inventer cette nouvelle histoire. Je n’étais pas guide, puisque le chemin n’était pas encore ouvert. J’étais plutôt un pyguara, le seigneur du chemin, pour reprendre José de Alencar (voir l’essai « Alegoria e palavra em Iracema » dans Une littérature dans les tropiques). Dans de telles circonstances, l’exercice de l’essai atteint le geste intempestif propre à l’aphorisme – dans le sentier ouvert dans la forêt par l’indien5 –, un héritage de Friedrich Nietzsche et de notre Oswald de Andrade.
Le mot « aphorisme » doit être compris dans le contexte du paragraphe et du livre. Il peut aussi prendre un nouvel élan dans des contextes proches ou contradictoires, voire dans des contextes qui sont évoqués par les lecteurs et par des ouvrages postérieurs. Je mets en avant un seul aphorisme qui, par son ampleur, me terrorise encore. Permettez-moi de le citer : la contribution majeure de l’Amérique latine à la culture occidentale vient de la destruction systématique des concepts d’unité et de pureté. Vive la différence !
7 janvier 2019
Para Eugenio e Sally6
La tortue jabouti7 qui n’était protégée que par une carapace blanche et molle se fit mordre par le jaguar lorsqu’il l’attaqua. La morsure fut si profonde que le jaguar resta accroché au jabouti et finit par mourir. Le jabouti fit alors du crâne du jaguar son bouclier.
(Antonio Callado, Quarup8 [Mon pays en croix])
Tout d’abord, des tâches négatives. Il faut s’affranchir de tout un jeu de notions qui sont liées au postulat de continuité. […] Telle la notion d’influence, qui donne un support – plus magique que substantiel – aux faits de transmission et de communication.
(Michel Foucault, Archéologie du savoir)
Montaigne ouvre le chapitre XXXI des Essais, celui consacré aux cannibales du Nouveau Monde, avec une référence précise à l’histoire grecque. Nous utiliserons cette référence pour nous inscrire dans les discussions à propos du lieu occupé aujourd’hui par le discours littéraire latino-américain dans sa confrontation avec le discours littéraire européen. Montaigne écrit :
Quand le roi Pyrrhus passa en Italie, après qu’il eut reconnu l’ordonnance de l’armée que les Romains lui envoyaient au-devant : « Je ne sais, dit-il, quels barbares sont ceux-ci (car les Grecs appelaient ainsi toutes les nations étrangères), mais la disposition de cette armée que je vois n’est aucunement barbare. » (Montaigne, 2002, p. 156)9
La citation historique chez Montaigne reste sans doute métaphorique car elle annonce l’organisation interne du chapitre sur les anthropophages d’Amérique du Sud, plus précisément du Brésil – et la métaphore chez Montaigne garde dans son essence la marque de l’éternel conflit entre le civilisé et le barbare, entre le colonialiste et le colonisé, entre la Grèce et Rome, entre Rome et ses provinces, entre l’Europe et le Nouveau Monde, etc. Par ailleurs, les mots du roi Pyrrhus, prononcés avec une sagesse pragmatique, ne cachent pas la surprise et l’émerveillement devant une découverte extraordinaire : les barbares ne se comportent pas comme tels, conclut-il.
Au moment du combat, instant décisif et révélateur où les forces contraires et ennemies doivent s’aligner l’une face à l’autre, se trouvant ainsi brutalement arrachées à leurs conditions de déséquilibre économique et corporifiées dans l’instant présent et dans la guerre, le roi Pyrrhus découvre que les Grecs sous-estimaient l’art militaire des étrangers, des barbares, des Romains. Le déséquilibre instauré par les soldats grecs avant le conflit armé, raison de fierté et de prétention, est avant tout imposé par le décalage économique qui gouverne les relations entre les deux nations. Cependant, lorsqu’on abandonne le domaine précis du colonialisme économique, on comprend qu’il est souvent nécessaire d’inverser les valeurs qui définissent les groupes opposés et d’interroger le concept même de supériorité.
Selon la citation des Essais, là où on s’attendait à une armée ennemie conçue à partir des préjugés que les Grecs avaient à propos des Romains, on retrouve, au contraire, une armée bien organisée et qui n’avait rien à envier à celles des peuples civilisés. Nous nous débarrassons ainsi d’un raisonnement en termes de quantité et de colonialisme : l’admiration du roi Pyrrhus inaugure un engagement inébranlable avec la qualité. Malgré les différences économiques et sociales, les deux armées sont équilibrées sur le champ de bataille. Même si les rapports de force n’étaient pas équilibrés, il serait pertinent de rappeler les circonstances insolites de la mort du monarque grec évoqué par Montaigne. L’accident inattendu et mortel fait guise d’alerte par son actualité, une alerte aux puissantes nations militaires contemporaines : Pyrrhus, roi d’Ephèse, « fut assassiné lors de la prise d’Argos par une vieille dame qui lui a jeté une tuile sur la tête depuis le toit » – comme délicieusement nous l’informe le Petit Larousse.
Nous allons évoquer l’espace où l’admiration du roi Pyrrhus s’articule et un processus probable d’inversion de valeurs.
1.
Mais avant, il est nécessaire d’établir quelques distinctions, de manière à limiter et à préciser notre sujet. Analysons d’abord, pour des raisons didactiques, les relations entre deux civilisations qui sont complètement étrangères l’une à l’autre et dont les premières rencontres ont lieu sous le signe de l’incompréhension mutuelle. Depuis le XXe siècle, les ethnologues10, désireux de démystifier le discours d’approbation des historiens, s’accordent sur le fait que la victoire du blanc dans le Nouveau Monde s’explique moins par des raisons culturelles que par l’emploi arbitraire de la violence et par le fait d’imposer brutalement une idéologie, comme l’atteste la récurrence des mots « esclave » et « animal » dans les écrits des Portugais et des Espagnols. Ces expressions, appliquées aux non-Occidentaux, traduisent plus un point de vue de dominant qu’un désir de faire connaissance.
Dans ce sens, Claude Lévi-Strauss commente une enquête d’ordre psychosociologique, menée par les moines de l’Ordre de Saint-Jérôme. À la question de la capacité des indiens à « vivre par eux-mêmes comme des paysans de Castille », la réponse négative s’impose :
À la rigueur, peut-être, leurs petits-enfants ; encore les indigènes sont-ils si profondément vicieux qu’on peut en douter : à preuve : ils fuient les Espagnols, refusent de travailler sans rémunération, mais poussent la perversité jusqu’à faire cadeau de leurs biens : n’acceptent pas de rejeter leurs camarades à qui les Espagnols ont coupé les oreilles. […] Il vaut mieux pour les Indiens devenir des hommes esclaves que de rester des animaux libres… (Lévi-Strauss, 1955, p. 80)
Dans un contraste évident, les indiens de Porto Rico, toujours d’après les informations apportées par Lévi-Strauss dans Tristes Tropiques, cherchent à capturer des blancs pour les faire périr par immersion. Puis, pendant des semaines, ils surveillent les noyés pour vérifier s’ils sont soumis à la putréfaction. Lévi-Strauss conclut de manière ironique :
Les blancs invoquaient les sciences sociales alors que les Indiens avaient plutôt confiance dans les sciences naturelles : et tandis que les blancs proclamaient que les Indiens étaient des bêtes, les seconds se contentaient de soupçonner les premiers d’être des dieux. À ignorance égale, le dernier procédé était certes plus digne d’hommes. (Lévi-Strauss, 1955, p. 81)
Les indiens ne pratiquent des actes violents que pour des raisons d’ordre religieux. Face aux blancs, qui se disent porteurs de la parole divine – chacun étant prophète à son propre compte–, la réaction de l’indigène, à son tour, est de vouloir savoir jusqu’où les mots des Européens traduisaient la vérité transparente. Je me demande maintenant si les expériences des indiens de Porto Rico ne s’expliqueraient pas par le zèle religieux des missionnaires. Ces derniers, dans leurs sermons successifs, prêchaient l’immortalité du véritable Dieu, la résurrection du Christ – les indiens, à leur tour, avaient soif de contempler le miracle biblique, d’éprouver le mystère religieux dans toute sa splendeur d’énigme. La preuve du pouvoir divin devait se produire moins par l’assimilation passive de la parole chrétienne que par la vision d’un événement véritablement miraculeux.
À ce sujet, nous trouvons des informations précieuses et extraordinaires dans la lettre écrite par Pêro Vaz de Caminha11 au roi du Portugal. Selon le témoignage de l’écrivain du roi, les indiens brésiliens seraient naturellement enclins à la conversion religieuse12 étant donné qu’ils imitaient de loin les gestes chrétiens pendant le saint office de la messe. L’imitation – imitation totalement épidermique – reflet de l’objet dans la surface du miroir, rituel privé de mots –, voici l’argument le plus convaincant que le navigateur ait pu énoncer à son roi en faveur de l’innocence des indiens. Devant ces personnages rouges qui singent les blancs, il serait pertinent de demander s’ils ne cherchaient pas à arriver à l’extase spirituelle par la duplication des gestes. Ne croyaient-ils pas pouvoir retrouver le dieu des chrétiens à la fin des « exercices spirituels » de la même manière que les indiens de Porto Rico se seraient agenouillés devant l’Espagnol noyé qui aurait échappé à la putréfaction ?
Parmi les peuples indigènes d’Amérique latine, la parole européenne prononcée et rapidement effacée se perdait dans son immatérialité de voix et jamais ne se cristallisait par le signe écrit, le nom de la divinité chrétienne ne pouvait jamais se concrétiser en écriture. La seule monnaie de communication acceptée par les indiens était la représentation des événements racontés oralement, alors que les conquérants et les missionnaires insistaient sur les bénéfices d’une conversion miraculeuse, faite par l’assimilation passive de la doctrine transmise oralement. Instituer le nom de Dieu équivaut à imposer le code linguistique dans lequel son nom circule avec une transparence évidente.
Transmettre la représentation religieuse et la langue européenne en même temps : tel a été le travail des jésuites et des conquérants à partir de la deuxième moitié du XVIe siècle au Brésil. Ainsi, les représentations théâtrales, données au sein des villages indiens, contiennent la mise en scène13 d’un épisode de Flos Sanctorum et un dialogue écrit en portugais et en tupi-guarani, ou, pour être plus précis, il y avait le texte en portugais et sa traduction en tupi-guarani. D’ailleurs, nombreux sont les témoins qui attestent du réalisme de ces représentations théâtrales. Le prêtre jésuite Cardim nous dit que, devant le tableau vif du martyre de Saint-Sébastien, saint patron de la ville de Rio de Janeiro, les spectateurs ne pouvaient pas dissimuler leur émotion et leurs larmes. La doctrine religieuse et la langue européenne contaminent la pensée sauvage, on présente sur scène le corps humain perforé par des flèches, corps en tout point semblable à d’autres corps qui, pour des raisons religieuses, retrouvaient une mort identique. Peu à peu, les représentations théâtrales proposent une substitution définitive et inexorable : désormais, le code linguistique et le code religieux se retrouvent intimement liés dans la terre découverte grâce à l’intransigeance, la ruse et la force des blancs. Les indiens, en revanche, perdent leur langue ainsi que leur système du sacré et reçoivent en échange le substitut européen.
Éviter le bilinguisme, signifie éviter le pluralisme et signifie également imposer le pouvoir colonialiste. Dans l’algèbre du conquérant, l’unité est la seule mesure qui compte. Un seul dieu, un seul roi, une seule langue : le véritable Dieu, le véritable roi, la véritable langue. Comme le disait Jacques Derrida : « le signe et la divinité ont le même lieu et le même temps de naissance » (Derrida, 1967, p. 25). Une brève correction s’impose quant à la dernière partie de phrase, le supplément d’un préfixe qui vise à actualiser l’affirmation : « […] le même lieu et le même temps de renaissance ».
Cette renaissance colonialiste – produit réprimé d’une autre Renaissance, celle qui avait lieu en Europe au même moment – s’approprie, au fur et à mesure de son avancement, l’espace culturel du Nouveau Monde et l’inscrit, par le biais de la conversion, dans le contexte de la civilisation occidentale, qui se voit attribuée, à son tour, le statut familial et social d’aîné. L’Amérique se transforme en copie, simulacre qui se veut de plus en plus semblable à l’original, alors que sa véritable originalité ne réside pas dans le fait d’être une copie du modèle original, mais justement dans son origine complètement effacée par les conquérants. Par l’extermination constante des traits originaux, par l’oubli de l’origine, le phénomène de duplication s’établit comme seule règle valide de civilisation. Et ainsi nous assistons partout à la naissance de villes avec des noms européens dont la seule originalité se trouve dans l’adjectif « neuf » ou « neuve » : New England, Nueva España, Nova Friburgo, Nouvelle France, etc. Avec le temps, cet adjectif peut garder – et souvent il le garde – un sens différent de celui que le dictionnaire lui prête : le « nouveau », bizarrement, devient « démodé », comme dans cette belle phrase de Lévi-Strauss (1955, p. 96) : « Les tropiques sont moins exotiques que démodés ».
Le néocolonialisme, le nouveau masque qui hantait les pays du tiers monde en plein XXe siècle, était l’implantation graduelle des valeurs rejetées par la métropole dans d’autres pays, c’était l’exportation d’objets démodés dans les sociétés néocolonialistes, transformées en centre de la société de consommation. Aujourd’hui, lorsque le mot d’ordre est donné par des technocrates, le déséquilibre est scientifique, préfabriqué ; l’infériorité est contrôlée par les mains qui manipulent la générosité et le pouvoir, le pouvoir et le préjugé. Tournons-nous vers Montaigne encore une fois :
Ils sont sauvages, de même que nous appelons sauvages les fruits que nature, de soi et de son progrès ordinaire, a produits : là où, à la vérité, ce sont ceux que nous avons altérés par notre artifice [art] et détournés de l’ordre commun que nous devrions appeler plutôt sauvages. En ceux-là sont vives et vigoureuses les vraies et plus utiles et naturelles vertus et propriétés, lesquelles nous avons abâtardies en ceux-ci, et les avons seulement accommodées au plaisir de notre goût corrompu. (Montaigne, 2022, p. 158)
La renaissance colonialiste engendre à son tour une nouvelle société, celle des métis, où la notion d’unité subit un bouleversement, elle est contaminée, devenant un mélange subtil et complexe de l’élément européen et de l’élément autochtone – une sorte d’infiltration progressive entreprise par la pensée sauvage, c’est-à-dire, le seul chemin qui pourrait mener à la décolonisation. Chemin inverse à celui parcouru par les colons. Ces derniers, mus par le désir d’exterminer la race indigène, ramassaient dans les hôpitaux les vêtements infectés des victimes de la variole pour les suspendre, avec d’autres cadeaux, sur les sentiers empruntés par les tribus. Dans le nouvel et infatigable mouvement d’opposition, de création d’une impureté raciale, de sabotage des valeurs culturelles et sociales imposées par les conquérants, une transformation plus grande opère en surface, mais elle affecte en profondeur les deux principaux systèmes qui ont contribué à la propagation de la culture occidentale chez nous : le code linguistique et le code religieux. Ces codes perdent leur statut de pureté et, peu à peu, se laissent enrichir par de nouveaux acquis, par de menues métamorphoses, par d’étranges corruptions qui transforment l’intégralité du livre saint, du dictionnaire et de la grammaire européenne. L’élément hybride est roi.
La contribution majeure de l’Amérique latine à la culture occidentale constitue la destruction systématique des concepts d’unité et de pureté14. Ces deux concepts perdent leur sens exact, perdent leur poids écrasant et leur sens de supériorité culturelle au fur et à mesure que le travail de contamination des Latino-Américains s’affirme, se montre de plus en plus efficace. L’Amérique latine établit sa place sur la carte de la civilisation occidentale grâce au détournement, actif et destructeur, de la norme qui transfigure les éléments et faits immuables que les Européens exportaient vers le Nouveau Monde. Puisque l ́Amérique latine ne peut plus fermer ses portes à l’invasion étrangère et ne peut pas non plus retrouver sa condition de “paradis”, d’isolement et d’innocence, on constate avec cynisme que, sans cette contribution, son produit serait une simple copie ― silence ―, une copie souvent démodée, à cause de ce mouvement imperceptible dans le temps dont parle Lévi-Strauss. Sa géographie doit être une géographie d’assimilation et d’agressivité, d ́apprentissage et de réaction, de fausse obéissance. La passivité réduirait son rôle effectif à une disparition symbolique. Gardant sa place au deuxième rang, il faut néanmoins qu’on signale sa différence, qu’on marque sa présence, une présence souvent d’avant-garde. Le silence serait la réponse souhaitée par l’impérialisme culturel, ou encore l’écho sonore qui ne servirait qu’à serrer encore plus les liens du pouvoir conquérant.
Parler, écrire signifient : parler contre, écrire contre.
2.
Si les ethnologues sont les véritables responsables de la démystification du discours de l’Histoire, s’ils contribuent de manière décisive à la récupération culturelle des peuples colonisés, levant le voile de l’impérialisme culturel, quel serait alors le rôle de l’intellectuel aujourd’hui face aux relations entre deux nations qui participent à une même culture, l’occidentale, mais dans laquelle l’une maintient le pouvoir économique sur l’autre ? Si les ethnologues ressuscitent par leurs écrits la richesse et la beauté de l’objet artistique de la culture démantelée par le colonisateur, comment le critique doit-il présenter aujourd’hui le système complexe d’œuvres expliqué jusqu’à présent par une méthode traditionnelle et réactionnaire dont la seule originalité constitue l’étude des sources et influences ? Quelle serait l’attitude de l’artiste d’un pays en évidente infériorité économique par rapport à la culture occidentale, à la culture de la métropole, et, finalement, à la culture de son propre pays ? Pourrait-on discerner l’originalité d’une œuvre d’art si l’on impose comme seule mesure les dettes contractées par l’artiste auprès du modèle qu’il a dû importer de la métropole ? Ne serait-il pas plus intéressant de signaler les éléments de l’œuvre qui marquent sa différence ?
Ces questions ne pourront pas avoir de réponse facile ou agréable pour la même raison qu’il faut déclarer la faillite d’une méthode qui s’est enracinée profondément dans le système universitaire : les recherches qui conduisent à l’étude des sources ou des influences. Puisque certains enseignants-chercheurs se prétendent garants de l’objectivité, de la connaissance encyclopédique et de la vérité scientifique, leur discours critique occupe une place capitale parmi les autres discours universitaires. Mais il faut désormais le ranger à sa véritable place. Tel discours critique ne fait que signaler un art déjà pauvre par les conditions économiques dans lesquelles il peut survivre, ce discours ne fait que souligner le manque d’imagination des artistes qui sont obligés, par manque d’une tradition autochtone, de s’approprier les modèles mis en circulation par la métropole. Tel discours critique ridiculise la quête don-quichottesque des artistes latino-américains lorsqu’ils accentuent, par ricochet, la beauté, le pouvoir et la gloire des œuvres créées au sein de la société colonialiste ou néocolonialiste. Tel discours réduit la création des artistes latino-américains à la condition d’œuvre parasite, qui se nourrit de l’autre sans jamais lui rajouter quelque chose en propre ; une œuvre dont la vie est limitée et précaire, enfermée par le rayonnement et par le prestige de la source, de son chef de file.
La source devient l’étoile inatteignable et pure qui, sans se laisser contaminer, contamine, l’étoile qui brille pour les artistes des pays d’Amérique latine, alors que ces derniers dépendent de sa lumière pour s’exprimer. Elle illumine les mouvements des mains mais, en contrepartie, assujettit les artistes à son magnétisme supérieur. Le discours critique insistant sur les influences établit l’étoile comme la seule valeur à prendre en compte. Retrouver le chemin jusqu’à elle puis contracter une dette pour minimiser l’immense distance qui sépare le simple mortel de l’étoile immortelle : tel serait le rôle de l’artiste latino-américain, telle serait sa fonction dans la société occidentale. Par ailleurs, il faut que ce dernier arrive à maîtriser ce mouvement d’ascension décrit par le critique, mouvement qui pourrait lui permettre d’inscrire son projet dans l’horizon de la culture occidentale. Le lieu du projet parasite restera encore et toujours soumis au champ magnétique ouvert par l’étoile principale dont le mouvement d’expansion brise l’originalité de l’autre projet et lui prête, a priori, un sens parallèle et inférieur. Le champ magnétique organise l’espace de la littérature grâce à cette force d’attraction unique que le critique choisit et impose aux artistes – groupe de corpuscules anonymes qui se nourrit de la générosité du chef de file et de la mémoire encyclopédique du critique.
Qu’il soit dit entre parenthèses : le discours critique que nous venons d’ébaucher ne présente dans son essence aucune différence par rapport au discours colonialiste : l’un et l’autre parlent d’économies déficitaires. Profitons de cette parenthèse pour ajouter une observation. Il serait nécessaire d’écrire un jour une étude psychanalytique à propos du plaisir dégagé par le visage de certains professeurs universitaires lorsqu’ils découvrent une influence, comme si la vérité d’un texte ne pouvait être signalée que par la dette et l’imitation. Étrange métier que celui dont le regard se tourne vers le passé au détriment du présent, dont le crédit se consolide lorsqu’on découvre la contraction d’une dette, d’une idée volée, d’une image ou d’un mot empruntés. La voix prophétique et cannibale de Paul Valéry15 nous interpelle : « rien de plus original, rien de plus soi que de se nourrir des autres. Mais il faut les digérer. Le lion est fait de mouton assimilé. » (Valéry, 1930, p. 292). Fermons la parenthèse.
Déclarer la faillite d’une telle méthode implique la nécessité de la remplacer par une autre dont les éléments oubliés, négligés et abandonnés par la critique policière seront isolés, mis en relief, au bénéfice d’un nouveau discours critique qui oubliera et négligera la chasse aux sources et aux influences, et établira comme seule valeur critique la différence. L’écrivain latino-américain – car il faut limiter notre sujet de discussion – regarde la littérature avec le même regard malveillant et ambitieux que nous retrouvons chez Roland Barthes dans son écriture-lecture de Sarrasine, cette nouvelle de Balzac décriée par d’autres générations. Dans S/Z, Barthes nous propose comme point de départ la classification des textes littéraires comme lisibles et « scriptibles », prenant en considération le fait que l’évaluation qu’on fait aujourd’hui d’un texte littéraire est intimement liée « à une pratique, et cette pratique est celle de l’écriture » (Barthes, 2002, p. 5). Le texte lisible est celui qui peut être lu, mais pas écrit ou réécrit, c’est le texte classique par excellence, celui qui invite le lecteur à rester dans l’intérieur de sa fermeture. Les autres textes, les « scriptibles », présentent, au contraire, un modèle producteur (et pas représentationnel) qui pousse le lecteur à abandonner sa position confortable de consommateur et à s’aventurer comme producteur de textes à « remettre chaque texte, non dans son individualité, mais dans son jeu », nous dit Barthes (2002, p. 5). Cependant, au lieu de rassurer le lecteur, de garantir sa place de client payant dans la société bourgeoise, la lecture le réveille, le transforme, le radicalise, accélérant finalement le processus d’expression de l’expérience même. En d’autres termes, elle l’invite à une praxis. Citons encore Barthes (2002, p. 5-6) : « quels textes accepterais-je d’écrire (de ré-écrire), de désirer, d’avancer comme une force dans ce monde qui est le mien ? »
Cette question, reflet d’une assimilation inquiète et insubordonnée, anthropophage, est proche de la question posée depuis longtemps par des écrivains issus d’une culture dominée par une autre : leurs lectures s’expliquent par la quête d’un texte « scriptible », d’un texte qui pourrait les inciter à travailler, leur servir de modèle dans l’organisation de leur écriture. Ces écrivains utilisent systématiquement la digression, cette forme mal intégrée par le discours du savoir, comme le signale Barthes. L’œuvre seconde est donc établie à partir d’un engagement féroce avec le déjà-dit16, pour employer une expression de Michel Foucault dans son analyse de Bouvard et Pécuchet, de Gustave Flaubert. Précisons : engagement avec le déjà-écrit17.
Le texte second s’organise à partir d’une méditation silencieuse et traîtresse à propos du texte premier, et le lecteur, transformé à son tour en auteur, essaie de surprendre le modèle original dans ses faiblesses, dans ses lacunes, il le désarticule et le réarticule en fonction de ses intentions, de sa propre orientation idéologique, de sa vision du thème présenté au départ par le texte original. L’écrivain travaille sur l’autre texte et n’exagère presque jamais le rôle que la réalité qui l’entoure peut jouer dans son œuvre. Ainsi, les reproches souvent faits, par exemple, à l’aliénation de l’écrivain latino-américain sont inutiles voire ridicules. S’il se limite à parler de son expérience de vie, son texte passe inaperçu parmi ses contemporains. Il faut qu’il apprenne d’abord à parler la langue de la métropole pour mieux la combattre par la suite. Notre travail critique se définira avant tout par l’analyse qu’un auteur fait d’un texte ou d’un procédé littéraire qui appartient au domaine public et du parti qu’il en tire. Notre analyse se complétera par la description de la technique créée par ce même écrivain dans son mouvement d’agression contre le texte original, ébranlant par là les fondations d’une perception de cet objet comme unique dont la reproduction est impossible. Dans l’espace du néocolonialisme, l’imaginaire ne peut plus être celui de l’ignorance ou de la naïveté nourrie par une manipulation simpliste des données offertes par l’expérience immédiate de l’auteur, mais devrait s’affirmer plutôt comme une écriture sur une autre écriture. L’œuvre seconde, puisqu’elle contient en général une critique envers l’œuvre précédente, s’impose avec la violence démystificatrice des planches anatomiques qui dévoilent l’architecture du corps humain. La propagande devient efficace car elle parle le langage de notre temps.
L’écrivain latino-américain joue avec les signes d’un autre écrivain, d’une autre œuvre. Les mots de l’autre ont la capacité de se présenter comme des objets fascinants à ses yeux et à ses doigts, et l’écriture du texte second est, en partie, l’histoire d’une expérience sensuelle avec le signe étranger. Jean-Paul Sartre a admirablement décrit cette sensation, l’aventure de la lecture quand il raconte son expérience de jeune garçon dans la bibliothèque familiale :
Les souvenirs touffus et la douce déraison des enfances paysannes, en vain les chercherais-je en moi. Je n’ai jamais gratté la terre ni quêté des nids, je n’ai pas herborisé ni lancé des pierres aux oiseaux. Mais les livres ont été mes oiseaux et mes nids, mes bêtes domestiques, mon étable et ma campagne. (Sartre, 1995, p. 40-41)
Étant donné que le signe se présente souvent dans une langue étrangère, le travail de l’écrivain, plutôt que de se rapprocher d’une traduction littérale, se veut une traduction globale, un pastiche, une parodie, une digression. Le signe étranger se reflète dans le miroir du dictionnaire et dans l’imagination créatrice de l’écrivain latino-américain et se dissémine sur la page blanche avec la grâce et le charme du mouvement de la main qui trace des lignes et des courbes. Pendant le processus de traduction, l’imaginaire de l’écrivain est toujours sur la scène, comme dans ce merveilleux exemple emprunté à Julio Cortázar.
Le protagoniste de 62 Maquette à monter, de nationalité argentine, voit affichée cette phrase magique dans le miroir du restaurant parisien : « Je voudrais un château saignant ». Mais au lieu de reproduire la phrase en langue originale, il la traduit immédiatement en l’espagnol : « Quisiera un castillo sangriento ». Écrit sur le miroir et approprié par le champ visuel du personnage latino-américain, « château » sort du contexte gastronomique et s’inscrit dans le domaine féodal, colonialiste, la maison où habite le seigneur, « el castillo ». Et l’adjectif « saignant » qui signalait seulement la préférence du client à propos de la cuisson de la viande, dans la plume de l’écrivain argentin, « sangriento » devient la marque évidente d’une attaque, d’une rébellion, d’un désir de voir le « château », le « catillo », sacrifié, de le mettre à feu et à sang. La traduction du signifiant produit un nouveau sens. De plus, le noyau du signe linguistique (château) contient le nom de celui qui a le plus compris le Nouveau Monde au XIXe siècle : René de Chateaubriand. Ce n’est pas une coïncidence si, dans le passage précédant celui du restaurant, le personnage de Cortázar avait acheté le livre d’un autre voyageur infatigable – Michel Butor – dans lequel il parle de l’auteur de René et d’Atala. Et la phrase du client – « Je voudrais un château saignant » –, dans toute son innocence gastronomique, est perçue à la surface du miroir, du dictionnaire, par le biais d’une imagination mise au travail par la lecture de Michel Butor et par la situation d’un Latino-Américain à Paris, « quisiera un castello sangriento ».
Il est difficile de préciser si c’est la phrase entendue au hasard qui attire l’attention du personnage latino-américain ou s’il la voit sur le miroir parce qu’il vient de lever les yeux du livre de Butor. Dans tous les cas une chose est sûre : les lectures de l’écrivain latino-américain ne sont jamais innocentes. Jamais elles ne pourraient l’être.
Du livre au miroir, du miroir à la commande du client gourmet, du château à sa traduction, de Chateaubriand à l’écrivain latino-américain, de l’original à l’agression. C’est dans ces transformations18 du désir en écriture, c’est là, dans cette absence finale de mouvement, que s’ouvre l’espace critique par où on doit commencer à lire aujourd’hui les textes romantiques du Nouveau Monde. Dans cet espace, si le signifiant est le même, le signifié fait circuler un autre message, un message inversé. Isolons, par commodité, le mot « índio ». Chez Chateaubriand et chez beaucoup d’autres romantiques européens, ce signifiant devient l’origine de tout un thème littéraire qui nous parle d’évasion, de voyage, de désir de fuir les contours étroits de la patrie européenne. Arthur Rimbaud, par exemple, ouvre son long poème « Bateau ivre » par une allusion aux « Peaux-rouges criards », qui annonce, dans sa fraîcheur infantile, le cri de rébellion qu’on écoutera à la fin du poème : « Je regrette l’Europe aux anciens parapets ». Cependant, le même signifiant lorsqu’il apparaît dans le texte romantique américain devient symbole politique, symbole du nationalisme qui finalement élève sa voix libre (apparemment libre, comme c’est souvent le cas malheureusement) après les luttes d’indépendance. Et si, parmi les Européens, ce signifiant exprime un désir d’expansion, pour les Américains, sa traduction marque la volonté d’établir les limites de la nouvelle patrie, une forme de contraction.
Arrêtons-nous un instant et analysons de près une nouvelle de Jorge Luis Borges, dont le titre est déjà révélateur de nos intentions : Pierre Ménard, auteur du Quichotte. Pierre Ménard, romancier et poète symboliste, mais aussi lecteur infatigable, dévoreur de livres, serait la métaphore idéale pour bien préciser la situation et le rôle de l’écrivain latino-américain, puisqu’il vit entre l’assimilation du modèle original – c’est-à-dire l’amour et le respect par le déjà-écrit – et la nécessité de produire un texte nouveau, qui affronte et qui, très souvent, nie le texte premier. Les projets littéraires de Pierre Ménard ont été initialement classés avec zèle par Mme Bachelier : ce sont les écrits publiés pendant toute sa vie et lus avec plaisir par ses admirateurs. Mais Mme Bachelier n’inclut pas dans la bibliographie de Ménard, raconte le narrateur de la nouvelle, le plus absurde et le plus ambitieux de tous ses projets – celui de réécrire Don Quichotte : « Il ne voulait pas composer un autre Quichotte – ce qui est facile – mais le Quichotte. » (Borges, 1983, p. 27). L’omission de Mme Bachelier s’explique par le fait qu’elle n’arrive pas à voir l’œuvre invisible de Pierre Ménard – déclare le narrateur –, celle qui est « souterraine, l’interminablement héroïque, la sans pareille » (Borges, 1983, p. 27). Le peu de chapitres que Ménard a écrits sont invisibles car le modèle et la copie sont identiques ; il n’y a aucune différence de vocabulaire, de syntaxe, de structure entre les deux versions : celle de Cervantes et la copie de Ménard. L’œuvre invisible est le paradoxe du texte second qui disparaît complètement, donnant place à sa signification la plus extérieure : la situation culturelle, sociale et politique dans lesquelles le deuxième auteur se situe.
Le texte second peut cependant être visible et c’est ainsi que le narrateur de la nouvelle a pu inclure le poème Le cimetière marin, de Paul Valéry, dans la bibliographie de Ménard, tout simplement parce que, dans la transcription du poème, les décasyllabes de Valéry se transforment en alexandrins. L’agression contre le modèle, la transgression du modèle proposé par le poème de Valéry, se situe dans ces deux syllabes rajoutées au décasyllabes, petit supplément sonore et différentiel qui organise l’espace visuel et silencieux de la strophe et du poème de Valéry, modifiant également le rythme interne de chaque vers. L’originalité de l’œuvre visible de Pierre Ménard réside dans le petit supplément de violence que sa présence installe dans la page blanche et dans la rupture entre le modèle et sa copie, situant finalement le poète face à la littérature, à l’œuvre qui lui sert d’inspiration. « Le lion est fait de mouton assimilé. »
Selon Pierre Ménard, si, pour construire son texte, Cervantes « ne repoussa pas la collaboration du hasard » (Borges, 1983, p. 29), lui-même, dans son propre travail avait « contracté le mystérieux devoir de reconstituer littéralement son œuvre spontanée » (Borges, 1983, p. 29). Il y a chez Ménard, comme chez les écrivains latino-américains, le refus de la spontanéité et l’acceptation de l’écriture comme un devoir lucide et conscient, et peut-être qu’il est temps de suggérer comme image révélatrice du travail souterrain interminablement héroïque le titre de la première partie du recueil de Borges : Le jardins aux sentiers qui bifurquent. La littérature, le jardin ; le travail de l’écrivain, le choix conscient devant chaque bifurcation et non une acceptation tranquille du hasard de l’invention. La connaissance est conçue comme une forme de production. L’assimilation du livre par la lecture implique déjà l’organisation d’une praxis de l’écriture.
Le projet de Ménard refuse donc la liberté totale dans la création, pouvoir qui est traditionnellement délégué à l’artiste et élément qui établit l’identité et la différence dans la culture colonialiste occidentale. La liberté, chez Ménard, est contrôlée par le modèle original, tout comme la liberté des citoyens des pays colonisés est surveillée de près par les forces de la métropole. La présence de Ménard – différence, écriture, originalité – s’installe dans la transgression du modèle, dans le mouvement imperceptible de conversion, de perversion, de détournement.
L’originalité du projet de Pierre Ménard, sa partie visible et écrite, est la conséquence de son refus d’accepter la conception traditionnelle de l’invention artistique, car il nie la liberté totale de l’artiste. À l’instar de Robert Desnos, il proclame comme lieu de travail, les « formes prisons ». L’artiste latino-américain accepte la prison comme forme de comportement, la transgression comme forme d’expression. D’où, sans aucun doute, l’absurde, le tourment, la beauté et la vigueur de son projet visible. L’invisible devient silence dans son texte : c’est la présence du modèle ; alors que le visible est le message, c’est ce qui est absent dans le modèle. Citons une dernière fois Pierre Ménard : « Mon jeu solitaire est régi par deux lois diamétralement opposées. La première me permet d’essayer des variantes de type formel ou psychologique : la seconde m’oblige à les sacrifier au texte “original” » (Borges, 1963, p. 29).
L’écrivain latino-américain est le dévoreur de livres dont parlent les nouvelles de Borges avec insistance. Il lit tout le temps et il publie de temps en temps. La connaissance n’arrive jamais à rouiller les délicats et secrets mécanismes de la création ; au contraire, elle stimule son projet créateur, car elle est le principe organisateur de la production du texte. Dans ce sens, la technique de lecture et de production des écrivains latino-américains semble être comme celle de Marx dont parle Louis Althusser. Puisque nous lisons les écrivains latino-américains, notre lecture est aussi coupable que celle d’Althusser,
Quand nous lisons Marx, nous sommes d’emblée devant un lecteur, qui devant nous, et à haute voix, lit. […] il lit Quesnay, il lit Smith, il lit Ricardo, etc. […] pour s’appuyer sur ce qu’ils ont dit d’exact, et pour critiquer ce qu’ils ont dit de faux. (Althusser, 2014, p. 9-10)
La littérature latino-américaine d’aujourd’hui nous propose un texte et, en même temps, ouvre le champ théorique qui servira d’inspiration lors de l’élaboration du discours critique dont elle-même sera l’objet. Ce champ théorique contredit les principes d’une certaine critique universitaire qui ne s’intéresse qu’à la partie invisible du texte, aux dettes contractées par l’écrivain en même temps qu’il rejette le discours d’une critique pseudomarxiste qui prêche une pratique primaire du texte, observant que son efficacité serait la conséquence d’une lecture facile. Ces derniers oublient que l’efficacité d’une critique ne peut pas être mesurée par la paresse qu’elle inspire ; au contraire, elle doit déconditionner le lecteur, rendre impossible sa vie au sein de la société bourgeoise et de consommation. La lecture facile donne raison aux forces néocolonialistes qui insistent sur le fait que le pays se retrouve dans la situation de colonie par la paresse de ses habitants. L’écrivain latino-américain nous apprend qu’il faut libérer l’image d’une Amérique latine souriante et heureuse, le carnaval et la fiesta, colonie de vacances pour le tourisme culturel.
Entre le sacrifice et le jeu, entre la prison et la transgression, entre la soumission au code et l’agression, entre l’obéissance et la rébellion, entre l’assimilation et l’expression – c’est là, à cet endroit apparemment vide, son temple et son lieu de clandestinité, c’est là que se réalise le rituel anthropophage de la littérature latino-américaine.
*
Mars 1971