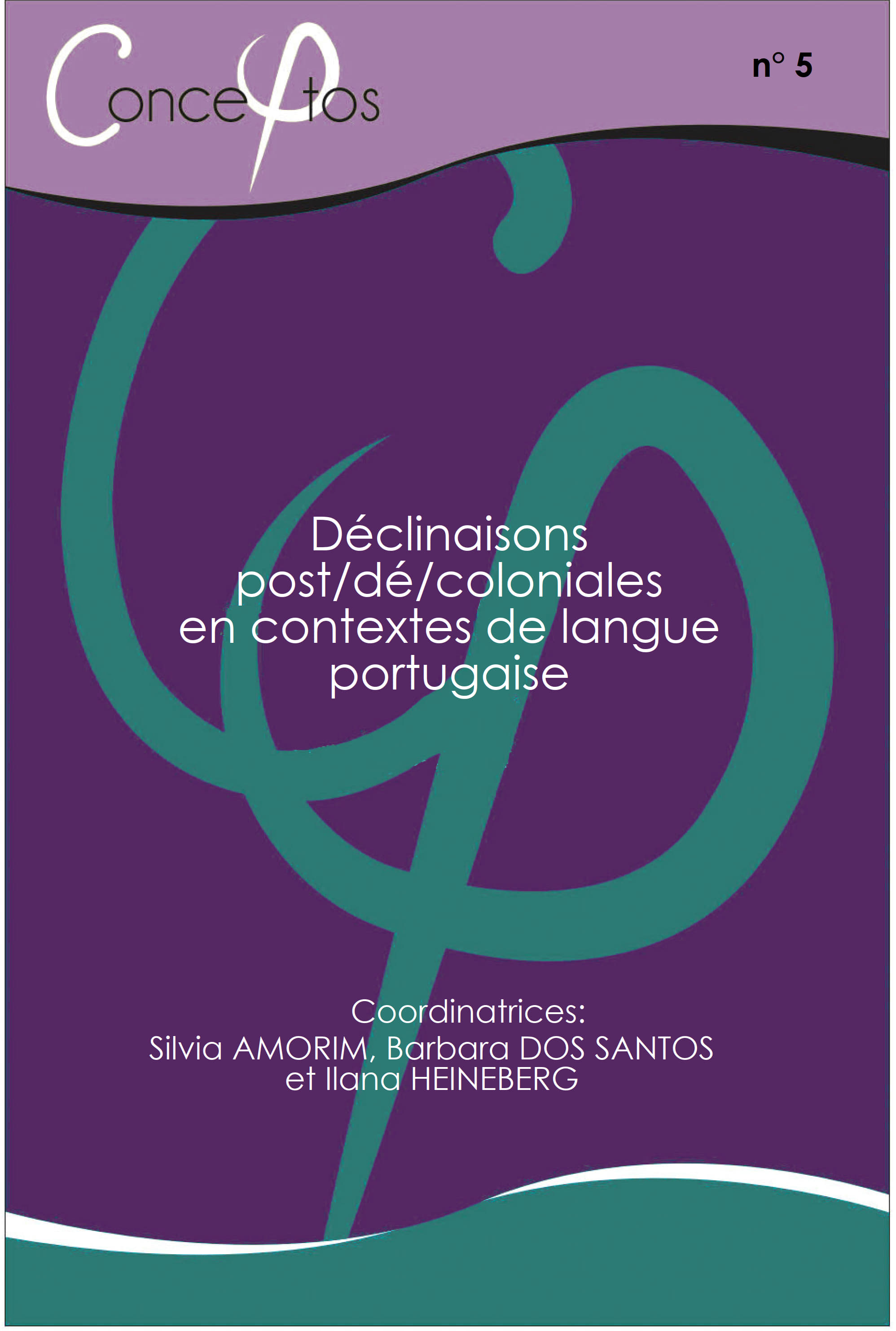Le féminisme noir au Brésil en dialogue avec le féminisme noir aux États-Unis et le féminisme décolonial latino-américain
Le féminisme noir au Brésil surgit dans l’entrecroisement des mouvements noirs, notamment à partir de la création du Mouvement Noir Unifié en 1978, et du mouvement féministe blanc des années 1970. Le féminisme décolonial, phénomène plus récent, du moins au Brésil, concerne plus directement les populations amérindiennes, quoique les revendications des deux mouvements soient similaires. Le présent article s’attache à montrer que les féminismes noirs au Brésil et aux États-Unis, ainsi que le féminisme décolonial, partent des mêmes postulats épistémologiques et politiques lorsqu’ils réaffirment la valeur des cultures des Amérindiens et des descendants des Africains et le lieu qu’ils veulent occuper sur la scène sociale et politique – un lieu dont ils ont été écartés à cause du racisme structurel et de la misogynie.
Dans le Brésil des années 1980, Lélia Gonzalez (1935-1994) et Sueli Carneiro (née en 1950) ont été les deux figures de proue qui ont contribué à l’éclosion du féminisme noir. La plupart de leurs articles ont été récemment réunis dans les ouvrages : Primavera para as rosas negras : Lélia Gonzalez em primeira pessoa [Printemps pour les roses noires : Lélia Gonzalez à la première personne] (Gonzalez, 2018), Por um feminismo afro-latino-americano : ensaios, intervenções e diálogos [Pour un féminisme afro-latino-américain : essais, interventions et dialogues], organisé par Flavia Rios et Márcia Lima (Gonzalez, 2020) et Escritos de uma vida[Écrits d’une vie] (Carneiro, 2018). Ces publications ont facilité l’accès à leur pensée. À l’heure actuelle, le marché éditorial commence à s’ouvrir à la production des féministes noires brésiliennes qui, pour la plupart, étaient publiées jusqu’à très récemment par des petites maisons d’édition ou des collectifs noirs. D’ailleurs, on vérifie aussi une véritable explosion de traductions de livres de féministes noires étrangères, surtout les étasuniennes.
Lélia Gonzalez et Sueli Carneiro se sont aperçues que les discours des féministes blanches de la classe moyenne supérieure ne rendaient pas compte des questions de race et de classe sociale. Lorsqu’elles le signalaient dans des assemblées ou réunions, on les accusait d’être agressives et de véhiculer un discours émotionnel. De même que les hommes, sujets « universels », ne se souciaient pas de la question du genre affectant les femmes (l’Autre), les féministes blanches des années 1970/1980 ne pensaient pas suffisamment à l’impact de la race et de la classe sociale sur la vie des femmes noires, métisses et amérindiennes, des ouvrières et des employées de maison. Au fond, les féministes blanches ne visaient « que » les hommes blancs de leur classe sociale, qui ne les considéraient pas égales sur les plans professionnel, politique et culturel. D’un autre côté, les féministes noires étaient victimes du sexisme et du machisme de leurs compagnons du Mouvement Noir Unifié, d’où cette nécessité d’établir un pont entre les deux mouvements.
Toutes différences et proportions gardées, les textes d’Audre Lorde (1934-1992), de Patricia Hill Collins (née en 1948) et de bell hooks (1952-2021) montrent clairement une similarité entre les processus d’apparition du féminisme noir aux États-Unis et au Brésil. Dans les deux pays, la lutte contre le racisme et pour la défense des droits civils semblait s’opposer à la lutte féministe dans les années 1970/1980.
Audre Lorde est l’auteure de Sister Outsider, traduit et publié en France en 2003 et au Brésil en 2019. Le titre paroxystique incite à la réflexion au sens où le dedans-dehors indique l’absence de lieu des femmes noires aux États-Unis : « Agir comme insider et se sentir outsider, conserver notre autorejet comme femmes noires que nous avons dans le même temps surmonté – pensons-nous. […] Et l’empowerment est le travail le plus profond qui soit, et le plus difficile » (Lorde, 2019, p. 212). La colère des femmes noires (y compris contre les autres femmes noires) traverse les articles qui composent le recueil. Ayant grandi au milieu des humiliations journalières, ces femmes ont dû apprivoiser leur irritation pour ne pas succomber : « Et j’appelle ça symphonie plutôt que cacophonie parce que nous avons dû apprendre à orchestrer ces colères pour qu’elles ne nous détruisent pas » (Lorde, 2019, p. 162). Elles ont dû apprendre à faire avec et à les utiliser comme une force, une puissance.
S’inspirant des enseignements du pédagogue brésilien Paulo Freire dans son livre Pédagogie des opprimés, Lorde affirme que ce sont les dominés qui doivent montrer aux dominants leurs erreurs. Ainsi, les Noirs doivent mettre à nu le racisme des Blancs et les femmes doivent apprendre aux hommes à ne pas être sexistes. Et l’auteure d’ajouter :
Le véritable objectif de la transformation révolutionnaire ne peut jamais juste être les situations oppressives desquelles nous essayons de nous libérer, mais ce fragment d’oppresseur qui est profondément enraciné en chacun de nous, qui connaît seulement les tactiques de l’oppresseur, les relations de l’oppresseur (Lorde, 2019, p. 153, souligné par moi).
D’après bell hooks, les femmes noires ont été très actives pendant le XIXe siècle. Pendant le débat sur le droit de vote, les hommes (blancs) accusaient les femmes (blanches) d’être faibles, incapables de prendre des décisions. C’est dans ce contexte, et pendant la deuxième convention annuelle des droits de la femme à Akron (Ohio), en 1852, que Sojourner Truth a prononcé son discours et sa célèbre phrase « Ne suis-je pas une femme ? ». hooks a repris cette phrase pour en faire le titre de son premier livre, publié en 1981 sous le titre original Ain’t I a woman ? [publié au Brésil sous le titre Eu não sou uma mulher ? en 2019]. Les femmes noires travaillaient dans les champs aux côtés des hommes pendant la période de l’esclavage, mais en plus elles devaient entretenir la maison et s’occuper des enfants. Elles n’étaient donc pas fragiles et n’avaient pas besoin de l’aide de gentlemen pour monter dans les carrosses (qu’elles n’avaient pas). D’où la question : les femmes noires n’étaient-elles pas des femmes ?
Mais hooks (2018b, p. 278) observe néanmoins qu’entre 1920 et 1960, les dirigeantes noires ont cessé de défendre les droits des femmes : « La lutte pour l’émancipation noire et la lutte pour l’émancipation féminine étaient jugées opposées » parce qu’on craignait que la lutte féministe nuise à la conquête des droits civils au niveau de l’État (patriarcal et capitaliste). C’est donc seulement à partir de 1970 que les nouvelles générations, dont hooks fait partie, ont commencé à militer en entrecroisant la critique du sexisme avec celle du racisme et du capitalisme. Cette prise de conscience et de position a donné lieu au concept d’intersectionnalité, créé par Kimberlé Crenshaw en 1987. Même si les intellectuelles noires brésiliennes Lélia Gonzalez et Sueli Carneiro n’ont pas conçu un terme spécifique pour fonder un concept, cette idée d’entrecroisement du genre avec la race et la classe sociale était présente dans leurs écrits et dans leurs discours des années 1980. Nous y reviendrons.
À la différence des États-Unis, et pendant les années de dictature (1964-1985), les féministes brésiliennes blanches et de gauche affrontaient l’opposition des maris et des camarades de parti, qui considéraient que le seul combat important à l’époque devait être d’ordre politique. Les contradictions au sein de la société étant nombreuses, les personnes ne sont pas toujours conscientes de leurs rapports de classes et de leurs privilèges. Ces femmes de la classe moyenne supérieure avaient chez elles des femmes de ménage, majoritairement noires, exploitées, sans aucun droit, qui subissaient tout type d’abus, y compris sexuel. Les exemples dans la littérature abondent dans ce sens.
Dans A vida invisível de Eurídice Gusmão [La vie invisible d’Eurídice Gusmão] (2016), Martha Batalha écrit sur cette génération. Violée une première fois à l’âge de 13 ans, la bonne Das Dores ne se révolte plus quand elle est abusée par le fils de la maison où elle travaille au moment présent de la diégèse. En plus, elle est accusée de faire tout de travers : « Das Dores ne fait rien comme il faut, Das Dores est une idiote, Das Dores a sali la serviette, brûlé le pantalon, cassé le verre, perdu mes boucles d’oreilles » (Batalha, 2016, p. 39). Dans les romans des écrivaines blanches, comme Clarice Lispector, Lya Luft et Lygia Fagundes Telles, les femmes de ménage sont des ombres silencieuses qui exécutent leurs tâches sans quasiment dire un mot. La sociologue étasunienne Patricia Hill Collins utilise le terme outsider within (outsider interne) pour désigner la femme de ménage qui vit dans la maison des Blancs sans appartenir à leur monde. Dans Joias de familia [Bijoux de famille] (2007), de Zulmira Tavares, la bonne s’appelle intentionnellement Maria Preta, ou Marie Négresse. Dans certaines circonstances, « elle est comme un membre de la famille », dans d’autres, non. Par exemple, elle n’a pas le droit d’écouter les conversations confidentielles sur des bijoux. Sa petite-nièce Benedita (Bene), en revanche, ne se satisfait pas de ce rôle subalterne : elle travaille chez une famille tout en suivant à côté des cours pour pouvoir entrer à la faculté de bibliothéconomie. On observe ainsi un changement socioéconomique et culturel. Il en est de même dans le film Une seconde mère, d’Anna Muylaert, où l’employée de maison, originaire du Nord-Est, est interprétée par Regina Casé. Un jour, sa fille vient à São Paulo dans l’intention d’entrer à l’université. Finalement, les exceptions viennent de la nouvelle génération d’auteures blanches. Dans Com armas sonolentas [Avec des armes somnolentes] (2018), Carola Saavedra fait de l’employée d’origine amérindienne un des trois personnages principaux, même si elle n’a pas de nom et d’identité. Elle est aussi violée par le fils de la maison.
Dans une analyse marxiste, on pourrait dire que le Brésil est une société surdéterminée par l’esclavage : les survivances perdurent malgré la fin du régime esclavagiste. Louis Althusser (2015) part d’une lecture de Marx pour montrer que ces survivances sont des « réalités, qu’il s’agisse des superstructures, des idéologies, des “traditions nationales”, et même des coutumes et de l’ “esprit” du peuple, etc. » (Althusser, 2015, p. 91). Pour bien comprendre, il est essentiel de recourir au concept de surdétermination de toute contradiction et de tout élément constitutif de la société. Même s’il se produit une modification dans la structure (y compris une révolution), les superstructures et les idéologies ne changent pas immédiatement parce qu’elles ont « une consistance suffisante pour survivre hors du contexte immédiat de leur vie, voire pour recréer, “secréter” pour un temps, des conditions d’existence de substitution » (Althusser, 2015, p. 91). Le comportement des Brésiliens de la classe moyenne supérieure est une survivance de la société esclavagiste ; ils tiennent à leurs nounous en uniforme blanc et leurs employées qui empruntent l’ascenseur de service et se couchent dans des petites chambres vétustes. Pour Hill Collins (2019), ce type de marqueur physique est un dispositif destiné à structurer les comportements de déférence.
L’un comme l’autre, le féminisme décolonial latino-américain et le féminisme noir, ont surtout été élaborés par le milieu universitaire étasunien, ou s’y sont enracinés. Certains auteurs comme Anibal Quijano, Maldonado-Torres et Walter Mignolo partent de l’analyse historique de la colonisation pour montrer que les Européens ont aussi bien nié l’humanité des autochtones que celle des esclaves qu’ils ont ramenés d’Afrique, avec pour corollaire l’affirmation de leur supériorité. Pour inférioriser l’Autre, ils ont procédé à un travail simultané de racialisation et de féminisation/sexualisation des peuples amérindiens et africains. Pour Karina Ochoa-Muñoz (2014), il s’agit là du point de départ de la colonialité du pouvoir, « l’élément constitutif de la colonialité, du système monde-moderne-colonialiste et de son ethos universalisant ». Selon elle, la misogynie est un élément important qui « explique l’articulation transversale entre la condition de race et la condition de sexe-genre ». Dans la mesure où le colonisateur n’a pas réellement « vu » les Amérindiens, ils sont devenus les Autres (inférieurs) de la même manière que les femmes étaient leurs Autres inférieurs en Europe. Tout projet colonial universalisant est excluant : il exclut tous les peuples racialisés en les réduisant à la figure de l’Autre, un Autre inclassable.
Maria Lugones (2019, p. 365) décrit le colonisé comme quelqu’un qui « commence à habiter un locus fracturé construit doublement, qui perçoit le monde doublement, se met en relation doublement, où les ‘côtés’ sont en tension et où le conflit informe activement la subjectivité du Je colonisé dans des relations multiples ». Toute cette discussion ne concerne pas seulement le passé colonial, elle fait référence au temps présent parce que nous sommes devant une question épistémique et géopolitique : « la tâche de la féministe décoloniale est d’abord de voir la différence coloniale, en résistant emphatiquement à son habitude épistémologique de l’effacer » (Lugones, 2019, p. 371). Autrement dit, il faut prendre conscience de nos propres contradictions et aliénations, savoir que l’agencement (pour reprendre Deleuze) est collectif, et non pas individuel : « Personne ne résiste à la colonialité des genres tout seul : il n’est possible d’y résister que si l’on comprend le monde et on vit ce qui est partagé, que l’on réussit à comprendre ses propres actions – qui garantissent une certaine reconnaissance (Lugones, 2019, p. 372). »
Dans cette perspective décoloniale, le féminisme est à rapprocher de la désobéissance épistémique dont parle Walter Mignolo (2007, p. 297) quand il propose une « pensée de frontière », ou une « épistémologie de frontière », pour éviter tout fondamentalisme. L’objet d’analyse des théories de la décolonialité est surtout lié aux pays où les Amérindiens sont fortement présents. Néanmoins, il est aussi présent dans les travaux de Brésiliens tels qu’Ailton Krenak, Daniel Munduruku et Eliana Potiguara. Conserver et respecter les cultures (l’épistémè) des peuples des premières nations et des descendants d’Africains, c’est pratiquer la décolonialité.
L’écrivain martiniquais Édouard Glissant (1981) plonge, lui aussi, dans l’histoire coloniale pour contester l’imposition de l’Universel occidental, la racine unique qui s’oppose à la notion de rhizome qu’il emprunte à Deleuze-Guattari. En outre, il fait une lecture psychanalytique lorsqu’il se demande si l’histoire de l’esclavage ne peut pas être vue comme l’histoire d’une névrose. Avec la traite comme trauma, le refoulement serait la tentative d’oubli, les délires coutumiers seraient les symptômes et le refus de revenir à « ces choses du passé », une manifestation du retour du refoulé. Dans le langage freudien, c’est quand l’événement a été oublié (refoulé) qu’il présente une valeur pathogénique. La redécouverte du souvenir et son expression produisent une décharge émotionnelle que Freud a nommée abréaction et qui a un effet cathartique. La névrose affecte les personnes jusqu’à aujourd’hui, et la littérature a comme rôle fondamental de susciter la réflexion.
La critique de l’universalisme occidental faite par Lélia Gonzalez et Sueli Carneiro se rapproche des postulats d’Édouard Glissant, lesquels sont similaires aux idées des théoriciens de la décolonialité. En d’autres termes, il y a une revalorisation d’autres épistémologies méprisées et rejetées par la raison occidentale. Alors qu’elle faisait référence à un concours de miss beauté noire en 1982, Lélia Gonzalez (2018) y voyait une tentative de décolonisation culturelle, de valorisation de l’esthétique noire, parce que tout cela conscientise les gens dans la lutte contre le racisme. Dans la préface des Cadernos Negros [Cahiers Noirs], elle écrivait en 1982:
Comme les Amérindiens et les Noirs ont été faits esclaves et exploités par les Européens, leurs manifestations culturelles ont été retirées de la scène, refoulées par la classe dominante d’origine européenne (mais très métissée d’un point de vue racial) qui les classifie comme ‘folklore’ et les place dans des musées de curiosité, de choses exotiques (Gonzalez, 2018, p. 138).
En somme, selon les assises de nos sociétés, la science et la raison sont occidentales alors que les savoirs produits par les autres peuples sont de simples croyances. Hill Collins participe de ce débat en affirmant que le féminisme noir doit fournir des connaissances sur les expériences des femmes noires, mais pas seulement. Il doit aller au-delà, « activer des épistémologies qui questionnent la connaissance en vigueur et nous permettent de définir nos réalités selon nos propres termes » (Collins, 2019, p. 434). Ce tournant épistémologique peut favoriser l’empowerment féminin dans la mesure où il démystifie la matrice de domination en la déconstruisant.
Gonzalez écrit que l’africanité de la culture brésilienne a été transmise par les femmes qui ont exercé le rôle de nourrice, la « mère noire », en parlant à leurs enfants en « pretuguês », un portugais africanisé. La valeur qu’elle attribue au langage lui vient de ses lectures de Lacan et de ses contacts avec le psychanalyste M.D. Magno, qui a écrit que le Brésil n’appartenait pas à l’Amérique latine, mais à « l’Améfrique ladine ». Selon elle, « la fonction maternelle fait référence à l’intériorisation de valeurs, à l’enseignement de la langue maternelle et à une série d’autres choses qui vont faire partie de l’imaginaire des personnes » (Gonzalez, 2018, p. 205). Gonzalez s’approprie le mot Améfrique qui lui paraît convenable parce qu’il peut s’appliquer aux autres pays de l’Amérique des plantations, pas seulement au Brésil.
Lélia Gonzalez affirme que plutôt que d’être seulement sujet de notre histoire, nous devons être sujets de notre propre discours. Avec cette affirmation, elle anticipe le questionnement soulevé par Gayatri Spivak dans Les subalternes peuvent-elles parler ? Parler, c’est construire/reconstruire/déconstruire en continu son identité. Pour occuper l’espace public et sortir de l’invisibilité imposée par le racisme, les Noirs sont chaque fois plus présents dans le domaine culturel, que ce soient dans la littérature ou les arts en général. Parler, écrire, jouer et revendiquer, bref, devenir des acteurs sociaux permet de quitter la place de subalterne au profit de celle de personnage principal.
Lélia Gonzalez a fondé le Nzinga en 1983. Il s’agit d’un collectif de femmes noires de Rio de Janeiro, un espace de parole et de débat aussi ouvert aux femmes des classes défavorisées, des bidonvilles et des banlieues. Mais comme elle le fait remarquer elle-même, ce n’est pas le premier et unique lieu d’échanges pour les femmes noires. En 1972, Maria Beatriz Nascimento organisait déjà la Semaine Culturelle Noire à l’Université Fédérale Fluminense ; et l’Université Cândido Mendes a mis en place le Centre d’Études Afro-asiatiques.
Professeure de sociologie de l’Université Catholique Pontificale de Rio de Janeiro (PUC-RJ), militante, membre du parti politique Parti des Travailleurs (PT), puis du Parti Démocratique Travailliste (PDT), candidate au poste de député, elle a participé au Conseil National des Droits de la Femme sous le gouvernement de José Sarney (1985-1990), aux côtés de la députée Benedita da Silva (alors au début de sa carrière politique) et des féministes blanches. Gonzalez a sillonné le monde tout en participant à des conférences internationales, des congrès et des débats. Avec toujours l’objectif d’unir les deux causes de son militantisme : la lutte pour les droits des Noirs (et Amérindiens) et des femmes.
Comme d’autres femmes noires, Lélia Gonzalez est passée par des conflits identitaires pendant sa formation scolaire, dans les rapports avec sa famille et avec celle de son premier mari d’origine espagnole, qui est mort jeune, ensuite avec son second mari qui, selon elle, était un mulâtre qui voulait devenir blanc. Bref, elle affirme que c’est la Psychanalyse qui l’a aidé à dépasser ses crises existentielles et à se reconstruire. À travers cette thérapie elle se reconnaît dans les religions afro-brésiliennes (candomblé et umbanda), religions qu’elle rejetait jusqu’alors en fonction de sa formation universitaire occidentale ainsi que de la religion catholique professée par sa famille. Elle met l’accent sur le fait que le candomblé appartient à l’héritage culturel africain, que ce n’est pas du mysticisme, c’est un autre code culturel ; le candomblé est très écologique, on prépare des plats, on fait des offrandes, on va à la forêt (Gonzalez, 2020, p. 323).
Lélia Gonzalez (2018) adopte l’explication psychanalytique et utilise le concept freudien de dénégation reprenant le Vocabulaire de la psychanalyse de Laplanche et Pontalis qui explique que la dénégation est un procédé par lequel le sujet dénie dans son discours un désir ou une pensée qu’il a refoulé ; bref, il affirme qu’il n’est pas [raciste, par exemple] alors qu’il sait qu’il est [raciste]. La dénégation se fait à travers ledit racisme à la brésilienne, qui s’exprime par l’idéologie du blanchiment, par l’affirmation de la démocratie raciale et par la création de mythes comme celui de la belle mulâtresse. Trouver la métisse beaucoup plus belle que la femme noire s’insère dans ce que l’on nomme aujourd’hui le colorisme, un sous-produit du racisme.
L’idéologie du blanchiment est un aspect qui traverse la plupart de ses textes car elle se constitue comme l’arrière-fond des discours qui exaltent le processus de métissage comme l’expression la plus achevée de notre soi-disant démocratie raciale (Gonzalez, 2020, p. 33). Abdias do Nascimento discute cette idéologie dans son livre Genocídio do negro brasileiro [Génocide du Noir brésilien], recensant les éléments qui composent ce tableau: l’absence de la mémoire et de l’histoire de l’Afrique dans le système éducationnel, l’esthétique de la blancheur comme modèle de beauté, l’insistance sur l’idée que les relations raciales sont harmoniques, la reproduction de stéréotypes concernant la population noire ; tout cela empêche ou, au moins, rend plus difficile, la libre expression des Noirs. (cité dans Ratts, Rios, 2010, p. 43-44).
Ce mythe de la démocratie raciale dans les sociétés de l’Amérique latine, en général, est basé sur le fait qu’il n’y a pas de discrimination officielle, légale, comme c’était le cas aux États-Unis ou en Afrique du Sud. Cependant, le racisme existe de fait, un racisme que l’on appelle aujourd’hui un racisme structurel étant donné qu’il est imprégné dans le tissu social brésilien et latino-américain. Comme les sociétés sont stratifiées racialement, avec un continuum de couleur, la ségrégation de la population noire et amérindienne n’est pas nécessaire car les hiérarchies garantissent la supériorité des Blancs comme groupe dominant (Gonzalez, 2020, p. 143). Alors, affirmer que tous sont égaux devant la loi a un caractère simplement formaliste. Et les femmes noires sont les plus opprimées parce qu’elles subissent doublement la discrimination, du fait d’être des femmes et du fait d’être noires.
Néanmoins, en niant le poids du racisme, les classes dominantes manifestent de l’indifférence envers les populations qui ont été subalternisées tout au long de l’Histoire. Et même les partis de gauche ne se montrent pas sensibles à la question des Noirs, comme l’affirme Lélia Gonzalez (2020, p. 288) dans une interview car ils n’envisagent que les luttes de classes et les problèmes socioéconomiques. D’ailleurs, les hommes de gauche de l’époque étaient très conservateurs par rapport aux coutumes, ils avaient des préjugés envers les femmes et les gays qui militaient dans les partis politiques.
Lélia Gonzalez affirmait que la « libération de la femme blanche se faisait aux dépens de l’exploitation de la femme noire » (Gonzalez, 2020, p. 43). Françoise Vergès (2020, p. 24) signale, plus récemment, que le travail de nettoyage, fait quasi exclusivement par des femmes racialisées, doit rester invisible. Le capitalisme produit des situations dans lesquelles des personnes font des tâches exténuantes, sont exposées à des produits chimiques toxiques et, en plus, subissent toute sorte de harcèlement sexuel et de violence. Françoise Vergès (2020, p. 127) parle de l’économie de la dépense des corps des femmes racialisées pour que les autres, les femmes blanches, les bourgeoises, puissent jouir de la ville propre, faire des promenades dans des jardins fleuris.
Comme le sexisme et le racisme se basent sur des différences biologiques pour s’affirmer en tant qu’idéologies de domination, Lélia Gonzalez (2020, p. 141) explique qu’elle perçoit le problème racial par le biais de ce que quelques sociologues caractérisent comme racisme par omission et dont les racines se trouvent dans une vision de monde européocentrique et néocolonialiste. En partant de deux concepts de la Psychanalyse lacanienne, celui de infans et celui de sujet supposé savoir, ainsi que des études d’Albert Memmi et de Frantz Fanon concernant la psychologie du colonisé, elle postule que: 1. Les femmes et les Noirs sont infantilisés et classifiés par un système idéologique de domination de manière à ne devenir sujets ni de son histoire ni de son discours; 2. Les femmes et les Noirs fabriquent des identifications imaginaires avec des figures de pouvoir, censés avoir des connaissances qu’elles/ils ne possèdent pas. Ainsi se rapproche-t-elle de l’affirmation de Pierre Bourdieu (2010, p. 46) concernant l’acceptation de la domination de la part des dominés qui appliquent des catégories construites du point de vue des dominants, en les rendant naturelles. Ce comportement peut amener les dominés à une espèce d’autodépréciation voire d’automépris systématiques. Par conséquent, la résistance contre l’imposition symbolique doit se faire par le biais d’une lutte cognitive qui, parfois, semble perdue, tant la résistance aux changements sociaux et culturels est forte. Les femmes, pour la plupart, continuent d’être sexistes et adoptent des attitudes qui favorisent la prévalence des hommes.
La prise de conscience et le changement de position propres au féminisme noir de Lélia Gonzalez correspondent à une transformation d’objets parlés par les autres en sujets de son propre discours, des sujets qui écrivent, qui font des discours dans des forums et présentent des propositions. Comme le signale Grada Kilomba (2019, p.28), le passage d’objet à sujet est ce qui marque l’écriture comme un acte politique. Il ne suffit pas de s’opposer au racisme, il faut devenir sujet, jouer un rôle sur la scène publique, sortir de l’invisibilité et échapper aux stéréotypes appliqués aux femmes noires.
La philosophe Sueli Carneiro (2018) a un profil d’activiste et n’est pas reliée au monde universitaire. Elle a créé le Geledés – Institut de la Femme Noire en 1988, qu’elle dirige jusqu’à présent. Le Geledés est né « comme une proposition d’actualisation et d’adéquation de matrices culturelles noires-africaines aux nécessités contemporaines de la lutte noire, en particulier des femmes noires » (Carneiro, 2018, p. 171). Le Geledés a un site qui véhicule des articles et des nouvelles concernant les droits et les revendications de la population noire. Il contribue à l’organisation des femmes noires à travers certains programmes tels que la préparation d’études et de documents présentés dans des conférences internationales. L’entrée de militantes du Mouvement Noir Unifié (MNU) dans le mouvement des femmes les a fait prendre conscience des questions de classe/race et a donné une nouvelle dimension aux luttes :
En politisant les inégalités de genre, le féminisme transforme les femmes en nouveaux sujets politiques […] des groupes de femmes amérindiennes et des groupes de femmes noires […] ont des demandes spécifiques qui, fondamentalement, ne peuvent pas être exclusivement traitées à partir de la question du genre (Carneiro, 2018, p. 198).
Étant donné que chaque groupe a besoin de pratiques particulières, Sueli Carneiro (2018) propose de « noircir » le féminisme, c’est-à-dire de délimiter et d’instituer dans l’agenda du mouvement des femmes le poids qu’a la question raciale sur la configuration de politiques démographiques, sur l’introduction du concept de violence raciale, sur la discussion autour des maladies ethniques/raciales (avec la création de politiques publiques visant des populations spécifiques) et sur la critique de la notion de « bonne apparence » sur le marché du travail.
La pensée de Sueli Carneiro (2018) est très proche de celle de Lélia Gonzalez en ce qui concerne la critique du racisme et de l’imposition d’un modèle unique de savoir et de canon de beauté : « L’imposition d’un sujet universel auquel seraient réduits tous les humains a obscurci, au fil du temps, les idéologies discrétionnaires qui promeuvent les inégalités entre les sexes, les races, les classes sociales, les religions, etc. » (Carneiro, 2018, p. 134). Les idéologies discrétionnaires sont le patriarcat, l’élitisme, l’homophobie, le fondamentalisme religieux et le racisme. Il faut valoriser la diversité pour réconcilier tous les êtres humains. C’est ce qui incombe aux prochaines générations afin de promouvoir une véritable mission civilisatrice (donc différente de la mission civilisatrice de l’Occident dans le cadre de son projet colonial).
Ces deux penseuses et activistes brésiliennes sont contemporaines de Conceição Evaristo (née en 1946), qui a su vaincre maints obstacles pour s’imposer dans le domaine de la littérature. Aujourd’hui, elle est une figure reconnue et renommée. Comme tant d’autres militants noirs, parmi lesquels le nom d’Abdias do Nascimento est incontournable, ces femmes ont été les moteurs d’une transformation : si Millôr Fernandes (cité plusieurs fois par Gonzalez) affirmait qu’il n’y avait pas de problème racial au Brésil parce que les Noirs connaissaient leur place, désormais les Noirs rejettent fortement ce lieu subalterne qui leur a été attribué et affirment que leur place se trouve là où ils veulent être.
Il convient également de mentionner l’œuvre singulière de Carolina Maria de Jesus (1914-1977), qui a eu un impact considérable à partir de 1960 avec le livre Le dépotoir : le journal intime de Carolina Maria de Jesus, lancé en France en 1962. Conceição Evaristo raconte que sa mère a été tellement touchée par ce livre qu’elle s’est mise elle-même à écrire un journal. En dépit d’un faible niveau scolaire, Carolina Maria de Jesus a laissé une œuvre immense, qui est en train d’être répertoriée et publiée. D’une grande fortune critique, elle a été traduite maintes fois à l’étranger. Dans un entretien au journal O Globo, la chercheuse Giovana Xavier (2019) signale que l’écrivaine doit être présentée comme une intellectuelle plutôt que comme une habitante de bidonville. Assurément ! Dans Journal de Bitita, elle interprète le Brésil depuis son lieu de femme pauvre et noire, qui voit comment fonctionne la société brésilienne : des employées de maison exploitées qui travaillent de 6h00 à 23h00 sans temps de repos, des filles noires abusées par les patrons (pères et fils), qui tombent enceintes et doivent se débrouiller seules pour élever leurs enfants ; des hommes noirs accusés injustement et persécutés par la police ; pas d’accès à la santé et ni à l’éducation pour les pauvres ; un racisme qui s’exprime au quotidien, des enfants insultés dès leur plus jeune âge.
C’est en tombant sur le roman A escrava Isaura [L’esclave Isaura] dans un tiroir qu’elle a découvert le plaisir de la lecture et fait amplement connaissance avec l’histoire du pays : « C’est par l’intermédiaire des livres que j’apprenais sur les guerres menées au Brésil […]. Je condamnais cette forme brutale et inhumaine choisie par l’homme pour résoudre ses problèmes (Jesus, 2014a, p. 179). Malgré les difficultés, elle achève sur ces mots : « Je ne suis pas entrée dans le monde par le salon. Je suis entrée par le jardin. J’allais gagner parce que j’étais autre » (Jesus, 2014a, p. 200).
Mettre ces figures en évidence ne revient pas à ignorer ou à sous-estimer le travail d’autres activistes et écrivaines de la même génération, qui ont aussi contribué à préparer le terrain pour de jeunes militantes comme Djamila Ribeiro, auteure de La place de la parole noire et Petit manuel antiraciste et féministe (traduits chez Anacaona); ou Rosane Borges, avec Esboços de um tempo presente [Ébauches d’un temps présent] ; ou encore Joice Berth, auteure de Empowerment et féminisme noir (traduit chez Anacoana). Et bien d’autres encore. Les livres de Djamila Ribeiro (2017) ont eu beaucoup de répercussions et ont suscité un débat intense. La place de la parole noire s’insère dans le projet de réfutation de l’historiographie et de la hiérarchisation de savoirs : « Quand on parle de droit à une existence digne, à la voix, on parle de locus social, de la manière dont ce lieu imposé rend difficile la possibilité de transcendance. Cela n’a absolument rien à voir avec une vision essentialiste selon laquelle seul le Noir peut parler du racisme, par exemple » (Ribeiro, 2017, p. 64).
De fait, il serait déplacé d’imaginer une femme blanche se raconter au nom d’une personne noire, car son expérience personnelle est forcément différente. Toutefois, elle doit se joindre aux Noirs pour combattre le racisme. bell hooks et Chimamanda Adichie, par exemple, invitent les hommes à devenir féministes en luttant contre le sexisme (en particulier celui qui a été intériorisé par la socialisation machiste des garçons). Au Brésil, l’université reçoit de plus en plus d’étudiants et de professeurs noirs, en partie grâce à la politique des quotas. Pour reprendre Sueli Carneiro, peut-être cela pourrait-il contribuer à « noircir » le milieu universitaire.