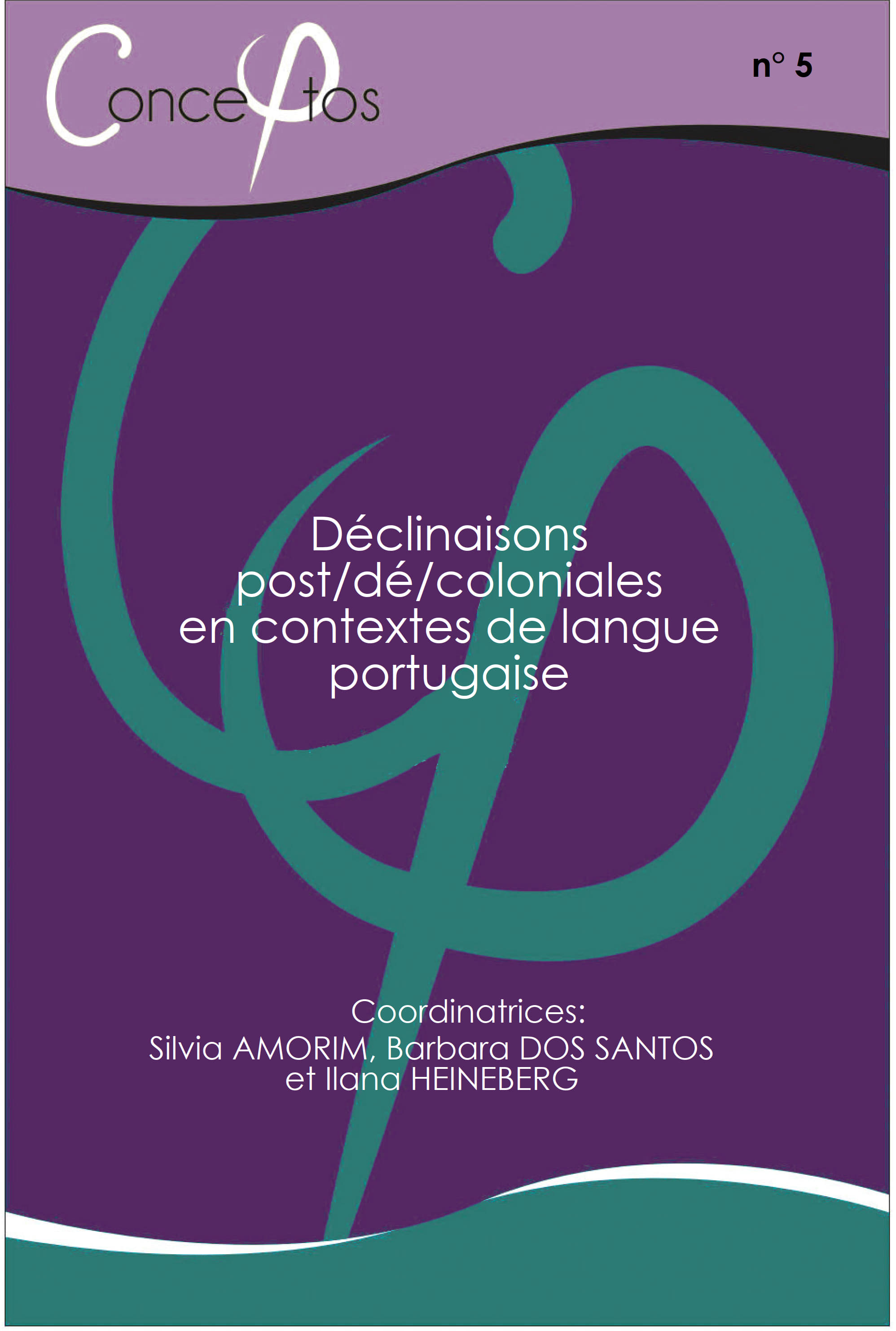Déclinaisons post(-)coloniales à la portugaise ? Théorie postcoloniale et culture nationale au Portugal1
Il peut sembler paradoxal d’accoler une « nationalité » – ici portugaise – à la pratique de l’approche postcoloniale, tant cette approche, qui prend place à l’époque de l’épanouissement de la mondialisation, se veut par définition « transnationale »2. Cependant, dans les diverses générations de la pensée postcoloniale, personne ne contestera que la territorialisation a joué un rôle. Ainsi, en ce qui concerne la première génération, le contexte bengali postérieur à la Seconde Guerre mondiale et à l’indépendance de l’Inde a pesé lourd dans l’émergence de ce qu’on a ensuite appelé les Subaltern Studies, formalisées au début des années 19803, puisqu’il s’agissait de s’opposer à une vision modernisatrice et développementaliste très liée aux visions du Parti du Congrès et du Parti communiste indien. Ces derniers ne reconnaissaient pas le caractère politique de certaines révoltes paysannes, parce qu’elles étaient de facture religieuse et donc « archaïques » et cadraient mal avec le modèle des luttes prolétariennes urbaines ou rurales.
Par ailleurs, il ne faut pas sous-estimer cet autre « lieu » qu’est la langue : la fortune des Subaltern Studies a été grandement facilitée par l’installation de chercheurs indiens en Australie et aux États-Unis et par de là en Angleterre. Peut-être n’est-il pas dû au hasard que, lors de la naissance de la deuxième génération4, l’ouvrage The Empire Writes Back, de 1989, considéré comme l’acte fondateur des Postcolonial Studies en littérature, soit le fruit de chercheurs australiens, citoyens d’une ancienne colonie de peuplement5.
Pourtant, on a là quatre situations historiques complètement différentes : une ancienne colonie dont les « indigènes » ont obtenu l’indépendance – l’Inde ; une ancienne colonie dont les colons ont obtenu l’indépendance – l’Australie ; une ancienne puissance coloniale – le Royaume-Uni ; et une grande puissance impérialiste ayant pratiqué à large échelle ce qui a été qualifié de « colonialisme interne »6 – les États-Unis d’Amérique. Le facteur linguistique, qui est aussi un facteur identitaire, a évidemment lourdement pesé dans la maturation conjointe des Postcolonial Studies dans ces pays anglophones, aux côtés d’autres facteurs comme la faiblesse du marxisme en leur sein (ou la réaction à un certain marxisme comme en Inde), l’émergence précoce des Areas Studies et des Cultural Studies, évidemment en rapport avec les types particuliers de pratiques multiculturelles dans ces pays.
C’est certainement très complexe et il n’y a aucun déterminisme, mais on ne peut pas ne pas penser qu’il y a un facteur identitaire dans l’émergence d’un certain type d’étude dans certains pays, même quand ces études se veulent, par définition, « transnationales ». Il y a aussi un rapport de domination, puisque les écrits de langue anglaise sont infiniment plus nombreux que tous les autres réunis et que la langue anglaise est devenue la lingua franca d’intercommunication générale, rejetant plus ou moins les autres langues dans une situation de subalternité. Le phénomène de copie, de mode, a aussi joué : combien de titres de livres ou d’articles publiés hors monde anglophone ne contiennent-ils pas les vocables « post(-)colonial » et plus récemment « décolonial », là où, dix ou vingt ans avant, pour un contenu strictement identique, ces derniers ne seraient pas apparus ? Mais, au-delà de la mode et de la copie, il est évident que l’influence énorme des « sciences sociales anglophones » sur le reste du monde a puissamment joué, même si des « retards » ou plutôt des « écarts » sont à noter, comme l’avait dit joliment Christine Chivallon7.
Ce qui est certain est que des aires importantes ont été retardataires, ou rétives, à « importer », ou à utiliser la problématique des Postcolonial Studies. Le cas de la France est bien connu, avec ses oppositions hétérogènes (marxistes, jacobines…) et la situation paradoxale d’une entrée tardivement bien établie8, pratiquement au moment où les Postcolonial Studies et les Subaltern Studies commencent à être délaissées dans les pays anglophones, du moins en sciences sociales. Mais d’autres aires gigantesques sont à noter : je pense à l’Amérique latine dans son ensemble (Coronil, 2015), qui avait connu précocement une certaine problématique subalterniste dans les années 1960-1980, avec le courant « cépaliste » (CEPAL, Commission économique pour l’Amérique latine) que l’on considérait à l’époque comme tiers-mondiste de gauche, mais sans aucun rapport ni même simple connaissance de ce que les Subaltern Studies commençaient à faire en Inde. Le courant cépaliste n’avait guère abordé la question indigène, exprimant plus la subalternité d’anciens milieux coloniaux (descendants des colons hispaniques et leurs esclaves) que celles des sociétés colonisées (« indigènes », Indiens). Au Brésil, les études postcoloniales ont été particulièrement tardives à pénétrer (Cahen et Braga, 2018). Plus tard, ce qui s’est développé en Amérique latine sont les concepts de colonialité et du décolonial, que l’on raccroche généralement aux Postcolonial Studies, alors que leur généalogie est très différente, venue d’une intersection entre l’école wallersteinienne du système-monde et le marxisme mariatéguiste péruvien9. Mais là encore il y a des nuances : si le concept de colonialité est largement accepté dans toute l’Amérique andine, centrale, et même en Argentine, il ne l’a longtemps été que très peu au Brésil – pour des raisons historiques que je ne peux évoquer ici10.
L’uniformisation globalisée de la pensée connaît donc de sérieuses limites, et c’est tant mieux. Il n’en reste pas moins que, lorsqu’on lit un ouvrage de Postcolonial Studies, ou de critiques aux Postcolonial Studies, ce qui est évoqué dans la grande majorité des cas est une production théorique dans les pays anglo-saxons, sans guère d’attention ni à l’Amérique latine, ni à l’Asie hors Inde, ni au monde arabe, ni à l’Allemagne ou encore aux mondes post-soviétiques. Or, la démarche « transnationale » des Postcolonial Studies devrait nous vacciner contre un tel tropisme, malgré les évidentes difficultés (comme le simple fait de devoir savoir des langues autres que l’anglais).
Pour ma part, dans le cadre d’un projet de recherche plus général sur la colonialité, je projette une étude spécifique sur l’appréhension des Postcolonial Studies dans les pays de langue portugaise11. Cet assemblage de pays est évidemment purement empirique et, à n’en point douter, malgré le point commun que constitue l’histoire coloniale portugaise, il s’agit de pays complètement différents. Même si l’on prend uniquement les pays africains, qu’y a-t-il de commun entre un archipel créole dont la société a été entièrement façonnée par le colonisateur, comme le Cap-Vert, et des pays « indigènes » envahis par le colonisateur, comme l’Angola et le Mozambique ? Un point commun sera notamment la langue portugaise, qui est justement la langue de travail des intellectuels de ces pays, « producteurs de théorie » et on ne s’étonnera pas que ce qui s’écrit au Brésil aura un poids particulier en Angola ou au Portugal, que ce qui s’écrit au Cap-Vert (comme la réflexion intense sur la créolité) pénètrera plus facilement au Portugal, etc. Mais le « monde lusophone » a justement l’avantage de son hétérogénéité sur quatre continents : en l’étudiant, on étudie en fait le monde entier.
Quelques précautions préalables
Ici, j’étudierai plus spécifiquement le Portugal. Mais je veux auparavant revenir sur la confusion qui continue à trop exister, partout et aussi au Portugal, entre le postcolonial (sans trait d’union) et le post-colonial (avec trait d’union ou, en portugais, avec juste un espace : pós colonial). L’avertissement a été donné précocement, mais la confusion a perduré12. Je mets personnellement mes pas (Cahen, 2011 octobre) plus particulièrement dans ceux d’Emmanuelle Sibeud (2007) et de Christine Chivallon (2007), qui avaient attiré l’attention sur une indispensable distinction à opérer : d’une part le post-colonial (avec trait d’union ou espace) comme désignant une époque après la colonisation, qui peut néanmoins rester empreinte de divers régimes de colonialité ; d’autre part une approche postcoloniale (sans trait d’union ou espace : póscolonial) qui, dans sa réflexion théorique, cherche à dépasser les scories de la pensée coloniale eurocentrée parfois incrustées là où on les attendrait le moins, une approche qui est donc au-delà de la pensée coloniale eurocentrique, mais sans aucune dimension chronologique particulière.
En principe, la distinction est claire. Mais elle l’est beaucoup moins dans la réalité. Beaucoup d’études « postcoloniales » parlent en effet de la « France post(-)coloniale » ou du « Portugal post(-)colonial ». Or, si le Portugal d’aujourd’hui est, évidemment, « post-colonial » dans la mesure où, sans même parler du Brésil (1822), il a perdu ses colonies entre 1960 (S. João Baptista de Ajuda), 1961 (Goa) et 1999 (Macao), avec le moment fort de 1974-1975 (les cinq colonies d’Afrique et Timor Oriental), peut-on pour autant considérer qu’il s’agit d’une société post-coloniale, d’un « Portugal post-colonial » ? Si tel est le cas et si les mots ont un sens, cela signifie que l’héritage colonial reste l’élément le plus structurant pour la société portugaise entière : c’est la transmission qui serait structurante. Par exemple, on peut dire : « il y a des Brésiliens, des Capverdiens et des Bissau-Guinéens émigrés au Portugal principalement à cause du passé colonial ». Je prends cet exemple volontairement, parce qu’il montre qu’il y a évidemment une dimension de transmission coloniale dans cet état de fait. Mais cette dimension ne saurait relativiser le fait que c’est la production contemporaine de subalternité qui pousse à émigrer : dans ce cadre interviennent d’autres dimensions, comme le facteur linguistique, les relations de parenté, etc. La décision d’émigration étant prise, il s’avère plus facile de la concrétiser au Portugal qu’en Allemagne. Il y a donc bien une dimension post-coloniale dans l’émigration, mais ce n’est pas sa nature première, qui n’est pas post-coloniale. Pour le montrer, il suffit de prendre l’exemple de la communauté immigrée qui fut la seconde en importance au Portugal dans les années 1990-2000, après la brésilienne, à savoir la communauté ukrainienne, à laquelle on peut ajouter la communauté moldave. Il n’y a là aucun passé colonial et pourtant on ne va pas établir une muraille de Chine entre les causes des émigrations capverdienne et ukrainienne vers le Portugal.
C’est d’ailleurs une critique fréquemment faite aux études postcoloniales, à savoir l’essentialisation de l’héritage et l’aspect fragmentaire de l’analyse (par exemple, considérer le Portugal comme post-colonial en raison d’immigrés africains des anciennes colonies, sans réfléchir à la présence massive des Ukrainiens). Cependant, d’autres auteurs ont été trop loin, remettant complètement en cause le rôle de la mémoire et des héritages – Romain Bertrand par exemple (2006). Personnellement je pense qu’il y a une dimension postcoloniale dans la production contemporaine de subalternité, fondamentalement non post-coloniale. On peut raisonner de la même manière à propos des émeutes françaises de 200513, etc. C’est la société actuelle qui produit la perpétuation de l’héritage. Ainsi, beaucoup d’héritages coloniaux disparaissent rapidement quand ils n’ont plus d’utilité sociale contemporaine ; à l’inverse ils persistent, voire se développent, s’ils jouent un rôle social renouvelé dans un contexte contemporain.
On peut donner les exemples contraires de Goa et Macao d’une part, et de Timor et Malacca d’autre part. Alors que Goa et Macao sont les seuls territoires où le mythe des « cinq siècles de colonisation » a un certain fondement, plus personne n’y parle portugais. À Malacca en revanche, ville dominée par les Portugais seulement de 1511 à 1641, persiste encore, quoiqu’en déclin prononcé, un créole de base lexicale portugaise, le Papia Kristang, utile pour stabiliser l’identité de pêcheurs chrétiens dans un contexte musulman14. Et à Timor, on parle certes peu le portugais, mais on le parle plus aujourd’hui qu’en 1975, car cette langue, langue de l’Église catholique, a été un vecteur de résistance contre la recolonisation indonésienne. Dans ces deux cas, c’est l’utilité sociale qui a fait perdurer l’héritage, et non pas l’héritage qui se serait maintenu tout seul par les simples liens familiaux, au-delà du bouleversement des contextes.
Un Portugal post-colonial ?
Revenons-en au Portugal. On l’a dit, le pays a perdu toutes ses colonies entre 1960 et 1999. Les décolonisations africaines de 1975 ont signifié la fantastique convergence d’une révolution coloniale africaine et d’une révolution démocratique européenne en 1974, transcroissant rapidement au Portugal en révolution sociale en 1975 (le concept trotskien de révolution permanente exprime parfaitement ce processus15).
L’anticolonialisme portugais, chrétien, socialiste, communiste, etc., était devenu massif, mais cela ne signifia nullement que l’idée coloniale, en tant que grand récit national portugais (Léonard, 1998), ait sombré avec les colonies. Il est impossible ici de détailler les raisons de cette persistance bien après la décolonisation, qui s’exprime souvent par le biais post-impérial de l’idéologie de la lusophonie, il est vrai beaucoup plus dans les médias (Cahen, 1997) que dans les sciences sociales16. Toutes les nations sont spécifiques, mais au Portugal, il s’agit de la tradition de l’exceptionnalité nationale et coloniale17. Elle a survécu sous plusieurs formes :
- l’idée, encore assez courante, que la colonisation portugaise n’a pas été raciste ;
- l’idée de la « décolonisation exemplaire », totalement contraire à la réalité (implantation de partis uniques dans les nouveaux pays africains, guerres civiles, etc.) ;
- l’idée que le Portugal, justement parce qu’il était pauvre et retardataire, aurait des relations d’une qualité particulière avec ses anciennes colonies : en clair, il serait incapable aujourd’hui d’être une puissance néocoloniale et n’aurait jamais été vraiment une métropole impérialiste ; dans le contexte de 1974-1975, le tiers-mondisme et le lusotropicalisme18 ont fait bon ménage…
- l’idée que la langue portugaise était le ciment pour une espèce de supranationalité commune, la « lusophonie » étant la patrie commune de gens certes différents mais d’origine commune, avec l’us et l’abus ad nauseam de la déclaration de Fernando Pessoa totalement sortie de son contexte et dont le sens a été carrément inversé : « Minha pátria é a língua portuguesa » (« Ma patrie est la langue portugaise »)19 – inutile de dire que le discours sur les origines, les « siècles de convivialité » et l’identité commune est totalement refusé par les Africains et donc contre-productif, et accepté seulement partiellement au Brésil. On avait là une forme renouvelée de lusotropicalisme.
- l’idée que le Portugal « connaît » intimement l’Afrique et peut vendre cette connaissance à l’Union européenne, etc.20
Tout cela a eu comme conséquence politique et universitaire que, de 1975 à 1990, la critique des intellectuels portugais contre les dictatures de partis uniques en Afrique a été quasiment inexistante – alors que celles d’Amérique latine étaient justement dénoncées. C’était comme si le fait d’être citoyen de l’ancienne métropole coloniale interdisait toute approche critique de la situation dans les nouvelles Républiques issues des anciennes colonies. Le soutien aux décolonisations fut confondu avec un soutien aux nouveaux régimes politiques. Il s’est clairement agi d’un « anti-eurocentrisme eurocentrique » ou d’un « anti-impérialisme paternaliste », dans la mesure où les intellectuels portugais, tétanisés par leur propre passé colonial, ne voulaient pas « calquer des modèles de démocratie européenne » sur des pays africains. Le problème est que, de ce fait, ils établissaient une différence essentielle entre les besoins des Européens (la démocratie) et ceux des Africains (qui n’avaient pas besoin de démocratie à l’époque de la « production de la nation »). Le fait que le Mouvement des Forces armées eût détruit le régime de parti unique au Portugal en 1974, mais qu’il eût partout favorisé la création de régimes de partis uniques en Afrique en 1975, ne posa, et ne pose toujours, aucun problème, à droite comme à gauche… On voit clairement ici comment l’absence d’une optique subalterniste dans les sciences sociales portugaises – qui part des besoins des gens eux-mêmes, si humbles et « archaïques » fussent-ils –, a continué à peser pendant quelques années et perdure sans doute.
La production d’une pensée critique portugaise envers l’Afrique est lentement apparue, surtout après les tournants néolibéraux et pluralistes des années 199021, et plus nettement au début du xxie siècle. L’expression de plus en plus forte, notamment artistique et musicale, de la première génération de jeunes Noirs nés au Portugal de parents immigrés africains, provoqua aussi des études « multiculturelles » et « post(-)coloniales ». Dans ce contexte, les études postcoloniales ont commencé à apparaître, principalement en littérature et études culturelles22 et seulement un peu plus tard en sciences sociales, sur lesquelles porte ma recherche23. Mais mon impression – à fonder et à vérifier – est que cela a parfois maintenu un mélange entre la simple copie de modèles postcoloniaux anglo-saxons et des traces de vieille idéologie nationale plus ou moins lusotropicaliste : par exemple, le jargon postcolonial put coexister fort bien avec la croyance en une colonisation ayant produit un « métissage sans égal » et des rapports d’une qualité particulière entre Blancs et Noirs24.
Par ailleurs, des universitaires portugais·e·s ayant publié des articles ou des livres incluant le mot « post(-)colonial », me dirent sans difficulté au cours d’entretiens (en 201425) qu’ils ou elles n’appliquaient pas nécessairement les concepts de l’approche postcoloniale, ou qu’ils/elles les avaient déjà abandonnés, ou encore les appliquaient au sens purement chronologique26. Il s’agissait donc parfois d’une simple séduction temporaire. Cette dernière, cependant, avait parfois permis de se poser des questions nouvelles.
Au plan des sciences sociales, il y eut alors une grande hétérogénéité au Portugal – ce qui n’est pas pour surprendre –, entre des études vraiment très lusotropicalistes27, d’autres rompant complètement avec cette tradition28 et enfin des études de posture radicale, entrant cependant rarement dans la critique subalterniste directe des régimes africains avant les années 2000.
C’est ici qu’il faut citer le cas du Centro de estudos sociais de Coimbra, fondé par Boaventura de Sousa Santos. Ce centre est un des plus importants et, à n’en pas douter, un des meilleurs centres de recherche sociale au Portugal, qui ne se résume pas à son célèbre fondateur et longtemps directeur. Sousa Santos est extrêmement connu au Portugal – haï ou adulé, rarement analysé de manière critique et scientifique –, très connu également en Afrique dite lusophone et au Brésil. Il ne s’agit pas ici de présenter son œuvre en général et sa production foisonnante, mais seulement de donner quelques axes relatifs au postcolonial29.
Un postcolonial radical ?
Jusqu’au début du xxie siècle, Boaventura de Sousa Santos ne se réclamait pas des études postcoloniales mais postmodernes30. Il fut ainsi l’auteur de travaux fortement contestés sur la science31 et accusé de la rabaisser à l’état de simple « savoir » aux côtés d’autres savoirs comme le bon sens populaire, la religion, etc., sous prétexte que la science n’est évidemment pas indépendante des grands systèmes de pensée et de l’idéologie dominante. Il était fidèle à la dénonciation des grands récits, etc. Cependant, il était aussi très critique envers ce qu’il appela le « postmodernisme de contemplation », dans la mesure où, jamais, il ne renonça à réfléchir et à théoriser sur les conditions de l’émancipation sociale. Il se définissait donc comme un « postmoderne d’opposition ». Au début du xxie siècle, pour des raisons qu’il rappela lors de son discours d’ouverture au VIIIe Congrès luso-afro-brésilien de sciences sociales tenu à Coimbra les 16-18 septembre 2004 – auquel j’assistai32 –, il abandonna la revendication « postmoderne » pour celle de « postcoloniale », également d’« opposition ». On aurait donc pu s’attendre à ce que la dimension politique de la critique postcoloniale soit plus développée que sa dimension épistémologique habituellement dominante, mais ce ne fut jamais très net. B. de Sousa Santos publie très souvent des prises de position directement politiques dans la presse, mais ses ouvrages d’auteurs ou édités sont, de manière écrasante, limités à l’épistémologie, renvoyant les traductions politiques de ses conceptualisations à un futur indéfini. Il reste cependant fidèle à son passé postmoderne sur la question des grands récits (qui ne fait pas consensus parmi les postcoloniaux), ayant écrit que « nous n’avons pas besoin d’une théorie générale, mais nous avons encore besoin d’une théorie générale de l’impossibilité d’une théorie générale »33. J’ai critiqué en 2018 ce postmodernisme persistant et son aspect étonnant en pleine globalisation – le capitalisme a, lui, au moins, une « théorie générale » (Cahen, 2018a). Mais ce n’est pas sur ces aspects que je veux ici mettre l’accent.
Dans sa posture de « postcolonial d’opposition », Boaventura de Sousa Santos a toujours appelé ses concitoyen·ne·s à ne pas simplement copier les analyses postcoloniales anglo-saxonnes, mais à développer un modèle propre, enraciné dans l’histoire de leur pays, en dialogue avec les pays issus de la décolonisation (y compris le Brésil) et bien sûr tous les autres. Je voudrais alors aborder trois thèses défendues par Boaventura de Sousa Santos dans cet effort a priori salutaire d’originalité et d’émancipation face au modèle anglo-saxon : la nature semi-périphérique du Portugal, l’impérialisme par substitution, et la thèse de l’ambivalence et de l’hybridation.
Selon B. de Sousa Santos, le « postcolonialisme portugais » (au sens de l’approche postcoloniale portugaise) devrait décrire le Portugal comme un pays « semi-périphérique », avec toute une série de conséquences économiques, politiques et culturelles dans sa trajectoire sur la longue durée et jusqu’à aujourd’hui. Après avoir fait partie du centre du monde aux xv-xviie siècles avec l’Espagne, le Portugal aurait été repoussé à la semi-périphérie, principalement par l’Angleterre, à partir du xviiie siècle – mais cette situation aurait perduré jusqu’à nos jours34. Cela aurait produit une situation dans laquelle son impérialisme colonial n’aurait pu survivre que comme sous-impérialisme de l’Angleterre, la métropole elle-même étant une semi-colonie de la première. De ce fait, les colonisés, en Afrique – le Brésil étant désormais indépendant (1822) – auraient eu un colonisateur apparent, portugais, et réel, anglais. Entre « sous-colonisation » ou « hyper-colonisation » et probablement un mélange des deux, les colonisés finalement n’auraient plus su exactement qui les colonisait ou même s’ils étaient colonisés, ce qui aurait produit un problème identitaire pour eux-mêmes et brouillé la constitution d’une conscience de colonisé, l’assimilation à l’identité coloniale étant également très forte.
Par ailleurs, à la différence du colonialisme anglais, le colonialisme portugais aurait été fortement marqué par l’hybridation et l’ambivalence : pendant une longue période, une hybridation aurait régné entre colonisateurs et colonisés, loin de la polarisation anglo-saxonne ; cette ambivalence s’avèrerait aussi sur le plan racial, non point pour dire qu’il n’y aurait pas eu de racisme, mais un racisme différent retardant d’autant la revendication anti et postcoloniale ; et enfin, comme on vient de le voir, cette ambivalence serait également identitaire35.
Or chacune de ces thèses est grandement contestable d’un point de vue historique et dans ses conséquences politiques.
La thèse de la semi-périphérie portugaise
D’une part il faut remarquer que Boaventura de Sousa Santos défend cette thèse sans jamais l’avoir étayée d’un appareil statistique, par des statistiques disponibles dès le xixe siècle ou, pour la période la plus contemporaine en comparant les PIB per capita ou les IDH du Portugal et de pays consensuellement considérés comme semi-périphériques comme le Maroc, la Turquie, le Brésil ou le Mexique. C’est pour lui une donnée qu’il ne pense pas avoir à démontrer tant il doit penser rencontrer l’assentiment général. Il n’a pas entièrement tort car il y a une véritable tradition sur ce point au Portugal dessinant presque une identité : le Portugal ne fait pas partie du centre du monde, donc il est proche de ses anciens colonisés. Bien qu’il ne les cite jamais, cela n’est qu’une expression moderne des thèses défendues au xixe siècle par Alexandre Herculano et développées par Antero de Quental et Oliveira Martins36. Or, s’il est plus qu’évident que le Portugal du milieu du xviiie siècle, du début du xxe, des années 1950 ou même d’aujourd’hui n’était et n’est pas l’Angleterre des débuts de la révolution industrielle, de l’impérialisme triomphant, de la décolonisation maîtrisée ou du partenariat spécial avec les États-Unis et de la plus grande place financière mondiale qu’est aujourd’hui la City malgré le Brexit, que veut dire « semi-périphérie » ?
La construction d’une catégorie intermédiaire, bien constituée, entre les pays du centre et ceux de la périphérie pose problème. Il y a naturellement une gradation infinie entre les deux pôles du capitalisme, à savoir son cœur où qu’il soit géographiquement situé, et les régions les plus marginalisées de la planète, mais cela ne produit pas une catégorisation nette. On peut appeler « semi-périphérie » – donc un « espace » hors du capitalisme central – des pays de la périphérie qui, néanmoins, en raison de leur histoire dans le cadre du système-monde, ont un certain degré d’autonomie et une bourgeoisie nationale séculairement constituée, malgré leur dépendance plus ou moins accentuée. Ainsi dans les années 1920, le Brésil, le Mexique ou l’Argentine n’étaient pas comparables à l’Oubangui-Chari, au Bechuanaland ou encore à la Nouvelle Guinée et aujourd’hui ne sont toujours pas comparables à la République Centrafricaine, au Botswana et à la Papouasie. En quelque sorte, les premiers constituaient et constituent l’élite de la périphérie, hors du centre. La IIIe Internationale parlait dans ses thèses de « pays semi-coloniaux ».
Mais où se situe le Portugal dans cette gradation ? La comparaison de ce pays avec le Brésil est instructive. Vers 1950, alors que le Brésil connaissait un vigoureux début d’industrialisation après la Seconde Guerre mondiale, le PIB per capita du Portugal, alors au pire moment de l’archaïsme salazariste, était supérieur à celui du Brésil. Les années ultérieures, il s’en dissocia plus encore.
| Années | Brésil | Portugal | France |
| PIB per capita en parité de pouvoir d’achat en dollars constants de 2019 | |||
| 1950 | 3 739 | 4 718 | 10 109 |
| 1975 | 9 366 | 14 737 | 25 257 |
| 2000 | 11 956 | 31 899 | 41 645 |
| 2019 | 15 114 | 36 489 | 48 025 |
Sources : Total Economy Database, <https://www.conference-board.org/data/economydatabase/total-economy-database-productivity-growthaccounting>37.
Naturellement, ces considérations quantitatives sont insuffisantes, il faudrait également analyser finement les formations sociales et les processus d’accumulation du capital : on verrait alors que le Portugal, même retardataire en Europe, avait une formation très différente de celle du Brésil encore profondément façonnée par la colonialité. Pour s’en sortir, il faut raisonner historiquement : si le Portugal avait été repoussé à la semi-périphérie du monde, comme le furent les pays arabo-ottomans et ibéro-américains à partir du milieu du xviiie siècle, il aurait perdu la totalité de ses colonies et même son indépendance. Le fait qu’il soit situé en Europe n’empêchait nullement sa colonisation, comme le démontrent les exemples irlandais ou polonais, ou les pays d’Europe orientale jusqu’à tardivement intégrés à l’empire ottoman. On peut aussi parler du Mexique, qui perdit la moitié de son territoire après 1848, mutilation inscrivant clairement son positionnement désormais subalterne face aux États-Unis. Or le Portugal a, contre vents et marées, jalousement préservé son indépendance et son empire, et a été au bord de la guerre avec l’Angleterre en 1890 pour cela.
Il est donc tout à fait différent de dire que le Portugal était (et est) à la périphérie dans le centre, ou à la périphérie du monde, fût-elle « semi », certes, mais extérieure au centre. Le Portugal fut, avec Venise, Gênes et l’Espagne, fondateur du système-monde capitaliste et une telle position aurait certes pu être perdue, mais les conséquences politiques en auraient été gigantesques. Or le Portugal a participé à la famille des impérialismes européens à la fin du xixe et au xxe siècle38, a participé à la Première Guerre mondiale dans l’un des deux camps impérialistes pour préserver son empire et a résisté à toutes les pressions décolonisatrices après la Seconde Guerre mondiale. Le Portugal était un pays pauvre et retardataire, mais nationaliste et capable de sauvegarder son indépendance et son impérialisme. Sur la longue durée, ce fut et c’est un pays du centre du monde capitaliste. C’est aujourd’hui une nation moderne d’Europe, pas du tout « semi-périphérique »39.
Mais ce qui est intéressant, c’est de comprendre pourquoi la caractéristique « semi-périphérique » a été si facilement admise par bien des gens – y compris et peut-être surtout pendant le PREC40 – alors qu’elle aurait pu froisser le patriotisme sourcilleux de l’élite et du peuple portugais, et pourquoi elle est restée présente aussi dans le « postcolonial à la portugaise ». J’y reviens par l’analyse de la deuxième thèse de Boaventura de Sousa Santos.
La thèse de l’impérialisme par substitution
Cette thèse est la conséquence mécanique de la première. Pas plus que pour la thèse de la semi-périphérie, Boaventura de Sousa Santos ne l’étaye par des sources historiques, montrant en quoi, sur le terrain, le vrai maître était le Britannique. Or il est très intéressant de ce point de vue d’étudier un cas extrême, celui de la Compagnie du Mozambique, une compagnie à charte fondée en 1891 suite à l’ultimatum du Royaume-Uni avec des capitaux majoritairement britanniques et qui « régna » jusqu’en 1941 sur tout le centre de la colonie (une superficie de trois fois celle du Portugal). Or même dans cette zone particulièrement sous la coupe britannique et dénoncée par les colons les plus nationalistes de la Liga de Defesa e Propaganda de Moçambique, la Compagnie dut faire très attention à nommer des fonctionnaires exclusivement portugais (même son gouverneur), à bien respecter la législation portugaise et les intérêts portugais, y compris en assumant une politique religieuse pro-catholique et antiprotestante.
La dépendance est toujours une question de relativité : oui, le Portugal était dépendant de l’Angleterre en bien des domaines, notamment financiers. Cela signifie-t-il qu’il participa à la ruée vers l’Afrique dans les années 1890 en « représentant masqué » de l’Angleterre ? Rien n’est plus faux, comme le montra du reste bien l’Ultimatum de 1890 qui mit les deux pays au bord de la guerre, provoqua une vague nationaliste au Portugal et affaiblit la monarchie jusqu’à sa chute en 1910. Par ailleurs, ce serait ignorer complètement le nationalisme économique de Salazar, qui réussit réellement à « reconquérir » économiquement son propre empire à partir des années 1930.
La thèse de l’impérialisme par substitution n’est donc pas fondée historiquement. Mais elle a un avantage – le même que celui de la « semi-périphérie » : si le Portugal n’était pas le « vrai colonisateur » mais le leurre de l’Angleterre, il n’était donc pas vraiment impérialiste – il était certes temporairement colonialiste à cause du régime fasciste, mais il ne s’agissait donc pas du mouvement d’expansion propre à la société capitaliste portugaise. Le Portugal « pas vraiment impérialiste » ne serait donc, suite aux décolonisations, « pas vraiment néocolonialiste » et pourrait par nature tisser des relations égalitaires avec ses anciennes colonies. On retrouve là le lusotropicalisme classique de la culture nationale portugaise.
La thèse de l’ambivalence et de l’hybridation
Là encore, sans jamais fonder ses thèses par un appareil de sources historiques, Boaventura de Sousa Santos mélange des choses très différentes. Premièrement, on ne peut pas analyser l’Afrique à l’image du Brésil, où un métissage massif a existé sur fond esclavagiste et continue aujourd’hui d’exister dans le petit peuple – la bourgeoisie, en revanche, demeure blanchissime. Le métissage en Afrique portugaise a existé de manière proportionnellement importante à l’époque moderne (xvi-xixe siècles), mais justement, proportionnellement au fait qu’il s’agissait alors d’aires extrêmement restreintes, parfois minuscules. En réalité, 95% de la superficie de ce que devint l’empire portugais au xxe siècle fut conquis à la fin du xixe et au début du xxe siècle, c’est-à-dire exactement au même moment que les autres impérialismes européens : il n’y a pas une ancienneté de l’impérialisme portugais plus forte que celle des autres impérialismes européens, sauf en des zones extrêmement réduites (Cahen, 2007). Et le xxe siècle colonial fut celui où, même compte tenu de la grande expansion territoriale de la colonisation, il y eut le moins de métissage, ce fut le siècle du blanchiment (comme au Brésil, du reste, mais avec un succès moindre, bien sûr).
Cependant, B. de Sousa Santos a raison sur un point : le racisme n’a pas été pratiqué exactement sous la même forme que dans les colonies anglaises, il fut ce que j’ai appelé un « racisme de proximité » et non un « racisme de distance ». En effet, des « petits-Blancs » pouvaient vivre dans des quartiers africains, en proximité donc, mais chacun sachant exactement à quelle catégorie il appartenait et ce qu’il en coûtait de s’en départir41. Par conséquent l’hybridation provenant du métissage biologique et culturel et provoquée par une telle proximité doit être relativisée. Du reste, les enfants métis non reconnus par leur père étaient versés par l’administration coloniale dans la catégorie juridique « indigène » (puisque « nés de mère indigène et de père inconnu ») et donc soumis à toutes ses ségrégations (travail forcé six mois par an ou un an sur deux, école missionnaire de qualité déplorable, etc.). Et les métis reconnus étaient considérés comme « civilisés », donc exclus de la catégorie « indigène ». Socialement parlant, ils étaient donc du côté du colonisateur, même si sur le plan des histoires personnelles, ce put être complètement différent.
Ce qui est certain est que la limite sociale, ou la « ligne de démarcation » entre colonisés et colonisateurs fut socioéconomiquement plus basse dans le cas impérial portugais que dans les cas anglais, hollandais, belge ou français : un petit-Blanc portugais, même pauvre et analphabète, n’en restait pas moins un colonisateur avec des privilèges liés à son statut social et phénotypique42. Mais le fait que la démarcation soit située plus bas dans l’échelle sociale n’atténuait en rien la démarcation elle-même. Le retard des luttes de décolonisation dans les colonies portugaises ne vint pas d’une « ambivalence » qui aurait pesé sur la conscience des colonisés, mais plutôt de l’urbanisation moindre, du sous-développement social plus marqué, d’un remarquable contrôle de la population par le biais du travail forcé (surtout à partir de 1939) et de l’intensité de la répression même avant les guerres de libération, la métropole coloniale connaissant – cas unique sur la durée – un régime fasciste.
Même si la majorité des personnes de ces milieux créoles43 restèrent conservatrices, c’est parmi elles – les plus « ambivalentes », donc – qu’apparurent les premiers militants de la cause anticoloniale moderne, du fait de leur alphabétisation et de leur connaissance, au moins minimale, de ce qui se produisait ailleurs sur la planète. Quant aux indigènes, ils savaient très bien qui les opprimait et cet oppresseur était portugais et point britannique : ils n’avaient aucun doute sur leur identité de colonisé. La colonisation portugaise est de ce point très comparable à ce qui se produisit dans les autres empires coloniaux européens en Afrique.
La « rencontre coloniale » (colonial encounter, encontro colonial…) chère aux thèses postcoloniales, qui adoucit la réalité de l’oppression coloniale en rétablissant une certaine égalité entre un colonisateur dominant mais non hégémonique et un peuple indigène dominé mais doué d’agency, n’a pas été d’une qualité meilleure dans le cas portugais, même si elle a évidemment des spécificités propres, qu’il n’est pas le lieu ici d’aborder. Ce que les subalternes coloniaux purent négocier sans relâche furent les conditions de leur subalternité, dans les cas portugais comme non portugais. Il y a beaucoup plus de ressemblance que de différences entre l’empire portugais d’Afrique et ceux des autres puissances européennes. Ce qui se passait en Angola et au Mozambique dans les années 1920 était parfaitement comparable à ce qui se passait au Tchad français, au Soudan anglais ou au Congo belge au même moment. La France supprime le travail forcé indigène en 1947. Le Portugal en 1962 : voilà la différence – quinze ans. Quand on étudie la colonisation portugaise, il faut certes avoir conscience de ses spécificités, mais, loin de l’exceptionnalité, accorder également une grande attention aux proximités et similitudes avec les autres empires…44
Postcolonial et grand récit national portugais
Mais ce que je voudrais remarquer ici, c’est que les thèses de Boaventura de Sousa Santos, bien rarement fondées sur un appareil statistique ou des sources historiques, sont avant tout des affirmations venant en ligne droite de la culture nationale portugaise, remplie de thèses telles que :
- un empire très ancien, incomparable aux autres, exceptionnel…
- … où se produisit un métissage sans égal, biologique, culturel ou mental (BSS dit « hybridation »)
- … empire lui-même largement dominé par l’impérialisme anglais et de ce fait empêchant le Portugal d’être vraiment impérialiste et le qualifiant, par conséquent, pour des relations de nature différente avec ses colonies ou anciennes colonies (certains diraient aujourd’hui relations « Sud-Sud »).
Certes, les thèses défendues par B. de Sousa Santos ne sont pas toujours l’exact décalque de cette culture coloniale et nationale portugaise, mais le moins que l’on puisse dire est que celles-là ne rompent pas avec celle-ci, même si elles peuvent être liées aussi avec des thèses classiques des analyses postcoloniales (comme l’hybridité).
En effet, sur d’autres plans, la filiation entre la culture nationale et coloniale portugaise et les thèses défendues par B. de Sousa Santos et son école de pensée est moins nette et les influences du postcolonial classiquement anglo-saxon et du postmodernisme sont peut-être plus grandes.
Je pense en particulier à ce que cette école appelle le « pluralisme légal » et l’« État hétérogène » (Santos, 2006 ; Menezes, 2019). Il s’agit d’une théorisation sur le fait que, dans nombre d’États de ce qu’elle appelle le « Sud » et notamment les PALOPs (pays africains de langue officielle portugaise), d’une part les chefs traditionnels ont été remis en selle après la phase « marxiste-léniniste » ou radicale, et d’autre part les tribunaux des plus bas échelons, non professionnels, acceptent de prendre en compte des pratiques traditionnelles comme la sorcellerie, les esprits des ancêtres, les possessions, etc. Or dans un cas comme dans l’autre, peut-on pour cela parler de « pluralisme légal », ou surtout d’« État hétérogène » ? Il saute aux yeux que les « concessions néo-traditionnelles » de l’État moderne ne concernent que l’échelon inférieur de l’appareil d’État, c’est-à-dire que ces concessions néo-traditionnelles sont un outil pour mieux implanter l’État moderne en brousse. Ce « néo-traditionalisme subalterne » est instrumental et modernisateur et ne remet pas en cause la nature de l’État capitaliste périphérique. Il ne crée pas une nouvelle catégorie d’État.
Épistémologies du Sud
Un point sur lequel Boaventura de Sousa Santos et son école ont consacré de grands efforts depuis les quinze dernières années est la question des « épistémologies du Sud », ce qui les ont rapprochés de l’école décoloniale. Ils partent de l’idée que l’histoire de l’expansion du capitalisme a provoqué non seulement une oppression sociale et économique, mais aussi cognitive et que cette oppression cognitive se poursuit de nos jours (le concept quijanien de « colonialité du savoir » est parfois utilisé). Ils considèrent que des « épistémicides » très nombreux ont été commis, provoquant une gigantesque déperdition de l’expérience. La tâche des « postcoloniaux d’opposition » serait donc de recueillir ce qui reste de ces épistémês grandement disparues (« sociologie des absences »), de les valoriser, d’apprendre avec elles, pour elles, et de pouvoir s’en servir dans les mondes centraux (« sociologie des émergences »). L’émancipation devra être sociale mais également cognitive, avec la résurgence de savoirs dominés, dialoguant avec les autres en une « écologie des savoirs ». Ils appellent cet ensemble d’attitudes intellectuelles et militantes « épistémologies du Sud ».
Là, règne une certaine confusion : en effet, il ne s’agit donc point simplement des « voix du Sud », des épistémologies existant dans le Sud, mais de l’ensemble des attitudes militantes et intellectuelles permettant d’apprendre avec le « Sud global », donc d’une coalition mondiale de militants et intellectuels « pro-Sud », qu’ils soient situés eux-mêmes au Sud ou dans le Nord/Occident (les deux termes sont employés selon les articles, prônant également un « occident non-occidentaliste »). Les Forums sociaux mondiaux seraient l’émergence de ce phénomène, que Santos qualifie aussi, de manière extrêmement optimiste, de « globalisation contre-hégémonique ».
Cependant, il y a deux problèmes. Il précise que pour lui, « Sud » est une métaphore : mais peut-on fonder toute une théorisation sur une métaphore ? Il n’en donne pas moins des précisions sur la situation géographique du Sud : il précise que le « Sud métaphorique » n’est pas exactement le « Sud géographique » puisque l’Australie et la Nouvelle-Zélande n’en font pas partie, et qu’en revanche, le Sud global est présent au Nord sous la forme des immigrés et le Nord global présent au Sud sous la forme des élites globalisées. On nage là dans l’impressionnisme le plus total.
Premièrement, si on le suit, ce qu’il décrit avait une ancienne désignation – le tiers-mondisme –, et on peut douter de ce que la nouvelle apporte, le concept de « Sud » étant encore plus flou que celui de tiers monde. Deuxièmement, l’analyse en termes de « sud » et de « nord » pour désigner des milieux sociaux écarte toute analyse en termes de classes, de corps sociaux, de formations sociales de ces contrées gigantesques… C’est un appauvrissement conceptuel considérable même par rapport à l’ancien tiers-mondisme. La notion de tiers monde était contestable, mais portait en elle-même l’analogie avec le tiers état, l’état tiers (et non « troisième »45), l’état des subalternes. Comme le « deuxième monde » stalinien avait disparu, il n’y aurait plus eu de sens à parler de « tiers-monde » – comme si cela changeait quoi que ce soit à la situation de ce dernier et à ses rapports avec le capitalisme central46. Ainsi naquit le « Sud », après la chute des pays du stalinisme sénile et le triomphe de la dictature mondiale du capital financier, que l’on dénomme habituellement, respectivement, par « pays communistes » et par « globalisation ». « Nord » et « Sud » sont des vocables qui « géographisèrent », c’est-à-dire qui naturalisèrent la division internationale du travail au détriment de l’analyse de classes. C’est un concept 100% néolibéral. On voit mal le progrès accompli.
Par ailleurs, le fait d’indiquer que le « Nord » (exit le capitalisme central) est présent au « Sud » (exit la périphérie du capitalisme) sous la forme des élites et que le Sud est présent au Nord par les communautés immigrées est un contresens complet si l’on se place du point de vue de la globalisation47 : justement parce que les sociétés de la périphérie sont intégrées au système-monde, elles produisent des classes en fonction de ce système. Isabel dos Santos, la fille de l’ex-président angolais José Eduardo dos Santos, qui fut la deuxième fortune d’Afrique, ne faisait pas partie du « Nord » mais bel et bien du « Sud » – elle fut un produit de l’insertion de la périphérie dans le système-monde. Inversement, les immigrations prolétaires venues de la périphérie font également partie du « Nord », intégrant la fameuse « armée industrielle de réserve » décrite par Marx afin de faire baisser le prix d’achat de la force de travail et de faire monter le taux de plus-value.
Mais ce qui est moins clair, c’est le fait de savoir si ces thèses sur l’« État hybride » et sur les « épistémologies du Sud » ont elles aussi un rapport avec la culture nationale et coloniale portugaise et le mythe de l’exceptionnalité du Portugal, comme on l’a vu pour les thèses sur la nature semi-périphérique du Portugal, sur l’impérialisme par substitution, et sur l’ambivalence ou l’hybridation. L’influence postmoderne semble rester très forte, notamment en ce qui concerne le refus de tout grand récit.
En effet, les épistémologies du Sud sont fondées sur quatre grandes prémisses48 :
- « La compréhension du monde excède largement la compréhension européenne du monde »49. Mais qu’est-ce que LA compréhension européenne ? Pourquoi cette réification et homogénéisation culturaliste de l’Europe ?
- « On ne manque pas d’alternatives dans le monde. Ce qui manque réellement est une pensée alternative aux alternatives »50. Au-delà du goût de la formule, indéniable chez B. de Sousa Santos, que signifie cette affirmation ? Qu’aucune pensée alternative ne peut plus présenter une optique émancipatrice ? On attend une critique argumentée du marxisme51, qui est rejeté sans argumentation comme un eurocentrisme.
- « La diversité épistémique du monde est infinie et aucune théorie générale ne peut ambitionner de la comprendre »52. Ainsi, à l’époque de la globalisation, il n’y aurait plus aucune théorie capable d’expliquer l’évolution du monde mondialisé. Mais pourquoi donc une théorie générale, qui ne sera jamais la somme de théories particulières, ne pourrait-elle pas essayer de penser cette « infinité » ? Et comment peut-on affirmer cette « diversité épistémique infinie » après avoir rappelé l’épistémicide généralisé provoqué par l’expansion capitaliste ? Il faudrait savoir… Le refus des grands récits mène ici à des contradictions insurmontables.
- « L’alternative à une théorie générale consiste en la promotion d’une écologie des savoirs combinée à une traduction interculturelle »53. D’une certaine manière, la montagne a accouché d’une souris. Bien qu’apparemment très radical, ce discours postcolonial/postmoderne considère que l’émancipation ne vient plus du jeu des rapports de forces, de la lutte des classes à l’échelle internationale, mais juste d’un effort (« d’une promotion ») pour combiner équitablement les diverses cultures existantes. Le monde est désormais un ensemble de « cultures » et non plus un système-monde structuré par la division internationale du travail, par des classes (dont une infime très haute bourgeoisie), des races, des genres54, par un mode de production dominant…
Mais, me dira-t-ton, on semble ne plus être là dans le postcolonial mais dans une résurgence du postmoderne. Peut-être. Il y a un point commun cependant dans tout cela : le tournant, remarqué par divers auteurs, entre une critique politique anticoloniale et une critique épistémologique postcoloniale. Même si Boaventura de Sousa Santos indique toujours qu’il y aura des conséquences politiques à ses thèses, il n’en répète pas moins à chaque fois qu’il est bien trop tôt pour savoir comment55, que l’on n’en est encore qu’à une phase de « transition paradigmatique ». Ainsi, ce qui domine est bel et bien la critique épistémologique, à savoir une certaine tendance à la dépolitisation. Le courant postcolonial qui, au Portugal, a pu paraître comme le plus radical ne l’est pas tant que ça…
Je viens de consacrer mon attention à l’école de pensée de Boaventura de Sousa Santos parce que, si du moins on en croit le nombre des citations, son influence est considérable (notamment dans les pays de langue officielle portugaise) alors qu’elle me semble, d’un point de vue décolonial (c’est-à-dire de lutte contre la colonialité), une voie sans issue, culturaliste et réificatrice du « Sud » comme du « Nord ». Une voie conservatrice.
Mais il me faut ajouter immédiatement ce qui suit : d’autres recherches post-coloniales, postcoloniales et décoloniales se sont développées et se développent au Portugal – y compris au sein du Centro de Estudos Sociais de Coimbra ! – ou parmi des chercheurs et chercheuses portugais·e·s établi·e·s à l’étranger, qui ne calquent pas – sans forcément s’y opposer frontalement comme je l’ai fait ici – les thèses de B. de Sousa Santos56. Enfin, il y aura toujours des penseurs inclassables, comme le fut Eduardo Lourenço dont la pensée, postcoloniale de fait – sans qu’il ne me semble jamais s’être réclamé de cette école de pensée –, a été bellement mise en valeur dans le livre recueil Do colonialismo como nosso impensado (Lourenço, 2014).
Une recherche à poursuivre
Outre l’étude du « postcolonial à la portugaise » à l’extérieur de l’école de pensée boaventuriste, il sera intéressant aussi de voir les critiques portugaises au postcolonial lui-même57. En sciences sociales ou dans des projets interdisciplinaires, des études post(-)coloniales très prometteuses sont en cours du côté de l’Universidade Nova58, à l’Instituto de Ciências Sociais59 et au Centro de Estudos Sociais de Coimbra60. Il y en a sans doute d’autres. Cela aidera à déterminer ce qui vient de pensées personnelles (ou collectives) particulières, et ce qui témoignerait d’un véritable trait d’une école postcoloniale portugaise enfin en rupture avec le grand récit national traditionnel.
*
Le 11 avril 2021