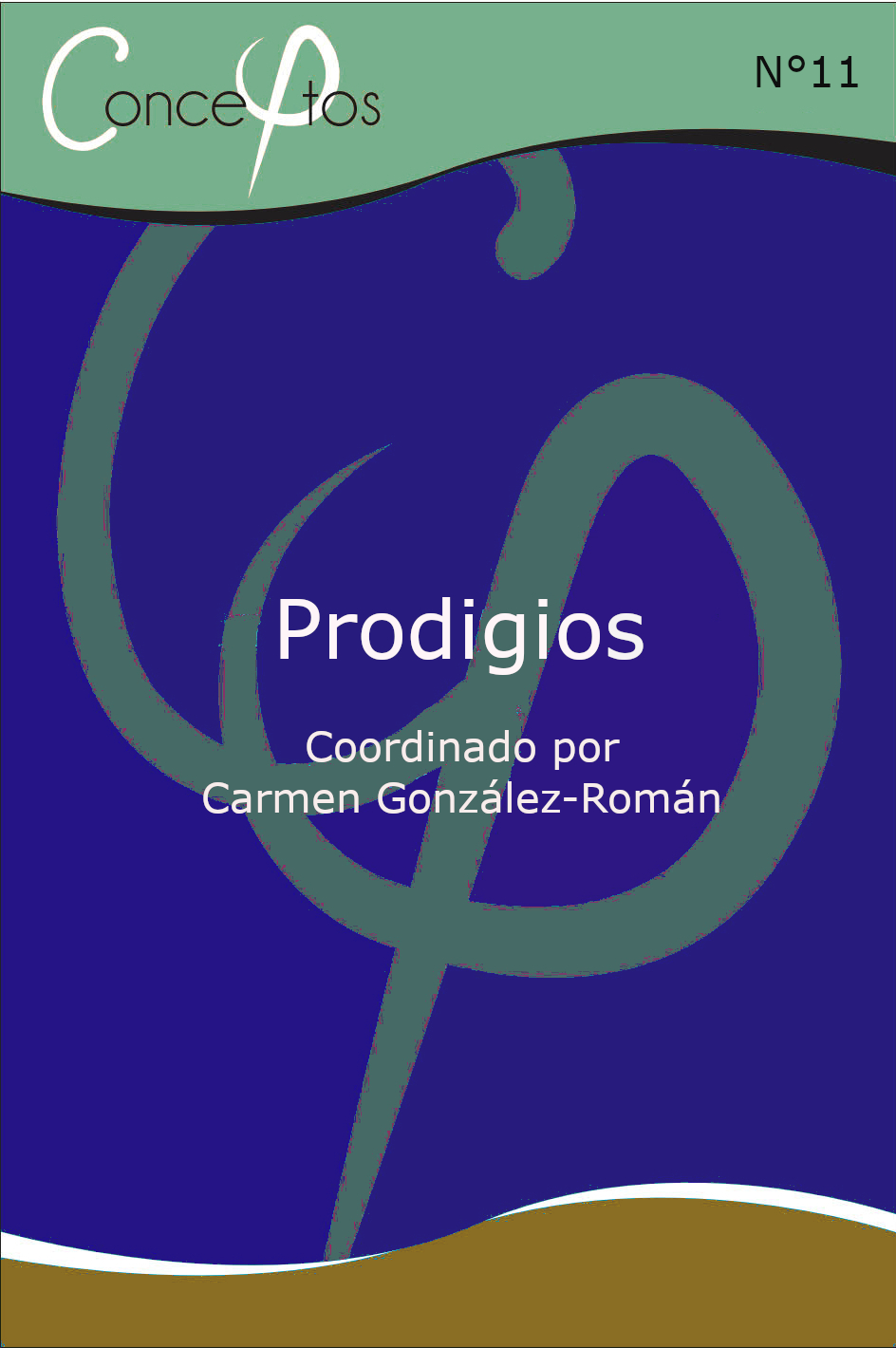Cruauté et animalité chez Antonin Artaud et Gonçalo M. Tavares
Abstract: This article offers a comparative reading of Animalescos (2013), a collection of short narratives byr the Portuguese writer Gonçalo M. Tavares, and Antonin Artaud’s The Theatre and Its Double (1938), by interrogating the notions of cruelty and animality. Drawing on Artaud’s theory of the “theatre of cruelty”, which seeks to place the body at the centre of the stage and to make performance a vital shock, we will show that Tavares’s writing operates as a narrative transposition of this theatrical project. Tavares’s cruel tales, in which man is animalised, mutilated, or reduced to absurd mechanisms, converge with Artaud’s ambition: to shatter language, to disorganise forms, to reveal life in its most violent and immediate dimension. Through the cross-analysis of selected passages, we will examine how the grotesque becomes both a method of thought and a radical critique of humanism.
Keywords: Cruelty, Animality, Grotesque, Body
Résumé : Cet article propose une lecture comparée d’Animalescos (2013), un recueil de récits brefs signé par l’écrivain portugais Gonçalo M. Tavares, et de Le Théâtre et son double (1938), d’Antonin Artaud, en interrogeant la notion de cruauté et d’animalité. En partant de la théorie artaudienne du « théâtre de la cruauté », qui vise à replacer le corps au centre de la scène et à faire du spectacle un choc vital, nous montrerons que l’écriture de Tavares fonctionne comme une transposition narrative de ce projet théâtral. Les récits cruels de Tavares, où l’homme est animalisé, mutilé ou réduit à des mécanismes absurdes, rejoignent l’ambition d’Artaud : briser le langage, désorganiser les formes, révéler la vie dans sa dimension la plus violente et la plus immédiate. À travers l’analyse croisée d’extraits, nous examinerons comment le grotesque devient à la fois méthode de pensée et critique radicale de l’humanisme.
Mots-clés : Cruauté, Animalité, Grotesque, Corps
Resumo: Este artigo propõe uma leitura comparada de Animalescos (2013), conjunto de narrativas breves da autoria do escritor português Gonçalo M. Tavares, e de Le Théâtre et son double (1938), de Antonin Artaud, mobilizando as noções de crueldade e animalidade como ponto de partida. Partindo da teoria artaudiana do «teatro da crueldade», que procura recolocar o corpo no centro da cena e fazer do espetáculo um choque vital, argumenta-se que a escrita de Tavares constitui uma transposição narrativa desse mesmo projeto. As narrativas cruéis de Tavares, onde o homem surge animalizado, mutilado ou reduzido a mecanismos absurdos, convergem com a ambição de Artaud: romper a linguagem, desorganizar as formas, expor a vida na sua dimensão mais violenta e imediata. Assim, mediante a análise cruzada de excertos, procura-se mostrar de que modo o grotesco se converte simultaneamente em método de pensamento e em crítica radical do humanismo.
Palavras-chave: Crueldade, Animalidade, Grotesco, Corpo
En guise d’introduction
La littérature comparée permet de mettre en évidence des affinités souterraines entre des univers esthétiques éloignés dans le temps, l’espace ou même le genre littéraire. Tel est le cas du dialogue que l’on peut établir entre Antonin Artaud (1896-1948), théoricien du « théâtre de la cruauté », et Gonçalo M. Tavares (né en 1970), écrivain portugais contemporain, dont le recueil Animalescos (2013) propose une série de récits brefs où l’homme est ramené à son animalité. À première vue, tout sépare ces deux univers : d’un côté, nous avons un poète, acteur et dramaturge qui, au cœur de l’entre-deux-guerres, remet en question la tradition théâtrale occidentale ; de l’autre, un romancier et nouvelliste qui, au début du XXIe siècle, construit une œuvre vaste et protéiforme, où l’expérimentation formelle s’allie à une réflexion sur la violence et la condition humaine. Pourtant, la mise en relation de ces deux œuvres révèle une logique commune : celle du grotesque corporel, compris comme outil critique et comme méthode de pensée.
Artaud, dans Le Théâtre et son double, affirme que le théâtre doit redevenir une expérience vitale, une épreuve qui engage le corps du spectateur et l’arrache aux illusions rassurantes de la représentation. Pour lui, le théâtre de la cruauté doit agir comme la peste : « il invite l’esprit à un délire qui libère ses forces » (Artaud, 1938 : 40). Cette conception transforme radicalement la fonction de la scène, désormais conçue comme le lieu où se manifeste, dans la violence et l’excès, la vérité de la vie. Tavares, de son côté, construit dans Animalescos (2013) un corpus de récits fragmentaires où l’humanité est confrontée à sa propre déchéance : les personnages y sont animalisés, mutilés, livrés à des pulsions absurdes et dévastatrices. La narration prend souvent la forme de micro-scènes, proches de courtes pièces, où le grotesque surgit comme moteur narratif et comme force de déstabilisation.
L’intérêt d’un tel rapprochement tient à la possibilité de penser la cruauté au-delà du théâtre, comme une catégorie transversale des écritures du corps au XXe et au XXIe siècle. En effet, la cruauté chez Artaud, loin de désigner une simple violence physique, renvoie à une intensité vitale, à une lucidité impitoyable qui arrache l’homme aux simulacres. De manière analogue, la cruauté de Tavares ne se limite pas à l’invention de scènes choquantes : elle traduit une interrogation plus profonde sur les limites du langage, sur la fragilité de la civilisation et sur la porosité des frontières entre l’humain et l’animal.
Notre question de recherche est donc la suivante : comment l’imaginaire animal de Tavares reformule-t-il, sur le plan narratif, la cruauté artaudienne ? Nous faisons l’hypothèse que le grotesque corporel constitue un terrain d’articulation commun, où s’opèrent à la fois une critique de l’humanisme et une redéfinition du rapport entre langage et corps. Pour ce faire, nous présenterons d’abord le cadre théorique artaudien, en insistant sur la notion de cruauté et sur le rôle du corps. Puis, nous analyserons quelques récits d’Animalescos (2013), en montrant comment la cruauté s’y déploie par la logique du grotesque et de l’animalité. Enfin, nous confronterons les deux univers pour mettre en évidence convergences et divergences, avant de conclure sur la portée critique de cette comparaison.
1. Cruauté, grotesque et animalité
Publié en 1938, Le Théâtre et son double cristallise chez Artaud une réflexion majeure sur le théâtre et sur la corporéité. Il y dénonce l’appauvrissement du théâtre européen, réduit à une imitation psychologique et textuelle : « Il existe une rupture entre les choses, et les paroles, les idées, les signes qui en sont la représentation » (Artaud, 1938 : 15). Le théâtre n’agit plus, il se contente de représenter et a perdu son pouvoir de transformation. À ce constat, Artaud oppose la nécessité d’un art qui ne se borne pas à reproduire la vie, mais qui soit la vie même, sous sa forme la plus excessive, la plus contradictoire, la plus cruelle.
C’est dans ce cadre qu’il forge le concept de théâtre de la cruauté, notion souvent mal comprise. La cruauté n’équivaut pas à la violence sadique exercée par l’homme sur son prochain, mais à une rigueur vitale : « Ce n’est pas la cruauté que nous pouvons exercer les uns sur les autres, mais bien celle, beaucoup plus effroyable et nécessaire, que les choses peuvent exercer sur nous » (Artaud, 1938 : 101). Celle-ci implique l’exigence de faire surgir la vérité nue, de confronter l’homme à la maladie, au temps, à la chair, à la mort — toutes dimensions que la culture tend à refouler. Pour cette raison, Artaud appelle à une dramaturgie qui « brûle les étapes de la pensée » (Ibidem : 75), qui touche directement le corps et l’inconscient, sans médiation.
Afin de rendre sensible cette nécessité, Artaud recourt à l’image de la peste. « Comme la peste, le théâtre est un formidable appel de forces qui ramènent l’esprit par l’exemple à la source des conflits » (Artaud, 1938 : 38). La peste n’est pas seulement un désastre biologique, mais une révélation1 : elle liquéfie les structures sociales, met à nu les désirs cachés, expose les corps à la vulnérabilité. De même, le théâtre de la cruauté doit agir comme un agent d’infection : il ne soigne pas, il secoue ; il ne console pas, il dévoile.
Dans cette perspective, Artaud en vient à revaloriser le corps grotesque. Celui-ci n’est plus pensé comme instrument harmonieux du texte, mais comme un champ de bataille traversé par des forces. « Tout ce qui est dans l’amour, le crime, la guerre ou la folie, le théâtre doit nous le rendre avec les cris, les attitudes, les gestes » (Artaud, 1938 : 118). Dans son essai, il décrit le malade ainsi : « les humeurs affolées, bousculées, en désordre, lui paraissent galoper à travers son corps » (Artaud, 1938 : 47). Le corps convulsif est la véritable scène : traversé par la douleur, les spasmes, la déformation, il révèle ce que la raison masque. Le grotesque, loin d’être marginal, devient une méthode de vérité : il déforme pour faire voir, exagère pour faire sentir et disloque afin de révéler.
C’est ici que les analyses contemporaines viennent enrichir notre lecture. Ana Kiffer (2008), dans son article « Limites da escrita ou como fazer da escrita uma plástica poética? », souligne qu’Artaud invente une écriture qui déborde la langue et refuse la clôture. La chercheuse insiste sur l’idée que « essa espontaneidade seria o próprio exercício face ao limite: subverter a ordem e a organização dos corpos começando pelo próprio corpo da língua – a letra, a linha, o texto »2 (Kiffer, 2008 : 216). Autrement dit, l’écriture artaudienne ne se contente pas de représenter : elle agit directement sur la matière du langage, comme sur un corps à déformer, à briser, à recomposer. Ce geste maintient la langue en tension, dans une crise permanente où chaque mot est vécu comme insuffisant et chaque texte comme inachevé. Loin d’un système achevé, l’écriture d’Artaud se fait toujours arrachement, défaillance, tentative — une scène scripturale où la langue se défait pour devenir matière, geste ou image. En d’autres termes, le texte devient lui-même convulsion, organisme en mutation.
Ce déplacement trouve un écho direct dans la prose de Gonçalo M. Tavares, qui transpose dans Animalescos (2013) ce qu’Artaud pensait pour la scène. Ses récits brefs fonctionnent comme de petites expériences de cruauté : un homme possédé par un vent qui lui fait avaler et vomir ses propres mots, une femme qui ingère des pièces de monnaie, un médecin offert à la dissection par ses élèves. Comme chez Artaud, le grotesque n’y est pas décoratif mais opératoire : il désarticule le corps et fracture la narration. Ce qui émerge n’est pas une psychologie cohérente, mais une matérialité crue du corps et du langage, exposée dans son absurdité.
Les travaux de Jacques Derrida, et notamment L’animal que donc je suis (2006), fournissent à ce processus un appui théorique. Ce que Derrida dénonce, c’est la violence conceptuelle qui consiste à réduire une infinité d’espèces vivantes sous le mot unique « animal ». Il le formule ainsi :
L’animal est un mot, c’est une appellation que les hommes se sont attribué le droit de donner à tout autre vivant. Ils ont ainsi construit un concept unique qui dissimule une multiplicité abyssale. (Derrida, 2006 : 54).
En imposant cette catégorie globale, l’humanisme occidental institue une coupure radicale entre l’homme et ce qu’il n’est pas, et fonde son identité sur cette exclusion.
Or, Derrida ne reste pas au niveau conceptuel : il introduit une expérience concrète, celle du regard de son chat. Cette scène intime révèle que la prétendue souveraineté humaine est immédiatement ébranlée. « Je suis vu, nu, par l’animal » (Derrida, 2006 : 13), écrit-il, soulignant la vulnérabilité fondamentale de l’homme lorsqu’il se découvre objet du regard animal. Loin de confirmer la coupure, cette expérience la fissure : l’humain se découvre exposé, traversé par une altérité qui le précède et le déborde. Cette déconstruction éclaire l’esthétique d’Artaud comme celle de Tavares : tous deux mettent en scène un corps investi par des forces animales qui le déstabilisent et l’arrachent à la fiction d’un sujet autonome.
Dans le prolongement de cette réflexion, Vincent Lecomte (2017) rappelle que l’animalité ne relève pas de la métaphore mais d’une dimension ontologique constitutive de l’homme3. Elle revient fissurer l’illusion d’un sujet stable et maîtrisé. Dans les récits de l’écrivain portugais, cette animalité se manifeste par l’effacement de la frontière entre homme et bête, entre parole et cri, entre économie symbolique et ingestion corporelle. L’indistinction entre l’animal et l’humain, perçue comme monstrueuse, ne fait en vérité que révéler et intensifier un devenir commun inscrit dans l’ordre du vivant. Anne Simon apporte un approfondissement à cette réflexion en insistant sur la porosité de la langue : « La langue est animale, la parole est animée, et les animaux racontent des histoires : cette réversibilité est le postulat de la zoopoétique » (Simon, 2021)4. Cette perspective met en lumière aussi bien les éclats scripturaux d’Artaud que la prose clinique et sèche de Tavares. Dans ce dernier, la matérialité du langage devient un terrain de contamination animale tangible, mise en scène dans le récit « Xcaret maldade diabo », comme l’atteste le passage suivant :
em Xcaret, os animais selvagens convivem com os homens — no meio, uma barreira, de resto tudo é possível: os homens gritam de um lado insultos e do outro lado os selvagens rosnam. (Tavares, 2013 : 40)5
Ici, la frontière se réduit à une mince cloison matérielle, tandis que les modes d’expression — cris et grognements — révèlent une communauté sonore qui désarçonne la dichotomie homme/animal, héritée de la tradition biblique de la Genèse, où l’homme, doté du langage, se voyait conférer une supériorité sur toute autre forme d’existence6.
C’est à partir de cette indistinction fondamentale que se comprend la convergence entre Artaud et Tavares : le théâtre de la cruauté et les récits grotesques transforment le corps en scène de vérité, brisent l’illusion humaniste et ouvrent l’écriture à la contamination. Artaud théorise et performe cette cruauté sur la scène, Tavares la transpose dans une narration brève et incisive. Les analyses de Kiffer, Derrida, Lecomte et Simon offrent ici un cadre de lecture essentiel : elles montrent qu’il ne s’agit pas seulement d’esthétique, mais d’une critique profonde de la frontière homme/animal, d’une poétique du grotesque comme méthode de vérité, et d’une écriture qui agit sur le lecteur comme une expérience corporelle.
2. Mise en regard
Dans Animalescos (2013), l’écriture de Gonçalo M. Tavares procède par courtes nouvelles, chacune construite comme une expérience de pensée, où l’humain est déplacé, désarticulé, animalisé. Ce qui frappe d’emblée, c’est la neutralité clinique du ton narratif : la voix qui décrit n’élève pas la violence en pathos, elle ne dramatise pas, mais constate. Ainsi, le grotesque surgit de l’écart entre l’horreur de la scène et la sécheresse de la diction. Un homme qui avale ses mots, un père qui danse sur la table et vomit, une femme qui ingère des pièces de monnaie — toutes ces situations sont décrites avec une précision mécanique, comme si l’absurde était une donnée naturelle, inévitable. Cette neutralité contribue à installer une logique de déréalisation : ce qui, dans un autre contexte, relèverait du délire ou du cauchemar, est ici livré avec la froideur d’un constat clinique.
Ces effets narratifs chez Tavares résonnent avec la pensée d’Antonin Artaud, pour qui le grotesque est une nécessité vitale. Selon le dramaturge, le théâtre doit produire « une secousse, une convulsion » (Artaud, 1938 : 121). Il ne s’agit pas d’un simple effet esthétique, mais d’une stratégie de mise à nu : le corps doit être secoué, brisé dans ses habitudes, rendu à sa vérité organique. Chez Tavares, cette secousse se traduit narrativement par une logique de contamination : une fois le récit entamé, tout y est déjà déréglé, comme si la folie ou l’animalité se diffusaient inexorablement à travers le texte. Le « vent Bora » ne se contente pas de troubler un individu, il traverse le banquet, les convives, les corps ; la cruauté n’est jamais isolée, elle est contagieuse. Ainsi, l’écriture de Tavares transpose dans la prose la métaphore artaudienne de la peste.
Ce déplacement ouvre sur une articulation décisive : chez Tavares, l’animalité sert de médiation pour penser la cruauté. L’animal, dans Animalescos, n’est pas un simple motif symbolique : il devient une dynamique narrative, une possibilité de penser autrement. Dans un récit, le fils est comparé à un porc : « o pior dos filhos, o melhor dos porcos »7 (Tavares, 2013 : 29). La valeur morale humaine est rabattue sur une échelle animale, non pour réaffirmer une hiérarchie mais pour la faire imploser. L’homme et le porc deviennent commensurables ; l’humain perd son privilège. Ce renversement, qui brouille les catégories morales et ontologiques, traduit une logique d’indistinction constitutive de la prose de Tavares.
C’est précisément ce que Jacques Derrida problématise dans L’animal que donc je suis (2006). Il dénonce la violence d’un mot — « l’animal » — qui englobe dans une seule catégorie une multiplicité infinie d’espèces et qui, surtout, institue une coupure radicale entre l’homme et ce qu’il n’est pas : « On peut dire, d’une part, que cette haine belliqueuse au nom des droits de l’homme, en somme, loin de soustraire l’homme à l’animalité au—dessus de laquelle il prétend s’élever, confirme qu’il y a là une sorte de guerre entre les espèces. » (Derrida, 2006 : 72). En d’autres termes, l’humanisme occidental s’érige sur une opposition structurante, à la fois agressive et disqualifiante, envers l’animal ; il ne se définit qu’à travers cette mise à l’écart belliqueuse. Dans sa prose, Tavares retourne cette disqualification contre elle-même : en animalisant les humains, il rappelle que la ligne de partage est illusoire. Tout homme porte déjà en lui l’animal, et c’est de ce portage que la cruauté prend naissance.
L’animal apparaît alors comme un véritable moteur d’affect et d’apprentissage. Derrida rappelle : « je suis en tant que je suis après l’animal » (2006 : 27). Être humain signifie donc toujours déjà être postérieur, redevable à l’animal, placé dans une filiation où le non-humain précède et enseigne. Cette idée trouve une résonance frappante dans Animalescos. Ainsi, dans le récit « pai, animal, bom-dia », le narrateur confesse :
eu sou o pior dos filhos e o pior dos filhos é chamado a dar um beijo a um animal, um beijo no dorso de um animal, pois os animais são o nosso ouro, não temos ouro mas temos animais : um beijo no dorso do cavalo, um beijo no dorso da vaca, um beijo no dorso da cabra8. (Tavares, 2013 : 29-30)
Ici, le geste de l’enfant, contraint de déposer un baiser sur le dos de l’animal, excède la simple transmission paternelle : il institue l’animal comme médiateur d’une initiation silencieuse à l’humain. L’animal n’est pas présenté sous un angle érotique, mais il ouvre la possibilité d’aimer et de reconnaître l’autre humain. En ce sens, l’animal devient pédagogie muette de l’humain, seuil où se forme une humanité que les hommes eux-mêmes ne savent pas toujours transmettre directement. Ce n’est pas un hasard si le fils répond : « o pai ensina-me coisas atrás das coisas que parece ensinar »9 (Tavares, 2012 : 30). La leçon paternelle passe par le détour animal, instaurant une éthique du baiser où le cheval, la vache ou la chèvre deviennent autant de relais d’une humanité décentrée.
Dans cette perspective, le travail sur le langage prend une valeur décisive. Pour Artaud, il existe « un langage unique à mi-chemin entre le geste et la pensée », voire « un langage visuel des objets, des mouvements (…) jusqu’aux signes, en faisant de ces signes une manière d’alphabet » (1938 : 90–91). Derrida prolonge cette réflexion en posant la question suivante : « l’animal a-t-il non seulement des signes mais un langage, et quel langage ? » (2006 : 92). Or, chez Tavares, cette interrogation se matérialise comme une véritable expérience-limite. Ses récits invitent le lecteur à se dénuder de concepts, d’idées, voire de mots, pour pénétrer nu et muet dans cet univers animal qui n’est autre que l’Humanité elle-même.
Le narrateur de Tavares déclare à ce propos : « prescindo da minha linguagem e avanço para a docilidade como um belo animal mudo, aqui estou, o mais belo e forte animal mudo, o melhor animal mudo que o meu pai tem — e ele tem muitos »10 (Tavares, 2013 : 31). Cette soustraction volontaire au logos installe une nouvelle économie du signe, où le langage perd sa fonction de maîtrise pour se transformer en docilité animale, en mutisme vibrant. On lit ainsi sous sa plume : « o abc da linguagem não interessa, que faças cálculos mas que não consigas gritar » (Tavares, 2013 : 34). Or, ce « manque » du cri chez Tavares ne contredit pas Artaud : il en constitue au contraire le négatif, la forme narrative inversée. Chez Artaud, le cri est revendiqué comme la possibilité d’un langage physique, préverbal, soutenu par « des collusions d’objets, de silences, de cris et de rythmes » (Artaud, 1938 : 127). Le théâtre doit retrouver ce souffle originaire. Chez Tavares, ce cri n’émerge jamais : il est empêché, retenu, signe d’un sujet privé de puissance expressive et réduit à une langue appauvrie. Là où Artaud rêve d’un langage convulsif qui excède les mots, Tavares met en scène l’impossibilité d’y accéder ; sa prose travaille la langue jusqu’à son point de rupture, sans atteindre toutefois l’éclat vocal artaudien. En ce sens, Tavares transpose la logique d’Artaud en l’inversant : le manque, et non l’excès, devient la forme narrative de la cruauté.
Le grotesque se présente dès lors comme le lieu de cette indistinction. Dans le récit de « a louca », la femme qui avale des pièces de monnaie n’est pas seulement une figure de la folie : elle incarne une régression animale où l’économie abstraite est réinscrite dans la physiologie. « Afinal ela não é louca, percebe tudo, percebeu o dinheiro, quer moedas pequenas »11 (Tavares, 2013 : 35). Ce qui choque n’est pas le geste absurde, mais sa logique implacable : si la valeur est destinée à circuler, pourquoi ne pas la faire circuler par le corps ? Ici, la cruauté est cognitive autant que physique : la femme réduit l’ordre social à une ingestion grotesque, elle dévore littéralement l’instrument de l’échange.
Ce grotesque narratif ne relève nullement d’un simple ornement stylistique ; il s’inscrit dans une critique à la fois politique et philosophique de la centralité du sujet humain. L’écriture de Tavares met en crise la notion même de civilisation : elle révèle qu’au fondement de la rationalité se trouvent la cruauté, le corps et la pulsion. L’épisode du « médico sem braços »12 est à cet égard emblématique : le médecin, symbole de savoir et de maîtrise, est lui-même réduit à matière opérée — « os meninos que tremem têm os utensílios para abrir um corpo a meio »13 (Tavares, 2013 : 49). La scène subvertit la relation entre soignant et soigné, entre autorité et vulnérabilité. Ce qui était garant de la santé devient cadavre en puissance. Artaud exigeait du théâtre qu’il « invers[e] les rôles, montr[e] la face cachée des choses » (1938 : 83). Chez Tavares, cette inversion prend la forme d’un récit cruel où la médecine, institution civilisatrice par excellence, est dévorée par sa propre logique.
Cependant, la logique animale et cruelle se clarifie si l’on revient à Derrida, qui insiste sur le fait que l’animal n’est pas extérieur à l’humain, mais qu’il l’habite : « l’animal est en nous, il nous regarde, il nous met à nu » (Derrida, 2006 : 41). Or, dans Animalescos (2013), ce regard de l’animal se retourne : les personnages sont sans cesse pris dans une altérité intérieure qui les défait. La « manada14 », la « loucura »15, les métamorphoses grotesques signalent toutes l’intrusion d’une animalité qui envahit l’humain, le contamine et l’oblige à se réinventer.
À ce stade, il est possible de dégager les lignes de convergence et de divergence entre Artaud et Tavares. La convergence se joue autour de trois notions : i) la cruauté comme méthode (rigueur, lucidité, intensité) ; ii) le grotesque comme esthétique (déformation, excès, convulsion) ; et iii) l’animalité comme critique (effondrement de l’humanisme, dévoilement du corps). Chez Artaud, ces notions se projettent sur la scène théâtrale, alors que, chez Tavares, elles se déploient dans la narration. Mais le résultat est analogue : une secousse qui traverse le lecteur/spectateur, qui l’arrache à l’illusion, qui le confronte à la vie nue.
Ainsi, comparer Le Théâtre et son double (1938), d’Antonin Artaud, et Animalescos (2013), de Gonçalo M. Tavares, revient à confronter deux gestes artistiques distincts — l’un scénique, l’autre narratif — qui partagent une même intuition : la vérité de l’art ne réside pas dans la belle forme, mais dans l’exposition crue du corps, dans la secousse où l’animalité fissure l’illusion humaniste et où le grotesque devient méthode de vérité.
Regards conclusifs
La mise en regard d’Antonin Artaud et de Gonçalo M. Tavares révèle que, malgré la distance des contextes et des médiums, leurs écritures partagent une même visée : secouer l’humain en l’arrachant aux illusions humanistes et en l’exposant à son fondement pulsionnel et somatique. La cruauté, chez l’un comme chez l’autre, n’est pas sadisme mais méthode : rigueur implacable, lucidité sans détour. Le grotesque, loin d’être un ornement, devient procédé de dévoilement, lieu où les corps se déforment pour mieux révéler ce que la rationalité dissimule. L’animalité, enfin, opère comme une critique radicale : elle contamine les frontières, elle déconstruit la prétention de l’homme à se poser comme exception.
Il reste que les divergences demeurent essentielles. Artaud pense le théâtre comme une expérience collective, une peste scénique destinée à provoquer la transe et à rétablir un contact direct avec la vie. Tavares, quant à lui, inscrit cette logique dans le récit bref, adressé à un lecteur solitaire : sa prose clinique déploie une cruauté froide, ironique, qui diagnostique les pulsions humaines plus qu’elle ne cherche la régénération. Là où Artaud vise une révolution vitale et esthétique, Tavares construit une archive grotesque, une clinique de la civilisation en crise.
Les analyses contemporaines de Derrida, Kiffer, Simon, entre autres, permettent de mieux comprendre ce déplacement. Tous insistent, chacun à sa manière, sur la nécessité de penser l’humain avec l’animal, d’entendre dans l’écriture la pulsation d’un corps autre, de reconnaître dans le langage même une zone de vulnérabilité et de contamination. Ces perspectives théoriques confirment que la force d’Artaud et de Tavares tient à la matérialité de leurs écritures : cri, convulsion, souffle d’un côté ; sécheresse clinique et dissection ironique de l’autre.
Or, si les textes de Tavares apparaissent d’un point de vue narratologique comme des récits brefs, ils s’apparentent également à des essais fragmentaires, rejoignant en cela la double démarche d’Artaud, à la fois critique et créatrice. Dans la postface de Animalescos, Reginaldo Pujol Filho insiste sur cette dimension spéculative, décrivant l’écriture de Tavares comme
um animal selvagem numa floresta de ideias, imagens, raciocínios, paradoxos. (…) Textos livres, soltos, fortes, tortuosos e até ameaçadores para ideias tranquilas, urbanas, terno-e-gravata. Textos selvagens. Sim, nestas narrativas, ensaios, fragmentos (o autor batiza-os de canções) todos são investidos ou relembrados de sua intrínseca e potencial animalidade: os seres humanos, os bichos, as máquinas, jesus cristo, a racionalidade e, claro, a linguagem16. (Filho apud Tavares, 2013 : 91).
Ce témoignage confirme que l’écriture de Tavares ne relève pas seulement de la fiction, mais d’un projet critique qui interroge les formes de vie, les frontières de l’humain et la puissance animale du langage.
Ainsi, la mise en parallèle de ces deux univers ne se limite pas à une analogie : elle met en lumière une continuité souterraine des écritures du corps, de la cruauté et du grotesque, de l’avant-garde théâtrale d’Artaud à la prose contemporaine de Tavares.
Notes
- 1À ce propos, nous rappelons que Gonçalo M. Tavares, dans son Diário da Peste – O Ano de 2020 (2021), a lui aussi convoqué l’image de la peste lors de la pandémie de 2020. Pour l’écrivain, cet événement fut une expérience intérieure, à la fois « nécessité pure » et « réaction individuelle à ces temps difficiles » (Tavares, 2020 : 8), qui rejoint la perspective d’Artaud ; la peste n’y apparaît pas seulement comme un fléau biologique, mais comme une épreuve révélatrice. Cf. Pupillo, Matteo (2024). « A criatividade como força tensora em tempos pandémicos: consonâncias e dissonâncias entre o Diário da Peste (Gonçalo M. Tavares) e o Diário da Peste de Londres (Daniel Defoe) », in Olhares cruzados: representações das epidemias nas Artes. Da catástrofe à resiliência (eds. Odete Jubilado et Ana Isabel Moniz), Dedalus – Revista Portuguesa de Literatura Comparada : 247-262.
- 2« Cette spontanéité constituerait elle-même l’exercice face à la limite : subvertir l’ordre et l’organisation des corps en commençant par le propre corps de la langue — la lettre, la ligne, le texte ».
- 3Lecomte nous montre qu’il ne s’agit pas là d’une véritable nouveauté dans le champ littéraire : les grands auteurs latins, par exemple, s’étaient déjà engagés dans une réflexion analogue. Tel est le cas du poète Ovide, dont l’œuvre majeure, Les Métamorphoses, se conclut « par une réflexion sur cette dynamique permanente que suit, entre autres, la transfiguration d’une espèce en une autre » (Lecomte, 2017 : 334). De même, Calvino rappelle que, chez Ovide, la contiguïté relie toutes les formes d’existence dans une chaîne de métamorphoses, chaque être glissant vers un autre (cf. Calvino, 1999 : 119-20).
- 4Simon, Anne (2021), in « Littérature et écologie : pour une zoopoétique » : https://d-fiction.fr/litterature-et-ecologie-pour-une-zoopoetique/ (consulté le 20/08/2025).
- 5
Trad. « À Xcaret, les animaux sauvages cohabitent avec les hommes — au milieu, une barrière, pour le reste tout est possible : d’un côté les hommes lancent des insultes, de l’autre les bêtes laissent éclater leurs grondements ». Les traductions proposées sont les nôtres, sauf mention explicite d’une version publiée.
- 6Voir l’article de Cristina Álvares (2019), « Jadis, dans le commencement la parole n’était pas. Sacré, anthropogenèse et animalité humaine chez Pascal Quignard », in Çédille, Revista de Estudios Franceses, (15),41-53. https://riull.ull.es/xmlui/handle/915/18970 (consulté le 20/08/2025).
- 7« le plus mauvais des fils, le meilleur des porcs ».
- 8
« Je suis le pire des fils, et le pire des fils est appelé à donner un baiser à un animal, un baiser sur le dos d’un animal, car les animaux sont notre or, nous n’avons pas d’or mais nous avons des animaux : un baiser sur le dos du cheval, un baiser sur le dos de la vache, un baiser sur le dos de la chèvre ».
- 9« Mon père m’enseigne ce qui se cache au-delà de ce qu’il paraît enseigner ».
- 10« Je me passe de mon langage et j’avance vers la docilité comme un bel animal muet. Me voici : le plus beau et le plus fort des animaux muets, le meilleur animal muet que mon père a — et il en a beaucoup ».
- 11« En fin de compte, elle n’est pas folle, elle comprend tout, elle a compris l’argent, elle veut de la petite monnaie. ».
- 12« médecin sans bras ».
- 13« Les garçons qui tremblent ont les outils pour ouvrir un corps en deux ».
- 14« le troupeau ».
- 15« la folie ».
- 16
« Un animal sauvage dans une forêt d’idées, d’images, de raisonnements, de paradoxes. (…) Textes libres, détachés, puissants, tortueux et même menaçants pour des idées tranquilles, urbaines, en costume-cravate. Textes sauvages. Oui, dans ces récits, essais, fragments (que l’auteur nomme « chansons »), tous sont investis ou rappelés à leur animalité intrinsèque et potentielle : les êtres humains, les bêtes, les machines, Jésus-Christ, la rationalité et, bien sûr, le langage. ».
BIBLIOGRAFÍA
- Alvares Cristina (2019), « Jadis, dans le commencement la parole n’était pas. Sacré, anthropogenèse et animalité humaine chez Pascal Quignard », in Çédille, Revista de Estudios Franceses, (15), 41-53. https://riull.ull.es/xmlui/handle/915/18970
- Artaud Antonine (1938), Le Théâtre et son double, Paris : Gallimard.
- Calvino Italo (1999), La Contiguïté universelle in la machine littérature, Paris : Seuil. 1999.
- Derrida Jacques (2006), L’animal que donc je suis (M.-L. Mallet, éd.). Paris : Galilée.
- Grossman Evelyne (2006), Antonin Artaud, un insurgé du corps. Paris : Gallimard.
- Kiffer Ana (2008), « Limites da escrita ou como fazer da escrita uma plástica poética? », in Alea: Estudos Neolatinos, 215-225. https://www.scielo.br/j/alea/a/SrYZ5tQsw8c8t6jQJpQY7Jq/?lang=pt
- Lecomte Vincent (2017). « L’a-métamorphose ou la chimère temporelle. Retour vers l’animalité humaine : Ovide, Kafka, Cronenberg… », in Figuras do Animal (eds. Cristina Álvares, Ana Lúcia Curado, Isabel Cristina Mateus et Sérgio Guimarães Sousa), Lisboa : Edições Húmus. p. 325-338.
- Simon Anne (2021), Une Bête Entre les Lignes : Essai de Zoopoétique. Marseille : Wildproject.
- Tavares Gonçalo. M. (2013), Animalescos, Lisboa : Relógio d’Água.