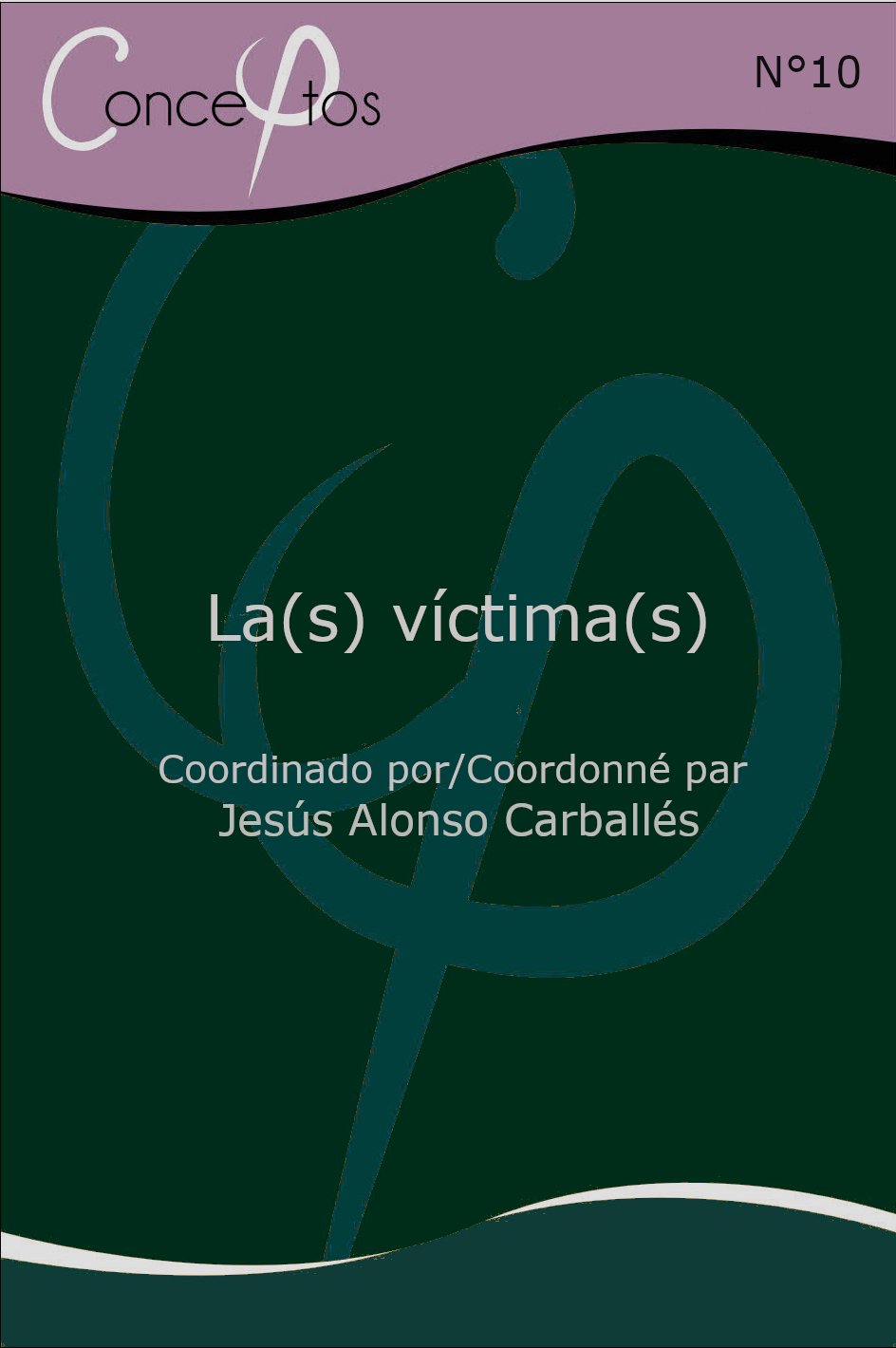Narrations festives et représentation queer : le monde de la nuit, du spectacle et du carnaval chez G. Cabrera Infante, S. Sarduy et R. Arenas
Dans l’intention d’examiner la relation que peuvent entretenir la fête et le queer dans un corpus provenant de la littérature cubaine contemporaine, nous nous proposons de sélectionner, en vue de les comparer, trois romans cubains signés par des auteurs dont la réputation n’est plus à faire au sein de la critique littéraire : Tres tristes tigres de Guillermo Cabrera Infante et De donde son los cantantes (1967) de Severo Sarduy, tous deux parus en 1967, et, enfin, El color del verano de Reinaldo Arenas, rédigé dans les années 1970 puis publié de façon posthume en 1991.
Il est vrai que ces trois romans semblent à première vue très différents, mais à y regarder de plus près, ils peuvent être rapprochés par le contexte commun au sein duquel ils émergent, outre la proximité temporelle de leur rédaction : à la fois socio-politique, avec l’avènement et l’institutionnalisation de la Révolution cubaine, puisque ces trois œuvres sont rédigées dans les années 1960-70 et publiées hors de Cuba, ce qui est hautement significatif1 ; mais également littéraire, étant donné que la critique tend à rattacher de façon quasi systématique ces trois auteurs aux grandes catégories que sont le Boom hispano-américain, le Post-Boom et le néobaroque cubain2. Mais au-delà de ce socle commun, ce qui va nous intéresser au cours du présent travail sera d’observer comment la fête, en tant que motif transversal au sein de ces trois romans, instaure un cadre propice à la mise en lumière et à la célébration de personnages queer.
Comme le rappelle Emmanuelle Lallement : « les anthropologues ont défini la fête, ou le phénomène festif, comme catégorie universelle de l’excès, de la rupture temporelle et de l’inversion de l’ordre coutumier » (Lallement, 2018 : 10). En ce sens, il est évident que la fête, qui représente une suspension temporaire des normes, quelles qu’elles soient, favorise l’expression et la mise en scène du hors-norme, que l’on pourra ici associer au queer. Par ailleurs, dans l’introduction d’un volume de la revue América : Cahiers du CRICCAL, paru en 2001 et dont la thématique est précisément « La fête en Amérique Latine », Amadeo López en propose la définition suivante : « La fête se présente comme objet protéiforme, toujours fuyant, en osmose avec d’autres notions dont les contours s’estompent et se confondent parfois » (López, 2001 : 5). Ce qui pourrait tout aussi bien s’appliquer à ce qui relève du queer, puisque si l’on enlève la dimension festive, il revêt également ce caractère protéiforme et insaisissable qui le fait parfois échapper à toute définition satisfaisante.
Selon le Oxford English Dictionary3, le terme « queer », d’origine anglo-saxonne, signifie initialement « bizarre, étrange ou inhabituel ». Utilisé comme insulte pour désigner les homosexuel.le.s, le terme a ensuite fait l’objet d’une réappropriation positive de la part des personnes concernées et, plus largement, par la communauté queer – non seulement homosexuelle – pour s’appliquer désormais à tout individu se revendiquant en marge du modèle social hétéronormé et patriarcal4. Il existe cependant de nombreux désaccords au sein de ce que l’on appelle la théorie queer5, certains spécialistes estimant qu’il est fondamental de refuser toute tentative de définition ou de catégorisation de ce terme et des individus qu’il est censé représenter, ce qui rend l’affaire assez complexe et parfois même polémique. Toutefois, il semble y avoir un consensus sur l’idée qui consiste à dire que le queer renverrait à des actes et à des comportements plutôt qu’à une quelconque identité susceptible d’être définissable ou délimitable ; autrement dit, le queer consisterait à faire et non à être6. En ce sens, le critique littéraire et sociologue américain Michael Warner affirme que le queer réside dans la capacité, consciente ou non, de résister à ce qu’il appelle les « régimes de la normalité7 » : en d’autres termes, les idéaux normatifs qui guident notre aspiration à être normal.e dans une société donnée. Nous comprenons donc bien que « queer » et « hors-norme » entretiennent ici une relation qui frôle la synonymie et que les notions de fête et de queer, aussi délicates à définir soient-elles, possèdent finalement toutes deux ce caractère démesuré et exceptionnel.
Le corpus sélectionné nous invite ainsi à mener une incursion progressive dans ce que nous appellerons pour l’occasion des festivités queer, à travers trois déclinaisons de la fête : le monde de la nuit (Cabrera Infante), celui du spectacle (Sarduy) et enfin celui du carnaval (Arenas). En traversant ces différentes ambiances festives, nous tâcherons d’examiner comment la fête et ses excès représentent un décor privilégié pour célébrer l’exceptionnel et le hors-norme, autrement dit le queer.
I/ Tres tristes tigres (1967) : observer ce qui brille dans la nuit havanaise
Nous commençons donc cet itinéraire festif par une lecture queer de Tres Tristes Tigres, un roman qui nous plonge dans la nuit havanaise et qui se donne à lire comme une exploration voire une célébration de la nuit. Les protagonistes elleux-mêmes sont fasciné.e.s par ce qu’elle peut leur offrir, de bon ou de mauvais : en ce sens, Silvestre évoque par exemple « la fauna del zoológico nocturno » (Cabrera Infante, 1995 : 342) et selon Arsenio Cué, « [h]ay de todo en la noche » (Cabrera Infante, 1995 : 115). Et il s’agit bien d’un véritable kaléidoscope de la vie nocturne havanaise, dont la narration fragmentée peut parfois mener à l’ivresse ou, tout du moins, donner le tournis en raison de la multitude de personnages, d’établissements nocturnes, de corps en mouvement ou encore du débit de boisson et de paroles qui s’y écoule.
L’exclamation « Showtime! » (Cabrera Infante, 1995 : 13) ouvre le roman, dans un prologue qui est en réalité le discours endiablé de l’animateur du cabaret Tropicana, ce qui a pour fonction de placer d’entrée de jeu la narration sous le signe du divertissement. Mais nous sommes en droit de nous demander à qui il est permis de faire la fête. Celle-ci est-elle inclusive ou n’est-elle destinée qu’à quelques privilégié.e.s comme, par exemple ici, les touristes américain.e.s du Tropicana ? L’ambiance nocturne et festive permet-elle d’effacer les différences ? En somme : la nuit, tous les chats sont-ils véritablement gris ?
Car si Tres tristes tigres est l’occasion d’entrer dans le monde de la nuit havanaise, il convient de préciser que nous évoluons ici à travers un point de vue essentiellement hétéronormé. Le peu de références directes au queer semblent en effet indiquer qu’il y est comme vu de l’extérieur, observé à une distance prudente à travers la perception de narrateurs/protagonistes masculins et hétérosexuels, dont le discours dénote parfois homophobie et fascination.
Nous prendrons l’exemple du Saint Michel, un établissement réputé pour accueillir une clientèle masculine homosexuelle que nos protagonistes se plaisent à observer à distance sans pour autant vouloir s’y mêler. Ainsi, lors d’une énième virée nocturne, Arsenio Cué et Silvestre veulent aller voir danser « las locas » (Cabrera Infante, 1995 : 115) tandis que leur ami se refuse d’assister à ce qu’il appelle «la mariconería en acción» (Cabrera Infante, 1995 : 115). Nous sommes ici face à un exemple de curiosité et de voyeurisme face à des individus marginalisés qui intriguent et repoussent tout à la fois, comme si finalement la libre expression de l’homosexualité n’était tolérée qu’en tant que spectacle d’exhibition – qui, soit dit en passant, ne leur est pas nécessairement destiné – ou autre freak show. Nous en avons d’ailleurs la preuve quelques pages plus loin lorsque nous lisons que les protagonistes s’en vont assister à « la exhibición de pájaros en la jaula musical del Saint Michel » (Cabrera Infante, 1995 : 117).
En outre – et pour continuer sur cette même idée –, il convient d’évoquer l’un des personnages emblématiques de Tres Tristes Tigres, à savoir La Estrella, également présentée comme une source de divertissement au sein du roman. Étoile de la nuit, chanteuse mulâtre à la forte corpulence et à la personnalité débridée, elle envoûte les noctambules par ses performances vocales, dans l’ambiance tamisée des bars havanais ou lors de soirées entre particuliers. Elle incarne la musique par sa seule voix et refuse de chanter si des instruments l’accompagnent ; lorsqu’elle ne chante pas, La Estrella rit à gorge déployée, hurle à tout-va ou bien ronfle allègrement après avoir ingurgité trop d’alcool. Au-delà de ce comportement extravagant, c’est bien son corps qui suscite le plus de fascination, avec son lot de commentaires grossophobes, de comparaisons animales et autres images grotesques, qui la caractérisent sans cesse : « es la prima de Moby Dick, la Ballena Negra » (Cabrera Infante, 1995 : 67) ou encore « aquel elefante qua bailaba ballet, aquel hipopótamo en punta, aquel edificio movido por la música » (Cabrera Infante, 1995 : 67).
Et l’aspect imposant du personnage est dû non seulement à son apparence physique, mais également à la méconnaissance totale des codes sociaux et de bienséance dont elle fait preuve. L’attitude de La Estrella intrigue tout autant qu’elle dérange, mais c’est aux autres de s’adapter à elle et non l’inverse. Elle ne leur laisse d’ailleurs pas véritablement le choix, comme en témoignent les épisodes où elle s’introduit chez certains personnages en leur absence, et que ces derniers la trouvent alors endormie au beau milieu de leur lit lorsqu’ils rentrent au petit matin après une longue soirée, ce qui donne lieu à des situations plutôt comiques :
sobre las sábanas impolutas del sábado, veo la mancha enorme, cetácea, carmelita, chocolate, que se extiende como una cosa mala y es, lo adivinaron, claro: Estrella Rodríguez, la estrella de primera magnitud que empequeñece el blanco cielo de mi cama con su fenomenal aspecto de sol negro: la Estrella duerme, ronca, babea, suda y hace ruidos extraños en mi cama (Cabrera Infante, 1995: 138).
Selon la caractérisation qu’en propose le roman, La Estrella est donc avant tout un corps, marqué par la démesure, décrit et exposé à outrance. Mais force est de constater que le personnage s’octroie une liberté tout aussi démesurée, bien loin de la rigidité des normes sociales, et cela est dû en grande partie au talent dont elle se sait pourvue : une voix tout aussi hors-norme et fascinante que son corps, devenant l’essence de ce personnage et lui permettant de ce fait d’acquérir cette liberté, à la fois dans son comportement et dans son discours :
La Estrella cantó más. Parecía incansable. Una vez le pidieron que cantara la Pachanga y ella, detenida, un pie delante del otro, […] echando la cara sudada, la jeta de animal salvaje, de jabalí pelón, los bigotes goteando sudor, echando por delante toda la fealdad de su cara, […] toda su cara por delante del cuerpo infinito, respondió, La Estrella no canta más que boleros (Cabrera Infante, 1995 : 71).
Nous le voyons, le corps occupe, comme toujours, le premier plan, mais cette attitude désinvolte et presque agressive atteste d’une confiance en soi inébranlable et d’une liberté totale dans l’expression, à la fois physique et verbale, du personnage. Forte d’une assurance à toute épreuve, La Estrella ne craint pas de s’affirmer afin de briller dans la nuit, quitte à en aveugler certain.e.s au passage.
Ainsi, par la mise en scène de ce corps hors-norme qui se veut libre et ne se cache pas, nous pouvons considérer que La Estrella fait preuve d’un comportement queer, s’exprimant à travers son corps et son art sans se soucier du regard des autres ni se limiter dans ses possibilités. Pour reprendre l’expression de Judith Butler, dans son essai intitulé Ces corps qui comptent, La Estrella ferait preuve d’une « puissance d’agir » (Butler, 2009 : 27) transformatrice puisqu’elle ne se laisse pas assujettir par la norme et parvient à se créer une position sociale qui fait d’elle un individu, si ce n’est apprécié ou détesté, pour le moins remarqué et incontournable au sein de la nuit havanaise.
Sa caractérisation même relève du queer, puisqu’elle est perçue à la fois comme étrange et comme étrangère aux yeux des autres personnages, l’un d’entre eux envisageant d’ailleurs l’hypothèse selon laquelle elle proviendrait d’une autre planète8. Et c’est là que réside tout le paradoxe qui génère l’impact du personnage : alors même qu’elle occupe le centre de l’attention et peut-être même du roman, La Estrella reste un personnage secondaire parce qu’hors-norme, sans cesse reléguée à la marginalité la plus totale9, jusque dans la place qui lui est attribuée dans la narration, puisque les sections qui abordent son histoire se trouvent à la toute fin des grands chapitres du roman, comme si l’on souhaitait la mettre au ban de la trame principale, alors qu’elle y occupe une place pourtant considérable.
Par conséquent, dans Tres Tristes Tigres, le queer est observé de l’extérieur et caractérisé de façon plutôt péjorative ; outre l’omniprésence de La Estrella dans les sections qui lui sont consacrées, les personnages queer sont simplement esquissés mais leur présence et leur évocation restent apparemment incontournables et suscitent une forme de fascination. Lieu de vie et de visibilisation, la nuit semble donc tolérer et faire briller les identités queer, pourtant condamnées en plein jour.
II/ De donde son los cantantes (1967) : la mise en scène d’apparences spectaculaires, entre artifices et transfigurations
À mi-chemin entre le milieu de la nuit et le monde du spectacle, le roman de Severo Sarduy nous sort de cette ambiance nocturne pour accéder à ce qui serait le deuxième pallier de notre incursion dans les festivités queer, avec notamment quelques considérations sur le travestisme et l’art du drag. Dans De donde son los cantantes, nous assistons à la mise en scène de personnages queer évoluant dans le milieu du spectacle. Celui-ci est évoqué de façon thématique dans le roman mais il transparaît également d’un point de vue formel, tant la narration est parfois empreinte d’une forte théâtralité.
Les deux protagonistes, Auxilio et Socorro, sont affublé.e.s d’identités fuyantes et insaisissables, d’apparences spectaculaires et extravagantes, sans cesse renouvelées par l’artifice, le maquillage, les parures et les déguisements farfelus. La voix narrative est d’ailleurs très explicite à ce sujet : « Y las veremos transformarse, poseedoras que son del secreto de las setenta y ocho metamorfosis » (Sarduy, 1997 : 112). Et, en effet, nous suivons – ou tâchons de suivre – les multiples transformations, transfigurations et autres mutations de ces personnages tout au long du roman, pour reprendre les termes qui y sont employés. En ce sens, dans son prologue de l’édition espagnole de 1980, Roland Barthes évoque un « texto hedonista y, por ende, revolucionario » (Barthes, 1980 : 5), à l’intérieur duquel les personnages ne sont autres que des créatures qui peuvent tout être à la fois, caractérisées par l’inconstance et la métamorphose, allant même jusqu’à circuler librement d’un sexe à l’autre. Il convient d’ailleurs de noter que le langage tend lui aussi à se travestir, au moyen d’une alternance dans l’utilisation genrée des pronoms et des accords, qui se réalisent tantôt au masculin tantôt au féminin, avec toutefois une nette prédominance pour le féminin, qu’il s’agisse du propre discours des personnages ou bien des commentaires de la voix narrative les désignant.
Présenté comme un art festif, le travestisme apparaît alors comme une constante dans leur caractérisation, ce qui permet aux personnages, bien souvent qualifié.e.s de drôles d’oiseau dans le texte10, d’exprimer et de célébrer leur identité de façon parfois outrancière mais toujours avec une certaine liberté et légèreté dans leurs comportements.
L’incipit du roman, par exemple, place les deux protagonistes sous le signe des artifices et de l’exubérance. Auxilio apparaît pour la première fois à travers la description de son accoutrement (plumes criardes, accessoires tape-à-l’œil et perruque) et le personnage est caractérisé par les couches de maquillage qu’il porte, comme le montre cette remarque de son amie : « Mírate. Las lágrimas te han hecho un surco en las cinco primeras capas de maquillaje. Evita que lleguen a la piel. Verdad es que para eso haría falta un taladro » (Sarduy, 1997 : 112). Comme nous le voyons, le déguisement et l’artificialité de ces apparences sont ici assumés avec humour et autodérision : bien conscients de l’emploi qu’ils font de ces artifices, les personnages s’en servent comme autant d’instruments leur permettant de célébrer leurs identités de façon toujours frivole. En ce sens, dans un article consacré au travestisme et à la notion de trans en littérature11, Lionel Souquet souligne l’importance de l’auto-dérision et tient les propos suivants, que l’on peut facilement appliquer à nos deux protagonistes : « On voit clairement combien la puissance trans-gressive de ces délires trans-formistes et trans-genres est sublimée par une insoutenable légèreté : c’est justement parce que les protagonistes pratiquent l’autodérision qu’ils sont subversifs. Là où le totalitarisme prétend tout prendre au sérieux, le personnage trans- (transformiste, transgenre, transsexuel…) dynamite la norme et les fausses évidences par la dérision. » (Souquet, 2018)
Dans notre cas, cette autodérision se retrouve à presque toutes les pages et nous pouvons penser par exemple au moment où les protagonistes, partis déjeuner au restaurant, sont l’objet de tous les regards en raison de leurs tenues et de leur maquillage. Les deux amis se mettent alors à distribuer aux clients des photos les mettant en scène dans des tenues et des poses toujours plus extravagantes, sans doute afin de désamorcer avec humour la tension de la situation initiale :
— Ojillos burlones nos recorren de pies a cabeza.
—Dedos nos apuntan, nos ponen asteriscos.
[…]
—Tengo una idea.
Abre una caja redonda forrada en piel de cocodrilo que trae colgada a la espalda con una cadenita plateada, como una cantimplora, y contándolas, saca cincuenta fotos en colores. Desecha dos, amarillentas, le entrega a Socorro un close-up en blanco y negro, y con las otras cuarenta y siete se va al extremo del comedor. Desde allí, mesa por mesa, las va repartiendo. (Sarduy, 1997 : 98)
Par ailleurs, il existe un personnage qui va au-delà du processus de travestissement et que l’on pourrait identifier comme une véritable drag queen dans le roman de Sarduy, puisque le travestisme devient drag lorsqu’il est combiné à de la performance et à d’autres pratiques artistiques : il s’agit de Flor de Loto, qui incarne le rôle d’une Impératrice chinoise à l’Opéra. Le public est subjugué, et notamment le personnage du Général, qui ne cesse de la poursuivre en espérant pouvoir la conquérir, malgré les mises en garde des protagonistes, qui tentent de lui faire comprendre qu’elle n’est pas la femme qu’il pense qu’elle est. Flor de Loto, quant à elle, se défait de ses artifices après chaque représentation, laissant retomber derrière elle le costume et les illusions du Général, si bien que lorsque ce dernier parvient enfin à entrer dans sa loge, il se retrouve nez à nez avec un “chino calvo y asténico” (Sarduy, 1997 : 115).
Travestisme ou drag, le motif du masque et du dédoublement apparait ici comme une constante : dans le cas de Flor de Loto, mais aussi dans celui de Socorro et Auxilio, nos deux protagonistes, dont les identités interchangeables semblent parfois fusionner en une seule et même créature, à la fois unique et multiple. Dans toute leur pluralité et leur diversité, les masques successifs que revêtent les personnages pourraient alors être interprétés comme autant de facettes qui tentent de rendre compte de la multiplicité du queer, de l’exprimer sous toutes ses formes, toujours de façon festive.
Et nous retrouvons d’ailleurs un processus similaire chez Reinaldo Arenas, dont les protagonistes ont bien souvent des alter egos ou des identités fragmentées et démultipliées : c’est le cas du roman intitulé El color del verano, qui nous fait désormais entrer dans notre troisième et dernière déclinaison de la fête, celle que l’anthropologue Daniel Fabre appelle « la fête à l’envers12 », à savoir le carnaval.
III/ El color del verano (1991): renversement carnavalesque et radicalité queer
El color del verano se présente effectivement comme un grand carnaval organisé par Fifo, avatar littéraire de Fidel Castro, pour célébrer ses 50 ans au pouvoir, l’action étant située en 1999, soit dans un futur proche puisque le roman a été rédigé dans les années 1970. Bien que de façon différente à ce que l’on a pu observer chez Sarduy, le protagoniste est également soumis au motif du masque et du dédoublement, ce qui donne lieu à des réflexions identitaires, comme il l’explique lui-même en s’adressant à sa mère : “No soy una persona, sino dos y tres a la vez. Para ti sigo siendo Gabriel, para aquellos que leen lo que escribo y que casi nunca puedo publicar soy Reinaldo, para el resto de mis amigos, con los cuales de vez en cuando me escapo para ser yo totalmente, soy la Tétrica Mofeta.” (Arenas, 2010 : 115)
Mais ce qui est sans doute le plus frappant dans ce roman est le déploiement du carnaval en lui-même. Car si la fête est caractérisée par l’excès, le carnaval les permet tous. Comme le soulignait déjà Bakhtine en commentant l’œuvre de Rabelais13, il s’agit avant tout d’un phénomène populaire marqué par la subversion, par le détournement de la hiérarchie sociale et de ses normes. Avec Arenas, nous sommes dans la célébration outrancière et le renversement radical des normes sexuelles : le carnaval arénien parodie en effet le modèle patriarcal hétéronormé en célébrant à l’excès l’homosexualité et ses pratiques, qui sont posées, voire imposées, en tant que norme. C’est bien simple : dans El color del verano, tout le monde est homosexuel et répond soit au modèle de la « loca » soit à celui du « bugarrón », eux-mêmes classifiés en différents types selon le comportement sexuel des uns et des autres. Par conséquent, par le truchement de cette invasion des pratiques homoérotiques au sein de la narration (Ventura, 2011 : 201), Cuba ressemble pour ainsi dire à une vaste « cage aux folles » au sein de laquelle l’hétérosexualité est tout bonnement évincée.
Par l’instauration d’une atmosphère orgiaque, les festivités du carnaval donnent l’impression d’une invasion des pratiques homosexuelles, ce qui est renforcé par les scènes pornographiques envahissent la narration en faisant intervenir des corps masculins aux membres disproportionnés. Par ailleurs, si comme nous le disions, tous les membres de la société sont homosexuels dans ce roman, il est curieux de constater que cet excès carnavalesque déborde même du cadre de la narration pour venir travestir et sexualiser les lecteur.rice.s, qui n’en sortent pas indemnes non plus. Dans un avis au lecteur, celui-ci est ainsi appelé “querida” (Arenas, 2010 : 15) d’office, comme s’il ne pouvait être qu’une « folle » de plus, ou encore lorsque l’instance narrative qui régit le prologue s’en prend ouvertement aux lecteur.rice.s en ces termes : “¡Niña! Saca tus manitas contaminadas y olorosas a pinga de este libro sacro, que la autora, la loca regia, va ahora mismo a escribir su prólogo.” (Arenas, 2010 : 259)
Force est de constater que le comique et la provocation extrême vont ici de pair, permettant par la même occasion de consolider la dimension contestataire de ce roman, où l’on ne s’étonnera pas d’assister à des ébats sexuels entre Fifo et le Che, ou encore de la présence menaçante et érotisée d’un requin aux attributs démesurés, nommé Tiburón Sangriento, chef de la milice marine du dictateur. Les représentations homoérotiques qui envahissent la narration jusqu’à la saturer apparaissent alors, dans le contexte cubain postrévolutionnaire, comme une puissante « arme de subversion » sociopolitique (Ventura, 2011 : 203).
Le carnaval représente donc ici le lieu et l’emblème d’une fiction cathartique (Ventura, 2011 : 184)14, le décor d’une vengeance socio-sexuelle (une sorte de « œil pour œil, dent pour dent » à la Arenas), comme pour compenser par la voie littéraire les entraves à la liberté subies à Cuba. Si Françoise Moulin-Civil évoque une « poétique de la transgression et du renversement15 » au sein de ce roman, nous pourrions même parler de radicalité queer puisque le hors-norme devient précisément la norme, dominante et exclusive à son tour. Radicalité queer puisqu’il semblerait que nous soyons face à la revendication d’une homosexualité en passe de devenir le nouveau régime politique dominant, pour reprendre en la détournant la fameuse formule de Monique Wittig, qui disait justement de l’hétérosexualité qu’il s’agit d’un régime politique16. En effet si le carnaval apparait comme la célébration des homosexualités masculines, posées en norme à tous les niveaux, il ne fait que renverser la norme et devient à son tour un système oppressif et radical, qui ne laisse finalement que peu de place à la diversité et à l’expression d’identités ou de pratiques autres qu’homosexuelles.
Cette radicalité queer est évidemment permise et exacerbée par le choix de la modalité carnavalesque, à tel point que l’homo-érotisation excessive causera finalement la destruction totale de l’île. Par conséquent, si dans les romans précédents l’ambiance festive permet de poser un regard extérieur sur le queer – chez Cabrera Infante – ou bien d’accéder aux coulisses de la communauté – chez Sarduy –, le carnaval rocambolesque imaginé par Arenas se présente comme un cataclysme vindicatif dont l’unique but est la célébration anarchique et destructrice, le déchainement de toutes les pulsions sans aucune forme de contrôle.
Qui plus est, il convient de mentionner que la dimension carnavalesque de El color del verano bouleverse également la structure de l’œuvre. Ainsi, dans un prologue qui apparait curieusement au beau milieu du roman, la voix narrative nous indique la chose suivante : “no se trata de una obra lineal, sino circular y por lo mismo ciclónica, con un vértice o centro que es el carnaval, hacia donde parten todas las flechas” (Arenas, 2010 : 262). Avec une narration non linéaire, un récit ponctué de ruptures et de distorsions, nous retrouvons ici les modalités d’un récit fragmenté qui étaient déjà présentes au sein des deux œuvres précédentes. La structure même du roman d’Arenas subit un effet d’hyper-fragmentation, puisque les quelques 450 pages sont réparties en un total de presque 120 sections, dont le titre de certaines se répète parfois.
Outre le récit et sa structure, un dernier élément mérite une attention particulière, à savoir le fait que cette carnavalisation de l’écriture s’opère également au niveau générique, au moyen d’un procédé bien connu d’intergénéricité – ou hybridité générique – qui consiste à superposer, au sein du roman, des modalités et des codes qui sont propres à d’autres genres littéraires, en particulier le théâtre et la poésie. Et cette imbrication des genres, qui peut faire du roman contemporain un objet protéiforme et constamment déguisé, est un procédé commun aux trois romans que nous venons d’aborder, mais qui est véritablement déployé chez Sarduy et Arenas.
Le carnaval sous toutes ses formes – rappelons-le – permet de renverser l’ordre établi, quel qu’il soit : politique, social, sexuel, mais également, du point de vue du récit, l’ordre chronologique et générique. En ce sens, au-delà d’une carnavalisation de l’écriture, ces transgressions génériques et textuelles nous conduisent à parler d’une forme d’écriture queer, ou d’une queerisation de l’écriture, puisque nous sommes bien face à des œuvres dont la définition oscille, précisément parce qu’elles bouleversent les codes du genre, à la fois sociaux et littéraires.
Considérations finales
Puisqu’elles représentent des moments privilégiés, la fête et ses déclinaisons permettent ainsi de célébrer la différence pour repenser voire renverser les catégories sexuelles et de genre, qu’il s’agisse du genre social ou du genre littéraire, les deux n’étant après tout rien d’autre que des constructions suivant des normes plus ou moins strictes et modulables.
Avec Cabrera Infante, nous avons observé les manifestations du queer au sein de la nuit havanaise, d’un point de vue extérieur et empreint de jugements. Le roman de Sarduy nous a ensuite permis d’accéder aux coulisses de performances queer, au fil des incessantes métamorphoses de ses personnages. Enfin, le carnaval d’Arenas nous a plongé dans une forme de radicalité queer qui n’aura laissé personne indemne.
Et finalement, le mieux à faire serait peut-être de conclure en affirmant que le queer pourrait se définir comme une fête : comme une transgression qui vient renverser les codes, c’est certain, mais également comme la célébration d’individus, de corps et de comportements hors-normes.