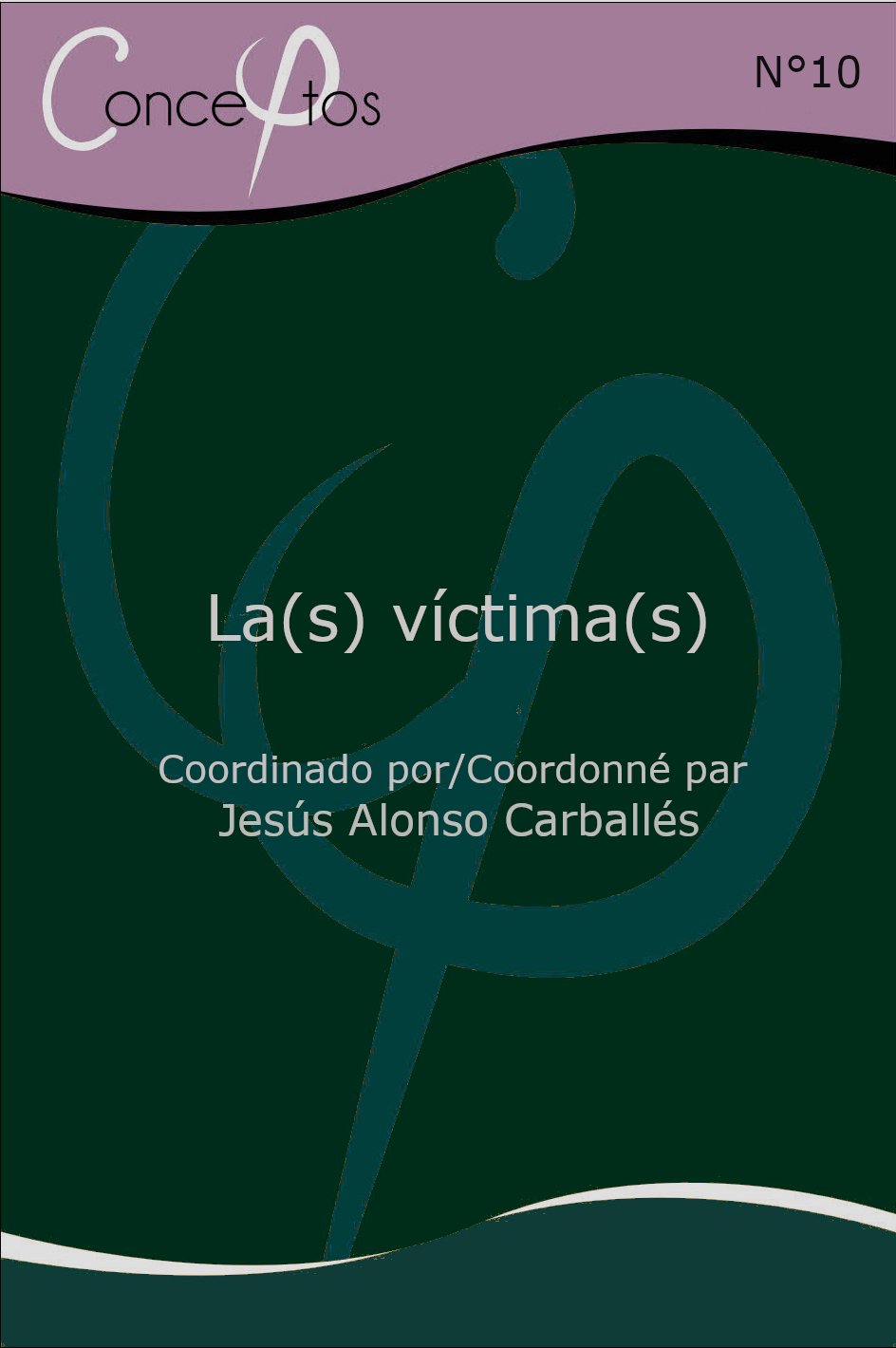Ce qui inquiète des victimes… et qu’il faut maintenant chercher ailleurs1
Ce qui nous échappe
Il s’agit de comprendre ce qui nous échappe. En sociologie, ce qui nous échappe ce sont beaucoup de choses, et si ce n’est pas l’entier du champ, nous dirions parfois que ce n’est pas loin. À savoir : ce qui n’est ni moyen ni médian, ni normal ni normatif, ni central ni centré, ce qui ne correspond pas à des répertoires d’action finalistes, ce qui balbutie parce cela ne cadre pas avec le discours, ni même avec la notion de discours. Aujourd’hui, en temps de catastrophes (Dupuy, 2005), d’Anthropocène (Tsing et al., 2017), d’incertitudes (Ramos et García Selgas, 2021), bref, en temps d’effondrement, ce qui nous échappe, ce sont donc beaucoup de choses.
Il y a quelque temps, nous avons trouvé avec les victimes en général, sans noms de famille, une voie pour répondre à la préoccupation liée à ce qui nous échappe. Il n’y a pas si longtemps, à peine plus d’une décennie, vers 2010, peut-être vers 2005, nous avons commencé à travailler avec d’autres, amis et collègues, sur la dimension sociologique de la figure de la victime. Lire à leur sujet, parler avec elles, individuellement ou en groupe, et même monter des projets de recherche dont elles faisaient l’objet n’était ni confortable ni facile : c’était à ce moment-là un univers opaque, où la théorie faisait défaut, et qui s’accordait mal avec les méthodes mobilisables en sociologie pour comprendre et travailler sur des questions telles que l’ « action », l’ « agentivité », l’« identité » ou le « sens », et moins bien encore avec la douleur et la souffrance. Sur les victimes, elles rebondissaient, constituant autant de répertoires d’action ayant fait du corps abîmé un patrimoine et de la souffrance un vocabulaire; autant de langages s’étant ordonnés autour du balbutiement produit par la souffrance; autant de positions face aux autres à partir de l’espace singulier qui marque que « ce qui m’arrive » est exceptionnel, unique, qu’il n’y a personne qui puisse surmonter cette douleur en étant victime, mais qui paradoxalement unit les uns aux autres, et construit communauté, identité, sens. Un lieu fascinant et formidable, où naît la nouveauté, qui a poussé les sociologues que nous sommes à mettre de côté ce dont nous avons hérité et à faire de la science-frontière. Comment parler à quelqu’un qui fait de la souffrance, du balbutiement, son langage ? Quel est l’acteur politique qui dénonce le grief et demande des soins ? Comment traiter tout cela quand ce n’est pas quelque chose qui vient d’un coin oublié de l’histoire, mais au contraire qui est installé au centre même de la vie sociale, et pas ici ou là, mais partout ?
Ce personnage situé aux marges, oublié, a occupé le devant de la scène sans que nous nous en rendions compte, à tel point que même pour nous, sociologues, ce pluriel concernant les autres – les victimes – devait commencer à être conjugué à la première personne : « nous, les victimes ». Elles n’étaient pas ou plus des tiers, une altérité : c’était nous-mêmes, et nous n’avions aucun outil pour les penser… pour nous penser. L’inquiétude pour ce qui nous échappait trouvait en elles… en nous, les victimes, un bon objet. Or peu de temps après, les choses s’étaient altérées. La figure de la victime s’était structurée au point de couper court à toute velléité de surprise, au point de revêtir une forme faisant le bonheur des sociologues et politologues de facture classique, satisfaits de ce qui est stable et se reproduit : un champ (Bourdieu, 1991), prévisible malgré son apparente variabilité, si délimité que si on le nomme – le champ des victimes –, on sait ce qu’on nomme. Il y a aujourd’hui tant de victimes si semblables entre elles qu’on les confond avec leur némésis, le citoyen (Gatti et Martínez, 2017a, 2017b). Et il y a aujourd’hui ce qu’il n’y avait pas il y a une décennie : bibliographie, centres d’études, thèses de doctorat, spécialistes, théories et méthodes. Elles n’étaient pas un objet de recherche « comme les autres ». Elles le sont devenues.
Où peut-on situer aujourd’hui la curiosité qui incite le sociologue à s’agiter et à nourrir des doutes sur la consistance de la vie sociale lorsqu’elle prend des formes inachevées (Biehl, 2005), visqueuses (Bauman, 1997), abjectes (Kristeva, 2015) ? La victime, qui était un terreau pour cela, ne l’est plus. Qui vit maintenant dans la région problématique, cette région inachevée, visqueuse et abjecte, que les victimes permettaient de voir ? Dans ce texte, nous voulons réfléchir à ce problème en proposant une excursion en trois étapes. La première est la victime elle-même, une figure qui était confuse, troublante et vitreuse, qui ne l’est plus, qui ne suscite plus la curiosité, qui n’inquiète plus. La deuxième est le disparu, et plus précisément, les usages profus de ce nom, académiques ou non, rigoureux ou non, pour appréhender le monde informe, celui qui dérange, celui que la sociologie n’atteint pas facilement. Enfin, la troisième, ce sont les territoires et les populations pour lesquels nos histoires, nos récits et nos registres ne semblent pas fonctionner, ceux pour lesquels les comptes et les récits appropriés restent à inventer.
De l’inquiétude à l’institutionnalisation : un regard sociologique sur les victimes
L’émergence a été spectaculaire. Sa consolidation s’est également faite en un laps de temps si court qu’elle nous a surpris. En quelques années, il y a eu des victimes de toute sorte et partout. En moins de deux décennies, ce personnage s’est installé dans nos économies morales (Fassin et Rechtman, 2009) ; et elle, la victime, une figure extraordinaire est devenue ordinaire, commune, banale. En Espagne, sans aller plus loin, une telle émergence a fait que «l’espace des victimes» (Gatti, 2017), autrefois restreint à une seule figure, celle de l’ETA (Izquierdo, 2014), s’est démocratisé au point de se démultiplier. À partir de ce moment il y a des victimes de tout : du terrorisme, du terrorisme d’État, des accidents de la route, des violences de genre, bien sûr, des négligences médicales, des accidents du travail, des victimes du vols de bébés, du djihadisme… Continuez la liste, ce n’est pas difficile : il y en a tellement que nous sommes tous des victimes. Les victimes ne sont plus l’exception, elles sont devenues la norme, elles sont désormais « comme tout le monde ».
Comment ne pas s’interroger sur un changement aussi radical, un changement de nombre –d’une victime à une multitude–, mais un changement aussi théorique, puisqu’il rend caduc le sujet de référence de la discipline, le citoyen qui n’est pas s’il n’est pas une victime (Gatti et Martínez, 2017a, 2017b) ? Et une fois ce processus accompli, comment la sociologie pouvait-elle aborder les victimes ? Avait-elle les outils théoriques pour le faire ? Devait-elle inventer de nouvelles voies théoriques ?
La sociologie a suivi d’une manière générale deux voies pour résoudre ces questions. La première voie trouve ses racines en France. C’est celle qui a connu la plus grande production autour de la victime, ou plutôt avec et contre la victime. La sociologie pragmatique, avec ses travaux sur les dispositifs qui façonnent les victimes (Dodier, 2009 ; Latté, 2008 ; Latté et Rechtman, 2006), permet de conférer une dimension empirique à ce processus désormais planétaire d’émergence et de consolidation des victimes. Ce qui est étudié n’est pas tant directement la victime, mais ce qui la façonne, ce qui lui permet d’apparaître, voire de s’établir en concurrence avec le citoyen, son contraire jusqu’alors : études sur la morale humanitaire (Fassin, 2015), ou sur les dispositifs –lois, institutions, agents, protocoles– qui se légitiment, politiquement et moralement, dans un certain rapport circulaire avec la nécessité de s’occuper de la souffrance des victimes. Le résultat, vu à travers les yeux des entomologistes, est un citoyen-victime (Gatti et Martínez, 2017a), un nouveau personnage qui a généré, bien sûr, de la suspicion dans une sociologie, la française, qui avait exalté l’individu-citoyen comme le référent même de l’idée de société. Si la sociologie avait construit son appareil théorique sur la parole, l’action et l’identité du citoyen, la victime y contrevenait, et elle inquiétait parce qu’elle disloquait cet appareil (Gatti et Martínez, 2016, 2017a, 2017b). Ainsi, la méfiance (Wieviorka, 2012 ; Garapon et Salas, 2007 ; Erner, 2007 ; Chaumont, 2007) s’impose à l’égard d’un personnage qui incarne une « identité négative », qui remet en cause le fonctionnement de la vie collective. La victime doit être victime, mais temporairement, recourir aux mécanismes de l’État –ceux de la première question sociale développés pour d’autres mises à sa marge (pauvres, précaires, indigents) – pour être réparée et restaurée dans sa condition antérieure : celle du citoyen. Et puis, ou en plus, une revendication annexe : affirmer que la victime n’est pas (si) différente du citoyen. C’est un sujet qui souffre, certes, mais cela ne l’empêche pas de toujours correspondre à ce qui fait le citoyen : une identité, une parole, une action ; la victime, dira-t-on, est un « acteur comme les autres » (Lefranc et Mathieu, 2009). La sociologie dispose alors des outils théoriques et méthodologiques pour l’analyser ; ce sont les outils que nous connaissons et utilisons.
Est-ce que la victime un acteur vraiment « comme les autres » ? Nous avons argumenté ailleurs contre cette affirmation (Gatti et Martínez, 2016, 2017a, 2017b), en nous appuyant sur une littérature plus anglo-saxonne, si l’on veut, qui aborde la victime, ou veut le faire, en tant que telle : non pas comme une mauvaise copie du citoyen, ou comme sa dégradation perverse, mais comme une entité singulière. C’est la deuxième voie qu’emprunte la sociologie pour résoudre les questions posées par ce personnage : quelle est son identité ? La victime peut-elle constituer une identité non négative, une identité propre ? Est-elle un acteur comme les autres ? La victime peut-elle parler ou a-t-elle un autre registre : le corps abîmé, le balbutiement, les pleurs ou la souffrance ? Peut-elle agir ou son action est-elle impossible ? Aborder la victime à partir de sa souffrance et de sa douleur, de sa vulnérabilité comme « condition anthropologique » de l’humain (Butler, 2006), permet à cet abord de considérer ce que l’approche française nie. Déployer une sensibilité pour le sujet souffrant et, avec elle, penser que ce sujet a un langage et une capacité spécifique à articuler communauté et sens (Das, 2008 ; Jimeno, 2008 ; Ortega, 2008), se traduit par une certaine orientation théorique conduisant au développement d’outils avec lesquels affronter différents oxymores : la parole de ceux qui n’ont pas de parole, l’agentivité de ceux qui en ont été dépouillés (Gatti, 2016 ; Martínez, 2019). Bien que le prix à payer soit une certaine perte d’historicité et une forte propension aux généralisations anthropologiques, cette approche fournit des outils pour analyser un personnage qui dépasse les limites de la sociologie, et permet d’être sensible à ses singularités.
Entre une voie et l’autre, les questions soulevées par ce nouveau personnage intense, la victime, ont été résolues, les doutes levés, le malaise qu’il provoquait atténué. Mais il n’y a pas que cela qui a été résolu et clos. En réalité, cela n’a pas d’importance et c’est relatif : la théorie sociale continue de passer à côté de ces territoires intenses, ceux de la douleur ou du traumatisme, ceux de la souffrance. Ce qui a annihilé la curiosité pour cette figure a été son institutionnalisation très rapide : d’abord sous la forme d’un immense appareil d’attention qui lui est consacré (lois, unités policières et médico-légales, tribunaux, indemnisations, experts), tout un gouvernement des victimes (Irazuzta et Gatti, 2017). La victime fait désormais partie du « tout organique » (Simmel, 2009) qu’est la société. On la craint ou on la plaint, son existence nous indigne ou produit du rejet. Mais nous la comprenons, et nous développons pour elle des politiques, des idées, des métiers ; les victimes ont formé un champ. Notre appareil moral est actif, très actif, sur ce territoire, mais peu excité : elles ne nous inquiètent pas ou plus, et nous faisons même nôtres leurs souffrances. Elles sont un fantastique alibi à nos actions. Elles sont si nombreuses qu’elles sont même devenues des acteurs communs, comme les autres : elles revendiquent des droits, elles parlent, elles s’organisent et agissent collectivement, elles cherchent à être reconnues. Même celles qui sont considérées comme les plus silencieuses et passives, les victimes de la violence de genre, le font (Martínez, 2020).
Enfin, cette figure qui échappait à la sociologie ne le fait plus autant ; elle n’inquiète plus. Elle s’est aussi institutionnalisée dans notre discipline. Où peut-on trouver ce qui nous inquiétait chez les victimes aujourd’hui ? Qui habite ce territoire ?
A la recherche d’un nom pour des souffrances sans moule. La disparition comme stratégie méthodologique
Hic sunt dracones était l’expression utilisée par les géographes du Moyen Âge pour désigner les territoires inexplorés, où l’on ne savait pas ce qu’il y avait. Il s’agissait d’endroits dangereux et mystérieux. Ils n’étaient pas désirables, mais ils étaient intéressants. Aujourd’hui, après des années et des années de cartographie du monde, il n’y a plus de dragons, mais il y a des lieux de vie où la vie ne fonctionne pas comme elle devrait, c’est-à-dire, comme elle fonctionnait avant. La profusion massive de victimes était un de ces lieux d’inquiétude. Or, maintenant que les victimes sont au centre de la société, voire qu’elles ont fusionné avec le citoyen, qui sont les dragons ? Qu’est-ce que nous ne sommes plus capables de compter, d’enregistrer ou de raconter, parfois même de penser, et certainement pas de théoriser ? Où est aujourd’hui ce qui est en dehors du social des sociologues (Giddens, 1991), ce qui est en dehors du « tout organique » (Simmel, 2009) ? Nous pouvons, et probablement devons, reconnaître notre « vulnérabilité épistémologique » (Gilson, 2011), et en même temps il est de rigueur d’affronter ce que Tuana appelle les « épistémologies de l’ignorance » (2006) sous l’une de ses quatre formes : savoir ce que nous ne savons pas ou ne voulons pas savoir, ne pas savoir ce que nous ne savons pas, ne pas savoir parce que d’autres privilégiés ne veulent pas que nous sachions, et l’ignorance délibérée. C’est précisément parce que nous reconnaissons ces limites, que notre préoccupation, notre inquiétude, croît : avec quels outils théoriques et méthodologiques pouvons-nous penser, enregistrer, raconter, narrer ce qui nous échappe ?
Où sont les dragons maintenant ? On ne peut pas nier qu’aujourd’hui beaucoup de choses restent au dehors. En dehors du tout organique, en dehors du registre sensible, en dehors du connu (Rancière, 2009). Avant, la victime donnait accès à ce dehors ; aujourd’hui, avec sa réussite, elle ne le fait plus. Comment encadrer théoriquement une souffrance sans nom, parfois immense, et qu’aucune des catégories de connaissance disponibles ne peut atteindre, qui les dépasse toutes ? Le terme « victime » n’aide plus : il inclut ceux dont la souffrance est reconnue ou ceux qui ont déjà mis en place des structures pour aspirer à être reconnus. Mais il y a d’autres souffrances qui n’ont pas leur place, qui sont encore dans un lieu inconnu, sans carte, encore en attente de catégories pour les rendre visibles et compréhensibles sans les abîmer, c’est-à-dire, sans dire qu’elles sont autre chose, différentes de ce qu’elles sont : des dragons. Les concepts de pauvre ou de vulnérable ne leur conviennent pas, ils sont trop globaux, trop éculés. La catégorie de victime les rattrape parfois, leur donne de la reconnaissance, mais elle ne raconte pas bien leurs histoires, plus maintenant. Nous faisons référence à des situations se mouvant à des échelles inconfortables pour l’œil de la sociologie, qui ne correspondent pas à ses périmètres, parce qu’elles sont sous-nationales, ou sous-sociales, ou capillaires (subalternes, souterraines, invisibles, non-politiques, non-sociales), ou trop mobiles (frontalières, hybrides, transnationales). Parfois, ils/elles ne sont même pas humaines parce que l’idée d’humain et de vie dont nous avons hérité ne s’y adapte pas (Fregoso, 2019).
Lorsque nous avons constaté que les études sur les victimes commençaient à faire partie d’un champ et que la recherche sur les victimes fonctionnait selon la modalité des franchises, avec plusieurs projets de recherche ou thèses de doctorat soutenus par le référent Mondes de victimes en Uruguay, en Argentine ou en Colombie, entre autres, nous avons laissé cette figure occuper le devant de la scène. À l’heure actuelle, des rumeurs ont commencé à circuler sur d’autres noms pour désigner ce qui échappe. Nous nous sommes intéressés à un nom difficile, inconfortable : desaparecido, disparu. Il a été et reste encore utilisé pour presque tout, et presque partout : pour les citoyens haïtiens dénationalisés en République dominicaine, pour les migrants traversant la Méditerranée ou d’autres frontières, pour les personnes appauvries à Montevideo, pour les corps victimes de la traite à Buenos Aires, pour les femmes indigènes évadées, kidnappées ou assassinées dans les réserves du sud des États-Unis, pour les personnes âgées perdues en Espagne…
Comment un concept né dans des contextes si étrangers à tout cela a-t-il pu faire un tel chemin, arriver si loin ? Le processus mérite d’être pris au sérieux. Pensons-y : « disparu » est un terme qui désigne une figure liée à l’extrême violence, un phénomène au sommet de la violation des biens juridiques de la plus grande portée dans notre lecture, la libérale, du sujet, celui qui comprend que l’on est ce que la loi dit que l’on est (Butler, 2017). Cette figure occupe désormais le firmament du droit humanitaire, s’étoilant dans une convention des Nations unies en 2006 – la Convention internationale pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées. Et elle a ensuite continué à grandir : depuis lors, elle sert d’étalon de mesure du terrible, parachutée en quelques années dans des situations, des contextes, des moments qui n’ont rien à voir avec ce que la figure nommait autrefois. Elle l’a fait pour aider à nommer ce qui n’a pas de nom : des formes de vie sans moule, informes, des morts en vie, des situations fantasmagoriques, des existences qui ne ressemblent pas à l’existence. C’est ainsi qu’elle a été et qu’elle demeure : elle est née pour qualifier les conséquences de la terreur d’État, lorsque l’État retire les titres de citoyenneté à ceux qu’il est censé protéger et les plonge, par action ou par omission, dans un territoire d’abandon. Aujourd’hui, elle qualifie les morts vivants, les migrants sans papiers, les corps réduits en esclavage, les travailleurs des plantations, les perdus, les effacés, les non-enregistrés. Tout ce qui n’entre pas dans d’autres rubriques. Beaucoup de ce qui, précisément, nous échappe.
Dans ce travail de dénomination de ce qui nous échappe, on est frappé par la profusion, mais aussi par le manque de netteté dans l’usage de cette figure, si peu précis parfois qu’il fait reculer le sociologue strict ou l’ethnographe rigoureux. Aujourd’hui, disparu nomme des morts ou des vies, des situations dans des contextes autocratiques ou dans ceux des démocraties libérales (Tassin, 2017), des violences politiques ou d’autres si anciennes qu’elles ne sont même pas pensées comme des violences, des phénomènes massifs et structurels ou d’autres exceptionnels et ponctuels. Il semblerait que l’usage n’est pas très rigoureux. Mais, comme nous l’avons dit, il faut prendre ce travail de dénomination au sérieux, car il occulte plusieurs vertus. Nous voudrions en souligner trois qui, ensemble, donnent des pistes pour répondre aux questions méthodologiques que pose l’analyse de ce qui se passe là, au-delà, là où sont les dragons.
La première vertu est sa capacité à nommer ; le vocable qualifie ce que d’autres termes plus sérieux – ceux d’horizon classique, et autres plus modernes – ne nomment plus bien ou correctement. Pauvre, vulnérable, misérable, oublié ou précaire, voire victime, sont en deçà de l’intensité des souffrances de ceux qui, parce qu’ils ne sont pas, n’ont même pas de nom. Disparu, en revanche, semble les accompagner plus confortablement.
La seconde est que ces usages s’adaptent aux caractéristiques des réalités, les nôtres, celles d’aujourd’hui s’entend, qu’on trouve dans des zones en ruine : fragmentées, jamais entières, toujours mobiles, faites de morceaux d’entités humaines, non humaines, plus qu’humaines ou moins qu’humaines qui collaborent entre elles pour survivre (Haraway, 2020). Il y a quelque chose, en effet, dans cette stratégie nominative, désordonnée et négligente même, qui s’accorde bien avec la texture des mondes précaires, qui semblent exiger de nous des approches en forme de patchwork (Tsing, 2021), des approches en morceaux (Luiselli, 2019) : des concepts qui fonctionnent à différentes échelles, plastiques, sensibles à différentes situations. Capables de s’allier avec d’autres, tantôt avec ceux qui parlent de race, tantôt avec ceux qui parlent de genre, tantôt avec ceux qui pensent à l’humain ou à la vie.
Le troisième, enfin, renvoie à l’endroit où se loge cet usage, c’est-à-dire, dans les grandes universités, et aussi dans les petites, mais aussi loin d’elles : ce sont des usages populaires, sans grande rigueur peut-être, mais pratiques et sages, voire utiles… Pourquoi ne pas prêter attention à la rumeur qui lie, sans sens apparent, la précarité ou la pauvreté ou l’oubli ou l’esclavage à la « disparition » (Gatti, 2022) ? Pourquoi ne pas prendre au sérieux ce geste qui nomme assez négligemment « disparu » ce que, dans des salons plus élégants, on appellerait mort sociale (Patterson, 2018), expulsion (Sassen, 2015), effacement (Tassin, 2017), ou vie insupportable (Bradley, 2019) ?
L’utilisation de « disparu » aujourd’hui est dispersée, désordonnée, multi-située. Elle est planétaire, comme le Coca Cola, la NBA ou le visage du Che. C’est un objet monde (Serres, 2015) : le terme est partout et partout il nomme des choses informes, inachevées (Biehl et Locke, 2017), ce que la sociologie ne peut pas faire. En le suivant, en opérant avec l’appel révisé de George E. Marcus à proposer des ethnographies multi-situées – un follow the thing (Marcus, 2001) qui se recompose en follow the disappeared – nous avons trouvé des vies sans histoire, sans registre, ou sans soins. Ce que nous voulions comprendre. Ce qui nous échappe. Nos dragons.
Ce qui nous trouble maintenant : la disparition sociale, les vies qui ne comptent pas et leurs histoires possibles
En suivant cette rumeur, celle de l’utilisation désordonnée du « disparu », nous avons donné forme à une catégorie, la « disparition sociale » (Gatti, 2020 ; Casado-Neira et al., 2021). Bien qu’elle se soit transformée au fil du temps et des progrès de la recherche, si nous devions en donner une définition, nous dirions que la « disparition sociale » réfère à la production systématique de sujets à la limite du reconnaissable, hors des cadres de perception partagés ; elle sert à nommer ceux qui n’existent plus ou ceux qui sont en train de cesser d’exister. C’est un concept pour penser la vie qui ne compte pas, la vie qui échappe, selon trois sens2 :
- La vie qui ne compte pas parce qu’elle n’est pas racontée, parce qu’elle est hors du récit commun, parce qu’elle n’est pas incluse dans les récits avec lesquels nous imaginons (sentons, lisons, entendons, voyons) le monde.
- La vie qui ne compte pas parce qu’elle n’est pas comptabilisée, c’est-à-dire, qu’est en dehors des comptes, qu’elle n’est pas incorporée dans les dispositifs d’enregistrement de la population.
- Et vie qui ne compte pas parce qu’elle est négligée, parce qu’elle n’est pas prise en compte, qu’elle n’a pas d’importance, parce qu’on ne s’en préoccupe pas d’elle, on ne la soigne pas.
Comment compter les vies qui ne comptent pas ? Nous ne pensons pas tellement à la façon de les prendre en compte, de prendre soin d’elles, ni à tout ce qui relie cette façon de comprendre la disparition à de vieux thèmes tels que la désaffiliation, la désinstitutionalisation, le manque de protection, l’abandon, le manque de soin, ou, enfin, la souffrance sociale. Cela nous inquiète, bien sûr, et nous pose énormément de questions : comment vit-on dans une situation de non-protection ? Quelle est la vie de quelqu’un d’abandonné ? Existe-t-il des formes de vie dans ces situations – d’abandon, de désaffiliation, de non-protection – qui nient la vie ? Comment pouvons-nous traiter des « objets » traversés par des logiques opposées : protégés par la loi, mais en même temps non protégés par sa mise en œuvre, négligés paradoxalement pour être soignés, qui trouvent une protection précisément dans une situation qui semble les déprotéger ?
Nous pensons surtout à la manière de raconter adéquatement ces vies du point de vue de la profession que nous exerçons. C’est-à-dire, faire compter ses vies dans le sens de « raconter ». Ce sens renvoie aux difficultés pour notre discipline d’approcher des objets impossibles à raconter. La disparition originelle a déjà activé cette question parce qu’elle a favorisé des situations insaisissables eu égard à notre façon de représenter le monde, et en particulier à la diversité de notre langage, et une grande partie de la littérature à son propos s’est concentrée sur la compréhension des stratégies complexes avec lesquelles elle est gérée. Ainsi, les travaux sur le témoignage ou le silence (Da Silva, 2001), ceux sur la place des fantômes et des fantasmes parmi les personnes affectées par la disparition, ou d’autres sur les singularités de l’art qui représente ce qui ne peut être représenté (Richard, 2007) posent un problème plus large : lorsque nos objets sont brisés, les outils avec lesquels nous travaillons – les catégories pour les nommer, les instruments pour les voir, les manières d’en parler – se brisent aussi. La disparition sociale, la disparition d’aujourd’hui, qui est massive et structurelle, radicalise ce problème et généralise la question de savoir comment raconter ce qui n’est pas raconté3.
Le monde est rempli de situations et d’individus hors des comptes, de vies qui ne comptent pas. Les catégories et les outils dont nous avons hérité pour les compter et les raconter, aussi pour les prendre en compte, semblent épuisés, et le malaise grandit quant à la manière de procéder. Il semble que nous soyons obligés d’inventer « une autre façon de raconter des histoires » (Haraway in Terranova, 2016), des histoires qui racontent précisément les histoires de ceux qui ne sont pas pris en compte, les vies qui ne comptent pas. Il s’agit d’une inquiétude majeure.