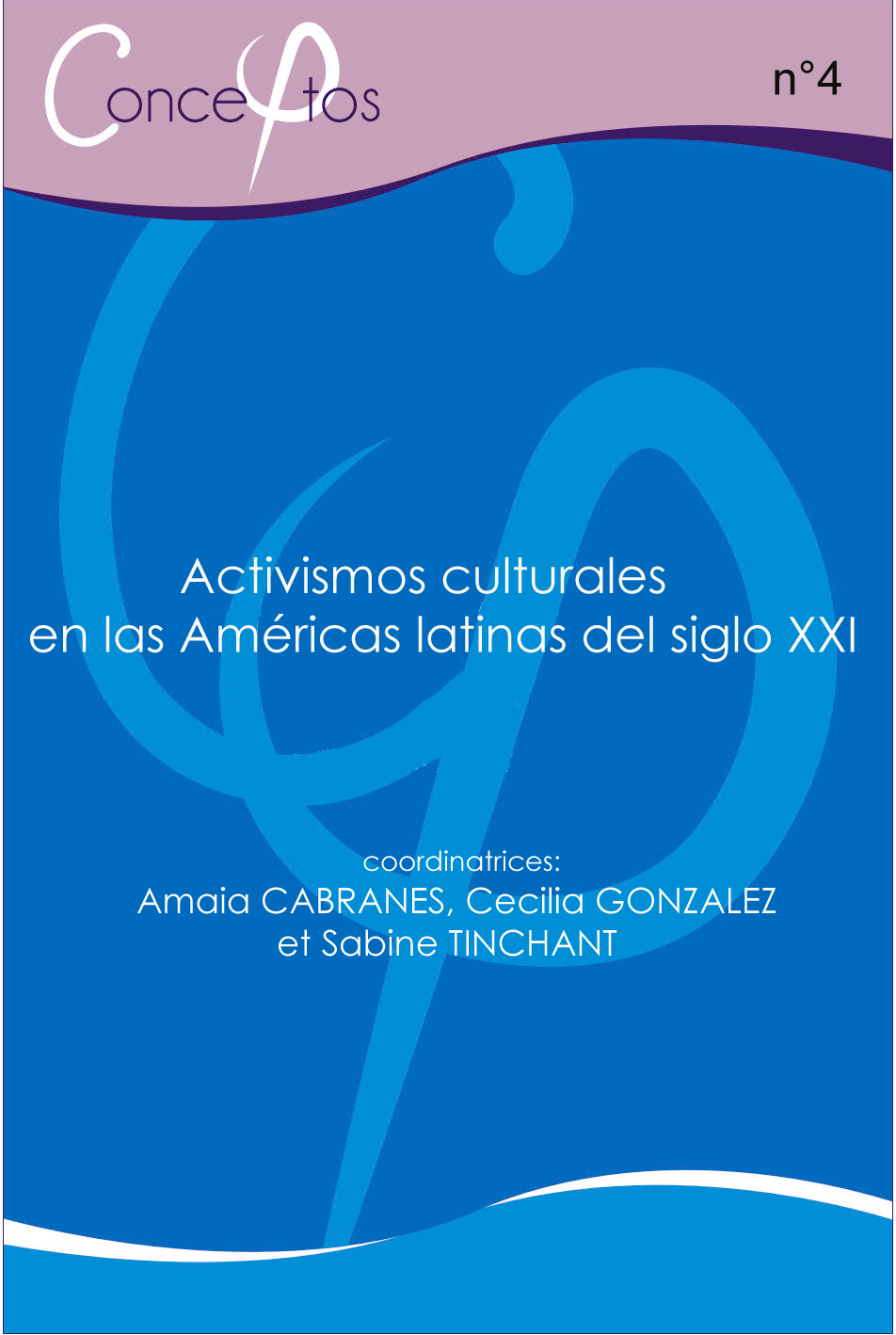Usages pratiques, traditions formelles, et injonctions de la mode : Chaussures et bottes en Espagne au Moyen Âge
Porter une chaussure qui soit à la fois pratique et élégante fait partie des préoccupations vestimentaires médiévales, qu’il s’agisse de marcher ou de chevaucher. Cependant, à plusieurs périodes du Moyen Âge, l’extravagance semble avoir pris le pas sur le caractère pratique de l’objet chaussure. Si tout un chacun a en tête les fantasques poulaines, celles-ci ne sont pas les seules chaussures invraisemblables de l’époque. Elles et leurs ancêtres des XIe-XIIe siècles, les pigaches, ne sont cependant que des formes périphériques de la mode en matière de chaussures, et réservées à des élites soumises aux injonctions d’une mode discriminante, ne reculant pas devant le ridicule pour signifier leur fortune… et leur oisiveté. Mais lorsqu’ils travaillent, marchent ou montent, les médiévaux ne sont pas plus fous que d’autres, et s’en tiennent en général à des chaussures et des bottes simples et souples, presque toujours sans talons, adaptées à la vie quotidienne et à un usage pratique. Si les mêmes formules morphologiques semblent répandues à peu près partout en Occident, ces souliers évoluent cependant en fonction des époques, mais aussi des états et des milieux (élites et rustres, laïcs et clercs, hommes et femmes). L’Espagne ne fait pas exception en la matière, cependant la péninsule Ibérique a connu quelques formules spécifiques, comme les bottes souples appelées borceguíes, ou encore les fameuses espadrilles de sparte, toujours portées (Bernis Madrazo, Herrero García, Astor Landete).
L’histoire de la chaussure médiévale ne date pas d’hier, puisque les érudits s’y sont intéressés dès le milieu du XIXe siècle, au moins (Lacroix et Duchesne, Vincent). Cependant les illustrations relèvent parfois plus de la fantaisie que de l’observation sérieuse de l’objet. Une étude serrée du vocabulaire de la chaussure reste encore à faire, à mon sens, que ce soit en castillan, catalan, ou dans les autres langues vernaculaires médiévales. L’étude serait à mener au moins à partir de dictionnaires (Coromines ; Coromines et Pascual), mais nous n’avons pu effectuer que quelques sondages. Je ne le signale ici que comme pistes de recherches à venir. Il faudrait y associer une étude des ordonnances des métiers (cordouaniers fabriquant le cuir, chausseurs etc.), mais qui excédait largement la mesure de cette modeste recherche1. Nous avons tenté de replacer les chaussures ibériques dans un plus vaste ensemble « européen », afin de mesurer le cas échéant les spécificités espagnoles. On a choisi de présenter en outre les types de chaussures et de bottes dans l’ordre chronologique, en tentant de différencier, dans la mesure du possible, chaussures aristocratiques et chaussures populaires, si les formes et les matières le permettent. Nous avons privilégié les témoins conservés, assez nombreux, le cuir étant une matière relativement bien préservée – par exemple dans une sépulture – en essayant de les comparer aux manuscrits contemporains, et surtout aux témoins textuels, qu’il s’agisse de romans ou de textes d’archive. Quatre époques me semblent pouvoir être distinguées.
1. La chaussure traditionnelle « à la forme du pied » jusqu’au XIIIe siècle
Comme partout en Occident, les chaussures ibériques de l’époque wisigothique et du haut Moyen Âge en général héritent des souliers « à la romaine », c’est-à-dire la sandale antique, elle-même d’origine grecque, appelée solea (soleæ au pl.), semelle, littéralement. Il s’agissait sans doute encore, à l’époque carolingienne, d’une semelle faite d’un simple morceau de cuir, d’alfa tressé2, ou de liège, semelle qui était attachée au pied à l’aide de lanières ou de bandes qui passaient entre le gros orteil et le doigt suivant ; le soulier pouvait aussi être attaché avec des bandes de cuir sur le cou-de-pied (disposées de multiples façons), fixant également le talon. Le contraste entre sandales et chaussures montantes apparaît nettement dans le Beatus de Valladolid (970)3. Dans ce manuscrit, la plupart des personnages ont les pieds nus, ou portent des chausses assez indistinctes (forme du pied peintes en noir), mais on distingue clairement les lanières des sandales dans un cas, et la forme de la chaussure montante dans une autre enluminure.
La chaussure montant sur le cou-de-pied est la seconde forme la plus répandue de chaussure, en Occident. À l’époque franque (sous les Mérovingiens pour la France), les hommes portent des chaussures fermées, en cuir plus ou moins travaillé, souvent encore couvert du poil des bêtes, mal raclé. Elles sont fendues sur le dessus du pied, et maintenues par des lacets sur le cou-de-pied, ou par des lanières entrecroisées, souvent très longues et montant jusqu’à mi-jambe, telles des bandes molletières (Boucher, p. 161). Certes, la chaussure peut être plus ou moins pointue, mais elle ne semble avoir jamais atteint en Espagne les extravagances des poulaines au bout surdimensionné, dénoncées vigoureusement par Orderic Vital pour une période transitoire entre le XIe et le XIIe siècle (Vital, III, p. 323-352). Toutes les chaussures conservées datant du XIIe siècle ne présentent cependant pas des formes pointues ou allongées. En fait, partout en Occident, elles ne différent guère de la période antérieure.
À peu près à la même époque, celui que l’on identifie traditionnellement comme le moine Aimery Picaud dénonce, dans le célèbre Guide du Pèlerin, les chaussures rustiques des Navarrais, seul peuple auquel il consacre un long développement – fort haineux – concernant leurs pratiques vestimentaires, alimentaires, sexuelles et sociales en général (Picaud, p. 27-31 pour l’ensemble du passage sur les « mauvaises mœurs » des Navarrais).
Les Navarrais (…) ont des souliers qu’ils appellent lavarcas, faits de cuir non préparé et encore muni de poil, qu’ils attachent autour de leurs pieds avec des courroies, mais qui enveloppent seulement la plante des pieds laissant le dessus du pied nu.
Ce qui était la chaussure basique des Francs et de bien d’autres peuples, quelques siècles plus tôt, semble désormais être considéré comme une marque d’atroce rusticité. Le moine poitevin stigmatise ici la vulgarité des chaussures navarraises, allant de pair avec le reste de leurs mœurs dépravées : cuir non tanné, simple pièce de cuir mal taillée, attachée sur le cou-de-pied par des courroies, et laissant le reste du pied nu, à l’opposé des chaussures fines et élancées qui doivent cacher les pieds des hommes, et a fortiori des femmes.
À la fin du XIIe siècle, on commence à voir apparaître des brodequins dont la tige est un peu plus haute, englobant la cheville, et qui se termine derrière par une longue languette, parfois découpée et festonnée. Le mot solers apparaît aussi en français au cours du siècle : il désigne des chaussures en cordouan (cuir de Cordoue), récemment introduit dans tout l’Occident. Le terme même de cordouanier apparaît par exemple dans les statuts de métier compilés en France par Étienne Boileau (1268), pour désigner un certain travail du cuir et son résultat, un cuir fin et souple, s’opposant à la « basane » plus rustique (Boileau, p. 183-185 ; p. 186-187 ; et p. 187-188). Les cordouaniers ne travaillent a priori que le meilleur cuir, le cordouan, préparé non pas à Cordoue mais à la façon de Cordoue. Le cordobán des Maures était plutôt du cuir de chèvre, de bouc ou d’agneau, voire de la peau de chagrin (cuir d’âne, de mulet ou d’hémione), c’est-à-dire une peausserie plus fine et plus souple que le cuir de vache. C’est ce que l’on appela aussi plus tard le maroquin. Le tannage se faisait à la noix de galle et au sumac. Quant aux savetonniers et savetiers de Paris, ils se contentaient de travailler la basane, peau de veau un peu plus épaisse, ou peau de mouton plus âgé que les belles peausseries d’agneau, voire cuir de vache ou de bœuf, également tanné par des substances végétales. Cela étant, bien souvent, les savetonniers (tout comme les selliers ou les bourreliers) avaient aussi des dérogations pour utiliser le cordouan, à condition de payer des droits d’entrée au métier de cordouanier. La solidité de la basane, par rapport au cordouan, se voit bien dans les statuts puisqu’on l’accepte comme « contrefort », peut-être pour l’empeigne ou la tige des souliers (LXXXIV, 5). En revanche, il est interdit de mélanger cordouans et basanes dans d’autres parties de la chaussure (LXXXV, 2). En fait, les choses ne sont pas très claires, car le savetier peut en fait ajouter des pièces de cordouan à ses souliers de basane, mais pas de la vulgaire basane à de fins souliers de cordouan (LXXXV, 3). Où passait la frontière entre les deux ?
L’iconographie rend compte d’un type de chaussures montant à peine à la cheville, type bottines, ou bien découpées sur le cou-de-pied et fermant par une bride, subsistant à concurrence des sandales découvertes. Les représentations des bottes souples et lacées autour de la cheville apparaissent ainsi dans les Cantigas de Santa Maria, vers 1280, de même que des sandales très découvertes, héritières de la solea romaine, qui semblent plutôt portées par des moines ou des frères franciscains.
Dans ces mêmes Cantigas de Santa María, le chant 61 (Fol é o que cuida…) relate un récit qui n’a rien de spécifiquement ibérique, puisque c’est une reprise par Alphonse X d’un récit de miracle déjà narré par Gauthier de Coinci et Jean de Garlande, et situé dans les deux cas à Soissons. En résumé, le couvent des religieuses de Soissons était très fier de posséder une relique précieuse, rien de moins qu’une chaussure de la Vierge4 ! Mais parmi les pèlerins, un homme se met un jour à contester l’authenticité de la relique : comment une chaussure aurait-elle pu subsister en aussi bon état, après autant de temps ? Le blasphème lui vaut une cruelle punition, sa bouche se tord comme s’il se trouvait à l’agonie ; il se reprend, et revenant devant l’autel, l’abbesse le guérit en lui flanquant un bon coup de la chaussure en travers du visage5, et il devient un fidèle serviteur de l’abbaye ! Malheureusement, ce miracle ne nous en apprend guère plus sur la morphologie de la chaussure, ne la désignant que comme une çapata.
À l’exception des pigaches, qui (en dépit des vitupérations d’arrière-garde des clercs) semblent n’avoir été qu’un « feu de paille » en matière de mode, et ne pas avoir atteint l’Espagne, les chaussures du Moyen Âge central se caractérisent par des formes simples, taillées dans un cuir plus ou souple (et sans doute de prix plus élevé pour les cordouans), adaptées à la morphologie du pied, et portées indifféremment par les hommes et les femmes, les clercs et les laïcs. Elles peuvent être plus ou moins découpées en fonction de leur usage saisonnier. Enfin, ces chaussures sont peu montantes en général, si ce n’est sous la forme de bottines ou brodequins, qui semblent cependant être plutôt réservés à un usage dynamique (monte à cheval), ou aux classes paysannes et populaires. Cependant l’exemple des Navarrais dans le Guide du Pèlerin montre que les paysans portent aussi des sortes de sandales. Ces formes simples et rudimentaires évoluent un peu à partir du XIVe siècle.
2. Les évolutions de la mode en matière de chaussures, aux XIVe et XVe siècles
Les chaussures évoluent finalement assez peu, dans leur ensemble, mais cela ne veut pas dire qu’il n’existe pas des types assez variés de chaussures, à partir du XIVe siècle. Les souliers (soliers, sollers…) constituent toujours la chaussure de base. Mais ils se diversifient, et on se chausse aussi de plus en plus de bottes, bottines, heuses, chausses semelées (en castillan : calzas soladas ou de soleta), etc. Le caractère pratique, voire pragmatique, des chaussures, n’empêche pas une différenciation de plus en plus grande des formes des chaussures ; en témoignent aussi bien les textes que les images.
L’étude que j’ai pu mener sur les documents d’archive, notamment princières, en France au XIVe siècle, montre que l’on peut y distinguer au moins une dizaine de formes : les souliers de base, sans spécification ; les souliers « ronds » à boucles, c’est-à-dire à la taille du pied ; les souliers « bien fermés » à deux, trois ou quatre noyaux » (ces « noyaux » sont en fait les trous des passe-lacets) ; les souliers ouverts, décolletés et « pertuisés » ou « écorchés » : ce sont des chaussures qui tiennent le milieu entre le soulier et la sandale, en raison de nombreuses découpes ; les souliers à boucles sans décolleté sur le cou-de-pied, c’est-à-dire montantes jusqu’à la cheville, et comportant déjà une pointe à poulaine à la fin des années 1380 ; les souliers écossais « de cuirs tout crus à tout le poil » (comme ceux des Navarrais) ; les chausses de drap « semelées » ou « carrelées », i. e. garnies de semelles cousues de façon à pouvoir être portées au moins à l’intérieur sans autre chaussure ; les bottines « hautes jusqu’au genou » ; les houseaux, qui désignent des bottes, bottines ou guêtres même, parfois. Je n’ai malheureusement pas pu me livrer à une étude semblable pour la péninsule Ibérique.
2.1. Les chaussures basses : y a-t-il des « poulaines » en Espagne ?
Enluminures, fresques, et exemples conservés, montrent la prédominance de chaussures semblables à celles des époques antérieures : souliers très peu montants (au niveau de la cheville), fermés en général par un laçage sur le côté du pied (les lacets passant dans les « noyaux »), ou bien par des boucles. On les voit notamment figurées sur le retable de saint Marc à la Seu de Manresa (église de Sainte-Marie), en 1346, où Arnau Bassa a représenté Saint Anian d’Alexandrie réparant les chaussures de saint Marc6. Ce sont toujours les mêmes modèles, avec une ouverture sur le côté du pied, fermée sans doute par un laçage, même si la forme tend à s’affiner et s’allonger en pointe.
L’Espagne ne semble guère avoir été perméable à la chaussure à la poulaine à bout très pointu (ou « chaussure à bec »), héritière lointaine de la pigache, et qui commence à être mentionnée et représentée en France et en Angleterre dans la seconde moitié du XIVe siècle. En tous cas, on ne la voit ni mentionnée dans les textes, ni figurée dans l’iconographie, sauf exception. Le musée du cuir de Francfort-sur-le-Main conserve ainsi une chaussure à bec ou poulaine, qui proviendrait d’Espagne (peut-être de Tolède) et daterait du XVe siècle. Nous en verrons plus bas d’autres exemples, à propos des socques. Portée par les hommes comme par les femmes, la poulaine se caractérise par une forme allongée ou pointue. On en trouve cependant de plus ou moins longues et pointues. L’étymologie est discutée, mais on en fait souvent le féminin de « poulain », qui serait dérivé de « polonais » et on parle d’ailleurs, de fait, aussi, de « souliers à la polonaise ». Elles sont portées principalement entre 1370 et 1410, puis entre 1460 et 1480. Certaines restent d’une taille raisonnable ; d’autres au contraire atteignent une taille démesurée (et sans doute très encombrante), jusqu’à 50 cm. Le bout pointu est parfois monté sur une armature afin de le rigidifier, et surtout rembourré d’étoupe ou de chanvre, pour éviter que le pied ne glisse dans cette quinzaine ou vingtaine de centimètres excédentaires. Plus on appartient à l’élite, et plus la pointe se doit d’être longue. Les rois peuvent les porter aussi longues qu’ils le souhaitent, paraît-il !
2.2. Les bottes souples ou rigides du XVe siècle : brodequins et bottines
Aux côtés de ces chaussures basses apparaissent des bottines montant cette fois plus haut, au-dessus de la cheville, couvrant le mollet, et allant jusque sous le genou, avec un bout rond ou parfois un peu plus pointu. Faites dans un cuir souple, qui tirebouchonne autour de la cheville, elles sont largement évasées au niveau du mollet. Ces bottes souples et fines n’ont pratiquement pas de semelle, ce qui nécessite de porter des patins (socques) pour les protéger. Il peut d’ailleurs s’agir aussi bien de simples chausses semelées que de bottines à proprement parler. C’est le cas de bottes ou bottines basses et souples, ou peut-être de chausses semelées portées tombantes, peintes par le « Maestro de Alpuente », dans la Fuite en Égypte, vers 1390-14057, et par le Valencien Miguel Alcañiz (actif entre 1408 et 1447), dans la Légende de saint Michel, en 1421, avec un large revers tombant sous le mollet.
La botte haute, montant jusqu’au genou (en dessous ou au-dessus), et beaucoup moins évasée dans le haut, si rare auparavant, se développe largement au XVe siècle. Il est cependant parfois difficile de distinguer, dans les enluminures, ce qui relève d’une chausse mal attachée et retombant sous le genou, sans aucun talon, et d’une botte à proprement parler. La botte haute semble avant tout liée à la pratique équestre, car il s’agit de protéger les fragiles chausses de soie du frottement des mollets contre les flancs des chevaux. Dans les enluminures ou les retables, elle apparaît très souvent liée à des éperons. À la différence de la bottine basse portée de façon souple, plissant sur le mollet, la botte haute est bien tirée et tendue, parfois jusqu’au-dessus du genou, peut-être rigidifiée par une tige. Dans le retable de Ferdinand I de Castille recevant saint Dominique de Silos, Bartolomé Bermejo (v. 1440-1500) peint ainsi une botte haute (type borceguí), en cuir non-teint, et portée glissée dans des patins, tandis qu’un autre personnage porte des bottines souples et évasées, en cuir jaune.
2.3. La spécificité des borceguíes ibériques
La péninsule Ibérique connaît un genre particulier de botte, le borceguí8. Il s’agit d’une botte montante et souple, documentée à la fin du XVe siècle, mais avec peut-être des antécédents iconographiques remontant au XIIIe siècle. Il arrive en général jusqu’à la cheville ou aux mollets dans une forme courte, jusque sous les genoux parfois, et plus souvent encore, la botte les recouvre complètement (borceguí de rodillete). Fait dans un cuir très souple (badana : cordouan ou peau de chamois), le borceguí colle à la jambe comme une chausse, véritable seconde peau, et le haut peut être porté retourné.
L’une des premières références littéraires se trouve dans la Celestina, associée à un proverbe « tomar calzas de Villadiego ». Lors de la rencontre nocturne entre Calixte et Mélibée, les valets du premier, Sempronio et Parmenio, restés à faire le guet dans la rue, et peu rassurés, se disent prêts à prendre la poudre d’escampette à la première alerte, tant pis s’ils doivent abandonner leur maître sur place ; l’un précise même à l’autre qu’il fuira d’autant plus vite qu’il porte des chausses, ou mieux encore « ces borceguíes si légers comme ceux dont tu parles » (Célestine, II, p. 376)9. Si le sens de l’expression proverbiale est à peu près clair (prendre ses jambes à son cou devant un péril menaçant), son origine est discutée ; Villadiego semble être une référence à une localité de la région de Burgos (le dicton est gravé sur une colonne de la municipalité) ; elle abritait une importante communauté juive, à l’époque de Ferdinand III de Castille, et aurait alors reçu des privilèges et une protection spéciale, en contrepartie du port de vêtements spécifiques, de couleur jaune. « Enfiler les chausses de Villadiego » aurait, dès lors, signifié quitter à toute vitesse sa communauté pour aller se réfugier dans ce village propice aux Juifs (Iribarren)10. Cependant, d’autres attribuent à l’expression une origine bien différente : Villadiego serait un soldat romain partageant la cellule de saint Pierre ; quand un ange leur apparut pour conseiller au saint de fuir au plus vite, dans sa précipitation saint Pierre s’empara par erreur des chausses de son compagnon de prison et s’enfuit comme s’il avait le diable aux trousses (Martínez López)11. Quoi qu’il en soit de l’origine du proverbe, on retiendra que les borceguíes sont des bottes/chausses si souples qu’elles n’entravent pas la marche ou la fuite, tout au contraire.
Dans l’iconographie, il est parfois difficile de le distinguer des bottes, sauf à observer les plis formés par l’objet sur le cou-de-pied : les bottes plissent toujours un peu, tandis que le borceguí colle au cou-de-pied, et s’y ajuste parfaitement, parfois grâce à l’empeigne, particulièrement bien marquée. Mais la forme était si étroite que pour enfiler ces bottes, il fallait recourir à des ustensiles appelés « subidor de borceguí », peut-être des pinces ou des tirants. Le dessous était taillé dans une ou deux épaisseurs de cuir, ce qui offrait une semelle souple, assez fine pour permettre de glisser le pied dans une autre chaussure, type socque ou patin. On pouvait le porter à la maison ou dans la rue, avec ces patins. Des borceguíes hauts et de couleur jaune, avec des revers remontés sur les chausses, sont ainsi figurés par Jaime Huguet (v. 1415-1492), dans le retable de Saint Vincent dans la fournaise, à San Vicente de Sarrià, vers 1450-1455. Des borceguíes montant sous le genou, avec un riche décor sans doute gravé dans le cuir et doré, et peut-être des semelles plus épaisses, sont aussi figurés par le même Jaime Huguet, dans Le chemin du Calvaire, Retable de San Agustín, vers 1465. Ce retable était une commande de la corporation des mégissiers (spécialistes du tannage des peaux d’ovins et de caprins destinés à l’industrie de la chaussure), ce qui peut expliquer la présence de cette représentation d’un exemplaire de l’art des commanditaires. Il s’agissait en tous cas d’une chaussure coûteuse, réservée aux élites aristocratiques ou bourgeoises.
À la fin du XVe siècle, les borceguíes commencent à s’orner d’un bout moins pointu, plus carré, avec l’apparition de la « patte d’ours » (punta chata). On mesure bien l’évolution entre deux retables de cette époque : dans La Flagellation du Christ, le « Maestro de Salomón » de Fromista figure des borceguíes hauts, de couleur claire, avec des revers descendus sous le genou, de couleur contrastée (d’un cuir orangé), une empeigne marquée, et des broderies courant sur l’intérieur de la cheville, assez haut. La botte présente encore une pointe à l’avant, mais peu marquée. Un peintre du cercle de Pedro Berruguete, dans une Épiphanie, vers 1500, peint cette fois des borceguíes hauts, « à crevés » (acuchillados), avec un bout à « patte d’ours ». Dans le dernier cas, ces bottes sont particulièrement intéressantes ; d’abord il s’agit clairement d’une botte destinée à l’équitation, puisque le cavalier, bien que démonté, porte encore les montants de fixation des éperons attachés à la botte : la sangle passe par les branches de l’éperon, et englobe tout le pied en passant sous la semelle de la botte ; ensuite, le modèle est « à crevés », ce qui permet non seulement de voir la chausse plus sombre en dessous, mais aussi de faciliter l’enfilage. On voit aussi que le comble de l’élégance semble être de porter un revers relevé sur le genou, l’autre descendu.
Au milieu du XVIe siècle, la chaussure prit l’aspect d’une botte (bota borceguí) avec le renforcement de l’empeigne et surtout de la semelle en cuir plus solide ; son usage fut alors laissé aux écuyers, mais cette botte apparaît aussi dans les déguisements de maures. Il resta aussi très en usage chez les Portugais12.
2.4. Les sandales, espadrilles, et autres chaussures légères populaires.
On connaît aussi, dans les milieux populaires de la péninsule Ibérique, différentes chaussures à semelle de corde de chanvre ou d’alfa, avec une pièce de tissu couvrant les orteils et le talon, et attachées sur le cou-de-pied par de simples cordes. Ces sandales sont appelées esparteña (du matériau : sparte ou chanvre) ou encore alparḡát, terme venant de l’arabe, comme sans doute le modèle et la technique de fabrication. Ce sont les ancêtres de nos espadrilles. Ce type de sandale populaire, portée sur des chausses rustiques qui semblent de laine rouge, s’observe sur le Retable des saints Jean de Bernat Martorell, vers 1434-1435. Légère et de faible coût, cette sandale n’a rien de spécifique au monde ibérique, et semble avoir été assez répandue dans tous les milieux populaires et paysans. Un type d’espadrille similaire s’observe ainsi presqu’un siècle plus tard, dans le Livre des Costumes (Das Trachtebuch) de Christoph Weiditz, 1529, mais cette fois sur des jambes nues.
Enfin, on distingue aisément ces espadrilles de véritables sandales « à la romaine », qui sont toujours formées d’une simple semelle, attachée par des liens de cuir très fins, noués sur le cou-de-pied, comme on peut l’observer dans la Tabla de la Vera Cruz de la Chartreuse de Miraflores de Burgos, vers 1530, associées à des chausses passant sous le pied.
3. Les socques et les pantoufles, complément des chaussures fines et des bottes
Une brève allusion, dans la Célestine, semble parfois mal traduite en français : en effet, Centurio s’exclame à un moment, à propos de sa bonne amie Areusa : « cuando alguno tocare en su chapín », ce qui est traduit en général par la semelle de ses souliers (Célestine, acte XVIII, p. 470). Le chapín est en fait une galoche à semelle de bois ou de liège, ou encore une pantoufle richement brodée portée par les femmes arabes, traditionnellement. Si le terme est propre à l’Espagne (ailleurs on parlera selon les cas de socques, de patins ou de pantoufles), l’objet est commun à tout l’Occident, dans ses deux fonctionnalités (intérieure ou extérieure).
3.1. Les patins d’extérieur
Pour sortir, il est indispensable de protéger les fines chaussures et les bottes souples par des patins ou socques, à semelle en liège ou en bois, parfois même en os, ancêtres des galoches. Ce type de sur-chaussure est bien documenté à partir des années 1330 (Boucher, p. 172), mais des proto-exemples apparaissent en Espagne dès l’époque d’Alphonse X, dans les Juegos diversos de Axedrez, dados, y tablas… (1283-87). Il s’agit de galoches primitives, c’est-à-dire des semelles – sans doute en bois – avec une unique lanière de cuir, au niveau du cou-de-pied ou des orteils, dans lesquels on peut glisser la chaussure de fin cuir (cordouan) pour la protéger, surtout si le sol est fangeux, neigeux, boueux…
Dans les formes plus classiques du XVe siècle, la semelle présente un arc au milieu de la plante du pied, et deux « talons », sous l’orteil et le talon. Elles s’attachent sur le pied par des lanières de cuir, au niveau du cou-de-pied ou de la pointe du pied13. Lorsque la mode allonge la chausse ou la chaussure à la poulaine, les socques s’allongent d’autant ! Jaime Ferrer (actif à Lleida au XVe siècle) représente ainsi des patins en galoche, portés sous des chausses rouges, avec des brides de cuir noir croisées sur l’avant du pied, dans son Saint Sébastien, Retablo de San Jerónimo, v. 1450-1460. Cet exemple montre que les chausses à la poulaine ne sont donc pas inconnues en Espagne, au moins dans la seconde moitié du XVe siècle.
Dans certaines représentations, le patin ou galoche semble porté jusqu’au moment de monter à cheval (il pouvait d’ailleurs servir de marchepied !). Il va de soi qu’on laissait tomber le patin, dès que l’on était hissé en selle. Dans le Retable de l’église San Salvador de Ejea de los Caballeros de Saragosse, peint entre 1438 et 1476 par Blasco de Grañén (1400-1459) et son neveu Martín de Soria, l’élégant a encore un pied glissé dans le patin, mais l’autre est déjà retombé à terre. Ses chausses ou ses bottes très fines sont déjà équipées d’étriers, pourtant. Il faut imaginer qu’un valet ramassait les patins afin que son seigneur puisse y glisser de nouveau ses chausses fragiles, à sa descente de cheval.
3.2. Les patins d’intérieur : les pantoufles (chinelas)
Les patins ne servent pas uniquement à l’extérieur, ils peuvent être aussi portés en intérieur, notamment sous la forme de pantoufles de cuir et non de socques de bois. Les patins portés avec les borceguíes, appelés chinelas (mule, pantoufle), sont généralement ouverts sur le devant, comme des sandales à talons plats, et très colorés. Mais les pantoufles peuvent aussi être fermées sur le devant.
D’après l’iconographie, ces sous-chaussures semblent être en soie, en velours, en peau de marte ou de zibeline, et souvent très richement décorés. García del Barco, dit le « Maître d’Àvila », représente ainsi des borceguíes arrivant aux chevilles, gravés ou brodés, et portés avec des mules rouges ouvertes sur le devant, dans son Triptyque de la Nativité, L’Épiphanie, en 1430. Un autre exemple, peinture de l’école de frère Alonso de Zamora, Jésus dans la maison de Caïphe, vers 1480-1494, montre des borceguíes de cuir orangé, portés au mollet, richement brodés, glissés dans des pantoufles ouvertes noires. À la même époque, des patins-chaussons, de couleur cuir, sont portés sur des borceguíes blancs à empeigne et revers, eux-mêmes glissés sur des chausses rouges ou grises (Juan de La Abadía, Saint Sébastien martyr, vers 1486 ; Alonso de Sedano, La Flagellation, vers 1495). Dans les deux cas, la semelle, assez haute et compensée, pourrait être en liège ou en bois peint.
Les borceguíes ou les bottes souples peuvent aussi être glissés dans des pantoufles fermées sur le devant, qui servent aussi de chaussons à la maison, simplement portées sur des chausses de drap, voire sur les jambes nues, dans la chambre à coucher. Ces pantoufles fermées peuvent être assez pointues (« Maître de Budapest », Martyr de saint Laurent sur son grill, v. 1475), ou présenter au contraire une forme arrondie préfigurant la « patte d’ours » (atelier de Fernando Gallego, Ecce Homo, fin du XVe siècle),
Conclusions. Évolutions à l’orée du XVIe siècle : pattes d’ours et chopines
La principale évolution de la chaussure au début du XVIe siècle est – en Espagne comme ailleurs – l’apparition de la forme dite en « patte d’ours », carrée et assez peu élégante. Cette forme s’observe sur les chaussures, les chaussons ou sur-chaussures, les bottes, etc. Certaines chaussures basses peuvent être rebrodées et fermées sur le côté par des liens (école castillano-léonaise, miracle d’un évêque, fin XVe siècle) ; ou encore en cuir rouge avec une fermeture à bride et petit bouton (« Maître de la Circoncision des Chrétiens » (actif à Séville au début du XVIe siècle), v. 1500-1520).
La mode du XVIe siècle connaît encore bien d’autres extravagances en matière de chaussure, notamment les célèbres « chopines » vénitiennes (platform shoes en anglais), dérivées des patins antérieurs, mais avec le plus souvent une seule semelle compensée ronde et très élevée, ce qui devait rendre l’équilibre de la personne ainsi chaussée particulièrement précaire. Certains datent même l’apparition des chopines du XIVe, voire du XIIIe siècle, mais je n’en ai pas retrouvé de trace imagée pour l’Espagne (Esedín Rojo)14.
Par comparaison, les chaussures médiévales semblent extrêmement raisonnables, si l’on excepte les farfelues pigaches et poulaines, qui ne constituent pas, et de loin, les chaussures les plus fréquentes, toutes classes sociales confondues. Les chaussures sont faites avant tout pour être portées, isoler la jambe du froid et de la saleté des rues, mais aussi protéger les mollets du frottement du poil rêche des chevaux, pour les cavaliers et les cavalières. Mais il va de soi que l’on connaît infiniment mieux les chaussures des élites que celles des classes populaires… qui devaient sans doute, bien souvent, se contenter de marcher pieds nus !