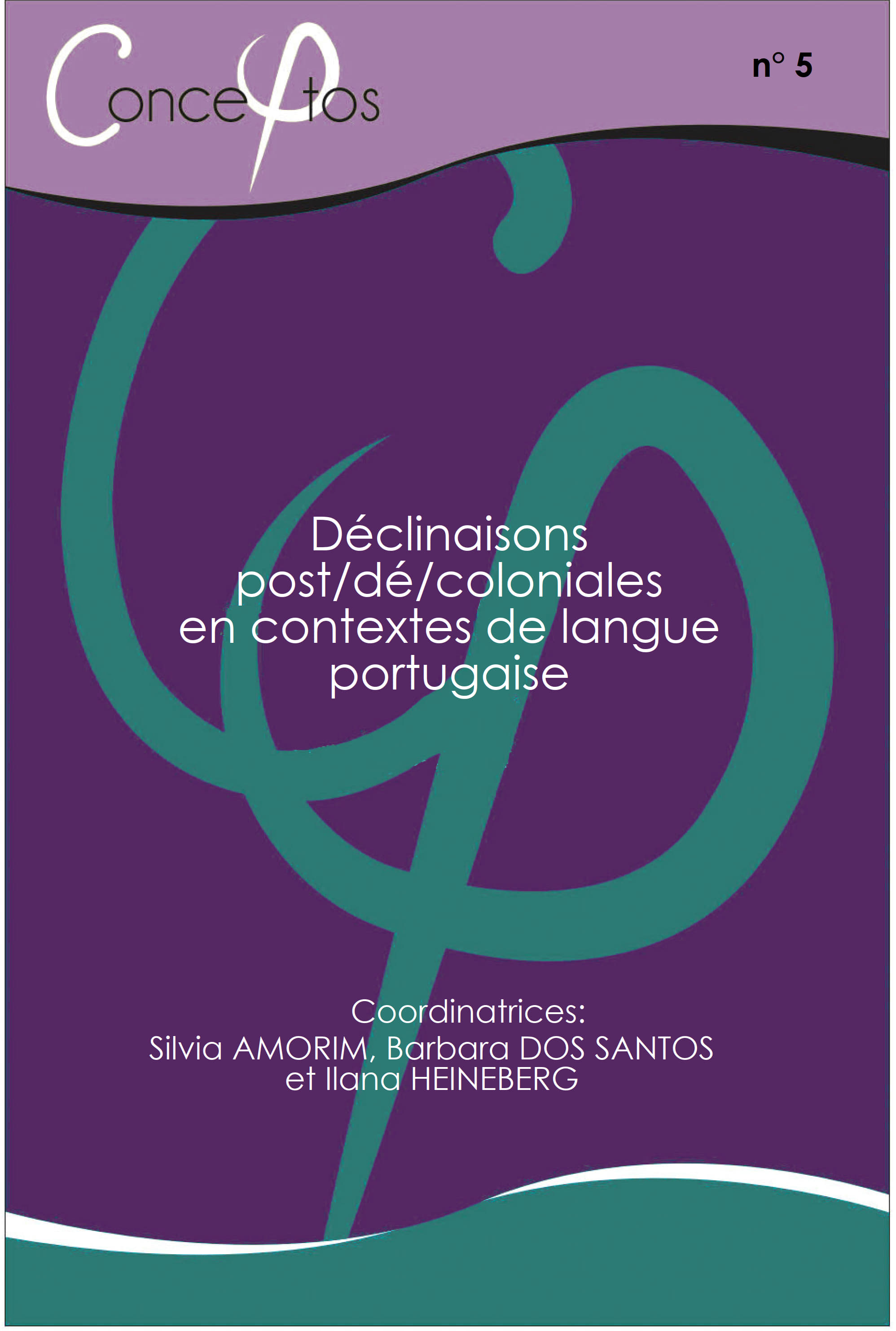Entre Prospero et Caliban : colonialisme, postcolonialisme et interidentité1
Exorde
par Boaventura de Sousa Santos
L’auteur a tenu à ce que la traduction soit accompagnée de ce préambule. Il souhaite ainsi préciser quelle fut sa démarche lors de la rédaction de « Entre Prospero e Caliban » et apporter des éclaircissements sur des aspects de ce texte pouvant donner lieu à d’éventuelles polémiques. Nous remercions très chaleureusement Boaventura de Sousa Santos pour sa collaboration et pour cet avant-propos inédit2.
Ce texte a été publié pour la première fois au début du millénaire et a été largement diffusé. Vingt-cinq ans plus tôt, le Portugal avait mis fin à quarante-huit ans de dictature et ses colonies avaient mis fin à des siècles de colonisation historique effective. Sur le plan international, c’était une époque où la fin de la guerre froide était encore vécue avec un certain soulagement et où la mondialisation, mue par des intérêts contradictoires, s’intensifiait. Le Forum Économique de Davos, qui avait été créé en 1971, jouait un rôle de plus en plus visible dans les discussions mondiales sur l’avenir du capitalisme et, début 2001, le premier Forum social mondial (FSM) s’est tenu à Porto Alegre (Brésil), se voulant une alternative au Forum de Davos, rassemblant des mouvements sociaux du monde entier impliqués dans des luttes contre l’injustice sociale créée par le capitalisme, le colonialisme et le patriarcat. J’ai été très actif dans l’organisation du FSM depuis le premier moment.
Ce texte a été généralement très bien accueilli, mais il a également fait l’objet de plusieurs critiques, souvent injustes. J’apprécie l’occasion que me donne la revue de répondre aux critiques, ou du moins d’apporter quelques clarifications qui aident à lire le texte dans son contexte.
- Ce texte a été écrit à la fin des années 1990, avant l’explosion des études postcoloniales et de la version de ces études qui deviendra dominante en Amérique latine, le courant décolonial. Après avoir écrit ce texte, j’ai continué à suivre de manière critique le développement de ces études3 et à partir de 2007 j’ai développé ma propre théorie critique anti-eurocentrique, à partir d’une rupture épistémologique que j’ai appelée épistémologies du sud. Sur les convergences et les différences entre les différentes perspectives postcoloniales, on peut lire le long article que j’ai écrit sur ce sujet (Santos, 2021) pour l’Encyclopédie de recherche Oxford sur la littérature [Oxford Research Encyclopedia of Literature].
- Ce texte se concentre sur l’expérience du colonialisme portugais en Afrique et sur les processus récents de décolonisation. Même en Afrique, la décolonisation a pris en compte des situations très diverses. Par exemple, lorsque les Portugais sont arrivés dans l’océan Indien, ils ont rencontré une mer qui, loin d’être inconnue (comme on le disait alors de l’Atlantique), était une mer hautement mondialisée, riche en relations et échanges commerciaux, dans laquelle les Portugais se sont intégrés à leur propre avantage, une caractéristique spécifique du colonialisme antérieure au colonialisme de la fin du XIXe siècle. Ce n’est qu’au prix d’une grande violence, dont Afonso de Albuquerque, en tant que gouverneur de l’Inde, est un exemple tristement célèbre, que les Portugais ont réussi à obtenir le monopole (jamais total) du commerce des épices en Europe occidentale. Publié peu après que j’ai terminé ce texte, l’article de Malyn Newitt (2021) est l’une des études qui dépeint le mieux la complexité des différents contextes coloniaux joués par le Portugal. La référence dans le texte au colonialisme britannique était inévitable puisque, à partir du XVIIIe siècle, le colonialisme européen a cessé d’être écrit par les pays ibériques à l’origine de l’expansion coloniale européenne pour être écrit par l’Angleterre. Le colonialisme britannique est devenu le colonialisme européen par antonomase. Avec toutes les limites qu’il peut avoir, le but de mon texte était de remettre en question cette hégémonie.
- Le colonialisme au Brésil et le processus respectif d’indépendance présentaient d’autres caractéristiques qui ne sont abordées que marginalement dans ce texte. Il s’agit de processus qui se sont déroulés dans un autre contexte historique et dans lesquels l’indépendance, au lieu d’être gagnée par les peuples d’origine comme en Afrique, a été gagnée par les descendants des colons, donnant lieu à ce que Pablo Gonzalez Casanova appellera, en 1965, le colonialisme interne. À la réalité latino-américaine dans une perspective postcoloniale, j’ai consacré un autre texte (Santos, 2001b)4 inspiré par le grand intellectuel cubain José Martí.
- Le cas brésilien a été mentionné avant tout pour rendre compte du « racisme insidieux » (au sens de l’expression utilisée par Nilma Gomes (2017)) et pour critiquer le paradigme, alors encore dominant, du « luso-tropicalisme ». Quelques années après la publication de ce texte, lorsque le président Lula da Silva a entamé son premier gouvernement, j’ai publié plusieurs articles dans la Folha de São Paulo pour défendre la politique de discrimination positive contre le racisme qui débutait alors. J’ai été sévèrement et publiquement critiqué, non pas par des intellectuels de droite (ce à quoi on pourrait s’attendre), mais plutôt par des intellectuels de gauche, dont deux éminents anthropologues. Selon eux, il n’y avait pas de racisme au Brésil et mes textes, en le dénonçant et en proposant une discrimination positive, auraient l’effet pervers de le provoquer. Cette position illustre mieux que toute autre la nature insidieuse du racisme structurel qui caractérise encore le Brésil.
- Ce texte a été écrit un peu plus de deux décennies après le retour de la démocratie au Portugal et une décennie après l’adhésion du Portugal à ce qui était alors la Communauté Économique Européenne (CEE). Le racisme de l’Europe centrale et du Nord à l’égard des peuples d’Europe du Sud — un racisme que l’on peut tout aussi bien qualifier d’insidieux que de structurel — était ancien et bien connu des Portugais qui y ont émigré dans les années 1960. Alors que les analyses conventionnelles marxistes et non marxistes tentaient d’expliquer les différences en fonction des niveaux de développement économique et de la structure de classe, il m’a toujours semblé qu’il existait en outre une situation de colonialisme interne profondément enracinée en Europe, dont l’une des manifestations était un racisme insidieux et structurel. Les événements ultérieurs, notamment la crise financière qui a frappé la Grèce en 2011 et s’est ensuite propagée aux autres pays du sud de l’Europe, en ont largement apporté la preuve (Santos, 2011). La complexité de la situation du Portugal dans le contexte européen et la longue durée des colonialismes dans lesquels il s’est déployé au Brésil, en Afrique et en Asie ont été et sont toujours un terrain privilégié pour étudier la complexité. C’est cette complexité que j’ai essayé de dépeindre dans ce texte5. Notez que lorsque j’ai écrit ces textes, je ne connaissais pas le travail de l’auteur tunisien Albert Memmi, un travail fondamental pour analyser l’enchevêtrement complexe des relations entre colonisateur et colonisé6 et qui m’a beaucoup inspiré ces dernières années.
- Un fait très spécifique du colonialisme portugais est la façon dont il s’est terminé. Les mouvements de libération contre le colonialisme portugais ont joué un rôle clé dans le renversement du régime fasciste de Salazar qui a dirigé le pays pendant quarante-huit ans. Pour les démocrates antifascistes portugais, qui, surtout depuis les années 1960, prônent l’indépendance des colonies, la révolution du 25 avril 1974 et l’indépendance des colonies sont deux processus politiques jumeaux. Ce sont elles qui, en partie du moins, expliquent pourquoi tous les pays issus du colonialisme portugais, sans exception, ont opté pour la voie socialiste, une voie libre des encombrements néocoloniaux qui avaient tant pesé sur l’indépendance des colonies africaines, françaises et britanniques au cours des décennies précédentes. Interdit de visiter les colonies pendant le fascisme, j’ai pu, à partir de 1975, collaborer avec les gouvernements des nouveaux pays, auxquels participaient certains de mes amis de l’époque où j’étais étudiant à l’université de Coimbra. Les projets de recherche que j’allais entreprendre et coordonner des années plus tard au Cap-Vert, au Mozambique et en Angola (voir Santos, 2015 ; Santos & Van-Dúnem, 2012 ; Santos & Trindade, 2003), cherchaient à être fidèles à la même marque de relations anticoloniales de partage et de bénéfices mutuels. La reconnaissance la plus significative de ma position épistémologique et politique non eurocentrique a peut-être été le fait que j’ai été le seul Portugais invité à participer à la Conférence internationale pour célébrer l’indépendance de Goa vis-à-vis du colonialisme portugais (1961), qui s’est tenue à l’Université de Goa du 18 au 20 décembre 2011.
- Pour moi, en tant qu’auteur, la plus grande actualité de ce texte réside dans l’appel à la complexité, à l’historicité, au cosmopolitisme subalterne, les seules procédures qui peuvent nous défendre des ghettos identitaires apparus dans le sillage du tournant ethnoculturel, qui malheureusement abondent aujourd’hui, rendant les alliances impossibles dans la lutte contre la domination et oubliant l’économie politique qui profite de la différenciation et de la fragmentation et les alimente. J’ai longtemps soutenu que les identités sont des identifications en cours et qu’aucun être humain ne peut être réduit à l’une d’entre elles, même si une telle réduction est le grand objectif des pouvoirs dominants. Plus récemment, des textes ont été publiés qui rendent compte de la complexité des identifications postcoloniales au-delà de tous les dogmatismes et des nativismes décoloniaux de différentes sortes7.
Comme je l’ai longuement argumenté dans mes textes ultérieurs (2014b, 2018), les sociétés modernes sont constituées de trois principaux modes de domination, le capitalisme, le colonialisme et le patriarcat. Avec les indépendances politiques, surtout après la deuxième guerre mondiale, une forme spécifique de colonialisme a pris fin : le colonialisme historique en tant qu’occupation territoriale par une puissance étrangère ; mais le colonialisme a continué sous d’autres formes (néocolonialisme, racisme, xénophobie et plus récemment islamophobie, expulsion de peuples autochtones ou de paysans de leurs territoires ancestraux pour faire place à des mégaprojets de « développement », l’occupation de la Palestine et le régime d’apartheid qui y règne, les camps d’internement pour les réfugiés et les migrants qui ne se sont pas morts dans la Méditerranée ou en tentant de franchir les frontières de Melilla ou du sud des États-Unis, ou encore l’effacement ou la marginalisation dans le Nord global des avancées scientifiques et des théorisations développées dans le Sud global). Le drame de notre époque réside dans le fait que, si la domination agit de concert (plus le capitalisme est excluant, plus le racisme et le sexisme sont violents), la résistance à cette domination est fragmentée. Combien de mouvements féministes ont été sexistes et pro-capitalistes ? Combien de mouvements anti- raci(ali)sation ont été sexistes et pro-capitalistes ? Combien de mouvements anticapitalistes ont été sexistes et racistes et ont en général promu la dégradation ontologique de ceux qu’ils ne considèrent pas comme égaux à eux-mêmes ? Tant qu’une telle asymétrie sera en vigueur, la libération de la domination ne sera pas possible.
Juillet 2022
La présente étude constitue une nouvelle avancée dans une recherche en cours sur les processus identitaires dans l’espace-temps de la langue portugaise, autrement dit, dans une vaste et multiséculaire zone de contact qui a englobé des Portugais et d’autres peuples d’Amérique, d’Asie et d’Afrique. Les hypothèses de travail qui orientent cette recherche ont été formulées dans des travaux antérieurs. Je les rappelle ici très sommairement.
La première hypothèse est que depuis le XVIIe siècle le Portugal est un pays semi-périphérique dans le système mondial capitaliste. Cette condition — celle qui caractérise le mieux la longue durée moderne de la société portugaise — a évolué au fil des siècles tout en conservant cependant ses traits fondamentaux : un développement économique intermédiaire et un rôle de médiateur entre le centre et la périphérie de l’économie-monde ; un État qui, parce qu’il est à la fois le produit et l’instaurateur de cette position intermédiaire, n’a jamais pleinement assumé les caractéristiques de l’État moderne des pays centraux, en particulier celles qui se sont cristallisées dans l’État libéral à partir du milieu du XIXe siècle. La deuxième hypothèse est que cette condition semi-périphérique s’est reproduite sur la base du système colonial et se reproduit, depuis quinze ans, dans le mode d’intégration du Portugal dans l’Union Européenne (UE). De ces hypothèses découlent trois sous-hypothèses : le colonialisme portugais, parce qu’il a été conduit par un pays semi-périphérique, a lui-même été semi-périphérique, ou subalterne ; en raison de ses caractéristiques et de sa durée historique, la relation coloniale instaurée par le Portugal a imprégné d’une façon très particulière et intense les configurations du pouvoir social, politique et culturel, non seulement dans les colonies mais également au sein même de la société portugaise ; le processus d’intégration à l’UE, en dépit de sa durée extrêmement réduite par rapport au cycle colonial, semble voué à avoir le même impact dramatique sur la société portugaise que le colonialisme — la question du sens et du contenu de cet impact demeure ouverte (Santos, 1995a, p. 53-74, p. 135-157).
La troisième hypothèse générale est liée à la valeur analytique de la théorie du système-monde pour comprendre la position du Portugal — périphérique, semi-périphérique ou centrale — dans les conditions actuelles de globalisation (Santos, 2001c, p. 25-102). La quatrième hypothèse est que la culture portugaise est une culture de frontière : elle n’a pas de contenu, elle a plutôt une forme, et cette forme est celle de la zone frontalière. La culture portugaise a toujours eu beaucoup de mal à se différencier des autres cultures nationales, conservant jusqu’à nos jours une forte hétérogénéité interne (Santos, 1995a, p. 150-151).
Dans ce texte, je me penche sur les pratiques et discours qui caractérisent le colonialisme portugais et sur la façon dont ces pratiques et discours ont imprégné les régimes identitaires dans les sociétés où le colonialisme portugais a été à l’œuvre, aussi bien durant la période coloniale qu’après l’indépendance des colonies, avec une incidence marquée en Afrique et en Amérique.
Le colonialisme portugais et le postcolonialisme
La spécificité du colonialisme portugais
Recourir au terme « spécificité » pour caractériser le colonialisme portugais revient à exprimer l’existence de relations hiérarchiques entre les différents colonialismes européens. Si la spécificité est l’affirmation d’un écart par rapport à une norme générale, dans ce cas la norme est déterminée par le colonialisme britannique : c’est par rapport à lui que se définit le profil — subalterne — du colonialisme portugais. Cette subalternité est double car elle se manifeste aussi bien dans le domaine des pratiques que dans celui des discours coloniaux. Dans le domaine des pratiques, la subalternité réside dans le fait que le Portugal, en tant que pays semi-périphérique, a lui-même été, pendant longtemps, un pays dépendant — à certains moments presque une « colonie informelle » — de l’Angleterre. À l’instar du colonialisme espagnol, le colonialisme portugais a eu un rapport bien moins étroit avec le capitalisme que celui qui a existé dans le cadre du colonialisme britannique. Dans bien des cas, ce rapport s’est exercé par délégation, autrement dit, sous l’effet de la pression de l’Angleterre exercée par le biais de mécanismes tels que des conditions de crédit et des traités internationaux inéquitables. Dès lors, tandis que l’Empire britannique s’est édifié sur un équilibre dynamique entre colonialisme et capitalisme, l’Empire portugais s’est édifié sur un déséquilibre, également dynamique, entre un excès de colonialisme et un déficit de capitalisme.
Dans le domaine des discours coloniaux, la subalternité du colonialisme portugais réside dans le fait que depuis le XVIIe siècle l’histoire du colonialisme s’est écrite en anglais, et non en portugais. Ce qui signifie que le colonisateur portugais rencontre un problème d’autoreprésentation semblable à celui que connaît le colonisé dans le cadre du colonialisme britannique. Le besoin de définir le colonialisme portugais dans sa spécificité relativement au colonialisme hégémonique révèle l’impossibilité ou la difficulté à le définir en des termes qui ne reflètent pas cette subalternité. D’une part, le colonisé portugais a un double problème d’autoreprésentation : par rapport au colonisateur qui l’a colonisé et par rapport au colonisateur qui, ne l’ayant pas colonisé, a néanmoins écrit l’histoire de sa sujétion coloniale. D’autre part, le problème d’autoreprésentation du colonisateur portugais crée une disjonction chaotique entre le sujet et l’objet de représentation coloniale, générant un champ apparemment vide de représentations (mais, en réalité, chargé de représentations sous-codifiées) qui, du point de vue du colonisé, constitue un espace de manœuvre supplémentaire pour tenter une autoreprésentation qui dépasse la représentation de sa subalternité.
La spécificité du colonialisme portugais repose essentiellement sur des facteurs d’économie politique — sa condition semi-périphérique (Fortuna, 1993, p. 31-34) —, ce qui ne signifie pas que cette spécificité se soit manifestée uniquement sur le plan économique. Bien au contraire, elle s’est également révélée sur le plan social, politique, juridique, culturel ; sur le plan des pratiques quotidiennes de coexistence et de subsistance, d’oppression et de résistance, de proximité et de distance ; sur le plan des discours et des récits, du sens commun et des autres savoirs, des émotions et des affects, des sentiments et des idéologies. La grande asymétrie entre le colonialisme anglais et le colonialisme portugais réside dans le fait que le premier n’a pas eu à rompre avec un passé divergent de son présent : il a toujours incarné le colonialisme-norme puisque le pays qui le pratiquait imposait sa normativité au système mondial. Dans le cas portugais, une fois créée la possibilité d’un colonialisme rétroactif, en tant que discours de désynchronisation et de rupture, celui-ci a pu être manipulé au gré des exigences et des conjonctures politiques. Il s’est aussi bien prêté à des lectures inquiétantes — p. ex. : le sous-développement du colonisateur a produit le sous-développement du colonisé, une double condition qui ne pourrait être surmontée que par le biais d’une politique colonialiste poussée — que réconfortantes — p. ex. : le luso-tropicalisme, « Le Portugal du Minho à Timor », le colonialisme cordial —, mais quasiment toutes les lectures comprenaient à la fois des éléments inquiétants et réconfortants. La négativité du colonialisme portugais a toujours été le sous-texte de sa positivité, et vice versa.
Le postcolonialisme
Le postcolonialisme doit être entendu dans deux acceptions principales. La première correspond à une période historique, celle qui succède à l’indépendance des colonies, et la seconde à un ensemble de pratiques et de discours qui déconstruisent le récit colonial écrit par le colonisateur, en cherchant à le remplacer par des récits écrits du point de vue du colonisé. Dans sa première acception, le post-colonialisme se traduit par un ensemble d’analyses économiques, sociologiques et politiques sur la construction des nouveaux États, de leurs bases sociales, de leurs institutions et de leur insertion dans le système mondial ; les ruptures et continuités relatives au système colonial ; les relations avec l’ex-puissance coloniale et la question du néocolonialisme ; les alliances régionales etc. Dans sa seconde acception, le postcolonialisme s’insère dans les études culturelles, linguistiques et littéraires et a essentiellement recours à l’exégèse textuelle et aux pratiques performatives afin d’analyser les systèmes de représentation et les processus identitaires. Dans cette acception le postcolonialisme contient une critique, implicite ou explicite, des silences des analyses post-coloniales dans la première acception du terme. Étant donné que je me centre, dans ce texte, sur les systèmes de représentation et les processus identitaires, je me rapporte au postcolonialisme dans sa seconde acception, bien que les analyses propres à la première soient régulièrement convoquées.
Mon hypothèse de travail est que les différences du colonialisme portugais doivent se répercuter sur les différences du postcolonialisme dans l’espace de langue officielle portugaise, notamment par rapport au postcolonialisme anglo-saxon. La première différence est que l’expérience de l’ambivalence et de l’hybridisme entre colonisateur et colonisé, loin d’être une revendication postcoloniale, a été une réalité du colonialisme portugais sur de longues périodes. Le postcolonialisme anglo-saxon part d’une relation coloniale reposant sur la polarisation extrême entre colonisateur et colonisé, entre Prospero et Caliban, une polarisation qui est aussi bien une pratique de la représentation que la représentation d’une pratique, et c’est contre elle que l’action subversive de la critique postcoloniale est dirigée et qu’elle fait sens. Mais où ancrer la subversion quand cette polarisation est, du moins sur de longues périodes, fortement atténuée ou nuancée ? Le postcolonialisme en langue portugaise doit davantage se centrer sur la critique de l’ambivalence que sur la revendication de celle-ci, et la critique proprement dite réside dans la distinction entre des formes d’ambivalence et d’hybridation qui donnent effectivement la parole aux subalternes (hybridations émancipatrices) et des formes qui utilisent la voix du subalterne pour le réduire au silence (hybridations réactionnaires).
La deuxième différence réside dans la question raciale abordée à travers la couleur de peau. Pour les critiques postcoloniaux anglo-saxons, la couleur de peau est une limite infranchissable des pratiques d’imitation et d’assimilation car, selon les cas, soit elle nie hors de l’énonciation ce que l’énonciation affirme, soit elle affirme ce qu’elle nie. Dans le cas du postcolonialisme de langue officielle portugaise, il faut tenir compte de l’ambivalence et de l’hybridation de la couleur de peau elle-même, c’est-à-dire que l’entre-deux, la zone intellectuelle où le critique postcolonial prétend lui-même se placer, s’incarne dans le métis ou la métisse comme corps et zone corporelle. Le désir de l’autre, sur lequel Bhabha fonde l’ambivalence de la représentation du colonisateur (Bhabha, 1994, p. 50), n’est pas un artefact psychanalytique et n’est pas non plus projeté dans le langage : il est physique, créateur, il se multiplie dans des créatures. Le métissage n’est pas la conséquence de l’absence de racisme, comme le prétend la raison luso-colonialiste ou luso-tropicaliste, mais elle est certainement la cause d’un racisme d’un genre différent. De ce fait, l’existence de l’ambivalence ou de l’hybridisme est banale, elle aussi, dans le contexte du postcolonialisme portugais. Il importera plutôt de clarifier les règles sexistes de la sexualité qui mettent presque toujours dans le même lit l’homme blanc et la femme noire, et non la femme blanche et l’homme noir. Autrement dit, le postcolonialisme portugais exige une articulation étroite entre la question de la discrimination sexuelle et le féminisme.
La troisième différence réside dans une dimension d’ambivalence et d’hybridisme inconnue dans le cas anglo-saxon. Pour le postcolonialisme de langue portugaise l’ambivalence des représentations ne découle pas seulement de l’absence d’une distinction claire entre l’identité du colonisateur et celle du colonisé, mais aussi de l’inscription de cette distinction dans l’identité même du colonisateur portugais, laquelle ne se limite pas à renfermer l’identité de l’autre, celui qu’il colonise ; en effet, elle contient elle-même l’identité du colonisateur en tant que colonisé par un autre. Le Prospero portugais n’est pas seulement un Prospero calibanisé : il est un Caliban lorsqu’il est considéré à partir de la perspective des Super-Prospero européens. L’identité du colonisateur portugais est ainsi doublement double, une combinaison de deux « autres » : l’ « autre » qui est le colonisé et l’ « autre » qui est lui-même le colonisateur en tant que colonisé. Cette dualité exacerbée a permis au Portugais d’être davantage un immigré qu’un colon dans « ses » propres colonies.
On peut donc en conclure que la « disjonction de la différence » (Bhabha, 1994, p. 50) est autrement complexe dans le cas du postcolonialisme portugais — une complexité qui peut paradoxalement entraîner des complicités ou des rapprochements insoupçonnés entre colonisateur et colonisé. L’« autre » colonisé par le colonisateur n’est pas totalement autre vis-à-vis de l’« autre » colonisé du colonisateur. À l’inverse du postcolonialisme anglo-saxon, il n’y a pas qu’un seul « autre » : il y en a deux qui ne se confondent pas mais ne se différencient pas non plus, ils n’interviennent qu’au niveau de l’influence que chacun d’eux a sur l’identité du colonisateur et du colonisé. L’autre-autre (le colonisé) et l’autre-soi (le colonisateur lui-même colonisé) se disputent, dans l’identité du colonisateur, le tracé des contours de l’altérité, mais dans ce cas l’altérité est, pour ainsi dire, des deux côtés de la ligne.
Pour la même raison, le stéréotype du colonisé n’a jamais eu les mêmes contours que ceux qu’il avait dans l’Empire britannique, ou du moins ses contours ont toujours été bien plus incertains et transitoires. La pénétration sexuelle convertie en pénétration territoriale et en interpénétration raciale a engendré des significations instables qui ont favorisé, avec le même degré de cristallisation, des stéréotypes contradictoires selon l’origine et l’intention de l’énonciation. Ils ont conforté le racisme sans race, ou un racisme plus « pur » que sa base raciale. Ils ont également conforté le sexisme sous prétexte d’antiracisme. Pour cette raison, le lit sexiste et interracial a pu être l’unité de base de l’administration impériale et la démocratie raciale a pu être exhibée comme un trophée anti-raciste brandi par les mains blanches, métisses et noires du racisme et du sexisme.
Le vécu de colonisé du colonisateur ne signifie pas qu’il s’identifie davantage ou plus aisément à son colonisé. Cela ne signifie pas non plus que le colonisé par un colonisateur-colonisé soit moins colonisé que le colonisé par un colonisateur-colonisateur. Cela signifie seulement que l’ambivalence et l’hybridation détectées par le postcolonialisme anglo-saxon vont, dans le cas portugais, bien au-delà des représentations, des regards, des discours et des pratiques d’énonciation. Ce sont des corps et des incarnations, des vécus et des survivances quotidiennes pendant des siècles, soutenus par des formes de réciprocité entre le colonisateur et le colonisé inconnues dans l’espace de l’Empire britannique.
Pour expliquer cette différence il faut en introduire une autre, à propos des jeux d’autorité. Dans les études postcoloniales le colonisateur apparaît toujours comme un sujet souverain, l’incarnation métaphorique de l’empire. Or, dans le cas du colonialisme portugais, on ne peut pas simplement s’en tenir à cette présupposition. Le colonisateur n’incarne l’empire que pendant une courte période — à partir de la fin du XIXe siècle, en Afrique —, qui plus est, en des circonstances très particulières. En dehors de cela, il ne se représente que lui-même. Il est un auto-empire et, en tant que tel, il a autant de liberté pour un maximum d’excès que pour un maximum de déficit de colonisation. Mais justement, comme cette identité impériale ne lui est octroyée par personne d’autre que lui-même, il est de fait un sujet aussi dépourvu de souveraineté que le colonisé. Pour cette raison, l’autorité n’existe pas au-delà de la force ou de la négociation qu’il est possible de mobiliser dans la zone de rencontre.
Cette double ambivalence des représentations affecte non seulement l’identité du colonisateur, mais également celle du colonisé. Il est possible que l’excès d’altérité que j’ai identifié chez le colonisateur portugais soit également identifiable chez son colonisé. En particulier au Brésil, on peut imaginer que l’identité du colonisé a été construite, du moins à certaines époques, à partir d’un autre double : celui qui comprend le colonisateur direct portugais et le colonisateur indirect britannique. Cette dualité s’est même convertie en élément constitutif du mythe des origines et des possibilités de développement du Brésil (comme nous le verrons plus loin) et a instauré une fracture qui, jusqu’à nos jours, est au centre d’un débat qui divise les Brésiliens entre ceux qui se sentent écrasés par un excès de passé et ceux qui se sentent écrasés par un excès de futur.
Le colonialisme portugais porte en lui les stigmates d’une indécidabilité qui doit être au cœur du postcolonialisme portugais. La colonisation par un Prospero incompétent, douteux, originairement hybride, a-t-elle conduit à une sous-colonisation ou à une hyper-colonisation ? Une colonisation pourvoyeuse d’autonomie ou de subordination pour le colonisé ? Un Prospero chaotique et absentéiste n’a-t-il pas créé un espace propice à l’émergence de Prospero de substitution parmi les Caliban ? N’est-ce pas pour cette raison que dans le contexte du postcolonialisme portugais la question du néocolonialisme est moins importante que celle du colonialisme interne ? Le déficit de colonialisme et de néocolonialisme nous aide à expliquer la spécificité des formes politiques qui ont émergé à l’indépendance des grandes colonies. À l’inverse, ces formes ont divergé de la norme de la décolonisation établie par le colonialisme hégémonique. Dans le cas du Brésil cela a donné lieu à l’une des indépendances les plus conservatrices et oligarchiques d’Amérique Latine, la seule ayant pris la forme d’une monarchie, ce qui a réuni les conditions pour que le colonialisme interne succède au colonialisme externe, pour que la colonialité du pouvoir succède au pouvoir colonial. Quant à l’Angola et au Mozambique, l’écart relativement à la norme a été dans le sens d’une adoption, par les pays nouvellement indépendants, de régimes révolutionnaires qui, dans le contexte de la Guerre Froide, les ont placés du côté opposé à celui dans lequel le Portugal les avait maintenus lorsqu’ils étaient des colonies. Les vicissitudes subies par ces pays au cours des 25 dernières années (fin de la Guerre Froide, guerre civile) ne nous permettent pas d’évaluer dans quelle mesure le colonialisme interne peut les caractériser.
L’indécidabilité du colonialisme portugais constitue une mine d’investigation pour un colonialisme situé qui ne se laisse pas piéger par le jeu des ressemblances et des différences entre le colonialisme portugais et le colonialisme hégémonique. Sans cela, certains ne verront que des ressemblances tandis que les autres ne verront que des différences, et entre les uns et les autres l’indécidabilité s’échappera comme un ultime objet incommensurable, invisible pour lui-même comme l’est le regard. Dans le contexte actuel, un postcolonialisme situé présuppose d’attentives analyses historiques et comparées des colonialismes et de ce qui les a suivis. Il est crucial de répondre à la question qui décolonise quoi, et comment. De cette façon seulement le discours postcolonial peut être digne de la diffusion que propose Bhabha : un discours qui circule parmi différentes formations culturelles sans une cause logique et centrale (Bhabha, 1990, p. 293). Sans une telle spécification historique et comparative le postcolonialisme demeurera une forme d’impérialisme culturel, et une forme particulièrement insidieuse car manifestement antiimpérialiste.
Jeux de miroirs I : un Caliban en Europe
Les identités sont le produit de jeux de miroirs entre des entités qui, pour des raisons contingentes, définissent les rapports entre elles comme des rapports de différence. De plus, ces entités attribuent de l’importance à ces différences, et les identités sont toujours relationnelles mais rarement réciproques. Le rapport fondé sur la différence est un rapport d’inégalité qui se dissimule derrière une prétendue incommensurabilité des différences. Celui qui a le pouvoir de déclarer sa différence a le pouvoir de déclarer cette différence comme étant supérieure aux autres différences dans lesquelles il se réfléchit. L’identité est, à l’origine, un moyen de domination qui repose sur un mode de production du pouvoir que je nomme « différenciation inégalitaire » (Santos, 1995b, p. 424-428 ; 2000, p. 264-269). Les identités subalternes sont toujours dérivées et correspondent à des situations dans lesquelles le pouvoir de déclarer la différence se combine au pouvoir de résister au pouvoir qui déclare l’infériorité. Dans l’identité subalterne, la déclaration de la différence est toujours une tentative de s’approprier une différence déclarée inférieure de manière à réduire ou à éliminer son infériorité. Sans résistance il n’y a pas d’identité subalterne, il n’y a que de la subalternité.
L’identité dominante se reproduit donc selon deux processus distincts : par la négation totale de l’autre et par le conflit avec l’identité subalterne de l’autre. Dans la plupart des cas, la première mène au second. L’identité dominante, voire matricielle, de la modernité occidentale — Prospero/Caliban, civilisé/sauvage — s’est d’abord reproduite grâce au premier processus puis grâce au second. Les deux procédés sont toujours actifs dans des jeux de miroirs différents. Du point de vue du différent supérieur, cependant, l’identité dominante ne se transforme en fait politique que dans la mesure où elle entre en conflit avec des identités subalternes. C’est ce fait politique que l’on appelle aujourd’hui « multiculturalisme ».
Dans chacun de ses modes de reproduction l’identité dominante est toujours ambivalente. En effet, même la négation totale de l’autre n’est possible que par la production active de l’inexistence de l’autre. Cette production implique toujours le désir de l’autre sous la forme d’une absence abyssale, d’un manque impossible à combler. Une telle ambivalence est également patente dans la représentation de l’Amérique au début de l’expansion européenne. Les témoignages sur la découverte du nouveau continent et les récits de voyage présentent, pour la plupart, un amalgame singulier d’images idylliques, utopiques et paradisiaques, et d’images des pratiques cruelles et cannibalesques des natifs. D’un côté, la nature luxuriante et amène ; de l’autre, l’anthropophagie répugnante.
À propos des jeux d’identité dans l’espace-temps portugais, j’avance les hypothèses suivantes. En premier lieu, il s’agit de jeux particulièrement complexes étant donné que les Portugais ont été, tout au long de l’histoire, des deux côtés du miroir : comme Prospero se reflétant dans le miroir de Caliban et vice versa. La deuxième hypothèse, qui découle de la précédente, est que l’ambivalence est permise dans cet espace-temps car le sujet du désir a également été objet du désir. La troisième hypothèse est que l’identité dominante dans cet espace-temps n’est jamais vraiment parvenue à la négation totale de l’autre, et n’a donc même pas su se confronter politiquement aux identités subalternes. Dans cette section et les suivantes j’apporterai certains éléments qui viendront étayer ces hypothèses.
Les caractéristiques auxquelles les Portugais ont eu recours pour construire, à partir du XVe siècle, l’image des peuples natifs de leurs colonies sont très proches de celles qui leur étaient attribuées à eux-mêmes, à partir de cette même époque, par des voyageurs, commerçants et religieux venus d’Europe du Nord8 : du sous-développement à la précarité des conditions de vie, de l’indolence à la sensualité, de la violence à l’affabilité, du manque d’hygiène à l’ignorance, de la superstition à l’irrationalité. Le contraste entre l’Europe du Nord et le Portugal est flagrant dans le récit de voyage (décrivant un séjour au Portugal et en Espagne entre 1531 et 1533) du frère Claude de Bronseval, secrétaire de l’abbé de Clairvaux. Les deux voyageurs se plaignent fréquemment de l’état des routes, des manières grossières des habitants, du logement et de l’accueil misérables, bien « à la manière du pays », de l’habitude des gentilshommes ou des notables de réserver aux étrangers les maisons les plus pauvres pour ne pas être pris pour des aubergistes. Quant à l’éducation des moines, il est dit que « rares sont ceux qui, dans ces royaumes hispaniques, aiment le latin. Ils n’aiment que leur langue vulgaire ». La description de Lisbonne ne pourrait être plus représentative de l’avis général des voyageurs :
Cette ville très populeuse est un réceptacle de Juifs, la nourricière d’une foule d’Indiens, une geôle de fils d’Agar, un réservoir de marchandises, une fournaise d’usuriers, une étable de luxure, un chaos d’avarice, une montagne d’orgueil, un refuge de fugitifs, un havre pour les Français repris de justice. (Bronseval, 1970, p. 329)
En analysant trois récits rédigés dans la décennie 1720, Castelo Branco Chaves affirme que
l’image générale que l’on se fait du pays est celle d’une terre fertile, riche mais sous-exploitée, vivant presque exclusivement de l’or du Brésil. Une grande partie de la nourriture, des vêtements, du bois de construction urbaine et navale, des biens nécessaires à la subsistance proviennent de l’étranger, d’Angleterre ou de Hollande, et sont achetés essentiellement grâce à l’or brésilien. Le Portugais est paresseux, pas du tout travailleur, il ne tire pas parti des richesses de son pays, et ne sait pas même vendre celles de ses colonies. (Chaves, 1983, p. 20)
Hormis la référence finale aux colonies, cette caractérisation correspond en tout point à ce qui se disait alors, depuis deux siècles, des peuples natifs d’Amérique et d’Afrique : les Portugais sont vindicatifs jusqu’à la cruauté, fourbes, railleurs, frivoles et idiots. Ce rapprochement est souvent implicite lorsque la couleur de peau des Portugais est invoquée pour confirmer la véracité du stéréotype. D’après l’un des récits, les Portugais sont, « dans leur grande majorité, basanés, ce qui résulte du climat et plus encore du mélange avec des noirs9 » (Chaves, 1983, p. 24). Tandis que les Portugais revendiquaient le métissage comme un triomphe humaniste ou un astucieux dispositif colonialiste, le regard du Prospero européen inscrivait le métissage sur leur peau comme un fardeau.
À partir de la seconde moitié du XVIIIe siècle, comme l’affirme Chaves, et essentiellement parmi les Anglais, la « légende noire » des Portugais comme peuple décadent, dégénéré, imbécile, s’affermit. En décembre 1780, le capitaine anglais Richard Crocker écrit depuis Lisbonne :
Les hommes portugais sont certainement la race la plus laide d’Europe. Ils peuvent vraiment considérer la dénomination d’« homme blanc » comme un honneur. Les Portugais descendent d’un mélange de juifs, de Maures, de noirs et de Français, et d’après leur apparence et leur caractère ils semblent avoir pris les pires aspects de chacun de ces peuples. Comme les juifs, ils sont mesquins, trompeurs et avares. Comme les Maures, ils sont jaloux, cruels et vindicatifs. Comme les peuples de couleur, ils sont serviles, peu dociles et faux, et ils rejoignent les Français dans la vanité, l’artifice et la forfanterie. (cité par Pires, 1981, p. 112)
Au début du XIXe siècle, les Portugais sont généralement décrits comme des paysans mal dégrossis. En septembre 1808, l’officier de la Marine anglaise Charles Adam écrit de Lisbonne à un ami : « Je vais essayer de me procurer […] des livres en espagnol, on me dit qu’il n’y a guère de livres portugais qu’il vaille la peine de posséder » (cité dans Pires, 1981, p. 85). Durant son séjour au Portugal, entre 1808 et 1814, August Schaumann, commissaire allemand de l’armée anglaise, regrette en ces termes dépréciatifs la situation d’un peuple qui se voit envahi, non par un, mais par deux pays, l’un qui l’attaque (la France) et l’autre qui le défend (l’Angleterre) : « De tout mon cœur je plains ces pauvres diables » (cité par Byrne, 1998, p. 108). Vers la même époque, Lord Byron visite le Portugal (1809) et écrit son fameux poème Childe Harold’s Pilgrimage. « Hutte et palais sont aussi crasseux l’un que l’autre ; ses sombres habitants élevés dans la saleté ; aucun individu, de haut ou de bas rang, ne se préoccupe de la propreté de son habit ou de sa chemise, […] négligé, malpropre » (Byron, 1900 [1812], p. 26). Et pour qu’il ne subsiste aucun doute, voici la comparaison avec les Espagnols : « Le paysan espagnol est aussi altier que le plus noble des ducs et sait parfaitement ce qui le distingue de l’esclave portugais, le dernier des esclaves » (p. 34-35).
À la fin du XVIIe siècle, le révérend anglican John Colbatch (qui occupa le poste d’aumônier de la British Factory à Lisbonne), malgré des jugements généralement plus favorables à l’égard des Portugais, n’en souligne pas moins « la haine suprême » qu’ils nourrissent à l’égard des étrangers et leur manque de gratitude envers les Anglais qui, si souvent, avaient été leurs « sauveurs » (cité par Macaulay, 1946, p. 224-225). Robert Southey visite le Portugal pour la première fois en 1796, et bien qu’il prétende également montrer de l’admiration pour les Portugais, il ne manque pas de les taxer de peuple rétrograde, superstitieux, sale, paresseux, ignorant, malhonnête, écrasé par la tyrannie d’un État et d’une Église tous deux corrompus et ignares, servi par des institutions singulières et effarantes, comme la justice, « généralement inefficace ou expéditive, laissant impunis nombre de voleurs et d’assassins », ou encore la médecine, « exercée par des praticiens qui ne connaissent pas leur métier, discrédités par des patients qui préfèrent considérer leur rétablissement comme l’œuvre de Dieu ». Et de conclure, en établissant un parallèle avec les stéréotypes européens à l’égard des peuples d’Afrique ou d’Amérique, que la « sensualité est sans aucun doute le vice des Portugais. Les images débauchées de Camões, son île aux amours et sa Vénus protégeant Gama, montrent qu’ils se complaisent dans des turpitudes de ce genre » (cité par Castanheira, 1996, p. 83, p. 92).
La symétrie entre les stéréotypes attribués aux Portugais par les Européens du Nord et les stéréotypes attribués aux peuples d’Amérique et d’Afrique par les Européens du Nord et du Sud est palpable dans l’ambivalence entre la stigmatisation de l’autre mêlée au désir de l’autre. Nous avons vu plus haut que les premières images de l’Amérique associent l’exaltation de la nature idyllique et de la vie simple avec la vive condamnation de la pratique cruelle et répulsive du cannibalisme. Ce contraste présente un curieux parallélisme avec les récits sur le Portugal des voyageurs européens à partir du XVIIIe siècle, dans lesquels la beauté des paysages, la richesse de la terre, le climat amène sont régulièrement opposés à la rudesse et à la brutalité des Portugais, comme dans cette déclaration de Lord Byron : « Pourquoi, ô nature, as-tu dilapidé tes merveilles pour pareils hommes ? Voici que, dans le labyrinthe bigarré de monts et de vaux, apparaît le glorieux éden de Sintra » (Byron, 1900 [1812], p. 26). Le même Robert Southey qui juge sévèrement les Portugais exalte les beautés naturelles du pays et s’exclame : « Je donnerais un de mes yeux à l’aveugle Fortune si elle me permettait de regarder le Tage de l’autre œil » (cité par Castanheira, 1996, p. 75). Charles Frédéric de Merveilleux, médecin naturaliste français invité par le roi Jean V à écrire « l’histoire naturelle de ces royaumes », affirme que « les terres produisent quasiment sans effort et compensent abondamment les soins dédiés à leur culture », et de conclure : « Combien de richesses pourrait Votre Majesté retirer de ses états si ceux-ci étaient peuplés de […] gens travailleurs » (cité par Chaves, 1983, p. 20).
La dialectique étrangeté/désir, répulsion/attraction, présente dans les descriptions des Indiens en interaction avec la faune du continent américain, est également perceptible dans les récits d’étrangers en visite au Portugal. Voici ce qu’écrit une voyageuse anglaise dans la décennie 1890 :
les porcs de cette région sont terriblement laids. Ce sont des animaux énormes, avec de longues oreilles, des échines démesurées, […] des flancs creux […]. Malgré cela, les villageois considèrent ces créatures comme des animaux domestiques qui répondent aux noms qu’on leur donne et viennent quand on les appelle, comme les chiens, et ils apprécient qu’on leur parle et qu’on les caresse. (cité par Pires, 1981, p. 40)
La dialectique de la représentation du colonisé fait de celui-ci, comme nous l’avons vu, un être à la fois attrayant et répugnant, docile et menaçant, loyal et perfide, utopique et diabolique. Dès lors, les stéréotypes ne sont ni univoques ni consistants : selon les besoins de représentation du colonisateur, les stéréotypes tantôt négatifs, tantôt positifs prédominent, bien que les uns et les autres soient mutuellement liés. Cette dialectique trouve également des parallèles dans les représentations des Portugais par les étrangers : à côté des représentations « négatives », que j’ai illustrées plus haut, on trouve également des représentations « positives ». D’ailleurs, le « profil du Portugais », de même que celui du colonisé dans les récits coloniaux, a suscité de vifs désaccords parmi les observateurs étrangers. Les stéréotypes négatifs finissent par prendre le dessus dans la deuxième moitié du XVIIIe siècle, à mesure que se creuse la domination britannique sur le Portugal, mais tout au long de l’époque moderne les récits qui cherchent à remettre en question les récits antérieurs et à proposer des alternatives sont fréquents. Certains partisans de la représentation cherchent même à construire une histoire des représentations des Portugais de manière à souligner leurs aspects positifs, comme le fait Rose Macauley (1990). Parmi les stéréotypes positifs, celui de la douceur des mœurs est certainement le plus consistant, bien que très récent, et il est à l’origine d’un autre stéréotype encore plus récent : celui du luso-tropicalisme.
Je cherche à montrer que la charge positive comme la charge négative des stéréotypes présentent des parallélismes surprenants avec les stéréotypes coloniaux. Dans un important travail de recherche sur le système de représentations sociales identitaires des Portugais, Pereira Bastos reconstitue de la façon suivante le profil du Portugais à partir des études du sociologue français Paul Descamps qui, invité par Salazar, mena des recherches au Portugal dans les années 1930 : prépondérance de l’amour sur les intérêts matériels ; propension à la saudade et à la mélancolie ; excessive faiblesse de caractère ; dévirilisation et hypersensibilité ; tempérament nerveux, émotivité et apitoiement ; esprit poétique ; amabilité et docilité ; « âme féminine » ; tendance à la simulation ; désirs effrénés et appel à l’irréel ; esprit d’aventure ; manque de persévérance, d’esprit d’entreprise et de capacités de commandement ; négligence de l’importance du temps et de la ponctualité ; incompréhension des conséquences sociales des actions (Bastos, 1995, p. 144-147). Dans cette liste, la complexe ambivalence de l’attraction et de la répulsion est notable. Mais il est encore plus remarquable qu’en plein XXe siècle nombre de caractéristiques attribuées aux Portugais présentent des similitudes surprenantes avec celles prêtées au noir africain ou à l’Indien d’Amérique dans les récits coloniaux, y compris portugais.
Jeux de miroirs II : un Prospero calibanisé
Les Portugais n’ont jamais pu s’installer commodément dans l’espace-temps d’origine du Prospero européen. Ils ont ainsi vécu comme intérieurement déplacés, dans des régions symboliques qui ne leur appartenaient pas et où ils ne se sentaient pas à l’aise. Ils ont fait l’objet d’humiliations et de célébrations, de stigmatisations et de condescendance, mais toujours avec la distance de celui qui n’est pas pleinement contemporain de l’espace-temps qu’il occupe. Contraints de jouer le jeu des binarismes modernes, ils ont eu du mal à déterminer de quel côté ils se trouvaient. Ni Prospero ni Caliban, il leur reste la liminalité et la frontière, l’interidentité comme identité d’origine. En apparente contradiction avec tout cela, cependant, le Portugal fut la première puissance européenne à se lancer dans l’expansion maritime et celle qui a gardé le plus longtemps son empire. Si le colonialisme a joué un rôle central dans le système de représentations de la modernité occidentale, le Portugal a joué un rôle pionnier dans la construction de ce système et, par conséquent, dans le jeu de miroirs fondateur entre Prospero et Caliban. Voici donc le mystère : comment un Caliban européen a-t-il pu être un Prospero outre-mer ? Ou encore, n’ayant jamais assumé aucune de ces identités pleinement et exclusivement, n’a-t-il pas assumé les deux simultanément ?
L’hégémonie du Portugal dans le système-monde moderne a été de courte durée, de sorte qu’à la fin du XVIe siècle les signifiants de Prospero et Caliban circulaient déjà hors du contrôle des Portugais. Les inscriptions de ces signifiants dans les systèmes de représentation des Portugais ont été si complexes et se sont produits sur une période si longue qu’ils ont fini par engendrer des stéréotypes et des mythes contradictoires, chargés de semi-vérités. Jusqu’à nos jours, la construction historique des découvertes et du colonialisme portugais est hantée par des mythes qui s’appartiennent et s’annulent mutuellement. Dans la construction de Charles Boxer, les Portugais apparaissent comme un Prospero incompétent, avec tous les défauts des Prospero et peu de ses vertus, tandis que dans celle de Gilberto Freyre il est question d’un Prospero bienveillant, cosmopolite, capable de s’allier à Caliban pour créer une réalité nouvelle (Boxer, 1963 ; Freyre, s.d.) — deux constructions crédibles au vu de la confusion et du chaos des pratiques dans lesquelles ils ont cherché à mettre de l’ordre.
Cette indécidabilité est le signe de la persistance d’un régime d’interidentité. Les Portugais, toujours en transit entre Prospero et Caliban, ont tout aussi bien été racistes, souvent violents et corrompus, plus enclins au pillage qu’au développement, qu’ils ont été des métisseurs nés, littéralement pères de la démocratie raciale, de ce qu’elle révèle et de ce qu’elle cache, meilleurs que n’importe quel autre peuple européen en matière d’adaptation aux tropiques. En Afrique, en Asie et au Brésil ce régime d’interidentité a eu d’infinies manifestations, parmi lesquelles se distinguent la « cafrealisation » et le métissage, des phénomènes liés entre eux mais correspondant à des processus sociaux distincts.
La cafrealisation est une désignation utilisée à partir du XIXe siècle pour caractériser de façon stigmatisante les Portugais qui, en particulier en Afrique orientale, se détachaient de leur culture et de leur statut civilisé pour adopter les modes de vie des « cafres », les noirs désormais transformés en primitifs et sauvages. Il s’agit donc de Portugais pris dans les filets de Caliban et effectivement « calibanisés », vivant avec femmes et enfants « calibans », adoptant les coutumes et les langues locales. Jusqu’alors le terme « cafre » (de l’arabe « kafir », « infidèle ») servait uniquement à distinguer les noirs non-musulmans de ceux qui parlaient arabe et étaient impliqués dans le commerce que les peuples de culture arabo-musulmane et swahili pratiquaient depuis des siècles dans ces parages10. Il prend une connotation dépréciative à un moment précis de l’histoire du colonialisme portugais — que je désignerai plus loin comme « moment de Prospero » —, et sa pertinence pour l’argumentation développée dans cette section réside dans le fait qu’avec lui le discours colonial cherche à donner un nouveau sens à une pratique qui s’est répandue entre les XVIe et XIXe siècles, en particulier sur la côte orientale de l’Afrique.
Cette pratique a consisté en l’interaction prolongée des Portugais avec les cultures et les pouvoirs locaux. Quand les intérêts du commerce n’étaient soutenus par aucune puissance impériale digne de ce nom, cette interaction tendait à se caractériser par la réciprocité et l’horizontalité, voire la subordination ou l’allégeance aux rois et aux autorités locales. La récurrence de ces interactions a été telle qu’elle a débordé des activités commerciales vers des sphères relationnelles plus étroites, ce qui impliquait fréquemment la constitution d’une famille et l’assimilation des langues et coutumes locales. Cette interaction aisée, ainsi que les pratiques culturelles hybrides auxquelles elle a donné lieu, sont documentées depuis le XVIIe siècle. Les récits, émanant bien souvent de religieux, critiquent ces pratiques, bien qu’ils montrent parfois une certaine compréhension à l’égard des difficultés rencontrées en ces lieux par ceux que nul pouvoir colonial ne défendait. Le frère João dos Santos écrit en 1609 :
Un Portugais nommé Rodrigo Lobo était le seigneur de cette île [dans l’actuelle région de Sofala, au Mozambique] dont le roi lui avait fait cadeau en signe d’amitié, tout en lui octroyant le titre de sa femme, un nom que le roi donnait au capitaine du Mozambique, à celui de Sofala et aux autres Portugais qu’il estimait, signifiant ainsi son affection et son souhait de les voir révérés comme l’est sa femme, et en effet […] les cafres vénèrent beaucoup les Portugais qui portent les mêmes titres que les femmes de roi. (J. Santos, 1999, p. 139)
En 1766, António Pinto Miranda écrit que les Européens du Mozambique
épousent certaines femmes natives et d’autres qui viennent de Goa [et] oublient facilement leur éducation chrétienne […], raison pour laquelle ils ne la transmettent pas à leurs enfants, ce qui fait que ces derniers se comportent aussi mal que les compatriotes que j’ai déjà évoqués. […] Outre leurs propres femmes, ils ne cessent d’en chercher d’autres. […] Ainsi passent-ils oisivement leurs journées. (Miranda, 1954, p. 64)
En 1844, João Julião da Silva écrit dans sa Memória sobre Sofala :
La civilisation de cette ville n’a pas avancé le moins du monde par rapport à son état primitif du temps où elle avait la dénomination de prison [et] où ses habitants […] criminels et immoraux y étaient envoyés pour y purger leur peine à vie […] ; les individus en question cherchaient purement et simplement à se familiariser avec les habitudes et les usages des cafres qui les entouraient, et pour trouver chez eux un soutien […] ils se mariaient à la manière des cafres avec les noires de la brousse et généraient des métis [lesquels], élevés dans la liberté et les habitudes des cafres, suivaient le même chemin que leurs pères, et même maintenant, rares sont ceux qui savent lire et écrire […] ; les superstitions, les méfaits et les coutumes barbares sont [si] enracinés en eux qu’il est impossible de les déloger ; ils méconnaissent les plus simples rudiments de notre Sainte Religion, la langue portugaise et les habitudes européennes. (Feliciano & Nicolau, 1998, p. 36)
Ignacio Caetano Xavier exprime, au milieu du XVIIIe siècle, une réprobation du même ordre lorsqu’il dit des habitants soumis à la Couronne qu’ils « ressemblent davantage à des fauves qu’à des hommes, étant donné qu’ils s’opposent à toute civilité et sujétion à l’autorité, sans parler de la religion » (Dias, 1954, p. 174).
La dépréciation des indigènes en tant que primitifs et sauvages est une constante dans ces récits, et avec elle la dépréciation des Portugais qui se mélangeaient à eux et adoptaient les modes de vie de ces populations. Sur une longue période, le stéréotype portugais dominant n’est pas celui de Prospero, mais celui d’un proto-Caliban, un « cafrealisé ». À mesure que l’on découvre les récits de ces Portugais cafrealisés, il est possible de se faire une idée plus complexe des processus d’hybridation, certainement différente de celle qui nous est transmise par les récits de ceux qui visitaient ces populations lors de manifestations éclair du pouvoir impérial, de l’Église et de la Couronne (un pouvoir, du reste, toujours absent). La condition des Portugais qui peuplaient ces territoires contribue également à déprécier et à stigmatiser le Prospero cafrealisé. D’après Marc Ferro, c’est d’abord au Portugal que l’on a adopté la pratique qui consiste à « se débarrasser des criminels, des délinquants, en les envoyant purger leur peine ailleurs — un exemple repris par l’Angleterre à très grande échelle avec les convicts qui, à partir de 1797, sont allés peupler l’Australie » (Ferro, 1996, p. 179). Depuis 1415, de fait, chaque navire en partance pour la côte africaine emportait son contingent de bagnards. Bon nombre de ces Portugais évoqués dans les récits en termes dépréciatifs, comme ceux de Xavier que nous citons, étaient des bagnards :
L’insolence de ces gens va encore plus loin puisqu’après avoir bafoué le respect dû à l’humain, ils ont aussi osé, bien souvent, rompre la bienséance des Maisons de Dieu avec de sacrilèges menaces de mort, des blessures, des bagarres etc. […] comme cela a été le cas il y a quelques années en l’église des dominicains à Senna, aujourd’hui réduite en cendres. (cité par Dias, 1954, p. 175-176)11
Le sous-texte de ces récits est que l’origine sociale des Portugais en Afrique exigeait une présence plus marquée de l’autorité coloniale. Or, comme nous l’avons vu, celle-ci était si faible et inconsistante qu’on devrait plutôt la considérer comme un simulacre de pouvoir, un trait fondamental, selon moi, pour comprendre tous les chemins de l’interidentité en Afrique durant cette période. Étant donné la faiblesse politico-administrative de l’État colonial, et en raison d’un colonialisme portugais en Afrique centré pendant plusieurs siècles sur le commerce maritime, et non sur l’occupation territoriale, les Portugais qui exerçaient une activité commerciale dans ces parages ont été des colonisateurs sans État colonial, contraints de pratiquer une sorte d’autogestion coloniale. Cette autonomie permettait à chacun de s’identifier à loisir au pouvoir de l’Empire, mais sans disposer d’autre pouvoir que celui qu’il pouvait mobiliser par ses propres moyens. Comme ces moyens étaient limités, le Portugais a dû tout négocier, non seulement le commerce, mais également sa survie. Il a donc été un « colonisateur » qui s’est régulièrement vu dans l’obligation, comme n’importe quel natif, de prêter allégeance au roi local.
Cette même absence de l’État colonial a souvent conduit à « sous-traiter » aux populations locales les fonctions de souveraineté, comme la défense des frontières. C’est ce qu’évoque Joaquim Portugal au milieu du XVIIIe siècle à propos des îles de Cabo Delgado, à l’extrême nord du Mozambique, dont les seuls habitants, des « Maures nationaux qui vivent dans la plus grande obéissance, représentent toute la force de défense de nos frontières face aux insultes des cafres makuas, car il est en effet impossible au Mozambique […] d’envoyer du secours […] en raison du manque de troupes » (cité par Dias, 1954, p. 276). La loi coloniale, elle aussi, en l’absence d’un État colonial assez fort pour l’imposer, demeurait moins entre les mains de ceux qui l’émettaient qu’entre celles des populations qui devaient s’y soumettre. L’autonomie coloniale a conduit à la constitution d’un droit parallèle, qui mêlait l’application fortement sélective des lois officielles, lorsque cela présentait un intérêt, avec des dispositions locales ou adaptées aux conditions locales. Ce fut certainement là le premier exemple moderne de pluralisme juridique (Santos, 1995b, p. 112-122). Du point de vue des Portugais dans les colonies, les conditions juridiques de leurs activités n’étaient ni légales, ni illégales : elle était alégales. Du point de vue de la Couronne, il s’agissait d’un système de désobéissance qui ne pouvait être assumé comme tel par personne, semblable à celui en vigueur en Amérique espagnole, connu sous la formule « j’obéis mais n’exécute pas ». C’était un système juridique « d’aller-retour » (port. « de torna-viagem ») : les lois, expédiées de Lisbonne, n’arrivaient pas toujours, et quand elles arrivaient leur venue était ignorée, ou quand elle était reconnue, bien plus tard, les conditions avaient tant changé que leur non application se justifiait ; finalement, les lois et la justification étaient envoyées à Lisbonne avec un vœu d’obéissance en appendice final : « Nous attendons les ordres ».
Bien entendu, les caractéristiques de l’économie politique ont eu un impact sur le régime des interidentités, sur la façon dont les Portugais se sont cafrealisés, mêlés aux cultures et pratiques avec lesquelles ils devaient cohabiter. Mais si cet impact est évident, son sens exact est l’un des facteurs d’indécidabilité du système de représentations identitaires dans l’espace-temps du colonialisme portugais. La cafrealisation et, en général, « l’adaptation aux tropiques » ont-elles été le produit de la facilité ou de la nécessité ? La facilité les a-t-elles rendues nécessaires ou, au contraire, la nécessité les a-t-elles rendues faciles ?
La lecture de la facilité tend à déstigmatiser la cafrealisation et à en faire une situation favorable. L’analyse de Jorge Dias constitue une version paradigmatique de cette lecture :
La composition hétérogène du peuple portugais et la structure traditionnelle communautaire et patriarcale lui ont permis une parfaite assimilation de l’esprit chrétien de fraternité […], même mis à l’épreuve dans des situations de grands contrastes raciaux et culturels. Les Portugais n’arrivaient pas avec des attitudes de conquérants, cherchant plutôt à établir des relations amicales avec les populations de différents continents, et ils ne faisaient usage de leurs armes et de la force que quand la situation l’exigeait. […] Notre action assimilatrice ne s’est pas exercée de façon violente, mais à l’inverse, nous avons cherché à nous adapter aux contextes naturels et sociaux, dans le respect des styles de vie traditionnels. Par ailleurs, grâce à l’exemple que nous donnions et à la cohabitation, nous éveillions parmi les populations indigènes le respect de certains principes de notre civilisation occidentale. (Dias, 1961, p. 155- 156)
Dans cette lecture, la cafrealisation est le non-dit qui sous-tend son contraire, l’assimilation12. Elle constitue un double non-dit : un non-dit de l’assimilation car il s’agit d’une assimilation inversée, de Prospero vers Caliban, mais il s’agit également du non-dit du diktat culturel qui caractérise la colonisation, qu’elle soit assimilationniste ou non, car il s’agit d’une identité négociée. Curieusement, dans un nouveau jeu de miroirs, cette lecture fait écho à celles de voyageurs étrangers au Portugal à partir du XVIIIe siècle, pour qui la porosité des pratiques identitaires des Portugais n’était pas passée inaperçue13. Alors que la lecture de la nécessité tend à voir dans la cafrealisation la faiblesse et l’incompétence d’un Prospero qui n’a pu ou su lui échapper. Ce serait là l’expression d’une dégénérescence qui a elle-même entraîné dans son retard le retard des colonisés. C’est là, en bonne partie, la lecture de Charles Boxer, tout comme celle qui est sous-jacente aux politiques coloniales depuis la fin du XIXe siècle, bien que dans ce cas la lecture vise exclusivement à justifier la rupture relativement aux politiques coloniales antérieures, sur lesquelles je reviendrai dans la prochaine section.
Le métissage est l’autre manifestation de la porosité des régimes identitaires des Portugais. Il s’agit d’un phénomène différent de la cafrealisation qui peut se produire sans celle-ci, mais le fait est que, dans les moments d’intensification des discours colonialistes et racistes — les moments de Prospero, que je mentionnerai plus loin —, la stigmatisation de la cafrealisation a entraîné celle du métissage (le métissage comme cafrealisation du corps). De nos jours, il est consensuellement admis que le métissage a été « l’exception portugaise » au sein du colonialisme européen (Ferro, 1996, p. 177), bien que l’on admette également que le colonialisme portugais n’a pas été le seul à le pratiquer.
La porosité des frontières entre Prospero et Caliban a atteint sa plus évidente expression identitaire dans la figure du métis et de la métisse. L’ambivalence des représentations à leur égard est révélatrice de la nature d’un pacte colonial aussi ouvert que dépourvu de garanties. Tantôt perçus comme des êtres génétiquement dégradés, expression vivante d’une trahison de Caliban, tantôt comme des êtres supérieurs, réunissant ce qu’il y avait de meilleurs chez Prospero et chez Caliban, les métis furent, au fil des siècles, une marchandise symbolique dont la cote a varié au gré des vicissitudes des pactes et conflits coloniaux. Dans les périodes où Prospero a voulu s’affirmer comme tel ou dans celles où Caliban a pris conscience de l’oppression subie et s’est disposé à la combattre, la cote des métis a baissé ; à l’inverse, elle est remontée dans les périodes, bien plus longues, durant lesquelles ni Prospero ni Caliban n’ont ressenti la nécessité ou n’ont eu la possibilité de s’affirmer comme tels. Expression de la démocratie raciale, les métis ont contribué — malgré eux et au mépris de leurs intérêts — à légitimer l’inégalité sociale raciste. On peut donc en conclure que le débat sur la valeur politique et culturelle du métissage est indécidable dans ses termes mêmes, étant donné qu’il a constitué l’un des débats-erzatz du règlement de compte entre Prospero et Caliban, entre le colonialisme européen et ceux qui ont été colonisés par lui, et qui va encore persister longtemps.
Dans ce contexte, il est intéressant de relever une autre subtilité du régime identitaire portugais. Il s’agit de la possibilité, pour le Portugais métisseur d’être lui-même métissé ; originairement métis, il ne peut engendrer que des métis et métisses, quand bien même les uns et les autres seraient blancs ou blanches. Ceux qui ont voulu faire des Portugais un Prospero de plein droit lui ont attribué une ancestralité lusitanienne, romaine et germanique, tandis que ceux qui les voyaient comme un Prospero douteux, insuffisant et calibanisé, lui attribuaient une ancestralité juive, maure et noire.
Le métissage originel, sous la forme de signifiants racistes inscrits dans la couleur de peau, dans la constitution physique, voire dans les habitudes, a poursuivi les Portugais où qu’ils aillent. Dans les colonies et ex-colonies d’autres puissances européennes, en particulier dans le monde anglo-saxon, les Portugais ont souvent suscité la perplexité, faisant l’objet de catégorisations extravagantes qui étaient, en fait, des manifestations de l’interidentité. Dans les Caraïbes, aux États-Unis ou à Hawaï, les Portugais ont toujours été considérés comme des groupes ethniques distincts des blancs et des Européens, dotés d’un statut intermédiaire entre ceux-ci et les noirs ou les natifs14. Dans les Caraïbes et à Hawaï, on appelait « portygees » ou « potogees », les travailleurs sous contrats temporaires venus remplacer les esclaves après la fin de l’esclavage et qui, par conséquent, n’étaient pas blancs, mais seulement un autre genre de « coolie men », comme les Asiatiques. Pour l’historien afro-caribéen Eric Williams, il n’est pas étonnant de citer comme il suit les groupes ethniques ayant soutenu le Mouvement National Populaire de Trinidad et Tobago : « Africains, Indiens, Chinois, Portugais, Européens et Syriens ». De même, pour V. S. Naipaul, la lutte postindépendance en Guyane a impliqué six races : « Indiens, Africains, Portugais, blancs, métis et Amérindiens » (Harney, 1990, p. 115 - 114).
Lors de son passage par Trinidad, Miguel Vale de Almeida a recueilli le témoignage suivant de descendants de Portugais (les « potogees ») : « les élites ne les considéraient pas blancs, au mieux Trinidad-white, et les non-blancs ne les traitaient pas comme supérieurs » (Almeida, 2000, p. 7). Ce statut intermédiaire contribue à expliquer le rôle joué par Albert Gomes en tant que leader politique des Afro et Indo-caribéens de Trinidad dans les années 1960, quand les partis politiques coïncidaient encore avec des divisions ethniques (Harney, 1990, p. 115) : ses ancêtres étaient des « Portugais africanisés » du port négrier de Vera Cruz, où ils jouaient les intermédiaires (y compris linguistiques) entre les esclaves récemment arrivés et ceux qui les achetaient (Leon, 1993). Maria Ioannis Baganha raconte qu’à Hawaï les Portugais étaient perçus comme un groupe ethnique intermédiaire : supérieur aux Orientaux mais inférieurs aux blancs caucasiens (« haolé ») (Baganha, 1990, p. 288). Effectivement, entre 1910 et 1914, le recensement à Hawaï distinguait « portygees » et « autres Caucasiens ». Ce statut intermédiaire, structurellement ambigu, était pourtant précis quand il était mis en œuvre dans le cadre des pratiques locales, comme le note Robert Harney : sur leur lieu de travail, les Portugais étaient toujours contremaîtres mais jamais régisseurs, une position réservée aux Écossais ; de même, le salaire des charpentiers portugais était supérieur à celui des charpentiers japonais, mais un forgeron portugais touchait moitié moins qu’un forgeron écossais (Harney, 1990, p. 115). Bien au-delà des relations professionnelles, Harney mentionne un cas où le statut intermédiaire des Portugais fut décisif pour parvenir à un compromis dans un important jugement pour viol. Comme les accusés étaient des Asiatiques et des natifs hawaïens, si les jurés étaient blancs (« haoles ») les prévenus seraient certainement condamnés, et s’ils étaient asiatiques ou natifs, les prévenus seraient certainement relaxés. La solution a été de composer le jury suivant : « six blancs, un Portugais, deux Japonais, deux Chinois et un Hawaïen » (Harney, 1990, p. 115).
Aux États-Unis la Harvard Encyclopedia of American Ethnic Groups regrettait qu’en 1976 encore la ville de Barnstable, à Cape Cod, continue de classer les groupes ethniques de sa population en deux catégories : d’un côté, Finois, Grecs, Irlandais et juifs ; de l’autre, noirs, Portugais et Wampanoags, soit un groupe indubitablement blanc et un groupe de non-blancs (Harney, 1990, p. 117). Suivant la même logique, en 1972 l’Ethnic Heritage Program considérait les Portugais comme l’une des sept minorités ethniques/raciales du pays : noir, Indien d’Amérique, Hispanique, Oriental, Portugais, Hawaïen natif, natif de l’Alaska — autrement dit, ils étaient le seul groupe d’émigrés européens dont on niait l’origine européenne15.
Originellement métis, calibanisé chez lui par les étrangers qui lui rendaient visite, cafrealisé dans ses colonies, semi-calibanisé dans les colonies et ex-colonies des puissances européennes qu’il a fréquentées, comment ce Prospero a-t-il pu être un colonisateur et coloniser prospèrement ? Est-il possible d’être fermement postcolonial face à un colonisateur aussi déconcertant et outrancièrement discrédité et incompétent ?
Jeux de miroirs III : les moments de Prospero
Je distingue deux moments de Prospero dans le colonialisme portugais : celui de la fin du XIXe siècle et des premières décennies du XXe, et celui du 25 Avril jusqu’à l’adhésion à l’UE. À chacun de ces moments l’ascension de Prospero dans le magma identitaire portugais se fait sous la pression de facteurs externes, toujours sous la forme de l’Europe capitaliste développée. Le premier moment se produit dans la période de l’après-Conférence de Berlin (1884-85), lorsque l’occupation effective des territoires sous domination coloniale devient la condition de la permanence de cette domination. Une fois le partage de l’Afrique effectué, les pays européens industrialisés confèrent à l’entreprise coloniale une tournure impériale qui la relie étroitement à l’exploitation capitaliste des colonies, ce qui présuppose un contrôle politique et administratif rigide. Pour s’assurer une présence en Afrique, le Portugal se voit contraint d’agir comme les autres puissances européennes, comme si le développement interne du capitalisme portugais avait des exigences comparables, ce qui n’était pas le cas. Ce fait n’échappe pas à l’historiographie anglaise, au service de l’impérialisme britannique et donc hostile à l’impérialisme portugais. Dans The scramble for Africa - 1876-1912, Thomas Pakenham est exemplaire à ce propos : « Et il y avait le Portugal, à moitié sénile et plus ruiné encore, attaché à ses possessions en Afrique, l’Angola et le Mozambique, davantage par fierté que dans l’espoir d’en tirer profit » (cité par Furtado, 1997, p. 77).
Ce moment marque réellement l’apparition de l’indigène primitif en opposition au Portugais colonisateur, représentant ou métaphore de l’État colonial. Le processus qui a fait descendre l’indigène au statut qui justifie sa colonisation est le même qui a élevé le Portugais au statut de colonisateur européen. La dichotomie entre les Portugais et la Couronne disparaît. L’empire portable que les Portugais transportent désormais n’est pas un auto-empire soumis aux faiblesses et aux forces de celui qui le transporte, mais l’émanation d’une force transcendante : l’État colonial. Le Portugais blanc et l’indigène primitif apparaissent simultanément divisés et unis par deux puissants instruments de la rationalité occidentale : l’État et le racisme. Par le biais de l’État on cherche à assurer l’exploitation systématique de la richesse, en la convertissant en mission civilisatrice via le transfert vers les colonies des modes de vie civilisés de la métropole — la création mimétique de la « petite Europe » en Afrique dont parle Edward Saïd (1980, p. 78). Par le biais du racisme on obtient la justification scientifique de la hiérarchie des races, ce qui mobilise aussi bien les sciences sociales que l’anthropologie physique.
L’occupation territoriale, dont la campagne contre Gungunhana est un bon exemple, vise à réduire les Africains, à commencer par leurs rois, à la condition de subordonnés dociles, tandis que des missions successives d’exploration scientifique visent à établir et confirmer l’infériorité des noirs16. Dans un contexte de prospérité du colonisateur portugais, il n’est pas étonnant que la cafrealisation et le métissage soient stigmatisés avec une particulière violence. En 1873, António Ennes écrit que « la cafrealisation est une sorte de retour de l’homme civilisé à l’état sauvage » (Ennes, 1946 [1873], p. 192). De même, Norton de Matos, gouverneur-général de l’Angola et défenseur de l’assimilationnisme, s’insurge contre l’assimilation inversée en disant qu’en 1912 circulaient parmi les indigènes « quelques Européens, heureusement peu nombreux, qui avaient malencontreusement rejoint les indigènes non civilisés et s’étaient totalement adaptés à leurs us et coutumes » (cité par Barradas, 1992, p. 54).
Tandis que le Portugais passe de criminel déporté enclin à la cafrealisation à la condition d’agent civilisateur, les natifs passent de rois ou serviteurs de rois à la condition de plus basse animalité, dans laquelle ils sont susceptibles de domestication uniquement par le biais de l’intervention impériale. L’animalité du noir justifie la brutalité du travail forcé17. Ainsi lit-on, dans une publication officielle de 1912 du Ministère des Colonies, que l’indigène, « prédisposé à l’ébriété depuis des générations », « est réfractaire au travail manuel, auquel il soumet sa femme ; il est cruel et sanguinaire, car il a ainsi été éduqué dans le milieu dans lequel il vit ; l’amour de sa famille et des siens n’est pas ancré en lui » (cité par Barradas, 1992, p. 124). Mais la diabolisation du colonisé atteint son paroxysme quand il est question de la femme. En effet, celle-ci est tenue pour responsable du métissage, et désormais stigmatisée en tant que principal facteur de dégénérescence de la race, comme l’exprime António Ennes :
L’Afrique a chargé la noire de la venger des Européens, et elle, l’abominable noire — car il n’y a pas une noire qui ne soit abominable —, conquiert pour les réduire à la sensualité des singes, à la jalousie féroce des tigres, aux manières torpides et inhumaines des négriers, aux délires de l’alcoolisme, à tous les abrutissements des races inférieures, et même aux dents des hyènes qui creusent dans les cimetières, les fiers conquérants du Continent Noir. (Ennes, 1946 [1873], p. 192)
Entre l’homme blanc et l’homme noir se dresse une barrière infranchissable qui est également un trait d’union entre eux. Dans ce jeu de miroirs le noir est sauvage, et parce qu’il est sauvage il est porté à croire que « nous » sommes les sauvages. En 1911, un médecin en mission dans la vallée du Zambèze écrit que le caractère « méfiant et égoïste » de l’indigène
ne lui permet pas de comprendre l’intérêt de l’Européen de veiller à sa santé […], alors il échafaude à ce propos les hypothèses les plus invraisemblables. Pour eux, nous sommes les sauvages, ils nous prêtent les pires instincts et font en sorte de protéger, autant que le leur permet leur stupidité paresseuse, leur vie, femmes et biens. […] L’indigène ne comprend pas les motifs d’ordre abstrait ni les raisons altruistes ; ainsi, ne pouvant expliquer autrement la collecte d’échantillons de sang destinés aux examens, il suppose qu’ils sont destinés à être mangés. Le médecin qui procède à cette tâche est regardé par la plupart d’entre eux comme un anthropophage et, curieusement, même les individus qui me servaient de près supposaient que le vin que je consommais était du sang. (Sant’Anna, 1911, p. 22)
Le cannibalisme est un thème récurrent dans les moments de jeux de miroir polarisés entre Prospero et Caliban. Et là encore, le lien même qui sépare abyssalement permet la plus intime réciprocité. Ainsi donc, l’imputation du cannibalisme aux Africains apparaît fréquemment articulée avec la même accusation de cannibalisme, de la part des Africains, à l’encontre des colonisateurs. Ainsi peut-on lire dans un récit recueilli par Henry Junod dans le sud du Mozambique au début du XXe siècle : « — Gungunhana est mort. Les Portugais l’ont mangé ! […] Les Portugais mangent de la chair humaine » (Junod, 1996 [1917], p. 299-300).
Face à la polarisation, la colonisation effective est un droit-devoir. Hegel avait déjà affirmé péremptoirement que l’Afrique, « pays de l’enfance, cachée dans l’ombre de la nuit », « ne fait pas partie du monde historique » (Hegel, 1970, p. 120, p. 129). Pour cette raison, d’après Ruy Ennes Ulrich, la colonisation relève, pour les États civilisés, d’« un devoir d’intervention » : il faut éviter que « la moitié du monde » demeure « dans son état naturel » et « entre les mains des populations sauvages » (1909, p. 698). Il n’est donc guère étonnant que les administrateurs coloniaux sentent que ce devoir ne peut être accompli sans violence. Alberto d’Almeida Teixeira écrit dans son Relatório das operações realizadas com o fim de prolongar a ocupação até ao rio Cuilo, daté de 1907 :
Je suis convaincu que, l’idée d’indépendance étant intuitive parmi les peuples sauvages, comme est innée chez eux la haine envers les peuples supérieurs, les processus de persuasion et de catéchèse sont par principe presque toujours vains et exigent le soutien et la manifestation préalable de la force pour porter leurs fruits. (cité par Barradas, 1992, p. 128)
À partir de la polarisation dichotomique entre l’homme blanc et le noir sauvage, cette mission civilisatrice impose au colonisateur une double dynamique identitaire : l’anthropologie coloniale et l’assimilationnisme. L’anthropologie coloniale vise à connaître les us et coutumes des indigènes de façon à mieux les contrôler politiquement, à les administrer et à en retirer impôts et travail forcé. Les différentes formes de « gouvernement indirect » adoptées en Afrique à la fin du XIXe siècle s’appuient sur l’anthropologie coloniale. L’assimilationnisme est une construction identitaire basée sur un jeu de distance et de proximité entre colonisateur et colonisé au terme duquel ce dernier — par un procédé qui présente certaines similitudes avec ceux qui entrent en jeu dans la naturalisation — abandonne son stade sauvage. Sa subordination cesse d’être inscrite dans un code juridique spécial (comme le Code de l’indigénat, par exemple) et se trouve désormais régulée par les lois générales de l’État colonial. L’assimilé est le prototype de l’identité bloquée, édifiée sur une double désidentification : par rapport aux racines africaines, auxquelles il cesse d’avoir un accès direct, et par rapport au choix de vie européen, auquel il n’a qu’un accès très restreint.
L’assimilationnisme, associé au métissage, est ce qui confère à la société africaine son hétérogénéité particulière. En 1952, Alexandre Lobato s’interroge :
Et qu’observe-t-on dans la population du Mozambique ? Quelques millions de noirs à l’état primitif, quelques milliers de blancs civilisés à l’européenne, quelques milliers de métis mi-européens et mi-indigènes pour la plupart, quelques milliers d’Indiens […] et quelques noirs assimilés, civilisés, européanisés. […] il n’existe pas de peuple mozambicain au sens où l’on parle de peuple portugais […]. Il n’y a pas au Mozambique de pensée collective. (Lobato, 1952, p. 116-117)
Le comble de la conscience de la pensée coloniale est de regretter que les peuples colonisés soient ce en quoi les politiques coloniales les ont transformés.
Le moment de Prospero des Portugais au tournant du XXe a été un moment excessif au regard de ses conditions de réalisation. Fortement influencé par les pressions internationales après le partage de l’Afrique, le colonisateur portugais ne pouvait cependant pas totalement rompre avec la longue durée historique de l’interidentité entre Prospero et Caliban. Il s’est ainsi avéré être un Prospero douteux et sous-développé. Avec une cinglante froideur colonialiste, Norton de Matos, alors gouverneur-général démissionnaire, écrit à propos de l’Angola dans un bilan daté de mars 1915 :
Nous ne savons pas occuper et dominer l’Angola. Nos campagnes se limitent à la constitution de colonnes qui infligent au peuple révolté […] une punition plus ou moins sévère et qui, une fois la mission militaire achevée, après quelques victoires, quelques prisonniers, quelques indigènes morts ou fusillées, se retirent et se dispersent, laissant çà et là une petite garnison modestement armée que les indigènes jugent rapidement inoffensive. L’occupation militaire intense sur une longue période (d’au moins cinq ans) après l’action violente et indispensable du combat, la destruction des cultures et des villages, l’emprisonnement et l’exécution des chefs indigènes, dans le but d’en choisir et d’en placer de nouveaux que nous savons pouvoir transformer en créatures absolument nôtres, [ainsi que] le désarmement général, l’obligation de travaux d’intérêt général rémunérés, la facilitation du recrutement de travailleurs […] pour des travaux du secteur privé et le recrutement militaire, le développement agricole et commercial de la région occupée, la collecte d’impôts de cubata18 et la transformation nécessaire du régime d’administration militaire ou de capitainerie en régime de circonscription civile — constituent un système rationnel d’occupation tout juste initié ces dernières années. (cité par Barradas, 1992, p. 132)
Quelques années auparavant, Oliveira Martins avait manifesté la même inquiétude face au manque de moyens du colonisateur portugais pour coloniser efficacement :
Se retrouver l’arme (sans gâchette) à l’épaule, sur les murs d’une forteresse en ruine, près d’une douane et d’un palais où végètent de piètres employés sous-payés, assister les bras croisés au commerce pratiqué par les étrangers, et que nous ne pouvons pratiquer nous-mêmes, vivre chaque jour dans la crainte des attaques des noirs tout subissant les moqueries et le mépris de ceux qui voyagent en Afrique — cela n’a franchement aucun intérêt. (Martins, 1904 [1880], p. 286)
Cette incapacité de Prospero à s’assumer comme tel est observée non seulement par les administrateurs coloniaux, mais aussi par les étrangers et assimilés. En 1809, dans son « Report to vice-admiral Albermarble Bertie », le capitaine Tomkinson déclare à propos de la condition des Portugais du Mozambique :
Le sol semblait fertile, avec des fruits tropicaux en abondance […], mais les plantations ont davantage l’air d’appartenir à de pauvres natifs non civilisés qu’à des Européens. Bien que la terre soit propice à la culture du sucre, du café et du coton, ils ne s’occupent que des fruits et ne cultivent que le maïs et le riz nécessaires à leur subsistance. […] Chaque plantation possède un nombre incroyable d’esclaves si mal surveillés que leur principale activité est de s’approvisionner en vivres. (cité par Theal, 1964, p. 4-5)
Un autre témoignage, dans une lettre du capitaine Owen (« Letter from captain W. F. W. Owen to J. W. Crocker, 9 October, 1823 »), vient conforter celui-ci. D’après Owen, l’« autorité militaire et arbitraire » des marchands portugais au Mozambique est telle que « les étrangers qui souhaitent commercer avec eux [sont] sujets à toute sorte d’injures grossières et d’affronts ». Et de conclure : « Le fait que la décadence poursuive les Portugais où qu’ils aillent est la conséquence naturelle de leur politique étriquée et mesquine » (cité par Theal, 1964, p. 34). En voyage au Brésil en 1815, les naturalistes allemands Spix et Martius distinguent les Européens des Portugais, ces derniers étant plus enclins à la « dégénérescence morale » qui guette le colon sous les tropiques. De plus, outre le « manque de persévérance et de disposition au travail », ils révèlent un « manque d’éducation et de respect dans le traitement des esclaves qu’ils ont chez eux, n’étant pas habitués à en avoir en Europe » (cité par Lisboa, 1995, p. 182-183).
Tout aussi caustique est l’appréciation du colonisateur par les assimilés en période de Prospero. João Albasini écrit en 1913 à propos du blanc des banlieues :
Dans un taudis sombre et malodorant, un comptoir encrassé, […] des bancs sombres, des mouches qui volent et… des détritus, beaucoup de détritus. Derrière le comptoir, un être hirsute et barbare se meut avec une certaine difficulté, jetant ici et là un regard distrait sur la sordidité des choses qui lui assurent la félicité et le pain. Il est le mulungu [le blanc] ; il est l’âme douce de la colonisation. (Albasini, 1913)
Comme une malédiction, le Caliban portugais poursuit le Prospero portugais, il le suit à la trace, carnavalisant sa posture comme une piètre imitation de ce qu’il voudrait être.
Le second moment de Prospero advient dans le contexte de la Révolution du 25 avril 1974, avec la fin de la guerre coloniale, la reconnaissance des mouvements de libération et l’indépendance des colonies, et il se prolonge dans l’établissement de relations de coopération avec les nouveaux pays de langue officielle portugaise et dans la création, en 1996, de la Communauté des Pays de Langue Portugaise (CPLP). Il s’agit du moment du Prospero anticolonial ou décolonisateur, comparable à celui qu’avaient vécu les autres puissances coloniales près de trois décennies plus tôt. La fin du colonialisme européen a été un moment de Prospero dans la mesure où les puissances coloniales, face aux coûts politiques excessifs du maintien de leurs colonies, ont cherché dans la reconnaissance de l’indépendance de ces dernières une nouvelle façon, plus efficace, de reproduire une domination sur elles, connue sous le nom de « néocolonialisme ». Le Caliban colonisé s’est transformé en pays sous-développé ou en voie de développement. Avec cela, le régime identitaire s’est considérablement transformé, mais l’économie politique sous-jacente ne s’est jamais altérée avec la même intensité. Au contraire, le lien économicopolitique avec les anciennes puissances coloniales a continué d’être décisif pour les pays désormais indépendants. Paradoxalement, Caliban a cessé d’exister pour que Prospero survive.
Une fois encore, le moment de Prospero portugais se distingue significativement du moment de Prospero européen équivalent. Avant tout, les processus historiques d’indépendance du Brésil et des colonies africaines ont été concomitants de profondes transformations à caractère progressiste dans la société portugaise : la Révolution Libérale, dans le premier cas, et le 25 Avril, dans le second. Dans chacun de ces processus était donc en jeu un sentiment partagé de libération pour le colonisateur et pour le colonisé, ce qui a créé une certaine complicité entre la nouvelle classe politique portugaise et la classe politique des nouveaux pays, notamment dans le cas des indépendances africaines. La conséquence la plus décisive de ces ruptures simultanées a été que, associées à la position semi-périphérique du Portugal dans le système mondial, elles ont permis de minimiser les séquelles néocolonialistes dans la période postindépendance. Dans le cas du Brésil, l’incapacité néocolonialiste du Prospero portugais se manifeste dans la panique de ce dernier face aux conséquences de la perte de sa colonie. D’ailleurs, le Brésil a joué le rôle de « colonie colonisatrice » (Ferro, 1996, p. 179) en envoyant les plus grands contingents d’émigrés blancs vers l’Angola — qui, du reste, se trouvait depuis longtemps sous la dépendance économique des Brésiliens19.
Si la faiblesse et l’incompétence du Prospero colonial portugais ont empêché le néocolonialisme, ils ont également permis, surtout au Brésil, la reproduction de relations de type colonial après la fin du colonialisme — le colonialisme interne. Ce faisant, ils ont suscité parmi les élites qui ont continué d’exercer leur domination en leur propre nom une divergence à propos de leurs responsabilités historiques et celles du colonisateur entretemps sorti de scène. Il s’agissait de décider, au fond, si l’incompétence des élites à développer le pays dérivait ou pas de l’incompétence du Prospero dont ils s’étaient libérés. L’incompétence de Prospero serait-elle un lourd héritage, un obstacle incontournable face aux possibilités de développement post-colonial, ou constituerait-elle, au contraire, une opportunité insoupçonnable de formes de développement alternatives ?
C’est ainsi que doit être lue la polémique entre ibéristes et américanistes brésiliens. Pour les ibéristes, le retard du pays pourrait être converti en avantage, en une possibilité de développement non-individualiste et non-utilitariste, basé sur une éthique communautaire dont peut témoigner le monde rural. D’après Oliveira Vianna, dans l’analyse de Luiz Werneck Vianna, la singularité brésilienne était moins un produit de l’histoire de la métropole que de la spécificité des relations sociales qui prévalaient dans le monde agraire, où une classe aristocratique rurale détenait un pouvoir de cohésion particulier (Vianna, 1997, p. 162). Tavares Bastos voyait déjà dans l’héritage de la culture politique ibérique et dans son atavique anti-individualisme le fondement de l’obscurantisme, de l’autoritarisme et du bureaucratisme de l’État brésilien, ce qui rend nécessaire la rupture avec cette culture politique et la création d’un nouveau modèle social, ayant pour référence la société nord-américaine, l’industrie et l’éducation. L’incompétence du Prospero ibérique est explicitée par Tavares Bastos lorsqu’il affirme que, non pourvu de la force des pays du nord, le Portugal a permis à « la dépravation générale et [à] la rudesse barbare des habitudes brésiliennes [de finir par] s’épanouir dans l’imposition culturelle portugaise » (Vianna, 1997, p. 157). En d’autres termes, ce sont les insuffisances de Prospero qui ont rendu possibles les excès de Caliban.
Dans le cas de l’Afrique, le jugement historique du Prospero portugais demande encore à être fait, de même qu’il n’est pas encore possible d’évaluer la force et la persistance des séquelles néocolonialistes, surtout depuis l’adhésion du Portugal à l’Union Européenne. Les vicissitudes traversées par la CPLP illustrent les faiblesses du Prospero colonial portugais. De fait, celui-ci ne parvient pas à imposer son hégémonie, contrairement aux Prospero anglais et français dans leurs respectifs commonwealths : non seulement il subit la concurrence de son ex-colonie, le Brasil, mais en plus il n’a pu empêcher certains pays d’intégrer des communautés « rivales », anglaise dans le cas du Mozambique, et française dans celui de la Guinée-Bissau. Étant donné que l’hégémonie dans les communautés de ce type signifie la légitimation du néocolonialisme, la faiblesse du Prospero portugais ouvre d’énormes potentialités en vue de relations démocratiques et vraiment postcoloniales. La question reste ouverte, cependant, quant à savoir si l’ex-colonisateur est capable de transformer cette faiblesse en force et si les ex-colonisés sont susceptibles d’y voir un quelconque intérêt.
Interidentités : pour un postcolonialisme situé
Si Prospero s’est un jour déguisé en Caliban, ce fut avec le masque des Portugais. Semi-colonisateurs et semi-colonisés, incapables de produire des règles à la hauteur de leur situation complexe, les Portugais n’ont pas pu gérer efficacement leurs colonies et, pour cette raison, ils n’ont pas pu préparer convenablement l’émancipation de celles-ci. La guerre coloniale en Afrique est la meilleure démonstration de cette double incapacité. Par conséquent, jamais il n’y a eu de colonies et d’ex-colonies aussi autonomes relativement au colonisateur et ex-colonisateur : aucun autre pouvoir colonial n’a transféré la capitale de son empire vers l’une de ses colonies, et dans aucun autre pays colonisateur l’essor d’une colonie n’a causé autant d’inquiétude. La colonisation portugaise apparaît ainsi comme un processus chaotique qui, à force de se reproduire au fil des siècles, s’est transformé en une sorte d’ordre. Ce fut un colonialisme qui, par incompétence ou incapacité, a permis l’émergence d’îlots de relations non impériales à l’intérieur de l’empire.
L’absence de norme et cette oscillation entre un Prospero aux pieds de Caliban et un Caliban nostalgique de Prospero se sont sédimentés dans l’une des caractéristiques de l’identité des Portugais, probablement la plus intrinsèquement semi-périphérique : ce que les journalistes sportifs, lorsqu’ils commentent le comportement irrégulier de la sélection nationale de football, nomment « oito-oitentismo »20. Le « oito-oitentismo » étant la norme, il est également l’absence de norme. Ce comportement suggère une façon d’être qui se meut dans une constante turbulence d’échelles et de perspectives où les extrêmes se banalisent, qu’ils soient exaltants ou dégradants, où rien ne se radicalise mis à part l’option radicale de ne jamais choisir radicalement. Cela crée un effet de présentification dévoratrice à travers lequel les palimpsestes de ce que nous sommes acquièrent une contemporanéité déconcertante : tout est contemporain de tout.
Les attitudes et comportements liés à cette configuration identitaire prédisposent à des modes de représentation et d’action qui se passent de preuve, c’est-à-dire des formes caractérisées par leur pure émergence, par leur nature apparitionnelle, sans autre justification que leur évidence post-factum. Ce que l’on en dit pour les justifier lorsqu’elles apparaissent peut être repris sans contradiction pour justifier leur non-apparition. Dans la construction identitaire des Portugais, cinq de ces modes de représentation négligeant la preuve sont particulièrement notables : l’urgence, la suggestion, la surprise, l’improvisation et la violence non organisée. Chacun d’eux suggère une validation qui ne peut convaincre que comme biographie et expressivité. Cette modalité épistémologique permet de critiquer la rationalité moderne et, en même temps, de critiquer les rationalistes modernes de ne pas l’être assez. La dispense de preuve, l’urgence et la contingence sont devenues assez courantes à partir du moment où, dès le XVIIe siècle, l’histoire de l’expansion européenne a cessé d’être écrite par les Portugais. Poussés à vivre les binarismes des colonialismes hégémoniques — sujet/objet, civilisé/sauvage, humain/animal —, ils les ont vécus à distance, sous des échelles impures et des « perspectives curieuses », dans le sens de la peinture post-renaissance (Santos, 2000, p. 251). Ainsi, les binarismes ont été carnavalisés sous forme de zones abstraites où tout est proportionnel à sa potentielle disproportion.
En l’absence de critères purs et péremptoires et de raisons exterminatrices, le colonisateur portugais n’a pas pu présenter un large éventail d’identités impériales. Ni identité émancipatrice ni identité émancipée, il a oscillé entre Prospero et Caliban comme s’il cherchait la troisième rive du fleuve dont parle Guimarães Rosa. Dans ces conditions il n’a pas été possible de consolider des essentialismes, lesquels, chaque fois qu’ils sont nommés, ne le sont que pour être contestés, révélant ainsi leur intrinsèque contingence. Les colonies ont tantôt été des colonies, tantôt des provinces d’outre-mer ; le métissage a été perçu tantôt comme dégradation de la race, tantôt comme sa plus exaltante caractéristique ; et les peuples natifs ont été tantôt des sauvages, tantôt des citoyens nationaux.
L’instabilité, l’imperfection et l’incomplétude du Prospero portugais ont rendu son auto-identification problématique, une condition qui a entraîné celle de Caliban lui-même : un Prospero peu rayonnant a appelé un Caliban terne. En l’absence de critères purs, point de grandeur, mais point non plus de petitesse quand ces critères, au lieu d’être perdus, n’ont jamais existé. Quand les ennemis ne se laissent pas saisir, ils ne sont ni petits ni grands, ce qui déséquilibre les rapports de force. Un Prospero si imprécis qu’il en vient parfois à se confondre avec Caliban ne pouvait que troubler ce dernier, brouiller son identité et bloquer sa volonté émancipatrice. Le difficile calibrage de la dimension de Prospero et de sa véritable identité a fait courir à Caliban le risque d’être colonialiste dans son ardeur anticoloniale, tout en lui permettant, comme à aucun autre, d’être pré-post-colonial dans la constance formelle du colonialisme. Le colonialisme informel d’un Prospero incompétent a permis que pendant longtemps des secteurs significatifs parmi les peuples colonisés n’aient pas à vivre quotidiennement l’expérience de Caliban et que certains d’entre eux — et pas seulement en Inde — puissent eux-mêmes se voir comme de véritables Prospero et agir comme tels dans leurs domaines. Bien souvent, ils ont pu négocier avec le Prospero venu d’Europe, quasiment sur un pied d’égalité, l’administration des territoires et les règles auxquelles elle était assujettie.
À la lumière de ce qui vient d’être présenté, il est notoirement difficile de penser le postcolonialisme dans l’espace de langue officielle portugaise. D’après moi, cependant, il doit se centrer sur les faiblesses du Prospero portugais. Deux orientations me semblent décisives. La première est liée au colonialisme interne et elle est particulièrement pertinente dans le cas brésilien. La faiblesse interne du colonialisme portugais a rendu possible l’indépendance conservatrice du Brésil. Il a été permis aux élites oligarchiques de s’approprier les structures de domination coloniale alors même qu’elles chantaient les louanges de l’acte inaugural de la construction de l’État national. Le colonialisme interne est la grande continuité de cet espace, et c’est contre lui qu’il faut diriger, dans une première orientation, le postcolonialisme en langue portugaise. Dans quelle mesure le colonialisme interne existe ou est en train d’émerger dans les ex-colonies d’Afrique, en particulier l’Angola et le Mozambique ? Cela reste une question en suspens.
La deuxième orientation est liée à la globalisation contre-hégémonique. Celle-ci est en rapport avec la faiblesse externe de Prospero, avec le fait que le colonialisme portugais soit resté l’otage, très tôt, du colonialisme hégémonique, en particulier anglais, et des formes d’impérialisme dans lesquelles il se traduit jusqu’à sa dernière incarnation, de nos jours, sous la forme de la globalisation néolibérale, où dominent les États-Unis d’Amérique. D’ailleurs, ce sont ces formes impériales qui permettent aujourd’hui la consolidation du colonialisme interne dans les pays issus du colonialisme portugais. La deuxième orientation est donc que le postcolonialisme doit être dirigé contre la globalisation hégémonique et les nouvelles constellations de domination locale/globale, interne/externe qu’elle permet. Au nom du postcolonialisme, il fait aujourd’hui aussi peu de sens d’agiter le drapeau antiespagnol en Colombie que d’agiter le drapeau anti-portugais au Brésil, au Mozambique ou en Angola.
À la lumière de ces deux orientations, le postcolonialisme dans l’espace portugais aura moins de « post » que d’anticolonialisme. Il s’agit d’un postcolonialisme déterritorialisé, car dirigé contre une entreprise d’injustice sociale, de domination et d’oppression exempte des binarismes modernes sur lesquels s’est fondé jusqu’à présent le postcolonialisme — local/global, interne/externe, national/transnational. De fait, le nouveau postcolonialisme n’a de sens qu’en tant que lutte pour une globalisation contre-hégémonique, comme recherche de nouvelles alliances locales/globales entre des groupes sociaux opprimés par différents colonialismes.
Il faut néanmoins garder à l’esprit que le Prospero portugais, aussi douteux, incompétent, incomplet et calibanesque soit-il, tout en fondant cette attitude postcoloniale avancée, rend sa réalisation difficile, dans la mesure où il tend à dissimuler ou à acclimater (ce qui revient au même) les rapports de force. Comme il est un Prospero incomplet, le monde qu’il a créé est le même que le monde qui l’a créé lui. Le pouvoir de création se trouve ainsi réparti entre un Prospero calibanisé et un Caliban prospérisé. C’est là que réside l’arrogance et la légitimité des élites post-indépendantistes.
L’analyse de certaines manifestations brésiliennes des commémorations des 500 ans des Découvertes révèle l’insistance sur la pluralité des peuples qui ont conflué vers le pays, au-delà des Indiens, qui s’y trouvaient déjà, et des noirs, qui y ont été conduits de force : Italiens, Allemands, Espagnols, Chinois, Japonais, Portugais etc. Placé parmi les autres immigrés, le Prospero obstiné se dissout dans la foule. Cependant, cette association cache que, du moins jusqu’à l’indépendance, les Portugais n’étaient pas un groupe d’immigrants parmi d’autres et que le pouvoir colonial dont ils étaient les protagonistes, aussi spécifique fût-il, n’en était pas moins colonial. En évacuant Prospero, cette représentation de la « nation arc-en-ciel » évacue les relations de pouvoir colonial et transforme les Découvertes en acte pluriel, non-impérial, dans un exercice de fraternité et de démocratie interculturelle et interethnique. Cette dissimulation peut favoriser l’indolence de la volonté anticoloniale et la neutralisation des énergies émancipatrices. On peut donc supposer que les élites ne sont pas naïves quand elles promeuvent de telles représentations.
Tantôt trop familier pour se faire remarquer, tantôt trop télescopique pour être regardé à l’œil nu, ce Prospero furtif invite à la complaisance vis-à-vis du pouvoir des élites, un pouvoir qui s’insinue, miniaturisé, à la faveur de l’impuissance de Prospero. La difficulté à développer des stratégies postcoloniales dans l’espace du colonialisme portugais sont, ainsi, l’autre versant des vastes possibilités de globalisation contre-hégémonique créées par ce type de colonialisme.