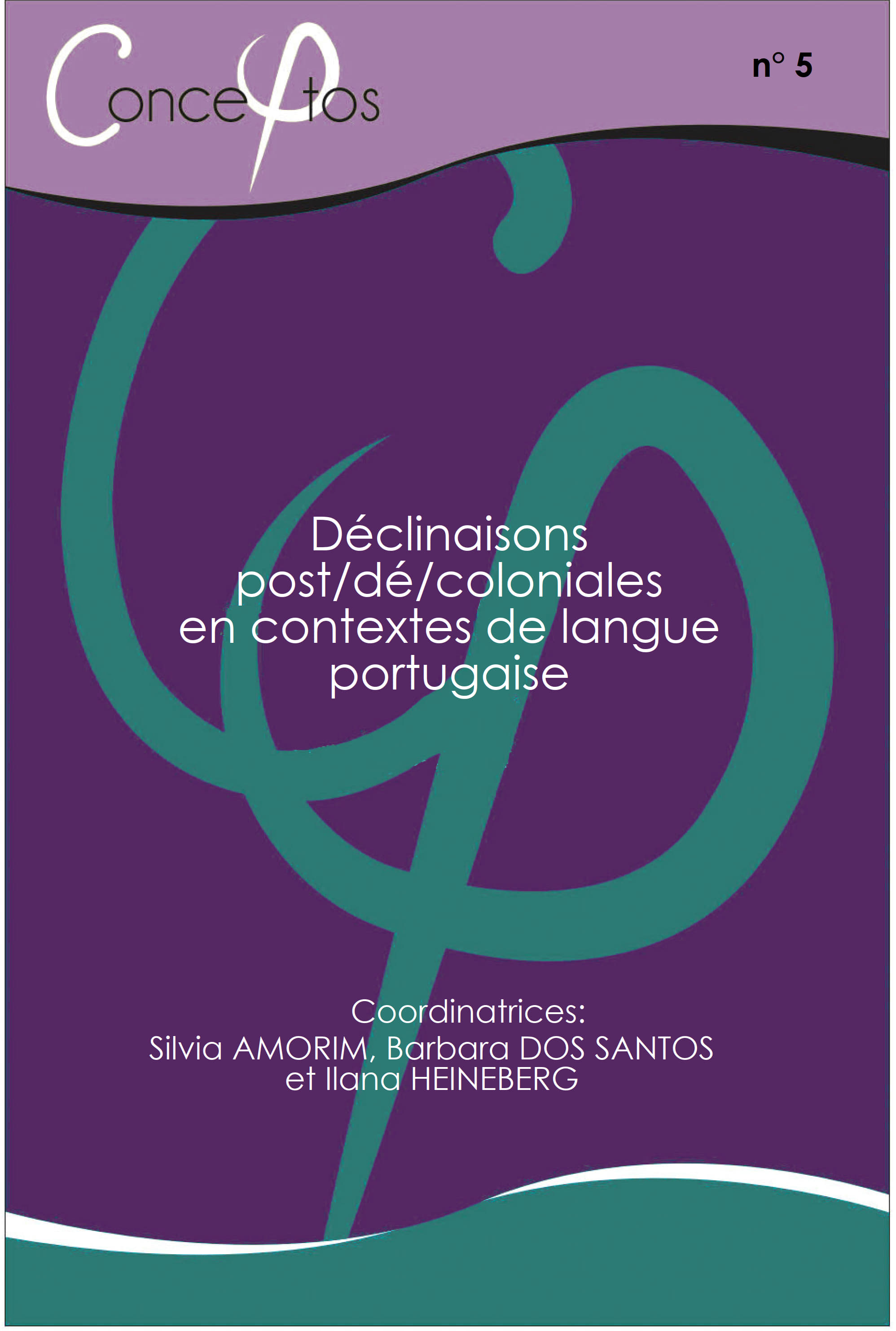Détours existentiels et impasses postcoloniales dans Half A Life de V.S. Naipaul
Plus que tout autre, la prise en main de son destin, par une société jadis colonisée, ou par un simple individu venant de ce genre de société, a constitué le thème majeur des écrits de l’auteur trinidadien V.S. Naipaul qui s’est évertué tout au long de sa carrière à se demander si une telle émancipation était possible. Né en 1932 dans une famille descendant d’engagés indiens, le futur Prix Nobel de littérature commence à publier ses premières œuvres de fiction en 1957, soit quelques années après la parution des écrits de Frantz Fanon, et juste avant celle du roman Things Fall Apart du Nigérian Chinua Achebe. À l’instar de ces auteurs, Naipaul devient l’une des influences capitales des théories postcoloniales qui émergeront dans les universités anglo-saxonnes dans les années 1980 (Nixon, 1992, p. 4). Alors que les critiques avaient catalogué ses œuvres, ainsi que celles d’autres auteurs de cette période qui suivait les indépendances, comme faisant partie de littératures régionales, ils n’avaient pas vraiment compris que cette nouvelle génération d’écrivains interrogeait en réalité la relation entre leur société et les empires qui les avaient jadis dominés. Naipaul allait quant à lui explorer ces problématiques pendant toute sa carrière littéraire, à travers des ouvrages de fiction certes, mais aussi par le biais de récits issus de ses enquêtes de terrain dans plusieurs de ces sociétés postcoloniales.
Traduit en français sous le titre La moitié d’une vie, Half A Life, publié en 2001, est le pénultième roman écrit par Naipaul. Il vient couronner une vie de recherches et de réflexions sur l’échec des expériences postcoloniales dans les anciens empires coloniaux britannique, français, espagnol, belge et néerlandais. Ce roman, dont l’action se déroule sur trois continents, porte, à travers un de ses narrateurs, un regard inédit sur une colonie portugaise fictive située sur la côte orientale du continent africain, dans la mesure où ce narrateur vient d’un autre pays et qu’il est lui-même un sujet postcolonial.
Un observateur postcolonial
Avec Half A Life, Naipaul situe pour la troisième fois une de ses œuvres fictionnelles sur le continent africain. Ce roman vient en effet après In A Free State, publié en 1971, et dans lequel deux fonctionnaires britanniques sillonnent un pays des Grands Lacs qui vient d’accéder à l’indépendance. L’ouvrage qui retient notre attention succède aussi à A Bend in the River, qui est paru en 1979, et qui raconte la vie d’un jeune homme d’origine indienne souhaitant rester dans une ancienne colonie belge alors que sa famille et sa communauté ont été chassés par les nouveaux hommes forts de l’Afrique postcoloniale.
Cette passion pour le continent africain, de l’ordre de la fascination, Naipaul la doit à ses voyages, mais aussi à la lecture de Conrad et de sa novella intitulée Heart of Darkness, ouvrage qui n’a cessé d’interpeller les théoriciens des études postcoloniales. Chacun des romans africains de Naipaul peut être vu comme une réécriture du texte conradien, à la fois hommage implicite au texte de l’auteur d’origine polonaise, mais aussi volonté de s’affranchir de ce regard qui demeure malgré tout européen pour livrer une version postcoloniale de ce continent qui tente de se reconstruire au lendemain des indépendances.
Sur le plan individuel, il est moins question de reconstruction que d’exploration et de quête identitaire. À cet égard, les personnages de Half A Life sont les héritiers de l’histoire coloniale et des choix effectués par leurs ancêtres. Le protagoniste principal, Willie Chandran, naît en Inde dans une famille de brahmanes. Mais lui-même n’appartient plus à cette haute caste, puisque, dans son désir de se conformer aux idéaux de Gandhi, son père s’est marié à une fille de caste inférieure. Willie est par conséquent frappé du sceau de la déchéance, de la « souillure », dès sa naissance, et il est définitivement exclu de la caste de ses ancêtres brahmanes. Il n’a ainsi plus droit aux privilèges de cette caste et doit effectuer sa scolarité dans une école pour les enfants de caste inférieure, tenue par des missionnaires européens. Étranger par la force des choses à son ascendance, il se met à admirer ces hommes de foi qui gèrent l’école et qui l’instruisent. Comme eux, il rêve de devenir enseignant et de voyager à travers le monde ; vœux qui se réalise, puisque Willie décroche une bourse qui l’aide à partir en Angleterre et à y poursuivre ses études supérieures.
Le roman suit un fil chronologique qui s’étire sur trois générations et qui voit son protagoniste quitter l’Inde de ses ancêtres avec la volonté de s’affranchir de son père, qu’il considère comme un être vaincu. La ville de Londres est le lieu où il s’émancipe consciemment de la figure paternelle et où il tourne le dos à ses ancêtres et à l’héritage culturel que ces derniers lui ont légué. D’abord déçu par la capitale anglaise, il finit par s’accommoder avec sa nouvelle vie, grâce aux personnes qu’il rencontre et qui sont toutes affairées à réaliser leurs petites ambitions, à l’image d’une comédie humaine balzacienne. De fil en aiguille, Willie est aussi embarqué dans ce tourbillon, et ce sont ses amis qui le poussent tantôt dans la réalisation de reportages radiophoniques pour la BBC, puis dans l’écriture d’un recueil de nouvelles. Cependant, après quelques succès dérisoires, il est confronté à un pays en proie aux émeutes raciales, et comprend, à l’instar d’un ami jamaïcain, qu’il est temps de chercher une autre terre d’asile. Et c’est ainsi qu’il propose à une jeune femme qu’il vient de rencontrer, et avec laquelle il vit une histoire d’amour passionnée, de partir avec elle dans son pays d’origine, une colonie portugaise d’Afrique de l’Est.
Si le protagoniste donne l’impression difficilement contestable de se plier aux circonstances, il n’en demeure pas moins que d’un point de vue narratif, le roman se fonde sur une poursuite, sur une quête de soi et une quête de sens. En effet, même s’il occupe une place centrale au cœur du récit, en tant que protagoniste, Willie Chandran est exclu de la narration au cours des deux premiers chapitres. Le narrateur homodiégétique du premier chapitre est le père de Willie. Ce père n’est jamais nommé, et il demeure un personnage caractérisé par l’effacement. Le deuxième chapitre relate quant à lui les efforts de Willie pour comprendre la société londonienne et y trouver sa place. Mais de manière inhabituelle dans l’écriture naipaulienne, nous avons affaire à un narrateur hétérodiégétique, ce qui fait que la période où Willie se débat le plus pour la constitution de son identité est vue de l’extérieur. Le seul moment où ce personnage prend en charge le récit concerne sa vie dans la colonie portugaise d’Afrique orientale. Ce choix narratif correspond au genre romanesque adopté ici, à savoir celui du Bildungsroman, du roman d’apprentissage. L’identité de Willie est en pleine construction pendant son enfance indienne et durant son premier exil en Angleterre. De ce fait, il n’est apte à se percevoir comme sujet, et à percevoir le monde qui l’entoure, qu’à partir du moment où il acquiert une certaine maturité. Outre les différentes expériences vécues à Londres, c’est surtout sa rencontre avec Ana, la jeune métisse Afro-portugaise, qui lui confère cette capacité, cette autorité, à devenir le narrateur de sa propre histoire. Par ailleurs, le fait qu’il prenne la parole sur la partie de sa vie qu’il passe dans la colonie portugaise donne un relief particulier à la peinture de ce milieu colonial et montre combien celui-ci l’a affecté.
Un sujet en perte de repères
Ce chapitre de sa vie, Willie le raconte une fois que tout est terminé, de manière rétroactive, comme pour établir une sorte de bilan : un bilan de son passage dans la colonie, mais aussi un bilan de cette société. Dans sa définition initiale, le narrateur postcolonial a pour fonction de réhabiliter l’histoire et la culture de son pays et de redonner une forme de dignité à son peuple. Dans Half A Life, Naipaul introduit un narrateur provenant d’un espace tiers, puisqu’il n’appartient pas au pays dans lequel se déroule son récit, pas davantage qu’il ne fait partie de la communauté au pouvoir. Toutefois, le récit de Willie Chandran met en œuvre des caractéristiques de cette narration postcoloniale, notamment le regard critique à l’égard des pratiques politiques du colonisateur. Le protagoniste vient lui-même d’un pays qui a lutté pour obtenir son indépendance, mais il était trop jeune pour y participer et pour en être même conscient. Le pays de son épouse Ana est encore une colonie portugaise au moment où le couple va s’y installer. Il existe par conséquent un décalage chronologique dans le processus de décolonisation, entre l’empire britannique et l’empire portugais, si l’on se fie au roman. On note même en outre un décalage idéologique, puisqu’au moment où ils arrivent dans ce pays personne n’imagine que le cours de l’Histoire est susceptible de changer.
Dans le roman de Naipaul, aucune date n’est précisément donnée, et le nom du pays d’Ana ne sera jamais indiqué. Cependant, des indices permettent de situer le récit dans une temporalité et une géographie approximatives. Ce sont les émeutes raciales de Notting Hill de 1958 qui sonnent l’alarme pour Willie alors qu’il a pris pied à Londres. Elles lui font comprendre la précarité de sa vie, à un moment où sa bourse d’étude arrive à son terme. Dans une préface rédigée quelque quatorze années après la parution du roman, Naipaul confirmera cette date. Par ailleurs, le pays africain dont il est question est situé sur la côte orientale du continent et au Sud de Dar es-Salaam (Naipaul, 2014, p. 160). Les critiques n’ont pas eu de mal à identifier le Mozambique, d’autant que le roman fait plusieurs allusions à des personnages qui se rendent en Afrique du Sud, pays frontalier du Mozambique.
Comme souvent, Naipaul s’inspire de ses propres voyages pour nourrir son œuvre fictionnelle. Ce recours à la réalité socio-politique d’un pays confère un caractère « semi-ethnographique » au roman, semblable à ce qui transparaît dans ses reportages (Nixon, 1992, p. 15). En tant que sujet externe, étranger, le narrateur apparaît alors comme un observateur attentif de la société qu’il découvre. Ses premières impressions à son arrivée lui font penser que le pays est figé dans une situation immuable. Willie reste longtemps obsédé par l’image des autochtones marchant le long des routes, donnant le sentiment d’une forme de mouvement perpétuel, même si ce dernier ne semble mener nulle part. Toutefois, si dans ses œuvres précédentes, Naipaul a décrit l’Afrique comme le continent de « l’échec » (Rahman, 2018, p. 277), il en propose une vision moins décadente dans Half A Life. Willie est en effet impressionné par les premières images du pays. « Vaste et splendide, bien supérieure à tout ce qu’il avait imaginé, la ville ne correspondait pas à son idée de l’Afrique » (Naipaul, 2014, p. 160). Il existe dans l’œuvre de Naipaul une dichotomie entre le pays rêvé et le pays réel, surtout lorsqu’il s’agit d’un déplacement entre une colonie, ou une ex-colonie, et la métropole. Le premier exil de Willie, celui qui le mène à Londres, centre de l’ancien empire colonial, le laisse en effet insatisfait. « Il savait que Londres était une grande ville. Dans son esprit, une grande ville était une féerie de splendeur et d’éblouissement, si bien qu’à son arrivée à Londres, lorsqu’il se mit à se promener dans les rues, il fut déçu » (Naipaul, 2014, p. 73). À l’inverse, alors que ses attentes sont modestes en allant en Afrique portugaise, Willie est stupéfait par la ville qu’il découvre à son arrivée. On retrouve même d’ailleurs l’idée de « splendeur », reprise par le narrateur, en contrepoint à ce qui est absent lors de l’arrivée à Londres.
Cette surprise démontre la méconnaissance de Willie quant à la réalité du pays dans lequel il souhaite s’installer. Elle traduit aussi son manque de préparation, car, rappelons-le, le choix de partir dans le pays d’Ana est pratiquement improvisé, et il survient en réponse à un sentiment de panique. Quand il propose à Ana de quitter Londres et de partir rejoindre son pays « pour de bon » (Naipaul, 2014, p. 157), celle-ci hésite avant de finir par céder. « Mais il te faudra apprendre la langue », lui lance-t-elle de manière pragmatique (Naipaul, 2014, p. 158), aspect auquel il n’avait pas pensé, et qui devient une obsession pendant le voyage en bateau.
Il songeait à la nouvelle langue qu’il aurait à apprendre. Il se demandait s’il parviendrait à conserver la pratique de la sienne […]. Willie tentait de surmonter la révélation qu’il ne lui restait pas grand-chose de sa langue maternelle, que son anglais allait le lâcher, qu’il ne maîtriserait plus vraiment aucune langue, aucun moyen d’expression. (Naipaul, 2014, p. 159)
Ce départ non prévu constitue un changement radical et requiert un effort d’adaptation d’une toute autre dimension que celle qui avait présidé à son premier exil, à tel point que cela génère une angoisse profonde. Dans le premier cas, il maîtrisait la langue de son pays d’accueil, la langue des anciens colons, qu’il avait apprise par l’entremise des missionnaires. Cela allait être différent cette fois-ci : il devait partir de rien. Mahender Singh affirme que « Willie reste un étranger dans ce pays, exactement comme il l’était en Inde et à Londres ; en effet, il souffre à présent d’un plus grand sentiment d’aliénation […]. En Afrique, Willie n’éprouve aucun sentiment d’appartenance. Il a l’impression d’être “nulle part” » (Singh, 2006, p. 23, ma traduction). Cette difficulté à trouver sa place dans ce nouveau pays affecte son identité même. « [Q]uelque chose n’allait pas. […] Willie percevait au fond de lui la présence d’un soi différent, tapi dans un recoin silencieux, coupé de sa vie extérieure » (Naipaul, 2014, p. 160). Une faille s’ouvre alors en lui, créant un hiatus identitaire.
Un empire anachronique
L’arrivée en Afrique et la découverte de la splendeur de la capitale le tourmentent davantage. « [Le] caractère imposant [de la ville] le tracassa. Il ne pensait pas être capable de l’affronter » (Naipaul, 2014, p. 160). Sitôt arrivé, il songe déjà à partir tant il est tenaillé par un « doute profond » depuis son départ de l’Angleterre (Naipaul, 2014, p. 160, 167). « Je me sentais très loin de tout ce que j’avais connu, un étranger dans cette demeure de béton blanc […] » (Naipaul, 2014, p. 168). La sécurité qu’il avait recherchée devient précisément la cause de son inquiétude, car elle repose sur une histoire qui n’est pas la sienne. La maison dans laquelle Willie peine à trouver le sommeil la première nuit a été construite par le grand-père d’Ana sur les « terres immenses que lui avait allouées » le gouvernement portugais soucieux d’attirer des citoyens pour faire contrepoids à l’importante population britannique et allemande déjà sur place, dans une logique de course à la colonisation du continent (Naipaul, 2014, p. 177). Willie se sent exclu de ce monde lorsqu’il le découvre, mais en même temps cette histoire a été bâtie sur des fondations dans lesquelles il ne peut pas se reconnaître, même s’il n’en a pas conscience. Malgré tout, en tant qu’époux d’Ana, le jeune homme est très vite intégré au groupe de propriétaires terriens Afro-portugais qui se fréquentent et qui sont à l’affût de la moindre opportunité. Willie souligne que ces personnes « jouissaient d’une position relativement privilégiée », et que « ce monde colonial ordonné semblait à tous solide comme du roc » (Naipaul, 2014, p. 173).
Cette impression de puissance se manifeste par les liens étroits entretenus par certains de ces propriétaires avec des groupes d’intérêts financiers à l’échelle du pays. Il en est ainsi du couple Correia qui s’enrichit en décrochant coup sur coup plusieurs appels d’offres gérés par celui qui est désigné par l’expression « l’homme important », un « Portugais à part entière », comme il est précisé dans le roman (Naipaul, 2014, p. 199). La puissance coloniale transparaît aussi dans la description qui est faite de la résidence du gouverneur. D’apparence ordinaire vue de l’extérieure, elle abrite néanmoins « une salle imposante » dans laquelle trônent les portraits d’anciens gouverneurs agencés de telle sorte que Willie en est impressionné. « [P]eut-être parce que ce décor mural partait d’une belle assurance et formait un ensemble, l’effet était réussi ; on avait une impression de grandeur » (Naipaul, 2014, p. 231). Mais ce qui suscite une plus grande fascination chez le narrateur est le mobilier en bois sculpté.
Ce n’étaient pas des meubles où s’asseoir ; c’étaient des meubles à contempler, pour voir du bois métamorphosé en dentelle, les meubles du gouverneur, une marque de son pouvoir. Ils passaient pour être aussi anciens que la maison et venaient tous […] de Goa, le territoire portugais en Inde. (Naipaul, 2014, p. 231)
Ces précisions sont à mettre en lien avec la remarque indiquant quelques lignes plus loin que la ville est un lieu isolé, éloigné de tout, pour saisir la vanité de cette démonstration de pouvoir, mettant en réseau des territoires conquis par la même puissance coloniale pour des raisons échappant à toute logique. Toujours est-il que parlant de Goa, le narrateur ajoute : « C’est là qu’avait été réalisé ce travail de sculpture gratuite » (Naipaul, 2014, p. 231), comme pour mieux souligner le décalage entre les heures de travail minutieux fournies par une main d’œuvre qui restera à jamais anonyme et le pouvoir colonial immortalisé par cette galerie de portraits de gouverneurs. Contrastant avec la résidence du gouverneur, la garnison est de dimension moins impressionnante lors de l’arrivée de Willie. « [L]a caserne était assez modeste, rudimentaire et peu menaçante […]. Les conscrits n’avaient pas d’argent » (Naipaul, 2014, p. 176). La modestie des moyens alloués est le signe d’un désintérêt pour la colonie, qui ne représente ni un enjeu pour la puissance coloniale, ni une place à défendre. Mais elle témoigne paradoxalement d’une confiance du pouvoir colonial en la stabilité de la colonie, d’une croyance, sans nul doute naïve, que la situation coloniale allait inévitablement perdurer. Des troubles survenant dans des pays voisins viendront ébranler cette assurance, et la garnison sera progressivement étoffée, accroissant par là même la présence portugaise dans la ville.
Cette présence ne passe pas inaperçue, y compris à l’époque où la caserne était réduite à sa plus simple expression. « [L]es jeunes conscrits portugais […] de notre petite garnison », remarque le narrateur, « donnaient à ces lieux un air bizarrement européen » (Naipaul, 2014, p. 176). S’il souligne le caractère insolite de cette présence portugaise, le narrateur n’en est pas moins sensible à la diversité de la population locale. En réalité, certaines divisions apparaissent d’emblée, et avant même de venir dans ce pays, la seule certitude qu’avait acquise Willie était qu’il y « régnait […] des principes raciaux et sociaux difficiles » (Naipaul, 2014, p. 169). En observant la structure sociale sur le domaine que possède Ana, le protagoniste comprend que la situation est plus complexe que ne laissent penser les apparences.
Seul le béton différenciait les contremaîtres [qui sont des « sang-mêlé »] des Africains tout autour. […] le béton représentait la dignité. Mais ce n’était pas une vraie barrière. En réalité, ces contremaîtres vivaient avec les Africains. Aucune autre possibilité ne s’ouvrait à eux. (Naipaul, 2014, p. 174)
La culture de castes du narrateur le rend sensible à ce genre de distinction, et il voit des frontières là où les identités se confondent presque du fait du métissage. Toutefois, son analyse est juste lorsqu’il comprend que les métis se répartissent en deux catégories, avec d’un côté les grands propriétaires terriens, dont les ancêtres ont été pour la plupart des acteurs du processus colonial, et d’autre part leurs employés. En réalité, la réelle division qui existe se situe entre les Portugais à part entière, comme on les appelle, et les gens qui, comme Ana, ont reçu la dénomination de « moitié-moitié ». Malgré tout, c’est la domination coloniale qui détermine les rapports sociaux. Les métis sont relégués à des positions subalternes, et l’humiliation est souvent leur lot, ainsi qu’en est témoin Willie. Le ressenti et le déni sont tous deux contenus et implicites dans le texte, mais ils mènent inexorablement vers la révolte finale.
Hamish Dalley explique que Naipaul intègre des phénomènes historiques dans sa prose dans le but de construire une vision à la fois réaliste et globalisante de la réalité (Dalley, 2018, s.p.). Ce n’est par conséquent pas un hasard si Willie est un observateur qui cherche à comprendre les mécanismes qui sont à l’œuvre au sein de la société coloniale dans laquelle il se trouve. Il perçoit la complexité des rapports sociaux entre colons et autochtones. Il voit aussi de quelles manières la colonie est maintenue dans des liens de dépendance vis-à-vis de la métropole, et comment ce pays ne constitue in fine qu’une parcelle de l’empire portugais. En cela, même s’il demeure un étranger après dix-huit années dans la colonie, Willie fait preuve de plus de lucidité que la plupart des autres protagonistes, pourtant plus familiers avec ce pays. En outre, son besoin d’analyser et de comprendre fait de lui ce que Balfour nomme un « intellectuel des frontières » (Balfour, 2007, p. 8, ma traduction), mais, plus largement, un véritable sujet postcolonial.
Half A Life peut être considéré comme le roman testamentaire de V.S. Naipaul. Il y condense d’une certaine manière les questionnements qui ont jalonné son parcours d’écrivain, mais c’est précisément le choix de situer une partie de son intrigue dans cette colonie portugaise qui en fait l’originalité. En effet, le monde colonial qu’il décrit a ceci de particulier qu’il est anachronique, puisque nombre d’anciennes colonies de par le monde ont accédé à leur indépendance, une voire deux décennies plus tôt. De même, le renversement postcolonial qui survient dans la conclusion du roman se produit de manière discrète, presque sans effusion. Les militaires cèdent la place aux guérilleros qui jusque-là étaient restés à l’écart du jeu politique, très loin des villes.
Mais cette émancipation semble être de courte durée, puisque les rumeurs laissent entendre une reprise en main sanglante par les anciens colons. Ceci confirme dans une grande mesure le postulat de Naipaul, à savoir la survivance inévitable de la domination coloniale, même après les indépendances. Son roman s’éloigne toutefois du récit conradien et de ce « cœur des ténèbres » coloniales dans la mesure où la violence physique n’est pas au centre du récit ; mais la violence mentale, psychologique, des rapports entre personnes de même milieu, de mêmes origines, est tout autant mortifère et fait dire à Ana qu’elle a finalement vécu une existence qui n’était pas la sienne.