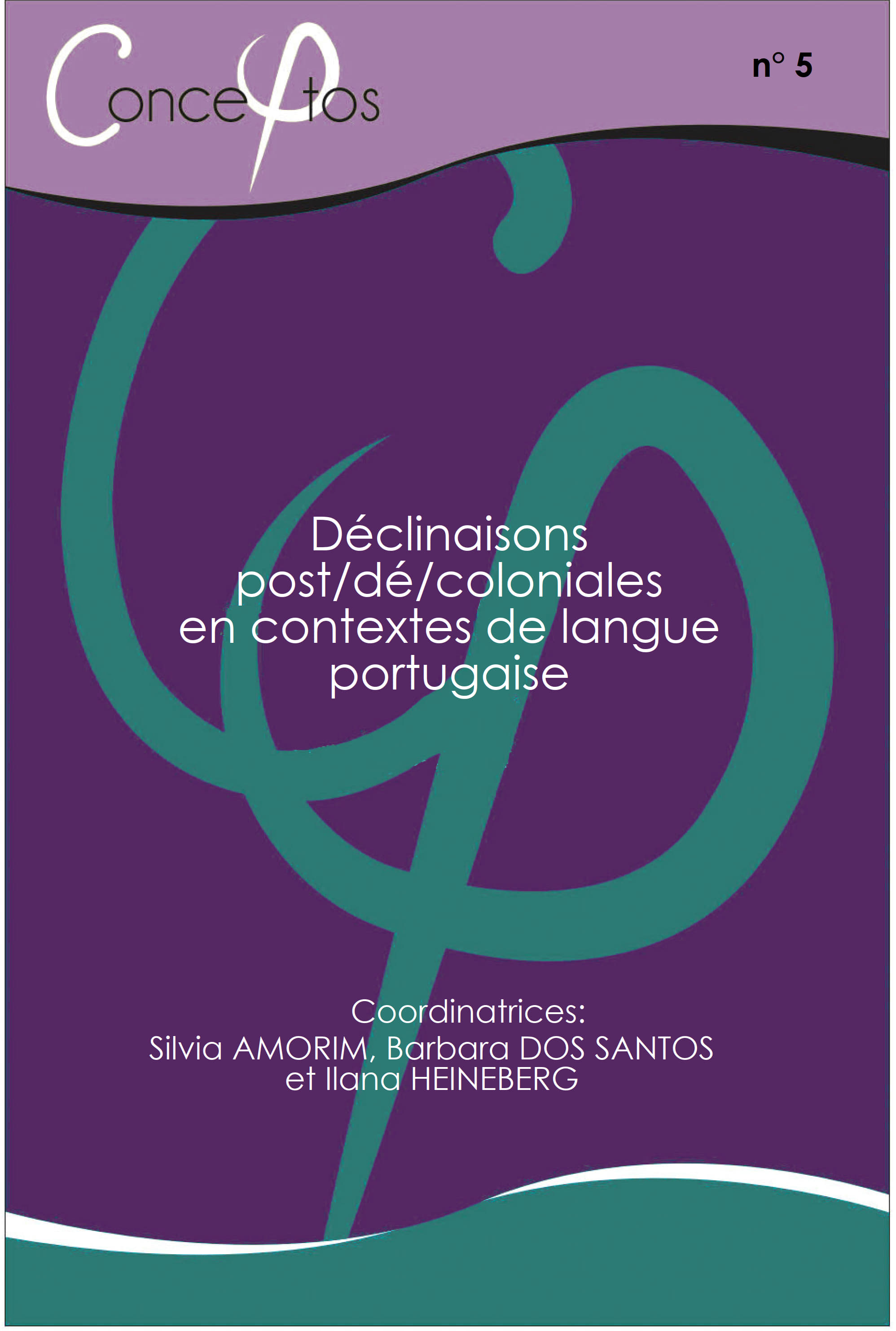Littératures de l’Après : l’extrême contemporain comme représentification d’omissions du passé
[…] écrire à l’orée des années 1980, c’est arriver après la littérature : ce n’est plus uniquement commencer quand tout est fini, mais recommencer depuis la Fin.
Introduction théorique
Johan Faerber est un critique mordant, iconoclaste. Il fustige des théoriciens comme Antoine Compagnon et Tzvetan Todorov, qui, avec d’autres, ont annoncé la mort de la littérature. S’il détrône les annonciateurs de l’apocalypse littéraire, c’est parce qu’il considère que chaque affirmation sur la mort de la littérature correspond en fait à un retour, un recommencement : écrire aujourd’hui consiste à restaurer l’écriture, à remplir un manque fondateur qui a contribué à l’effacement de plusieurs cultures et ethnies. Plutôt que la disparition du texte littéraire, Faerber voit la marque du contemporain dans la capacité de réapparition de la littérature, comme une écriture du sensible et du symbolique. Quels sont les textes littéraires qui ont cette capacité à réapparaître ? Sûrement pas ceux que Dominique Viart qualifie de littératures consentantes, qui ne contestent pas la société et représentent « l’art de l’agrément » – des textes écrits pour le grand public et très souvent destinés à devenir des best-sellers. Les littératures concertantes, qui réaffirment la doxa et instaurent l’harmonie avec les opinions générales ne le sont pas d’avantage. Pour l’auteur, les littératures de l’Après, ou de l’extrême contemporain, équivalent aux littératures déconcertantes, qui déplacent les attentes de la majorité des lecteurs ; elles sont celles qui ne reproduisent plus les vieilles recettes littéraires et échappent aux significations préconçues (Viart, 2008, p. 10-11). De même que Viart, Faerber semble penser que ce sont les littératures qui provoquent le dissensus et non pas le consensus, qui inaugurent la reviviscence de la littérature quand beaucoup annoncent sa disparition.
Quitter la zone de confort de l’évidence, des croyances naïves et de la transparence peut être le geste qui inaugure le contemporain, indépendamment de l’époque où vit l’écrivain. Comme l’écrit Michel Chaillou, le contemporain ne doit pas être confondu avec l’époque actuelle parce qu’il consiste à « mettre tous les siècles ensemble » (M. Chaillou, dans Viart, 2008, p. 20). Pour Faerber, Marcel Proust est un écrivain contemporain parce qu’il brise tous les paradigmes scripturaux de son époque et continue de défier l’imagination de ses lecteurs jusqu’à aujourd’hui.
Revisiter le présent avec un regard nouveau ou écrire sur un présent qu’ils n’ont pas contribué à construire, comme les écrivains afro-brésiliens et afro-américains, correspond à la réinvention du contemporain. Dans L’écriture comme un couteau (2003), Annie Ernaux ressent et expérimente l’écriture comme une arme, comme une lame tranchante pour combattre le lieu commun, la phrase toute faite, les récits qui essaient d’harmoniser le contradictoire et qui nient les absences et les invisibilités de certains genres ou ethnies.
Si tout a déjà été écrit, si les pages sont noircies et non pas blanches comme celles que craignent tant les écrivains, alors on ne sait peut-être plus sur quoi écrire, tout a déjà été dit. Mais pour Johan Faerber, c’est précisément en face de la page noire que peut resurgir la littérature correspondant au désir de « recommencer, de surseoir aux défaites et de revenir au monde » (2018, p. 37). Il associe cette littérature de l’Après au sens hégélien de l’Aufhebung, qui renvoie à « dépasser, annihiler et conserver » (Jungues et Costa, 2013). En somme, la littérature aurait cette capacité de recommencer à partir de sa Fin, de transcender sa propre mort annoncée par nombre de critiques et théoriciens de la postmodernité. Toujours selon Faerber, il ne suffit donc pas de commencer quand tout finit, mais de « recommencer depuis la Fin » (2018, p. 50).
Contourner le « post »
Comme Pierre Ouellet (2008) avant lui, Faerber met en avant l’usure du « post » (postmoderne, postdoctorat, post-pandémie, …). Un peu comme lorsque nous avons usé et abusé du « néo » (néobaroque, néocolonial, etc.) à d’autres époques. D’après le théoricien québécois, « le temps d’après serait un arrière-temps, comme on parle d’arrière-plan, et il renverrait au ‘dessous’ où la temporalité ne cesse de glisser, de chuter, de tomber » (2008, p. 35).
Ouellet (2008) mentionne un temps après le temps, un temps supplémentaire qui est devenu le temps de toute énonciation. Dans ce sens, les deux auteurs se rejoignent quand ils affirment que la conception du contemporain n’est pas celle du temps présent, pas plus qu’elle n’est en synchronie avec lui. Une œuvre littéraire peut être considérée comme contemporaine y compris quand elle évoque des thèmes très anciens, à condition que ces thèmes soient resignifiés dans le présent. Le rôle de la mémoire ne coïncide pas avec la récupération d’éléments perdus dans la nuit des temps, mais, pour reprendre Benjamin, avec une remémoration qui passe par la resignification dans le présent de l’élément oublié dans le passé.
Ouellet (2008) utilise le terme d’« après tout », à entendre au sens de « en définitive », « finalement », « tout bien considéré », c’est-à-dire voir les choses de manière différente. Un « après tout » qui ne débouche ni sur une question, ni sur une affirmation, mais « sur une insoluble énigme dont la clé est à jamais perdue » (2008, p. 346).
Pour Faerber et Ouellet, le contemporain est quelque chose qui vient « après » (comme dans postmoderne) et qui se trouve rapidement dépassé, un temps en dehors de la linéarité de Chronos (temps linéaire, mesuré par l’horloge, temps qui dévore) ; quelque chose qui endosse de nouvelles formes de temporalité (comme Kairos et Aiôn) caractérisant la relation complexe entre instant et éternité, qui s’inscrit dans l’aspect relationnel et performatif du transculturel.
Faerber défend la perspective transculturelle parce qu’elle ne recherche pas la synthèse – le propre de la perspective interculturelle –, mais le dépassement : quand deux ou plusieurs cultures sont en contact, savoir combien l’une a pu « influencer » l’autre, ou s’il y a eu acculturation ou déculturation, n’est pas en soi intéressant. Ce qui importe, c’est l’apparition de nouveaux produits culturels issus de ce contact initial. Le transculturel est en lien avec le dissensus, pas avec le consensus.
Le contemporain dans les Amériques
Si l’on va dans le sens de Faerber pour qui le contemporain est la capacité de la littérature à resurgir de ses propres cendres, à se recréer elle-même, alors on peut dire que les littératures qui naissent dans de nouveaux espaces, en fonction des migrations, sont des littératures de la contemporanéité. Elles se constituent très souvent dans le lieu entre le pays d’origine et le pays d’accueil, elles entrecroisent des éléments des deux cultures pour produire quelque chose de nouveau.
Ce mouvement de création de quelque chose de nouveau à partir d’éléments de différentes cultures se nomme la transculturation. Le transculturel « mène à une relecture et à une recontextualisation des perspectives. [Il] ouvre sur l’avenir en proposant un présent qui vise à enclencher des relations personnelles comme pratiques institutionnelles, menant à une influence efficace et positive des uns sur les autres » (Imbert, 2015, p. 34). L’accent n’est plus mis sur la synthèse, mais sur l’innovation, le mélange, la circulation entre cultures, l’aller au-delà.
Haïtien d’origine, vivant au Québec où il a enseigné pendant de nombreuses années à l’Université Laval, Maximilien Laroche [1937-2017] a beaucoup travaillé sur les conséquences des déplacements des immigrants, et en particulier de différentes parties de la planète vers le Nouveau Monde et le Québec. Il a mis en lumière l’invisibilité de ces communautés dans le nouveau cadre de l’immigration et leurs efforts pour tenter de renverser l’effacement de leurs cultures d’origine dans le nouveau contexte du Canada : « Un homme venu d’outre-mer et qui a dû rompre avec sa civilisation originelle. Un homme qui a dû recommencer son histoire donc et qui dans ses œuvres d’imagination, ses œuvres littéraires notamment, s’efforce de découvrir le sens de recommencement. » (1970, p. 231)
On retrouve ici l’idée de « recommencer » que Faerber rapproche de la création du contemporain. Alors que les mythologies sont liées à l’histoire d’un commencement, d’une origine des civilisations, Laroche (1970) associe les récits migrants au recommencement et aux tentatives d’« interprétation de leur nouveau sens » (p. 231). Le processus d’émergence de nouvelles littératures, comme les afro-américaines et la québécoise, se constitue en prolongements, transformations et renouvellements dans le contexte des Amériques. Il devient un défi pour la littérature comparée en tant que discipline, traditionnellement créée pour étudier « les sources et les influences » des « grandes » littératures européennes en comparaison avec les littératures périphériques, ou émergentes, de l’Afrique et des Amériques.
À ce stade, une question se pose : est-il possible, dans le cadre de la littérature comparée « traditionnelle », de comparer des littératures émergentes entre elles – comme nous l’avons fait récemment ?
Pour répondre à cette question théorique – peut-être une question pour la postcritique ? –, il faut se tourner vers Wlad Godzich, professeur, dans les années 1990, du département de littérature comparée de l’Université de Montréal, et aujourd’hui professeur à l’Université de Californie, Santa Cruz.
En 1991, Michel Peterson et moi-même avons contacté Godzich pour rédiger l’introduction du livre que nous avons organisé et publié en 1992 à Montréal : Confluences littéraires Brésil-Québec : les bases d’une comparaison. Un livre qui réunit des textes de professeurs brésiliens et canadiens. Godzich n’a pas caché sa surprise dans la mesure où la littérature québécoise est très récente et qu’elle entretenait jusque-là un rapport étroit avec la littérature française, alors que la littérature brésilienne était déjà l’objet de nombreuses études comparatistes. Rapprocher et comparer deux littératures périphériques sans passer par le « centre » apparaissait à ses yeux comme un défi étant donné que cela exigeait, d’une certaine manière, une reconceptualisation de la littérature comparée en tant que discipline. Il fallait en quelque sorte abandonner l’eurocentrisme qui la caractérisait.
Concernant le processus croissant de mondialisation et sa tendance à homogénéiser les expressions culturelles, Godzich (1991) observe que les littératures dites émergentes présentent une tendance à la résistance et s’opposent à certains aspects de la mondialisation : quelquefois frontalement, d’autres fois sans aller jusqu’à remettre le processus en question. Il y a des littératures émergentes qui tirent parti de la mondialisation, à l’exemple du boom des littératures latino-américaines qui se sont imposées sur la scène internationale. D’autres se rassemblent dans une sorte de « communautés de conscience » (p. 53) et partagent des thèmes comme la valorisation de la femme, la lutte contre les intégrismes et les exclusions de groupes tels que les Noirs, les Amérindiens ou les homosexuels.
De l’avis de Godzich, c’est finalement par rapport à ce processus complexe que le comparatisme littéraire peut se développer et être resignifié :
Tout comparatiste a toujours su que la comparaison exigeait toujours un tertiumcomparationis. Trop souvent ce tiers terme est resté implicite, ce qui a permis de valoriser l’un des deux termes de la comparaison et de faire ainsi pencher la balance en faveur des modèles hégémoniques. En rendant explicite le troisième terme de la comparaison, on échappe à ce parti pris. En adoptant le développement de la littérature et des littératures par rapport à la globalisation, on assure non seulement de faire œuvre de comparaison mais, comme je le soulignais plus tôt, œuvre de résistance aussi, car les liens que l’on tisse ainsi exigent que l’on laisse filer certaines des mailles de cette globalisation et qu’on lui oppose une autre vision de l’ordre mondial. (1992, p. 53-54)
Il est intéressant de noter qu’un comparatiste reconnu internationalement, membre d’un département de littérature comparée de l’Université de Montréal, un établissement auquel sont associés des noms tels que Walter Moser et Antonio Gomes Moriana, a valorisé notre tentative de rompre avec la littérature comparée de tradition européenne et hégémonique. Il nous a même indiqué le chemin à suivre pour la quête du tertiumcomparationis en dehors du cadre du comparatisme traditionnel1.
Ainsi, cette exploration des littératures des Amériques par le biais du comparatisme est un parcours que nous traçons depuis plus de trente ans. Si aujourd’hui la démarche paraît évidente, elle s’est mise en place à partir d’un acte d’insubordination face aux modèles du comparatisme traditionnel. Elle a permis de rapprocher de la littérature brésilienne des œuvres caribéennes, canadiennes, québécoises et hispano-américaines, qui étaient alors inconnues des lecteurs de langue portugaise.
Des écrivaines brésiliennes qui produisent l’extrême contemporain
Très loin de la tradition de romancières écrivant des romans à l’eau de rose, une série d’écrivaines brésiliennes renouvellent l’écriture féminine : elles écrivent avec les lames tranchantes dont parle Ernaux et qui atteignent le lecteur en plein cœur. En misant sur l’insolite et l’inouï, un grand nombre de romans récents crée (ou réinvente) le contemporain, retire de l’invisibilité des aspects scabreux de la vie de femmes de différentes époques. Ils dévoilent la mémoire abîmée par des traumatismes divers, parmi lesquels l’esclavage. Certains vont même jusqu’à montrer l’impasse que provoquent l’impossibilité de représentation et/ou la quête de nouvelles conceptions de représentations permettant l’inclusion des faits traumatiques.
Des sujets tabous sont abordés avec une très grande cruauté, à l’exemple du viol dans O Peso do pássaro morto [Le poids de l’oiseau mort], de Aline Bei (2017). Des secrets honteux habituellement cachés au sein des familles sont étalés au grand jour : être mère célibataire, avoir qui a été violée. Le viol est l’un des thèmes qui pourrait rejoindre la liste d’une poétique de l’absence si un jour elle venait à être établie, parce qu’il fait de la victime une coupable. Elle est celle qui doit avoir honte, sa mémoire est à jamais blessée et elle a honte d’un crime qu’elle n’a pas commis. Autrefois, les familles avaient pour habitude de cacher, de masquer et de ne pas aller à la recherche des coupables. Autrement dit, de rendre le cas invisible. Aline Bei représentifie2 une absence qui s’est perpétuée pendant des décennies, voire des siècles, dans la culture brésilienne. Le viol n’est pas seulement énoncé comme un dol au moment où le crime est perpétré, il est aussi quelque chose d’invalidant pour le reste de la vie du personnage. C’est en ce sens qu’il devient le différentiel du roman. Au-delà de la scène du crime sur le plan physique, l’auteure présente les marques durables qui ont empêché la victime d’aimer son fils et même de se développer en tant qu’être humain, aussi bien comme femme que professionnellement. Un crime odieux, masqué et bâillonné par les propres parents de la victime ; des vies occultées. Énoncer le délit, sortir de l’invisibilité des faits de ce genre, inscrit ce roman dans ce que Faerber nomme la littérature qui vient après la littérature. Une littérature qui émerge de la fin des absences en montrant ce qui semblait être devenu tacite : le viol n’est pas une matière poétique.
L’impossibilité de la victime du viol d’établir des relations avec son fils est liée au manque de soutien de ses parents : pour éviter le scandale et la honte aux yeux des voisins, ils n’ont pas dénoncé le coupable. Mais en occultant le crime, ils ont culpabilisé d’une certaine manière la victime.
Dans son roman uma duas [Une deux] (2018), Eliane Brum déconcerte ses lecteurs en transformant deux thèmes forts en matière poétique : l’automutilation et l’impossibilité de la relation mère-fille. Cette relation impossible a déjà été abordée dans Meus desacontecimentos [Mes non-événements] (2014), où il est question d’une mère qui n’a pas su aimer sa fille parce qu’elle n’a jamais réussi à faire le deuil de sa première fille. La tombe de la sœur de la narratrice, « qu’aucun membre de la famille ne réussissait à fermer » (2018, p. 21, nous traduisons), a créé un vide dans sa vie, néanmoins elle parviendra à le remplir avec son amour pour la lecture et l’écriture, un héritage de son père.
Dans uma duas – titre étrange, écrit en minuscules –, l’auteure approfondit ce clivage d’amour et de haine qui caractérise les relations entre la fille et sa mère. De la haine parce qu’elle ne sent pas suffisamment aimée par cette mère qui ne fait pas attention à elle. Mais quand elle finit par l’abandonner, la vieille dame arrête de manger. Une scène dantesque est abruptement présentée au lecteur au début du récit : seule dans son appartement où il n’y a plus rien à manger, la mère agonise. La situation est telle que le chat lui a mangé un des pieds. Cette scène est d’une cruauté extrême pour la personne qui écrit comme pour celle qui lit, elle décontenance les lecteurs. La contrepartie est le fossé créé dans la relation mère-fille et qui a pour conséquence l’automutilation répétée de la narratrice : « Le rire du bras. Le sang qui sort de la bouche du bras. Combien de fois je me suis déjà coupée ? » (2018, p. 9, nous traduisons).
Sur la quatrième de couverture du livre, la psychanalyste Diana Corso (2018, nous traduisons) écrit :
Même en naviguant dans le fantasme, Eliane la journaliste ne pouvait pas ne pas écouter les deux côtés. Le cauchemar symbiotique a deux versions, la mère et la fille écrivent ce qu’elles ressentent sans se lire l’une et l’autre, c’est à nous de nous confronter à la vérité inexistante. Elles se détestent et s’aiment avec passion et nous emmènent vers leur douloureuse séparation. C’est un reportage dans les abîmes.
L’auteure anticipe peut-être dans les dernières pages du livre une des caractéristiques de cette littérature de l’Après, à savoir cesser de correspondre aux attentes des lecteurs et ne pas croire en la capacité de la littérature à représenter le réel et à pouvoir contribuer à sauver le monde :
Je découvre que j’ai écrit sur l’impossibilité de la littérature. L’échec préalablement assumé en tentant de transformer la vie en mots. Ce qui compte le plus, c’est ce qui ne peut pas être écrit, ce qui crie sans voix et sans corps entre les lignes. L’à jamais indicible. C’est mieux comme ça, que ce soit comme ça. (p. 189, nous traduisons)
Chez les deux écrivaines supra citées apparaissent les jalons du contemporain, tels que rendre visibles les absences et refuser de correspondre aux attentes du lecteur lambda. Mais il y a aussi la présence du récit de filiation, où l’autofiction – récit de l’intériorité – est remplacée par le récit de l’antériorité, celui qui abrite la mémoire intergénérationnelle et qui correspond à un détour nécessaire : évoquer les histoires des ancêtres comme stratégie des narratrices pour se raconter elles-mêmes. Dans uma duas, les récits de la mère et de la fille apparaissent en parallèle : des parallèles qui ne se rencontrent pas parce qu’aucune des deux ne va lire le récit de l’autre. Ce roman de filiation dont parle Dominique Viart correspond à des « tentatives de restitution » (2008, p. 103) de ce qui ne peut pas être dit ou vécu entre le narrateur et son ancêtre, pour essayer de combler des transmissions imparfaites ou des mémoires honteuses des parents.
Le dénouement, qui aboutit à la mort de la mère, s’inscrit sur la liste de l’indicible et de l’irreprésentable en fonction de la tragédie annoncée : la disparition de l’une empêche l’autre d’aller de l’avant – d’où le titre (quasiment) indéchiffrable et déconcertant : uma duas.
Martha Batalha a publié récemment La vie invisible d’Eurídice Gusmão (2018)3, un roman qui cherche à dévoiler l’invisibilité du personnage principal, la jeune femme Eurídice Gusmão. L’auteure l’invite à l’existence et met en avant ses tentatives d’émancipation, toutes frustrées par son mari. Le livre se transforme en un véritable inventaire d’absences dans la vie d’Eurídice, femme au foyer typique de la classe moyenne des années 1940, une époque où travailler en dehors de la maison caractérisait l’échec de l’homme à subvenir aux besoins de sa famille.
O inventário das coisas ausentes [L’inventaire des choses absentes], de Carola Saavedra (2014), est aussi un livre qui renvoie aux absences, aux manques dans la vie des femmes au Brésil et au besoin de les inventorier. En effet, ce n’est qu’après l’inventaire que peut être distribué l’héritage et qu’après avoir reçu l’héritage qu’il est possible de le transmettre. Les mémoires ne se constituent pleinement qu’à travers la transmission.
Dans ces deux romans, les termes « absences » et « invisible » apparaissent dans le titre pour renverser le processus d’occultation de la vie des femmes. Les auteures s’attachent à les représentifier, à les tirer de la condition d’oubli pour (à travers la transmission de l’écriture) les amener à exister en restaurant et en donnant un sens à des mémoires blessées. Le travail de la représentation, ou de la représentification, peut avoir lieu dans la dimension du laisser émerger en rendant présent ou en matérialisant ce qui « n’existe plus », mais aussi dans la dimension créative de la représentation qui débouche sur l’émergence de nouvelles entités, de nouveaux horizons. Dans ce sens, c’est l’oubli et non pas la mort qui transforme les personnes et les événements en rien définitifs. Rappeler équivaut à maintenir un dialogue avec les signes de l’absence ; c’est la représentification du passé qui garantit la préservation de la mémoire des absents, ainsi que notre propre avenir.
En ce qui concerne l’invisibilisation du Noir dans la littérature brésilienne, et plus spécifiquement de la femme noire, deux auteures se distinguent : Ana Maria Gonçalves et Conceição Evaristo. Si l’émergence de voix noires au féminin existe dès les premières anthologies intitulées Cadernos Negros [Cahiers Noirs] du Groupe Quilombhoje, la production de nouvelles et de romans est au contraire récente.
Ana Maria Gonçalves a innové dans le domaine des études littéraires afro-brésiliennes : elle est l’auteure de la première saga sur l’histoire des esclaves africains envoyés au Brésil, depuis la traversée sur les navires négriers en 1810 jusqu’au retour de la narratrice au Dahomey en 1877. Dans Um defeito de cor [Un défaut de couleur], elle retrace pour la première fois la vie d’une esclave à partir du point de vue d’une femme noire et esclave, Kehinde. L’histoire évoque sa vie en Afrique avant la traversée de l’océan, les péripéties autour de sa vie d’esclave à Bahia et, finalement, son retour au Dahomey une fois affranchie.
En plus du travail de recherche immense et de l’habileté de la narratrice, la plus grande innovation de cet ouvrage a été de céder le lieu de parole à une femme esclave. Pour la première fois dans la littérature brésilienne, le lecteur peut accompagner au plus près la lutte, la souffrance et la détresse, mais aussi les joies et les conquêtes de cette femme devenue esclave sur le sol brésilien, où on lui attribuera le prénom chrétien de Luísa.
Très énigmatique, le titre (Um defeito de cor) renvoie à une phrase d’un texte attribué au poète Luiz Gama, qui serait le fils perdu de Kehinde-Luísa. Dans ce sens, le livre est une quête inlassable des traces laissées par le fils disparu, vendu comme esclave par son propre père. Le texte de Luiz Gama auquel fait allusion Ana Maria Gonçalves se trouve sur le site Internet du groupe Literafro de l’Université fédérale de l’état de Minas Gerais :
Chez nous, même la couleur est un défaut. Une maladie de naissance impardonnable, le stigmate d’un crime. Mais nos critiques oublient que cette couleur est l’origine de la richesse de milliers de voleurs qui nous insultent ; que cette couleur conventionnelle de l’esclavage, si semblable à celle de la terre, abrite sous sa surface sombre des volcans où brûle le feu sacré de la liberté.
Le voyage à la recherche du savoir ancestral conduit la protagoniste – dont le récit constitue une longue lettre écrite au fils disparu – à Casa das Minas. Là, elle y rencontre Noche Naê, une prêtresse vaudou, une « mère ancestrale » qui renforce sa compréhension de la religiosité de sa grand-mère, morte pendant la traversée. Ces passages transculturels entre la culture ancestrale africaine et la culture des Blancs qu’elle a côtoyée pendant de longues années quand elle était esclave, l’aident à revaloriser son origine, même si elle sait au fond qu’elle n’appartient déjà plus à aucune des deux cultures. Les processus transculturels ont donné naissance à quelque chose de nouveau : la formation d’une culture noire dans les Amériques, qui se complète avec la création poétique de son fils Luiz Gama, le premier poète afro-brésilien à assumer le je-énonciateur noir dans le contexte de la littérature brésilienne, et le premier à rire de l’homme blanc dans Trovasburlescas [Vers burlesques] (1904) :
Que je sois Noir ou bouc
Peu importe, non ?
Des boucs, il y en a dans toutes les castes
Parce que l’espèce est très vaste.
Finalement, le dernier récit brésilien de la contemporanéité évoqué dans ce travail est Banzo, mémoires de la favela (2016), de Conceição Evaristo. Publié au Brésil en 2006 sous le titre original Becos da memória, puis une deuxième fois en 2013, il est ensuite traduit en français et paraît en 2016 aux éditions Anacaona. À l’époque, Evaristo est déjà une poétesse et nouvelliste très connue. Si une troisième édition brésilienne est apparue en 2018, le livre est en réalité déjà ancien : il devait être publié par la fondation Palmares en 1988, à l’occasion des commémorations du centenaire de l’abolition de l’esclavage, mais le manque de subventions l’en a empêché. On le voit, le périple vécu par l’ouvrage met en évidence les effacements et les difficultés de pénétration de la littérature afro-brésilienne.
Même si elle a été écrite il y a plus de vingt ans, l’histoire garde toute son actualité parce qu’elle parle d’une favela sur le point d’être détruite pour laisser la place à un grand projet immobilier. La mémoire de l’auteure parcourt les ruelles de la favela, mais son imagination la mène beaucoup plus loin, jusqu’aux origines de sa famille au temps de l’esclavage. Le livre est une succession de remémorations qui ne suivent pas une chronologie. Des portraits de différentes époques, un parcours de souffrances, de privations et de douleurs qu’ont connu, et que connaissent encore, les Noirs du Brésil ; un peu comme si l’esclavage avait créé des racines et que le système d’exclusions continuait. Le va-et-vient entre la vie dans la favela et la vie d’esclave vise à montrer que les injustices demeurent les mêmes.
Plusieurs personnages du temps de l’esclavage et des habitants actuels du bidonville sont des conteurs d’histoires. Ces histoires orales circulent dans l’espace de la favela et la narratrice agence les fils pour tisser son récit autour de Vó Rita, Tio Totó et Maria-Nova – celle qui aimait écouter les histoires. Il s’agit d’une sélection mémorielle guidée par les affects et par la perte imminente de leurs baraques à cause des pelleteuses qui se rapprochent.
En fonction des ruelles, des venelles et même des voies sans issue, des voix de différentes générations sont convoquées pour le travail de mémoire ; ces voix contribuent à éclairer l’obscurité des ruelles aux souvenirs douloureux mais pleins d’affects et d’exemples de solidarité. Comme les ruelles, les récits sont brefs, tortueux et sans issue. La baraque des esclaves [senzala] et la favela coïncident : ceux qui habitaient les senzalas pendant l’esclavage et ceux qui vivent aujourd’hui dans les favelas ont pratiquement les mêmes conditions subalternes de vie. L’objectif majeur du livre est de souligner un tel parallélisme, avec des situations analogues d’inégalité et de violence. À la différence que le démantèlement de la favela ne va pas effacer la voix de Maria-Nova, qui a l’intention de continuer à fréquenter l’école ailleurs. Son amour pour les mots et pour les histoires la conduira vers l’écriture, à l’image de l’écrivaine Conceição Evaristo.
Conclusions
Je ne suis pas revenu pour revenir
Je suis arrivé à ce qui commence.
Ces vers en épigraphe ont été écrits par le poète québécois Gaston Miron en 1970 à l’occasion de la période de la Révolution tranquille, qui a engendré une prise de conscience identitaire et l’apparition de la littérature québécoise. Avant cela, la littérature québécoise était connue sous le nom de « littérature d’expression française du Québec », une dénomination colonialiste qui la voyait comme une production « connexe et marginale » par rapport à la littérature française. Il est donc possible d’affirmer que les vers de Gaston Miron ont inauguré le contemporain au Québec, quand les écrivains ont constaté l’importance de donner naissance à une littérature en langue française qui se voulait indépendante de la littérature française.
De la même manière, les modernistes brésiliens sont arrivés en 1922 « à ce qui commence », c’est-à-dire à une nouvelle vision de la poésie et de la littérature. Une vision dissociée des marques antérieures du mouvement parnassien et du symbolisme, qui prenait désormais en compte les différentes cultures présentes au Brésil.
Les exemples cités dans ce travail montrent également que la littérature brésilienne arrive « à ce qui commence ». Elle découvre le « sens de recommencement » de Maximilien Laroche, ou, pour reprendre Johan Faerber, recommence « depuis la Fin ».
Les caractéristiques de ce « nouveau », de ce « recommencement » qui qualifie la littérature de l’Après et qui s’observent dans l’écriture de l’extrême contemporain, sont résumées dans les lignes suivantes :
- Le renouvellement des anciennes formules, respectueuses de faux moralismes ; avec la rupture de paradigmes et le dépassement des limites imposées aux femmes, on passe de la stabilité du XIXe siècle et du début du XXe siècle au dynamique et au relationnel ;
- La production de récits déconcertants, sans crainte de provoquer un sentiment de malaise chez le lecteur. La littérature de l’extrême contemporain perturbe le lecteur, elle suit d’une certaine manière la proposition d’Elena Ferrante : « Écrire, c’est tourner le couteau dans la plaie, quelque chose qui peut faire très mal » (Ferrante, 2020, p. 15). Créer des formulations inédites et inattendues, loin des significations préconçues.
- Le règlement de comptes avec ses ancêtres, des romans de filiation qui retracent la mémoire intergénérationnelle. Toutes les écrivaines analysées règlent, chacune à leur façon, leurs comptes avec une mère ou un ancêtre dans la mesure où elles écrivent à partir d’un manque : des parents absents, des transmissions imparfaites ou des malentendus générationnels. L’écriture permet de remplir ces vides et d’établir un continuum familial en mettant en valeur l’héritage transmis, comme dans les romans de Conceição Evaristo et Ana Maria Gonçalves. Ou alors d’affronter les aïeuls et de se rappeler des mémoires blessées et des ruptures, comme dans les ouvrages d’Aline Bei, d’Eliane Brum, de Martha Batalha et de Carola Saavedra.
- Le lieu de parole est cédé aux absents pour l’inventaire des invisibilités. La représentification des absences est le dénominateur commun de tous les récits, car l’objectif est de donner vie à ce qui a été longtemps omis et non dit. Les auteures savent qu’il est essentiel de remémorer ou représentifier dans le présent les omissions du passé par rapport aux femmes pour pouvoir établir ce que Fernando Catroga (2009) nomme « le dialogue avec les signes de l’absence ». En effet, ce dialogue correspond à une « représentification par l’intermédiaire de laquelle, en donnant des futurs au passé, les vivants garantissent un futur pour eux » (2009, p. 7).
- La perspective transculturelle est à nouveau une caractéristique majeure de tous les récits évoqués : tous partent de l’implosion de binarismes (civilisation/barbarie, masculin/féminin, présence/absence) pour arriver à la construction du nouveau mais aussi à l’acceptation du divers et de la relation. Sur le plan de la transculturalité, il y a un entrelacement des identités culturelles « qui se définissent et se transforment en résonance les unes avec les autres » (Benessaieh, 2012, p. 85). Autrement, dit, la conception transculturelle de la culture est « fondamentalement relationnelle et transformative » (Benessaieh, 2012, p. 85). Cette perspective ne prend pas la synthèse comme horizon, « c’est du dissentiment que se fait l’invention et que peuvent être générées les nouvelles idées » (Gondar, 2005, p. 14, nous traduisons).
- La représentabilité et ses limites. L’écrivaine Eliane Brum (2018) soulève la question déjà plusieurs fois abordée de l’impossibilité de représentation à « l’ère des catastrophes ». Dans l’extrait ci-dessous, déjà cité auparavant, elle se voit en face de l’inénarrable, de l’impossibilité de la littérature à pouvoir rendre compte de certains événements tels que l’assassinat de sa mère :
Je découvre que j’ai écrit sur l’impossibilité de la littérature. L’échec préalablement assumé en tentant de transformer la vie en mots. Ce qui compte le plus, c’est ce qui ne peut pas être écrit, ce qui crie sans voix et sans corps entre les lignes. L’à jamais indicible. C’est mieux comme ça, que ce soit comme ça. (2018, p. 189)
Eliane Brum souligne le drame que connaît l’écrivain quand il doit dire l’indicible, raconter ce qui ne peut pas être raconté. Cette question sur l’échec de la représentabilité dans la littérature est aussi posée par Arthur Nestrovski et Márcio Seligmann-Silva dans Catástrofe e representação [Catastrophe et représentation] (2000) quand ils évoquent la difficulté de représentation de la Shoah, un « événement qui ne se laisse pas capturer par la pensée, ni par le mot, ni par la parole » (2000, p. 186).
Jô Gondar (2005), psychanalyste et professeure de l’Université fédérale de Rio de Janeiro (Unirio), va dans le même sens. Elle indique les limites de la représentation quand il s’agit d’écrire sur une mémoire sociale analysée comme un processus « duquel les représentations ne sont qu’une partie : celle qui s’est figée et qui a trouvé sa légitimité dans une collectivité » (2005, p. 24).
Elle précise toutefois que « […] la mémoire est bien plus qu’un ensemble de représentations : elle s’exerce aussi dans une sphère irreprésentable : manières de sentir, manières de vouloir, petits gestes, pratiques de soi, actions politiques innovantes. » (2005, p. 24, nous traduisons)
Si dans ce texte nous avons mis l’accent sur l’importance, pour la littérature de l’extrême contemporain, d’établir l’inventaire des absences survenues au fil des siècles dans le vécu de femmes de différentes ethnies et classes sociales, de femmes victimes d’atrocités comme le viol ou soumises à l’esclavage, ces processus de représentation ne montrent finalement que la pointe de l’iceberg…