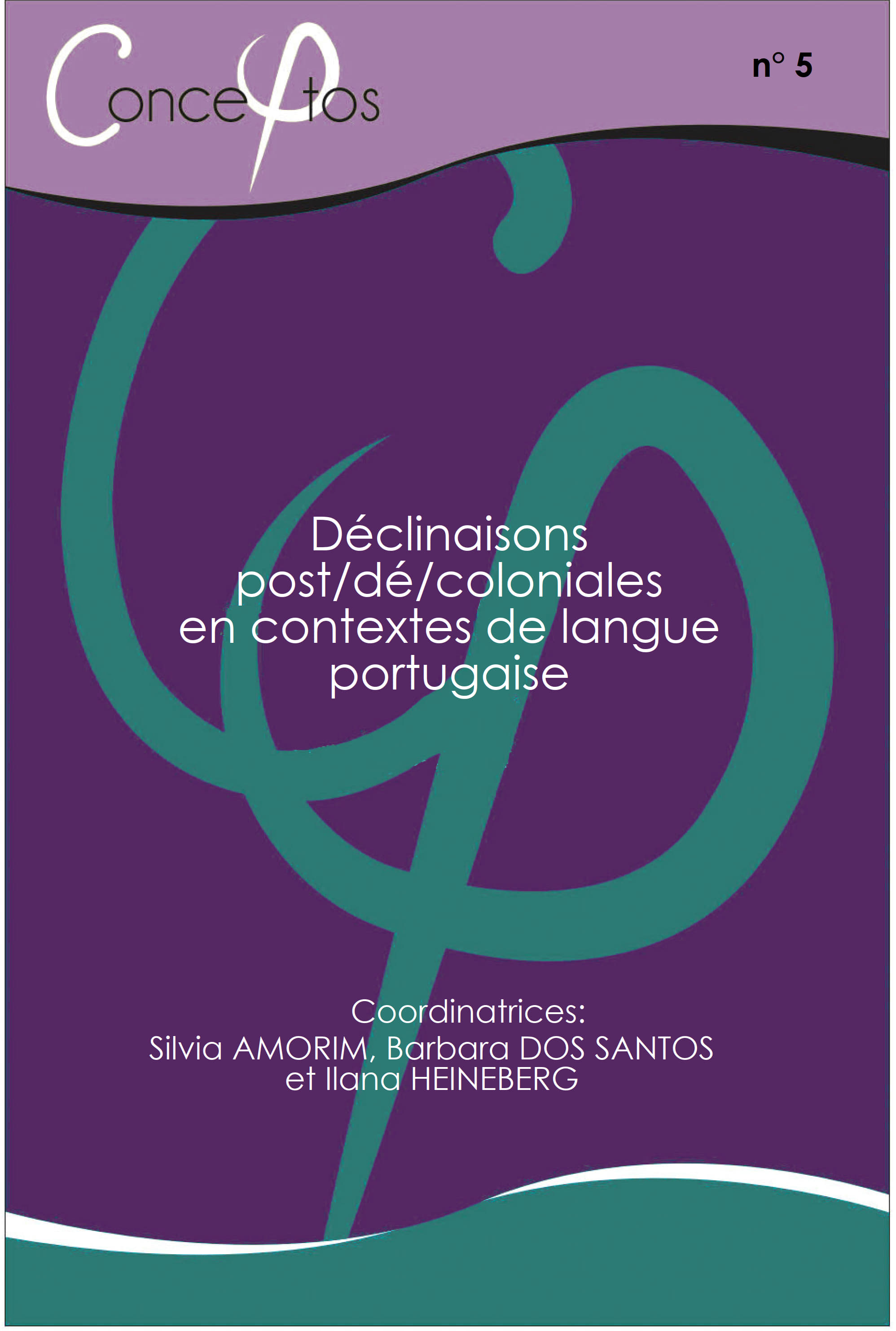Penser autrement l’identité africaine : culture transnationale et globalisation
La fin du XXe siècle marque un tournant dans l’histoire de la pensée africaine, comme dans la vie même de l’Afrique. Vers cette période commence une nouvelle période qui se poursuit sous nos yeux et dont Achille Mbembe, Souleymane Bachir Diagne, Anthony Appiah et Felwine Sarr, pour ne citer que les universitaires les plus en vue sur la scène intellectuelle internationale, sont les principales figures de proue. La disposition psychologique de ce « renouvellement sans précédent » (Mbembe, 2013b) s’esquisse d’abord par des initiatives individuelles et collectives qui, comme Les Ateliers de la pensée, s’inscrivent manifestement dans la continuité du 1er Festival Mondial des Arts Nègres qui s’était tenu à Dakar du 1er au 24 avril 1966. Cette manifestation politique et culturelle faisait elle-même écho aux Congrès des écrivains et artistes noirs de Paris de 1956 et de Rome en 1959, qui tous les deux figuraient la « Présence africaine », pour reprendre le leitmotiv de l’article de Souleymane Bachir Diagne (Diagne, 2019, p. 13-35). Il est pourtant essentiel de remarquer que cette période d’effervescence qui correspond à l’accession à la souveraineté internationale de la plupart des anciennes colonies françaises ne sera que de courte durée. Organisée à l’initiative de Léopold Sédar Senghor avec le concours d’un groupe de brillants écrivains et intellectuels, cette rencontre restera unique dans l’histoire intellectuelle du continent. Au fur et à mesure que la génération de la Négritude se retire de la scène intellectuelle, se réduit la dynamique insufflée par Léopold Sédar Senghor au Sénégal1.
Le Festival Panafricain d’Alger (1969), organisé en partenariat avec l’Organisation de l’Unité Africaine, aura une ambition plus politique que culturelle. Il entérine l’émergence d’une classe de révolutionnaires antiimpérialistes déterminés à mettre fin à l’hégémonie des puissances occidentales dans le Tiers-monde. Le discours d’Alger contraste avec l’approche senghorienne d’une révolution artistique et intellectuelle. D’un point de vue symbolique, on passe alors d’une rencontre essentiellement artistique et intellectuelle à un rendez-vous des grandes figures des révolutions politiques africaines des années 1960 et 1970. Toutefois, ce sont les années 70 qui mettront définitivement fin aux grandes messes intellectuelles sur le continent africain. C’est l’époque des régimes militaires, des famines, de la paupérisation des populations, du chaos politique et last but not least du désenchantement généralisé. Les années 1970 et 1980 avaient été pour la pensée africaine un temps d’échec et d’absence de perspective sans égal. Les écrivains de cette période, au premier rang desquels figure Sony Labou Tansi, traduisent dans leurs œuvres un sentiment d’instabilité et de perte de repères et d’absence. Cette période tranchait manifestement avec le bouillonnement intellectuel des années trente et la brève euphorie des indépendances. Le pessimisme y était perceptible, et l’absence d’une inclination à se projeter dans l’avenir sensible. Au cours de cette période, aucun grand mouvement intellectuel et artistique ne s’affirme sur le continent, les intellectuels et les écrivains prennent le chemin de l’Europe et de l’Amérique ; ceux qui résistent sont soit en prison soit assignés à résidence. Il faut attendre la fin des régimes autoritaires et le retour du pluralisme en politique pour voir se dessiner une nouvelle ère intellectuelle où surgissent de nouvelles inspirations et émergent de nouvelles figures et de nouvelles problématiques. En un sens, Les Ateliers de la pensée sont héritiers du 1er Festival Mondial des Arts Nègres notamment du colloque sur les « Fonction et signification de l’art négro-africain dans la vie du peuple et pour le peuple ». C’est, pour reprendre les termes de Michal Obszynski, des moments « marqués par l’autoréflexion et un souci d’autodétermination des artistes et des intellectuels africains » (Obszynski 2021, p. 132). Refusant de se plier plus longtemps aux discours catastrophistes et fatalistes d’une Afrique en marge de l’Histoire de Sarkozy, Les Ateliers de la pensée font preuve d’audace ; ils ont conscience de s’inscrire dans une longue tradition et de poursuivre une lutte intellectuelle2. Tout comme le colloque organisé sous le patronage de l’Unesco et de la « Société africaine de culture », Les Ateliers de la pensée sont une sorte de laboratoire transnational de partage et de débats où chacun exerce sa réflexion sur l’Afrique et le sujet Africain, teste sa pensée, la fait évoluer et la confronte avec celle des autres intellectuels africanistes venus du monde entier afin de proposer de véritables perspectives au continent et à sa diaspora. Tout l’intérêt de ce laboratoire est de rassembler ces connaissances profondes du sujet Africain et de repenser en profondeur le discours à propos de l’Afrique qui, à bien des égards, converge vers une seule et même direction : la restauration de sa propre identité, de son histoire, de sa présence au monde.
Emancipés de ce poids, les intellectuels unifiés autour des Ateliers de la pensée en une puissante force de proposition font sentir une nouvelle ère où s’exprime le besoin d’un changement de paradigme nécessitant un renouvellement des idées. Il est important de noter que ce besoin s’inscrit dans la continuité d’une prise de conscience, plus générale, de sortir de la bipolarisation qui favorisait le face à face Occident versus continent noir pour aller vers une pensée du Tout-monde (Glissant). En somme, il s’agit de l’idée d’appartenance à un seul Monde. Cette nouvelle exigence qui invite à « scruter le présent et le futur [du] monde à partir de l’Afrique et, ce faisant de participer au renouvellement de la pensée critique dans le contexte contemporain » (Mbembe et Sarr, 2019) est formulée par Souleymane Bachir Diagne en termes de « Présence africaine » dans le monde (Diagne, 2019, p. 13). Une présence africaine en équilibre avec elle-même, capable d’élaborer un discours critique sur elle-même3, d’intégrer l’idée d’un pluralisme religieux et culturel. Quel que soit l’ordre dans lequel ces trois faits se produisent, ils apparaissent comme faits concomitants et connexes. Les réflexions de Souleymane Bachir Diagne, Anthony Appiah, Felwine Sarr, Achille Mbembe, etc. ont en effet en commun de faire de l’africanisme une science critique de l’Afrique contemporaine et une prospective qui se caractérise par un double programme. D’une part, il s’agit de faire un état des lieux des discours sur l’Afrique et ses diasporas, et c’est alors, dans l’ensemble, la même stratégie que l’on retrouve : dénonciation et réévaluation d’un discours jugé hégémonique et discrétionnaire. Il s’agit de comprendre le processus qui a mené à une telle situation et de déconstruire les mécanismes institutionnels et discursifs. D’autre part, l’objectif consiste à s’inscrire dans une réflexion plus globale sur la présence africaine dans le monde ; ce que cette présence signifie et implique. Nous allons nous intéresser principalement aux textes d’Achille Mbembe.
Prenant en compte les diverses prises de positions d’Achille Mbembe, notre réflexion s’intéressera de prime abord aux enjeux d’une pensée en évolution constante, qui certes ne varie pas sur certains points, notamment sur la critique de l’État postcolonial et de la pensée racialiste, mais n’en présente pas moins un certain nombre de variations. Historien, politiste et essayiste, Achille Mbembe a cherché, et c’est le premier mérite de ses nombreuses études, à parler de la colonisation, du multiculturalisme, du cosmopolitisme, du panafricanisme, etc. à partir de l’Afrique, et ce, à la fois dans une perspective critique qui questionne ces différents concepts et notions (Delas, 2013). Les textes de Mbembe montrent que la critique de la représentation de l’Afrique n’est pas seulement le produit d’un afrocentrisme débridé, mais que certains courants de la critique du discours africaniste et de l’eurocentrisme se forment également dans le contexte international et dans la confrontation avec les développements des études postcoloniales. L’évolution de Mbembe prouve également de manière exemplaire qu’une telle critique peut, dans certaines conditions, aboutir à la formulation d’un nouvel humanisme. C’est pourquoi nous allons dans un premier temps examiner les voies que Mbembe emprunte pour élaborer un nouveau discours sur l’Afrique et comment sa critique prend forme après la publication de son ouvrage phare De la Postcolonie. Essai sur l’imagination politique dans l’Afrique contemporaine (Mbembe, [2000] 2005), puis nous montrerons dans un second temps comment à partir de deux ouvrages majeurs à savoir Sortir de la grande nuit. Essai sur l’Afrique décolonisée (Mbembe, [2010] 2013) et Critique de la raison nègre (Mbembe, [2013] 2015) l’historien de l’Afrique devient l’historien de la globalisation en initiant une réflexion sur l’afropolitanisme et le cosmopolitisme.
Réécriture du récit continental
S’inscrivant dans la continuité de la tradition inaugurée par le philosophe congolais V.Y. Mudimbe auteur de The Idea of Africa (1994) et The Invention of Africa (1988) à qui l’on doit les concepts de la « bibliothèque coloniale » et celui de « l’invention de l’Afrique », deux des concepts les plus commentés en études africaines, Achille Mbembe revient sur les modalités d’élaboration d’un discours sur l’Afrique en portant le regard sur l’image de l’Afrique4. Il élabore en même temps les conditions de possibilité d’un nouveau discours à propos de l’Afrique dans son rapport à Soi et à l’Autre.
La pensée critique de Mbembe attaque le rationalisme moderne et la modernité occidentale en son réduit le plus fort, chez Husserl et Paul Valery (Mbembe, 2013a). Il trouve dans la pensée du philosophe et celle du poète, qui placent l’Europe comme le lieu par définition de la Raison et de l’Universalité, les motifs majeurs du doute. La perception husserlienne et valérienne de l’Europe dans ses relations avec le reste du monde s’est vite transformée en « une vocation de capitanat » (Mbembe, 2013, p. 72) et en une « volonté de puissance » qui s’est exprimée dans l’impérialisme du XIXe siècle et la domination néocoloniale au XXe siècle, explique Mbembe. La posture postcoloniale de Mbembe s’attache donc à dénoncer l’eurocentrisme des discours philosophiques et des récits stéréotypés des voyageurs et d’intellectuels européens en même temps qu’il livre une critique contre toute forme d’essentialisme. En même temps, le besoin de croire en « une autre Europe » (Mbembe, 2013a, p. 74) le rapproche de Jacques Derrida (« Le souverain bien – ou l’Europe en mal de souveraineté ») qui ne craint pas d’affronter les pires moments de l’histoire européenne pour y trouver, non pas la négation, mais la confirmation de sa grandeur. Cette vision derridienne de l’Europe « sans le moindre eurocentrisme » serait, à en croire Mbembe, l’une des sources d’inspiration de la critique postcoloniale : « On retrouve cette façon d’écrire la biographie de l’Europe dans le courant de pensée que l’on a appelé la “critique postcoloniale” » (Mbembe, 2013a, p. 74).
La critique de la pensée occidentale passe également par ce que Mbembe appelle l’« auto-aveuglement » et qu’il définit comme la « formidable volonté d’ignorance qui, chaque fois, veut passer pour du savoir » (Mbembe, 2015, p. 108). L’historien s’inspire de l’analyse du colonialisme de Frantz Fanon mais aussi du Discours sur le colonialisme où Aimé Césaire posait déjà la question de savoir si « la colonisation [était] elle vraiment mis en contact ? Ou, si l’on préfère, de toutes les manières d’établir un contact, était-elle la meilleure ? » (Césaire, 1955, p. 9-10). La réponse de Césaire est sans équivoque : « Je réponds, non » (Césaire, 1955, p. 10). Pour Césaire « entre le colonisateur et le colonisé, il n’y a de place que pour la corvée, l’intimidation, la pression, la police, l’impôt, le vol, le viol, les cultures obligatoires, le mépris, la méfiance, la morgue, la suffisance, la muflerie, des élites décérébrées, des masses avilies » (Césaire, 1955, p. 19). Mbembe s’inscrit résolument dans la continuité de la réflexion césairienne lorsqu’il écrit à son tour que la « conscience de l’empire […] ruine par avance toute possibilité de rencontre et de relation autre que celle que fonde la force » (Mbembe, 2015, p. 108). Il met en avant les fondements de la pensée et de l’action coloniale avec notamment la violence réelle et symbolique, la pensée anthropologique classificatoire et ethnocentrique qui brille par « une ignorance désinvolte et frivole » (Mbembe, 2015, p. 108). Critique de la raison nègre développe ainsi une critique de la pensée occidentale à partir d’une réhistoricisation des termes « nègre » et « race ». Le texte se présente ainsi comme une rupture avec les humanismes de la modernité et leur manière d’envisager les rapports avec l’Autre et l’ailleurs, jugée ethno- et logocentrique. La visée de Mbembe est davantage une critique des rapports de pouvoir existant ou ayant existé entre l’Europe et l’Afrique, ce qui lui permet de retracer l’histoire de l’Afrique dans une perspective globale, allant du temps de l’esclavage à la période contemporaine. Il s’agit dès lors de déconstruire l’histoire des systèmes de représentations à partir d’une généalogie des termes « nègre » et « race » (Mbembe, 2006) et de s’attaquer au néolibéralisme à l’origine de la condition nègre. L’idée récurrente de Mbembe est bien de démontrer que « le nègre » et « la race » sont des constructions d’une Europe impérialiste soucieuse de s’approprier l’Autre et de le soumettre comme le montre les propos de Victor Hugo cité par l’auteur : « Dieu offre l’Afrique à l’Europe. Prenez-la ! » (Hugo « Discours sur l’Afrique », cité dans Mbembe, 2015, p. 110).
Pour l’historien et intellectuel camerounais, la critique de la raison coloniale n’est pas une fin en soi mais une manière d’envisager de nouveaux rapports entre l’Afrique et le reste du monde. Mieux, elle lui permet d’imaginer « un devenir nègre du monde » où « le nom Nègre ne renvoie plus seulement à la condition faite aux gens d’origine africaine à l’époque du premier capitalisme […]. C’est cette fongibilité nouvelle, cette solubilité, son institutionnalisation en tant que nouvelle norme d’existence et sa généralisation à l’ensemble de la planète […] » (Mbembe, 2015, p. 16-17). Un tel élargissement de la condition nègre à l’ensemble de la planète n’est pas sans rappeler les discours du marxisme triomphant comme le constate Daniel Delas : « Le terme “nègre”, ainsi déconnecté du terme “noir” et de l’Afrique, prend la place occupée au temps du marxisme par “prolétaire” (Delas, 2013, p. 140). À côté de cette critique ou mêlée à elle, se dessine d’une certaine manière « une critique politique, culturelle et esthétique du temps qui est le nôtre, le temps du monde. […] C’est un temps marqué, entre autres, par […] l’idée d’un futur que pourrait partager l’humanité dans son ensemble » (Mbembe, 2013b). Et au pessimisme que suggérait l’axiologie coloniale se substitue l’optimisme d’un monde postmoderne marqué par la « circulation des mondes » (Mbembe, 2013a). Comment expliquer ce passage de l’Afrique au monde ? C’est que la vision de Mbembe largement tributaire de la créolisation glissantienne s’est singulièrement élargie, mettant en jeu les grandes questions de notre contemporanéité. Ces divers thèmes s’appellent et s’engendrent les uns les autres ; ils tendent à former un tout organique ; ils constituent au début du XXIe siècle, la substance psychologique de la globalisation. On peut comprendre que sa réflexion sur les mondes postcoloniaux l’amène à penser le cosmopolitisme à partir de l’Afrique.
L’afropolitanisme : conditions de possibilité d’une identité transnationale
Mbembe est un glissantien de la première heure comme l’attestent les nombreuses références au Tout-Monde et à La Poétique de la Relation (Mbembe, 2013a, p. 70-71 ; Mbembe, 2015, p. 143). En tant que disciple de Glissant, il affirme qu’« il n’existe pas d’identité nègre comme il existe des Livres révélés. Il y a une identité en devenir qui se nourrit à la fois des différences entre les Nègres du point de vue ethnique, géographique et linguistique, et des traditions héritées de la rencontre avec le Tout-Monde » (Mbembe, 2015, p. 143). Témoin de la rupture intérieure qui creusait un abîme entre les communautés en Afrique du Sud et en Europe, il a exprimé, mieux que tout autre, les aveuglements de l’essentialisme et les dangers du repli identitaire. C’est au chapitre 6 de son essai Sortir de la grande nuit qui porte sur la « circulation des mondes : l’expérience africaine » (Mbembe, 2013a, p. 203-237) que Mbembe propose une définition de l’afropolitanisme comme un dépassement de la pensée anticoloniale, de la Négritude et du panafricanisme.
Pour Mbembe, la voie à suivre serait celle de Kwame Appiah selon laquelle « le cosmopolitisme est le nom non pas de la solution mais du défi »5 (« cosmopolitanism is the name not of the solution but of the challenge », Kwame Appiah cité dans Knudsen et Rahbeck, 2016, p. 3). Eva Rask Knudsen et Ulla Rahbek reprennent cette idée au philosophe pour considérer l’afropolitanisme comme un challenge, en somme, comme espace de conversation et de dialogues pour de nouveaux débats et de nouveaux échanges, « a space for conversation and dialogues, for new debates and exchange of idea » (Knudsen et Rahbeck, 2016, 3). Pour les deux auteurs, l’afropolitanisme est un espace de questionnements et de réflexions critiques. L’afropolitanisme répond à un besoin réel de repenser l’identité africaine qui se caractérise d’une part, par la relation de l’Afrique avec le reste du monde, d’autre part, par le désir de prospecter la présence de l’Afrique dans le monde. Ce mouvement intellectuel, culturel et artistique participe ainsi à un courant d’idées lié à la « circulation des mondes » et « aux identités itinérantes » (Mbembe, 2015, p. 148) ; sa fécondité à faire apparaître des relations jusque-là restées en marge des réflexions sur la globalisation justifie l’intérêt que lui accorde depuis une décennie de nombreux universitaires (Wawrzinek et Makokha, 2011; Chielozona, 2014; Krishnan, 2015). En ce sens, Achille Mbembe a opéré sur ce concept un travail essentiel de définition qu’il convient de mettre en perspective avec d’autres approches de l’afropolitanisme souvent anglophones.
Pour Taye Selasi, l’afropolitanisme est surtout un art de vivre d’« une nouvelle génération d’émigrés africains »6 (Selasi, 2005) et l’affirmation d’une identité hybride que Johny Pitts a présentée dans son essai Afropéens. Carnets de voyages au cœur de l’Europe noire (Pitts, 2021). Parallèlement à ce travail sur l’identité, se développe une approche critique de la représentation de l’Afrique et de l’Africain dans le monde occidental. Il s’agit donc de déconstruire le discours médiatique à propos d’une Afrique moribonde et toujours en crise. De son côté, Simon Gikandi affirme qu’il faut sortir de “la trope de la crise“ (Gikandi, 2011, p. 9). Taye Selasi et Simon Gikandi exigent un regard qui tienne compte de la complexité historique du continent, des dynamiques diasporiques et des processus politiques et socioculturels. Toutefois, tout en prêtant une oreille attentive aux discours et aux représentations, le débat sur l’afropolitanisme est largement dominé par le débat sur l’identité, comme on le voit chez Taye Selasi lorsqu’elle tente de définir l’Afropolitain:
Certains d’entre nous sont des mélanges ethniques, par exemple un Ghanéen et un Canadien, un Nigérian et un Suisse ; d’autres ne sont que des mutants culturels : Accent américain, affect européen, ethos africain. La plupart d’entre nous sont multilingues : outre l’anglais et une ou deux langues romanes, nous comprenons une langue indigène et parlons quelques langues vernaculaires urbaines. (Selasi, 2005)7
Les afropolitains se définissent ainsi par leur style de vie, les liens nouveaux qu’ils établissent entre le pays d’origine des parents et une forme de multiple appartenance assumée « être d’Afrique et d’autres mondes en même temps »8 (Gikandi, 2011, p. 9). Le propos de Mbembe s’inscrit parfaitement dans la double approche qui consiste d’une part à faire une critique du discours médiatique à propos d’une Afrique en crise et, d’autre part, il propose une approche de l’identité qui tienne compte de la multiappartenance9. Avec Taye Selasi et Simon Gikandi, Mbembe partage l’idée de l’afropolitanisme comme « prise de position politique et culturelle par rapport à la nation, à la race et à la question de la différence en général » (Mbembe, 2013a, p. 232). Toutefois, Mbembe procède à un changement de perspective qui implique un élargissement de la question qui modifie profondément l’approche de l’afropolitanisme. Il parle à partir d’un lieu spécifique : l’Afrique. Ce n’est pas le cas de Taye Selasi. L’afropolitanisme se pense ici comme un dépassement nécessaire et indispensable de trois paradigmes qui, depuis près d’un siècle, ont dominé le discours africain dans les arts, la littérature, la philosophie et les sciences humaines en général. Il s’agit du « nationalisme anticolonial », du « socialisme africain » et du « panafricanisme »10. Mbembe précise encore que « l’afropolitanisme n’est […] pas la même chose que le panafricanisme ou la Négritude » (Mbembe, 2013a, p. 232). Défini comme « une stylistique, une esthétique et une certaine poétique du monde » (Mbembe, 2013a, p. 232), l’afropolitanisme comprend deux moments de l’histoire africaine. Le premier moment dit « proprement postcolonial » est marqué par une rupture esthétique et un changement de paradigme qui vient mettre fin à une « quête du nom perdu » chez les écrivains de la Négritude (Senghor) et à une mystification du « passé glorieux » (Mbembe, 2013a, p. 222). En même temps, il ouvre la voie d’une écriture de soi dépouillée de tout complexe d’infériorité et ouverte sur le monde. Selon Mbembe, Yambo Ouologuem déconstruit les fondements épistémologiques et esthétiques de la Négritude en remplaçant les notions d’« origine », de « naissance » et de « généalogie » par celle de l’« autocréation » et l’ « auto-engendrement ». Ce changement de paradigme a pour conséquence, explique Mbembe, de mettre l’Africain face à son destin, face à lui-même : « ne pouvant plus se raconter des histoires, [il] est comme condamné à faire face à lui-même, à s’expliquer avec lui-même ». C’est ce que Mbembe appelle « la problématique de « l’auto-explication » (Mbembe, 2013a, p. 222). Le second moment que j’appellerai « transnational » correspond « à l’intensification des migrations et l’implantation de nouvelles diasporas africaines dans le monde » (Mbembe, 2013a, p. 224). Il est marqué par deux notions essentielles : la dispersion et la circulation. Il exprime une conscience de soi nouvelle en Afrique, et commune avec ses diasporas, qui consiste à ne plus penser son identité uniquement à partir d’une origine, mais dans une ouverture sans précédent au « tout-monde », explique Mbembe en se référant au « Tout-Monde » et au mouvement de « créolisation » d’Edouard Glissant : « Que ce soit dans le domaine de la musique ou de la littérature, la question n’est plus de savoir de quelle essence est la perte : elle est de savoir comment constituer de nouvelles formes du réel – des formes flottantes et mobiles. Il ne s’agit plus de retourner à tout prix à la scène première ou de refaire dans le présent les gestes passés » (Mbembe, 2013a, p. 224-225).
L’afropolitanisme est donc une notion-programme qui permet aux artistes, écrivains et intellectuels de faire une double réflexion : d’une part, il s’agit de faire un diagnostic de la situation de l’Africain dans notre époque, et c’est alors, grosso modo, de rappeler les différentes formes de représentation et la condition du noir depuis les premiers mouvements transatlantiques jusqu’au « nouvel âge de dispersion et de circulation » (Mbembe, 2013a, p. 224). Taye Selasi, Simon Gikandi, Achille Mbembe partagent tous une même sensibilité critique vis-à-vis de l’assignation identitaire ; ils s’insurgent contre la religion des préjugés et des stéréotypes, et s’inquiètent quant au destin de l’humanité dans un monde dominé par les essentialismes. Pour Mbembe, il s’agit de comprendre, par une observation et une analyse des organisations sociales, les nouvelles conditions nées de la dispersion de l’Africain dans le monde et de voir comment les nouvelles générations afropolitaines négocient leur situation dans un monde globalisé. C’est le passage de la communauté à la multiple appartenance. En définitive, l’afropolitanisme ne serait rien d’autre qu’un processus de métissage biologique et d’hybridité culturelle, de connaissance et de reconnaissance de l’Autre, une approche praxéologique de la relation à Autrui (Todorov11, 1982). Mbembe attribue à l’afropolitanisme une valeur heuristique et parle d’une esthétique d’entrelacement qui permet « de reconnaître sa face dans le visage de l’étranger et de valoriser les traces du lointain dans le proche, de domestiquer l’in-familier […], c’est cette sensibilité culturelle, historique et esthétique […] » (Mbembe, 2013a, p. 229).
Penser autrement l’identité africaine
La perception du concret est sans doute la principale motivation de la réflexion de Mbembe à propos de l’expérience africaine de la circulation des mondes (Mbembe, 2013a, p. 203-237). Cette partie de son œuvre se nourrit de l’expérience sud-africaine (Mbembe, 2013a, p. 236) de l’historien qui renverse, selon un procédé simple et presque mécanique, les représentations habituelles de l’identité africaine. Pour Mbembe, « l’expérience sud-africaine représente peut-être la seule, dans l’histoire de l’Afrique et sa diaspora, présentant autant des chances de conjuguer déclosion du monde et montée en humanité » (Mbembe, 2013a, p. 237).
Une telle démarche n’est pas pour nous étonner. Elle ne fait qu’exprimer, sur un autre plan, ce souci glissantien de la créolisation du monde que nous voyions se manifester dans les précédents chapitres. La réflexion sur la dispersion et la circulation nous oblige à poser la question de savoir « qui est “Africain” et qui ne l’est pas », explique Mbembe (Mbembe 2013a, p. 225). Cette double question nous met en demeure de repenser la culture et l’identité africaines en tenant compte des mouvements migratoires et des flux culturels de ces derniers siècles. La position de Mbembe, me semble-t-il, est en rupture avec les discours dominants et les interprétations traditionnelles sur l’identité africaine qu’elle dénonce. Les approches de la Négritude et du panafricanisme, nous paraissent en effet introduire un clivage important entre les communautés autochtones et allogènes. L’approche de Mbembe ne sépare pas, mais unit au contraire, les faits et l’histoire, la culture et les hommes, la complexité des flux migratoires et les dynamiques transculturelles comme en témoigne ce passage : « si l’Afrique a longtemps constitué un lieu de destination de toutes sortes de mouvements de populations et de flux culturels, elle a aussi, depuis des siècles, été une zone de départ en direction de plusieurs autres régions du monde » (Mbembe, 2013a, p. 226-227).
Mbembe distingue alors deux processus de circulation des mondes : le premier, que Mbembe appelle le processus de dispersion, est historiquement déjà présent dans l’Afrique précoloniale où on assiste à des mouvements internes des peuples pour différentes raisons, qu’il s’agisse des guerres, des mariages, des migrations ou des invasions. Le processus de dispersion sera accéléré par la Traite et l’esclavage à travers le Sahara, l’Atlantique et l’océan Indien. La colonisation, la division de l’Afrique après la partition de l’Afrique à Berlin en 1880 et l’érection des frontières constituent autant d’éléments qui viennent figer cette dynamique. Le second processus de circulation des mondes est celui de l’immersion, qui concerne les populations asiatiques, européennes et arabes venues s’installer en Afrique (Mbembe, 2013a, p. 225).
Ce sont les mouvements successifs des populations et les flux culturels qui autorisent une critique d’une identité africaine construite à partir de la « différence raciale brute » (Mbembe, 2013a, p. 226) qui ne se soucie pas des flux migratoires sur le continent. Mbembe introduit en lieu et place la notion de « citoyenneté africaine », détachée du poids de la race et qui inclut les populations « installées à la faveur de circonstances historiques plus ou moins tragiques » (Mbembe, 2013a, p. 226). Cette approche de l’identité africaine dépouillée de toute forme d’essentialisme, comprise comme une identité artistique et culturelle, dévoile la complexité de la structure des sociétés africaines contemporaines, trop souvent associées à la race noire, avec ses deux pôles, d’une part, la civilisation africaine précoloniale, des récits d’origines et des empires « prise […] dans le maelstrom des guerres, des invasions, des migrations, des mariages mixtes, de religions diverses » (Mbembe, 2013a, p. 227), et, d’autre part, l’Afrique contemporaine née de la « circulation des mondes » où des populations venues de l’Asie, de l’Europe, du Proche et du Moyen Orient côtoient les populations autochtones. En définitive, nous dit Mbembe, l’avenir de l’humanité, et celui de l’Afrique en particulier, est lié à la double « conscience de cette imbrication de l’ici et de l’ailleurs, la présence de l’ailleurs dans l’ici et vice versa » (Mbembe, 2013a, p. 229). Il plaide pour une « […] relativisation des racines et des appartenances primaires » (Mbembe, 2013a, p. 229).
Conclusion
Daniel Delas a proposé de lire De la postcolonie, Sortir de la grande nuit, Critique de la raison nègre comme une proposition de « définir l’être humain d’aujourd’hui à partir de l’Afrique » (Delas, 2013, p. 138-139). Pour A. Mbembe, le discours sur l’Afrique est, non pas un lieu de revendications identitaires, mais une méthode permettant de penser, d’une part, l’Histoire, notamment sa rencontre avec l’Occident, avec ses implications sociales, économiques, culturelles et, d’autre part, de considérer les mutations des sociétés occidentales et africaines comme quelque chose de changeant et de relatif, susceptible de prendre des formes diverses, et difficile à estimer selon une mesure fixe. Les propositions de Mbembe valent par la puissance de la conception de ses œuvres, la solidité de son érudition, la somme d’observations personnelles et d’expériences subjectives qui entre en leur constitution. Il y a donc, dans la pensée de Mbembe, plus d’élasticité, une puissance de renouvellement de paradigme plus grand ; elle se veut en phase avec la réalité continentale. C’est ainsi qu’il est amené à partir d’une analyse de notre contemporanéité, à interpréter les dynamiques internes à l’Afrique et les activités esthétiques et intellectuelles des diasporas établies hors du continent. Les réflexions théoriques de Mbembe rappellent à plus d’un titre celles de Glissant, notamment lorsqu’il aborde la question de la dispersion et de la circulation. Mais alors que Glissant part des Antilles pour décrire un monde qui se créolise, Mbembe médite sur les mouvements de la diaspora africaine et sur le peuplement de l’Afrique contemporaine pour montrer comment un continent souvent décrit comme homogène, habité par une seule race, s’est métissé au fil des siècles. En ce sens profond, il prolonge à partir de l’Afrique, la réflexion de Glissant sur la créolisation et le « nomadisme circulaire », dont il ne fait qu’appliquer plus largement les principes à l’Afrique. Les nuances propres et différentielles de ses thèses sont dans les caractères nécessairement uniques de l’histoire de l’Afrique.
Comme on le voit, les réflexions de Mbembe ouvrent une veine féconde qui a facilité le renouvellement des paradigmes dans les études africaines. Ses différentes études ont eu un écho favorable aussi bien en Amérique du Nord que chez les africanistes Français et Francophones12. En réalité, l’afropolitanisme est d’abord une définition du lieu à partir duquel Mbembe parle. Il s’agit d’un effort d’« auto-explication » et d’ « auto-compréhension ». Mbembe parle à partir de l’Afrique, exactement à l’image de l’Afrique du Sud, une société multiculturelle qui a connu l’apartheid et le rejet de l’autre et qui tente de relever le défi de la pensée raciale. C’est dans cette perspective qu’il opte, tout en critiquant l’humanisme occidental qui ne penserait le Nègre que « sur le mode de la hantise, de la dénégation et de l’effacement », pour un monde post-racial, qui évite le fétichisme de la race. Multiraciale, multireligieuse et multiethnique, l’Afrique du Sud constitue, explique Mbembe « le laboratoire le plus manifeste de l’afropolitanisme » (Mbembe, 2013, p. 233). Ensuite, il s’agit pour Mbembe de voir comment avec le déplacement, la circulation et la dispersion l’Afrique et le Nègre habitent le monde. L’afropolitanisme est synonyme d’une culture transnationale née de l’expérience de plusieurs mondes, des allers et retours entre l’Afrique et le reste du monde, des échanges avec le reste de la planète. Enfin, l’afropolitanisme est une esthétique de l’entrelacement, du mélange et de l’hybride. Il procède d’une transnationalisation des productions culturelles et artistiques.