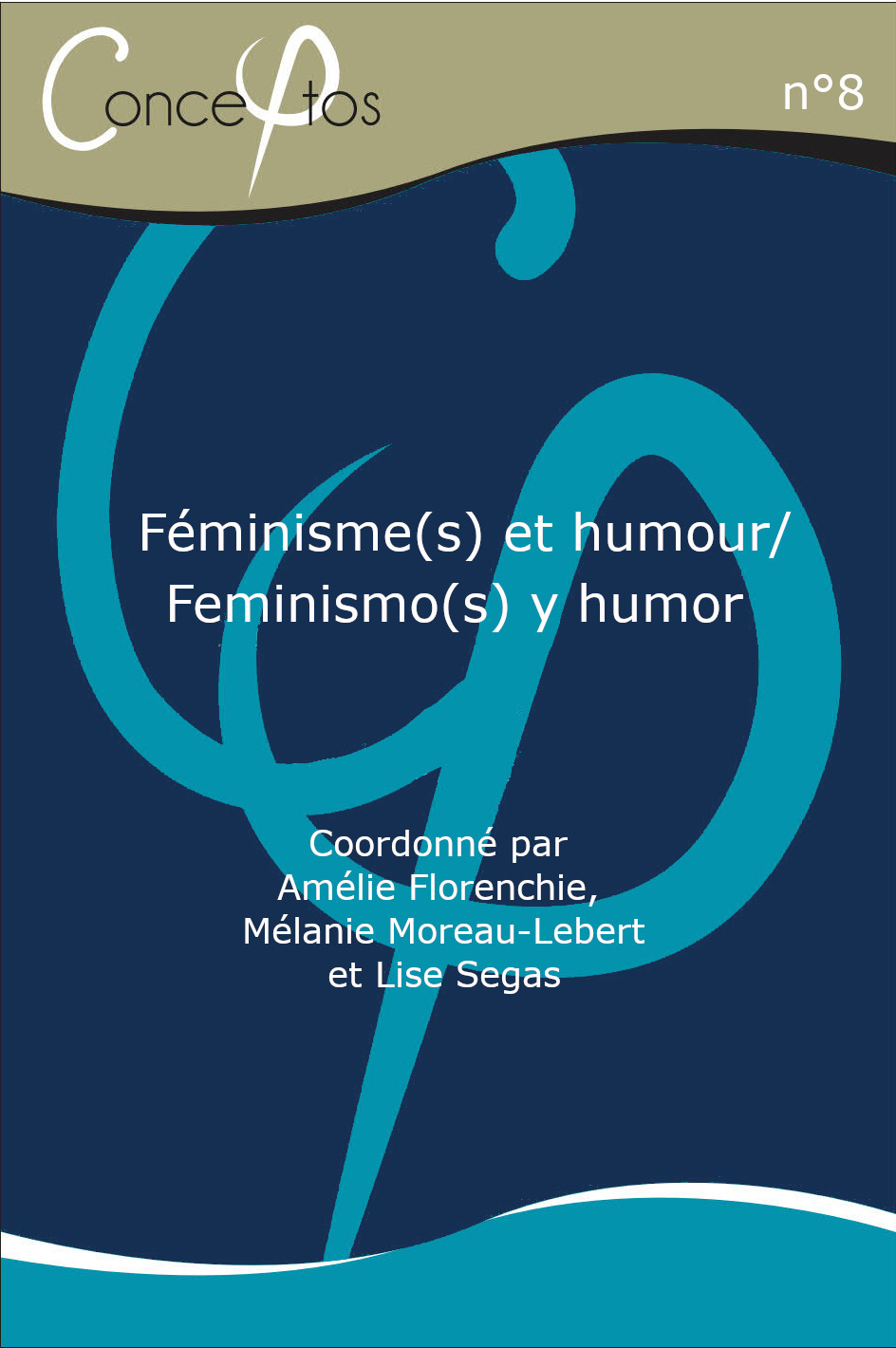Droit canon et scolastique : la question du baptême forcé en Espagne et en Europe au Moyen Âge et à l'époque moderne
Pendant tout le Moyen Âge, d’âpres polémiques ont entouré la question du sacrement de la foi. Pour faire court, on dira que saint Thomas d’Aquin et ses partisans étaient hostiles à la pratique du baptême forcé, tandis que Duns Scot et ses disciples y étaient favorables. Ce conflit entre thomisme et scotisme est à l’origine d’une véritable controverse scolastique sur le baptême, comme ne manque pas de le souligner Elsa Marmursztejn :
La question du baptême forcé a, de fait, donné lieu à des divergences radicales. On verra que la ligne thomiste, hostile au baptême forcé des enfants juifs, est suivie par Richard de Mediavilla, dont Duns Scot conteste directement la solution ; que Durand de Saint-Pourçain rejoint la position de Duns Scot en faveur du baptême forcé des enfants juifs, mais par de tout autres voies ; que Pierre de la Palud confronte les opinions de Thomas d’Aquin et de Durand de Saint-Pourçain et tranche en faveur de Thomas, comme le fera aussi Guido Terreni, qui s’inspire de Thomas et de Pierre de la Palud pour réfuter l’opinion scotiste. Les liens entre les textes font ainsi apparaître un authentique débat qui se cristallise, au tournant du XIIIe et du XIVe siècle, dans l’opposition des opinions de Thomas d’Aquin et de Duns Scot (Marmursztejn, 2016 : 29-30).
À la croisée de tous ces débats, l’enfant représente l’enjeu d’un conflit juridique entre les parents et le prince. Il s’agit d’évaluer les droits de la puissance parentale par rapport aux droits du prince, et de déterminer le statut des infidèles et des Juifs dans la société.
Pour le fil de notre raisonnement, il convient de souligner qu’un cadre juridique bien distinct délimite le baptême des enfants et des adultes. Dans le premier cas, ce qui compte, c’est la volonté des parents qui jouissent de l’autorité (puissance) parentale. Dans le deuxième cas, on prend en compte la raison et le libre arbitre des adultes.
Quelle attitude faut-il adopter à l’égard des infidèles ?
Selon saint Thomas d’Aquin, il existe trois sortes d’infidélité : celle des païens qui n’ont jamais reçu la foi, celle des Juifs qui l’ont reçue en préfiguration ou en figure, et celle des hérétiques qui l’ont abandonnée après l’avoir reçue. Celui qui résiste à la foi qu’il a reçue pèche plus gravement que celui qui résiste à la foi qu’il n’a pas reçue. À ce titre, le péché de l’hérétique est plus grave que celui du Juif et, a fortiori, de celui du païen qui ignore tout de la loi évangélique. Si l’on ne peut contraindre le païen à embrasser la religion chrétienne, il est tout à fait légitime, en revanche, d’obliger le Juif à respecter la religion chrétienne et l’hérétique à vivre comme un chrétien en vertu des promesses faites au moment du baptême (Aquin, Somme théologique, IIa, IIae, Question 10, article 8).
Les décisions prises lors du quatrième concile de Tolède (633) illustrent bien cet état de fait. Le synode prescrit que personne n’use de force pour amener les Juifs à la foi, mais en même temps il adopte des mesures très sévères à l’encontre des nouveaux convertis (ceux que l’on appelle conversos en espagnol) :
Quant à ceux qui ont été jusqu’à aujourd’hui forcés de venir au christianisme, comme cela a été le cas à l’époque du très religieux princeps Sisebut, parce qu’il a été avéré qu’ils ont déjà été assujettis aux sacrements divins, qu’ils ont reçu la grâce du baptême, qu’ils ont été oints du chrême et qu’ils ont eu part au corps et au sang du Seigneur, il convient qu’ils soient obligés de conserver la foi qu’ils ont reçue par la force ou par la nécessité, afin que ne soit pas tenue pour vile et méprisable la foi qu’ils ont embrassée (Dumézil, 2005 : Annexe 3).
Le canon 59 prévoit que les convertis qui continuent de pratiquer les rites judaïques et la circoncision soient corrigés par l’autorité pontificale, ramenés par les prêtres au culte du dogme chrétien et privés de leurs enfants (Aquin, Somme théologique, IIa, IIae, Canon 59). Le canon 60 ordonne que les enfants des Juifs soient enlevés à leurs parents et placés dans des monastères ou des familles chrétiennes « de sorte qu’à leur contact ils apprennent le culte de la foi et que, mieux instruits, ils progressent tant dans les mœurs que dans la foi » (Aquin, Somme théologique, IIa, IIae, Canon 60). Le canon 62 interdit les contacts entre Juifs officiels et chrétiens convertis issus du judaïsme pour éviter toute tentation de retour à la loi mosaïque (Aquin, Somme théologique, IIa, IIae , Canon 62). Le canon 63 oblige les Juifs mariés avec des converties à se convertir au catholicisme sous peine de dissolution du lien matrimonial (Aquin, Somme théologique, IIa, IIae, Canon 63).
Avant l’existence de l’Inquisition moderne, créée en Espagne par les Rois Catholiques à la fin du XVe siècle, ce sont les évêques ou bien leurs représentants (vicaires) qui se chargent de lutter contre l’hérésie dans leurs diocèses respectifs. Le châtiment de l’hérésie s’articule autour de la dialectique de la miséricorde et de la justice. Les hérétiques qui se repentaient de leurs fautes étaient réconciliés avec l’Église, tandis que ceux qui s’obstinaient dans leur erreur étaient remis à la justice civile qui leur appliquait la peine de mort sur le bûcher (« relajación al brazo seglar ») (Alfonso X, 1555 : Partida VII, Título XXVI, fol. 78v-79r.).
Pourquoi ne faut-il pas baptiser les enfants juifs contre la volonté de leurs parents ?
Jusqu’au XVIe siècle, la Somme théologique de saint Thomas d’Aquin, composée au milieu du XIIIe siècle, devint une référence en matière de théologie, car « elle intégrait dans un édifice cohérent aussi bien la métaphysique que la morale et la politique » (Poutrin, 2012 : 17). Voyons les principales thèses développées par les partisans de la ligne thomiste.
— La pratique du baptême forcé est contraire à la nature même du sacrement de la foi.
Le sacrement doit être reçu de façon libre et volontaire, et implique donc l’usage de la raison et du libre arbitre de la part du baptisé. Celui-ci doit exprimer sa volonté de regretter sa vie passée et de commencer une vie nouvelle. Aussi ne faut-il pas baptiser quelqu’un qui dort, un enfant qui est encore dans le sein de sa mère, une personne sous l’emprise de l’alcool, un fou ou un dément. Dans le cas des nouveaux-nés, c’est la foi de l’Église qui vient se substituer à celle de l’enfant :
Par le baptême, on meurt à l’ancienne vie de péché pour commencer une vie nouvelle : “ Nous avons été ensevelis avec le Christ par le baptême en sa mort, afin que, comme le Christ est ressuscité des morts, nous aussi nous marchions dans une vie nouvelle ” (Rm 6, 4). Or, pour mourir à sa vie ancienne, il faut, dit S. Augustin, chez l’homme qui dispose de son libre arbitre, la volonté de commencer la vie nouvelle dont le principe est la réception même du sacrement. Par conséquent, il est requis du baptisé qu’il ait la volonté, ou l’intention de recevoir le sacrement (Aquin, Somme théologique, IIIa, Question 68, article 8).
Selon le rite de l’Église, les catéchumènes doivent affirmer clairement et ouvertement leur intention de recevoir le sacrement du baptême (Catéchisme Concile de Trente, 1923 : 156).
— La pratique du baptême forcé est contraire aux mesures adoptées lors du quatrième concile de Tolède (Aquin, Somme théologique, IIIa, Question 68, article 10)1.
Le quatrième concile de Tolède se tint dans l’église de Sainte-Léocadie le 5 décembre 633. Convoqué par le roi Sisenand, il réunit soixante-deux évêques venus d’Espagne et de la Gaule narbonnaise, sous la présidence de saint Isidore de Séville.
Le canon 57 (De Iudeis) reposait sur un paradoxe juridique dans la mesure où, d’une part, il condamnait les conversions obtenues sous la contrainte et, d’autre part, ne sanctionnait pas ouvertement les baptêmes forcés des Juifs qui eurent lieu sous le règne du roi wisigoth Sisebut dans les années 612-615 (Charenton, 1725 : 597). Comme l’explique saint Paul, ce n’est pas à l’homme de réaliser le salut ou la perte de son prochain, mais Dieu qui « fait miséricorde à qui il veut et endurcit qui il veut » (Romains, IX, 18 : 492). Par ailleurs, en vertu de son libre arbitre, l’homme a la possibilité de choisir entre le bien ou le mal, comme l’a fait Adam en écoutant le serpent, instrument du Diable et cause du péché originel. Il faut donc évangéliser les Juifs par la prédication et non par la force, comme le recommandent les Écritures saintes et la doctrine chrétienne du salut :
Au sujet des Juifs, le saint synode a prescrit que personne désormais n’use de force pour les amener à la foi, « car Dieu fait miséricorde et endurcit qui il veut » (Rom. 9, 18). En effet, ce ne sont pas ceux qui refusent, mais ceux qui veulent qui doivent être sauvés, afin que la justice soit complète. En effet, de même que l’homme a péri en obéissant au serpent de sa propre volonté, de même, en croyant, tout homme est sauvé par l’appel de la grâce de Dieu et par la conversion de son propre esprit. En conséquence, ce n’est pas par la force, mais par le ressort de leur libre arbitre qu’ils doivent être persuadés de se convertir, et non pas obligés de se convertir (Dumézil, 2005 : Annexe 3).
Le décret De Iudeis ne semble pas avoir été appliqué au début du Moyen Âge jusqu’à ce que Gratien l’intègre dans son Décret dans les années 1140. Il rappelait clairement que les Juifs ne devaient pas être forcés à recevoir la foi catholique, mais que si néanmoins ils l’avaient reçue contre leur gré, ils étaient obligés de la conserver (Friedberg, 1879-1881 : vol. 1, Dist. 45, C. 5).
— La pratique du baptême forcé relève bel et bien de l’injustice.
À la suite de décrétistes tels que Huguccio de Pise à la fin des années 1180 ou Jean le Teutonique vers 1216, saint Thomas d’Aquin reprenait l’adage selon lequel il ne fallait faire d’injustice à personne (Aquin, Quodlibet : II, 7). Les Juifs ne devaient pas faire exception à la règle. En effet, en 1122 ou 1123, le pape Calixte II leur avait accordé une bulle de protection (Sicut iudeis) qui réaffirmait l’interdiction des conversions forcées sous peine d’excommunication :
De même qu’il ne doit pas être permis aux Juifs d’oser, dans les synagogues, outrepasser ce qui est permis par la loi, de même ne doivent-ils souffrir aucun tort dans ce qui leur a été concédé. C’est pourquoi, même s’ils préfèrent demeurer dans leur raideur plutôt que de comprendre les paroles cachées des prophètes et reconnaître la foi chrétienne et le Salut, parce que néanmoins ils demandent Notre défense et aide, attachés à la bonté de la piété chrétienne de Nos prédécesseurs d’heureuse mémoire, les pontifes romains Calixte et Eugène, Nous acceptons leurs pétitions et leur accordons le bouclier de Notre protection. Nous décidons donc qu’aucun chrétien ne les force à venir au baptême contre leur gré et leur volonté. Mais celui d’entre eux qui fuira vers les chrétiens pour cause de foi, après que sa volonté aura clairement été établie, qu’il soit fait chrétien sans aucune calomnie. On ne doit pas croire qu’il y a de vraie foi chrétienne pour celui qui n’est pas venu spontanément au baptême des chrétiens, mais dont il est connu qu’il y est arrivé contre son gré […] Mais si quelqu’un, ayant compris le sens de ce décret, osait, ce qu’à ne Dieu ne plaise, aller à son encontre, il souffrirait la perte de ses honneurs et offices ou serait frappé d’une sentence d’excommunication s’il ne corrigeait pas son comportement de manière digne et satisfaisante (Simonsohn, 1988 : 51).
Cette bulle fut reprise par de nombreux papes jusqu’au XVe siècle, notamment par Alexandre III (1159-1181), Célestin III (1191-1198), Innocent III (1199), Honorius III (1216), Grégoire IX (1235), Innocent IV (1246), Alexandre IV (1255), Urbain IV (1262), Urbain V (1365), Martin V (1422) et Nicolas V (1447) (Marmursztejn, 2017 : paragraphe 4). Par ailleurs, Huguccio de Pise fut le premier à déclarer illicite l’enlèvement des enfants non baptisés à leurs parents juifs, car c’était leur faire une grave injustice que de les priver de leur droit de puissance parentale (Marmursztejn, 2017 : paragraphe 17).
— La pratique du baptême forcé est contraire à la coutume de l’Église.
Pour saint Thomas d’Aquin, en matière de norme, la pratique de l’Église doit prévaloir sur les opinions des Pères. La « coutume de l’Église » n’a pas l’habitude de faire ce qui est contraire à la raison. Sous les règnes des empereurs romains Constantin et Théodose, conseillés respectivement par les évêques Sylvestre et Ambroise, l’Église n’a jamais eu recours à la pratique des baptêmes forcés, alors qu’elle aurait pu parfaitement le faire si cela avait été conforme à la raison et à ses intérêts :
Il faut donc s’en tenir plus à l’autorité de l’Église qu’à celle d’un Augustin ou d’un Jérôme ou de quelque docteur que ce soit. Or, l’usage de l’Église n’a jamais admis que les enfants des Juifs soient baptisés malgré leurs parents. Il y eut cependant dans les temps reculés beaucoup de princes catholiques qui furent très puissants comme Constantin et Théodose ; de très saints évêques furent familiers avec eux, comme Sylvestre avec Constantin et Ambroise avec Théodose. Ces évêques n’auraient nullement omis de leur faire porter cette loi si elle était conforme à la raison. C’est pourquoi il semble périlleux d’introduire cette nouveauté : baptiser les enfants des Juifs malgré leurs parents en dehors de la coutume jusqu’à présent observée dans l’Église (Aquin, Somme théologique, IIa, IIae, Question 10, article 12).
La coutume de l’Église s’accorde ainsi avec la loi naturelle exprimée par l’adage juridique selon lequel il ne faut faire de tort à personne (Aquin, Quodlibet, II, 7). La politique de conversion forcée menée par Sisebut constitue, à cet égard, une transgression exceptionnelle par rapport à la coutume observée par de « nombreux princes catholiques très puissants » (Marmursztejn, 2017 : paragraphe 12)2.
— La pratique du baptême forcé empêche l’accomplissement de la prophétie d’Isaïe.
La prophétie d’Isaïe, reprise par la suite par saint Paul (Romains, IX, 27 : 493)3, annonçait la conversion du « reste d’Israël » à l’approche de la fin des temps (Isaïe, X, 20-22 : 37).
La défense de l’unité de l’Ancien et du Nouveau Testament contre les manichéens conduisit saint Augustin à reconnaître un statut propre au peuple juif dans l’économie du salut. Prophète du Christ et de l’Église, en conservant ses rites au milieu des nations, il était le « peuple-témoin » de la vérité chrétienne venue accomplir la Loi et les Prophètes. Saint Augustin développait de la sorte un discours original sur la fidélité de Dieu dans l’élection d’Israël (Massie, 2016 : 551-565 ; Simon, 1983 : 119-120). Comme le dit Elsa Marmursztejn, cette doctrine augustinienne se résume à trois arguments communs : « les juifs déicides devaient être conservés pour être punis de leur crime, comme peuple témoin de la vérité du christianisme et en vue de la conversion finale de leur reste » (Marmursztejen, 2016 : 32).
— La pratique du baptême forcé est contraire au droit naturel.
À la suite d’Aristote (Aristote, Éthique, Livre 5, 1134b 10-11 ; Livre 8, 1161b 18), saint Thomas d’Aquin considère que l’enfant est « naturellement quelque chose de son parent », c’est-à-dire qu’il vit dans un régime initial d’indistinction corporelle qui se prolonge en un régime d’indistinction spirituelle. Autrement dit, tant que l’enfant n’a pas atteint l’âge de raison, il se trouve sous la tutelle de ses parents qui peuvent disposer de lui comme le propriétaire d’un bœuf ou d’un cheval, et lui imposer leur religion. Ce droit de propriété est un droit inaliénable qui l’emporte sur le droit du prince. Cela dit, cette tutelle disparaît dès lors que l’enfant atteint l’âge de raison et peut prendre des décisions qui, parfois, vont à l’encontre même de la volonté de ses parents. Si l’on n’a pas le droit de contraindre l’enfant dépourvu de raison à recevoir la foi, on peut cependant inciter l’enfant doué de raison à y consentir par la douceur et la persuasion :
Une autre raison, c’est que cela est contraire au droit naturel. En effet, par nature, le fils est quelque chose du père. Et d’abord il n’est même pas distinct de ses parents corporellement, aussi longtemps qu’il est contenu dans le sein de sa mère. Mais ensuite, alors même qu’il en est sorti, tant qu’il n’a pas l’usage du libre arbitre, il reste enfermé sous la tutelle des parents comme dans un sein spirituel. Car, aussi longtemps que l’enfant n’a pas l’usage de raison, il ne diffère pas de l’animal sans raison. Aussi, de même qu’un bœuf ou un cheval appartient en droit civil à quelqu’un qui s’en sert quand il veut, de même est-il de droit naturel que le fils avant d’avoir l’usage de la raison demeure sous la tutelle du père. Il serait donc contraire à la justice naturelle que l’enfant, avant d’avoir l’usage de la raison, soit soustrait à la tutelle de ses parents ou qu’une disposition soit prise à son sujet malgré les parents. Mais, après qu’il commence à avoir l’usage du libre arbitre, il commence à être lui-même et il peut, dans ce qui est de droit divin ou naturel, se gouverner. Et alors il faut l’amener à la foi non par contrainte mais par persuasion ; et il peut, même contre le gré de ses parents, adhérer à la foi et être baptisé, mais pas avant d’avoir l’âge de raison. Aussi est-il dit à propos des enfants des anciens pères qu’ils furent sauvés “ dans la foi de leurs parents ”, ce qui donne à comprendre qu’il appartient aux parents de pourvoir au salut de leurs enfants avant que ceux-ci aient l’âge de raison (Aquin, Somme théologique, IIa IIae, Question 10, article 12).
Pour le franciscain Richard de Mediavilla, qui fut régent en théologie à Paris au milieu des années 1280, le pouvoir des parents est bel et bien subordonné au pouvoir de Dieu, dont dépend leur âme, mais la volonté divine ne cherche nullement à limiter le droit de la tutelle parentale :
Bien que les enfants relèvent davantage du pouvoir de Dieu que de celui de leurs parents charnels, Dieu veut toutefois que les parents conservent, intact, le droit qu’ils possèdent sur le corps de leurs enfants ; dans la mesure où ils conservent ce droit intact, baptiser leurs enfants contre leur volonté conduirait davantage, dans la plupart des cas, à déshonorer qu’à honorer le sacrement de la foi (Marmursztejen et Piron, 2004 : 9).
L’honneur du sacrement de la foi et le respect du droit des parents débouchent chez cet auteur sur une condamnation des conversions forcées d’enfants.
— La pratique du baptême forcé met en péril la foi.
C’est ce qu’explique saint Thomas d’Aquin dans la Somme théologique : « Car, si ces enfants recevaient le baptême avant d’avoir l’usage de la raison, dans la suite, en parvenant à l’âge parfait, ils pourraient facilement être entraînés par leurs parents à abandonner ce qu’ils ont reçu sans connaître » (Aquin, Somme théologique, IIa, IIae, Question 10, Article 12). Le précédent historique de Sisebut en apporte la preuve éclatante.
Les conversions massives des Juifs au début du VIIe siècle furent à l’origine des premiers juifs du secret, ceux que l’on appela par la suite les crypto-juifs. En voulant s’attaquer à l’infidélité, le roi créa un nouveau problème : celui de l’hérésie (Charenton, 1725 : 597)4. Ce phénomène de dissimulation religieuse devait être monnaie courante au point que l’on en débattait en 633 lors du quatrième concile de Tolède et que l’on en parlait encore en 653 lors du huitième concile de Tolède :
Les Principaux de la Nation s’assemblèrent, & ils écrivirent au Roi [Récésvinthe] au Nom de ceux de Tolede, & de toute l’Espagne, qui étoient dans le même cas ; pour lui protester que s’ils avoient dissimulé jusques là, n’étant ni tout-à-fait Juifs, ni tout-à-fait Chrétiens, ils étoient résolus de changer de Conduite, en embrassant sincèrement la Religion Chrétienne. Ils assuroient ce Prince qu’ils n’auroient plus aucun Commerce avec ceux de la Nation qui n’étoient point batisés ; qu’ils ne se marieroient plus avec eux ; qu’ils n’observeroient ni le Sabbath, ni la Circoncision ; & que s’ils ne pouvoient se résoudre à manger du Lard à cause d’une longue Abstinence, du moins, ils ne feroient aucun scrupule de prendre ce qui seroit cuit avec de la Chair de Pourceau (Charenton, 1725 : 396-397).
Le problème n’était pas encore résolu à la fin du siècle à en juger par les débats du dix-septième concile de Tolède. En 694, le roi Égica prit la décision de réduire en esclavage et de confisquer leurs biens aux convertis de juifs qui, au-delà du baptême, continuaient de pratiquer en secret les rites et les préceptes de la loi mosaïque (Méchoulan, 2003 : 18-19).
— La pratique du baptême forcé va à l’encontre des droits naturels des esclaves.
Pour saint Thomas d’Aquin, la servitude des Juifs vis-à-vis des princes dans l’ordre civil n’impliquait pas une servitude dans l’ordre des droits naturel et divin. Si, aux dires d’Aristote, « l’esclave n’est pas seulement l’esclave d’un maître, mais encore lui appartient entièrement » (Aristote, Politique, Livre I, chap. 4), celui-ci n’était pas soumis à son maître dans ce qui relevait des nécessités du corps et de l’esprit, et impliquait la conservation de soi et de l’espèce. À titre d’exemple, une lettre du pape Adrien IV à l’archevêque de Salzbourg, datée du milieu du XIIe siècle et insérée en 1234 au Liber extra, interdisait de séparer des esclaves mariés même s’ils s’étaient unis contre la volonté de leurs maîtres (Marmursztejen, 2017 : paragraphe 25). D’après Pierre de la Palud ou Guido Terreni, la propriété n’autorisait pas cependant tous les usages et il y avait des limites à la servitude :
Dans son commentaire sur les Sentences, Pierre de la Palud répond que la propriété n’autorise pas tous les usages. Une esclave était destinée au service de son maître, non à ses plaisirs ; elle ne pouvait être contrainte de se marier contre son gré. De même, bien que le Juif appartienne au prince (quamvis sit res sua), il ne pouvait être contraint au baptême, ni en lui-même, ni en la personne de son fils. La distinction qu’avait opérée Durand de Saint-Pourçain entre le régime des adultes et celui des enfants est supprimée au moyen de la notion de « volonté interprétative » : « Seule la volonté des parents est la volonté interprétative des jeunes enfants avant qu’ils aient l’usage de la raison ». Cet argument imposait des limites strictes à « l’ordre du droit humain dont relevait la servitude ». Guido Terreni étoffe la liste des droits naturels de l’esclave dans son commentaire sur le Décret de Gratien, en y ajoutant le droit d’éduquer ses enfants. Le maître ne pouvait vendre l’enfant, parce que l’enfant ne pouvait être séparé de ses parents tant qu’il n’avait pas l’usage de la raison. Cet argument se fonde sur une analogie qui indique le lien avec le débat sur les rapports entre mariage et servitude : le maître n’avait pas plus le droit de séparer les enfants de leurs parents qu’il n’avait le droit de vendre séparément des esclaves unis par mariage, « en raison du devoir, de droit divin et naturel, par lequel l’homme et son épouse sont une seule chair et sont tenus de se rendre mutuellement le devoir conjugal ; et c’est pourquoi ils doivent rester attachés l’un à l’autre » (Marmursztejen, 2016 : 37-38).
Pourquoi faut-il baptiser les enfants juifs contre la volonté de leurs parents ?
Témoin direct de l’expulsion des Juifs d’Angleterre décrétée par Édouard Ier en 1290, le théologien franciscain Jean Duns Scot était un farouche partisan de l’unification religieuse de la société et des conversions forcées. Il eut un prédécesseur en la personne de Pierre le Chantre qui, à la fin du XIIe siècle, dans la troisième partie de sa Somme sur les sacrements, déplorait que l’Église ne baptise pas les enfants juifs et que la volonté des parents prévale en pareil cas, alors que le sacrement de la foi était la condition indispensable du salut (Marmursztejen et Piron, 2004 : 10).
Pour Duns Scot, le baptême des infidèles apparaissait comme un défi à relever et une mission confiée par Dieu aux princes chrétiens. Pour que se réalise le millénaire de paix, qui devait succéder au règne de l’Antéchrist, caractérisé par des troubles et des convulsions, et hâter le retour de Jésus-Christ lors de la Parousie, il fallait absolument que les Juifs et les musulmans embrassent la foi chrétienne (Milhou, 2007). Dans son commentaire du livre 4 des Sentences, le théologien franciscain faisait savoir qu’il était inutile de tolérer des communautés juives en pays chrétien et proposait un remède, pour le moins curieux, pour permettre à la prophétie d’Isaïe de s’accomplir : déporter un « reste de Juifs » sur une île déserte :
Je dis qu’ils se convertiront en si petit nombre et si tard, qu’il ne serait pas nécessaire que tant de Juifs, dans tant de régions du monde, persistent pendant si longtemps dans l’observance de leur loi ; car le profit que l’Église en retire est, en soi minime. Ainsi, il suffirait qu’un petit nombre d’entre eux aient l’autorisation d’observer leur loi enfermés dans une île, pour que la prophétie d’Isaïe se réalise (Scot, Ordinatio, Livre 4)5.
Au péril pour la foi avancé par saint Thomas d’Aquin, Duns Scot oppose l’argument suivant : l’hérésie est préférable au maintien de l’infidélité, et même si les adultes convertis de force ne seront jamais de « véritables fidèles intérieurement », leurs descendants finiront par l’être avec l’éducation et le temps :
Plus encore, je crois qu’il [le prince] agirait pieusement si les parents eux-mêmes étaient forcés par les menaces et les terreurs à recevoir le baptême, et à le conserver après l’avoir reçu. Parce que bien qu’eux-mêmes ne soient pas de véritables fidèles intérieurement, cependant c’est un moindre mal qu’ils ne puissent pas observer leur loi illicite, plutôt qu’il puisse l’observer librement. De même, leurs enfants, s’ils sont bien éduqués, seront de véritables fidèles à la troisième et à la quatrième génération (Poutrin, 2012 : 24).
C’est exactement la même position que défendait Ferdinand d’Aragon à propos des maures de Grenade juste après la conquête de 1492 :
Le roi répondit : « Quand votre cheval fait un écart, vous ne prenez pas votre épée pour le tuer. Vous lui donnez une tape sur la croupe et vous lui cachez les yeux. Eh bien, mon avis et celui de la Reine est que ces musulmans se fassent baptiser, et si eux ne sont pas chrétiens, leurs enfants ou leurs petits-enfants le seront » (Poutrin, 2012 : 71).
Chez saint Thomas d’Aquin et Richard de Mediavilla, le droit du prince est opposé au droit des parents en tant que tels, tandis que chez Duns Scot le droit du prince est opposé au droit des parents en tant que sujets. Si une personne privée ne peut décider d’enlever leurs enfants aux Juifs et de les baptiser sans leur consentement, sous peine de commettre une injustice, en revanche, le prince « dont les Juifs sont les sujets dans le gouvernement de la chose publique », en a parfaitement le droit. Pour étayer sa thèse, Duns Scot développe l’argument de la hiérarchie des puissances qui stipule que le pouvoir inférieur est obligé vis-à-vis du pouvoir supérieur et que celui qui « résiste au pouvoir, résiste à l’ordre de Dieu » pour paraphraser une célèbre formule de saint Paul (Romains, XIII, 1-2 : 504-505)6. Dans cette logique, le droit des parents est subordonné au droit du prince qui, à son tour, doit réaliser la volonté de Dieu, quitte à contrecarrer la volonté d’un pouvoir inférieur (Marmursztejen et Piron, 2004 : 35)7.
Pour justifier la doctrine des baptêmes forcés, Duns Scot détourne expressément le sens du canon 57 du quatrième concile de Tolède dans lequel le roi Sisebut était loué en tant que « prince très religieux », mais condamné en même temps pour sa politique coercitive à l’égard des Juifs (Poutrin, 2012 : 252)8 :
Le seul argument d’autorité allégué par Duns Scot pour justifier la conversion forcée des adultes, dans le dernier paragraphe de la question, nous reconduit aux temps wisigothiques. L’exemple du roi Sisebut, qualifié de « prince très religieux » par le concile de Tolède pour avoir contraint les infidèles à recevoir le baptême, est l’unique point d’ancrage canonique invoqué en faveur de ce programme de conversion massive « par la menace et l’effroi ». Cette référence est de plus employée en détournant expressément le sens d’un canon qui, dans son ensemble, loin de faire la louange du roi, cherchait surtout à régler le problème posé par son action intempestive : les Juifs baptisés de force devraient conserver la foi chrétienne, mais l’exemple de Sisebut ne devait pas être imité. Le recours de Duns Scot à cette unique autorité canonique signale bien la singularité de sa position et l’originalité d’un propos dont on ne trouve aucun équivalent avant lui […] Duns Scot est ainsi le premier et pratiquement le seul théologien médiéval qui ait prôné des baptêmes forcés d’adultes que le droit canonique prohibait explicitement (Marmursztejn et Piron : 14).
Par rapport à la coutume de l’Église, Duns Scot souligne qu’elle n’était pas immuable et qu’elle devait s’adapter au contexte historique. Ainsi les circonstances de l’Église primitive du temps de Constantin et de Théodose, accommodante avec les infidèles pour des raisons politiques et sociales, n’avait plus rien à voir avec l’Église du XIIIe siècle, solidement ancrée dans la chrétienté latine occidentale :
Ainsi, on peut répondre à ces allégations que l’Église ne force pas les infidèles pour préserver la paix de l’Église, prenant garde aux perturbations qui surviendraient si tous les infidèles, généralement, étaient contraints d’embrasser la foi. Pour la même raison, il en est autrement des saints Sylvestre et Ambroise : parce qu’à l’époque de Sylvestre les chrétiens étaient peu nombreux, et à l’époque du bienheureux Ambroise beaucoup étaient des hérétiques ariens, de sorte que des conversions forcées générales ne pouvaient être menées convenablement. Toutes les choses doivent être faites à leur moment et à leur manière (Poutrin, 2012 : 163).
Aux yeux de Duns Scot, les Juifs ne sont pas seulement les sujets du prince mais aussi des esclaves (Aquin, Somme théologique, IIIa, Question 68, article 10 ; Quodlibet, II, 7) 9. Cette servitude, conçue en terme purement juridique, possède néanmoins une origine théologique, dans la mesure où elle liée à la peine qu’avait valu aux Juifs la négation de la messianité de Jésus et sa crucifixion. Il en découle que les princes peuvent disposer des enfants des Juifs en toute liberté comme s’il s’agissait de leur propre bien. C’est le point de vue que défendait, notamment, Guido de Baisio, surnommé l’Archidiacre :
Je crois que les princes dont les Juifs sont les serfs peuvent leur prendre leurs petits enfants sans aucune injustice, parce que ceux-ci, en tant que serfs, n’ont pas la puissance sur leurs enfants […] De même, les princes peuvent conduire les enfants, comme des biens, vers le baptême, et en cela ils seront méritants, à condition cependant qu’ils ne le fassent pas pour forcer les parents à se convertir mais pour sauver les enfants par le sacrement de la foi, pour la réception duquel il suffit que ceux-ci ne fassent pas d’obstacle de leur propre volonté (Poutrin, 2012 : 166).
Les baptêmes obtenus sous la contrainte sont-ils valides ?
En vertu de la loi divine qui défend de donner au Seigneur des fidèles contraints et des ministres forcés, le sacrement du baptême est nul lorsqu’il est conféré à une personne qui ne consent pas qu’on le lui confère. Cette loi trouve son illustration dans la coutume de l’Église, dans les conciles, les décrets des souverains pontifes, et dans la nature même du baptême qui demande à être reçu librement. C’est donc le degré de contrainte qui détermine la validité ou la non-validité du sacrement.
À la suite d’Aristote et des juristes romains, les canonistes, décrétistes et théologiens médiévaux reprennent la distinction entre contrainte absolue et contrainte conditionnelle.
Dans son ouvrage Summa Decretorum publié en 1164, le canoniste bolonais Rufin distingue trois types de contraintes : modique, « violente et passive » (absolue), et « violente et active » (conditionnelle). Il donne un exemple pour chacune d’entre elles : pour la première, la menace proférée contre un individu d’incendier sa maison le lendemain ; pour la seconde, l’homme dont on saisirait les mains pour l’obliger à faire un sacrifice aux idoles, sans son consentement ; pour la troisième, le couteau placé sous la gorge d’un homme pour lui soutirer un serment. Il explique que la culpabilité de l’individu est engagée dans les cas de contrainte modique, mais non dans les cas de contrainte absolue (Poutrin, 2010 : 495).
Le second exemple renvoie à l’apostasie forcée à Rome aux IIIe et IVe siècles, qui ne relevait pas de l’hérésie si l’individu y avait été contraint de façon absolue :
Après avoir obtempéré aux édits impériaux qui ordonnaient à tous d’offrir de l’encens ou un sacrifice aux divinités romaines, des milliers de chrétiens, désignés comme lapsi (ceux qui ont faibli), demandèrent leur réintégration dans l’Église. Contre les tenants de la tradition pour qui l’apostasie était un péché sans rémission possible, et contre les partisans d’une réintégration rapide des lapsi, la majorité des Églises parvint à prononcer une voie moyenne. La grande persécution de Dioclétien, en 303-311, produisit une deuxième vague de lapsi et renouvela le débat. En Orient, le concile d’Ancyre réuni en 314 introduisit la distinction entre deux cas de figure (canons 3 et 4). Certains fidèles avaient, sans cesser de se proclamer chrétiens et de persévérer dans la foi, été l’objet de contraintes physiques, leurs mains étant prises et posées sur les sacrifices païens. Le concile ne les excluait pas de la communion de l’Église. Les seconds en revanche, avaient été forcés dans les temples à sacrifier aux idoles par des pressions qui n’empêchaient pas toute résistance physique : ils devaient s’astreindre à une année de catéchèse et à trois ans de pénitence (Poutrin, 2010 : 495).
Dans son Commentaire à l’Éthique à Nicomaque, saint Thomas d’Aquin reprend à son compte la différence entre contrainte absolue et contrainte relative. Il explique que, dans le premier cas seulement, la responsabilité morale de l’homme n’est pas engagée. En effet, dans les actions dites « mixtes », l’individu conserve une part de volonté, car il opère un choix réfléchi avant de prendre sa décision :
Ce qui se fait par contrainte est ce dont le principe est à l’extérieur […] ce qui est fait par contrainte exige que l’homme n’y collabore en aucune façon, à savoir par son propre appétit. En ce cas, l’homme est dit opérant en tant qu’il fait quelque chose en contraignant, et on le dit patient, en tant qu’il subit la contrainte. Il [Aristote] donne un exemple. Supposons que le vent, par sa violence, transporte un objet dans un autre lieu, ou, encore, que les hommes qui ont la puissance ou la domination exilent quelqu’un malgré lui, contre sa volonté (Aquin, Commentaire, Livre 3, leçon 1, 387).
Il dit en premier lieu, qu’il y a des actes qu’on fait ou bien par crainte de maux plus grands, maux que l’on craint d’encourir ou bien à cause d’un bien qu’on craint de perdre. Voici un exemple. Si un tyran, maître du sort des parents et des enfants de quelqu’un ordonne à ce dernier de faire des actes honteux à la condition suivante : s’il fait ces actes, ses actes et ses enfants seront saufs, s’il ne les fait pas, ils mourront (Aquin, Commentaire, Livre 3, leçon 1, 388).
Mais parce que les actions portent sur des singuliers, il faut juger davantage de la condition d’un acte d’après les circonstances particulières qu’en s’en tenant à des considérations générales. Voilà pourquoi il dit que les opérations mentionnées plus haut [actions mixtes] sont volontaires au moment qu’elles sont accomplies, c’est-à-dire après considération de toutes les circonstances singulières qui se présentent à ce moment-là ; et c’est d’après ce moment particulier que la fin existe et que l’acte trouve son achèvement (Aquin, Commentaire, Livre 3, leçon 1, 390).
Le pape Boniface VIII (1235-1303) déclare que le baptême est valide dès lors qu’il n’a pas fait l’objet d’une contrainte absolue, et signale que les convertis qui reviennent à la loi mosaïque doivent être poursuivis au même titre que n’importe quel hérétique :
Contre les chrétiens qui passeraient ou reviendraient aux rites des Juifs, même si ceux qui y reviennent ont été baptisés lorsqu’ils étaient enfants, ou par crainte de la mort, du moment qu’ils n’ont pas été l’objet d’une contrainte absolue et précise : on leur infligera les mêmes poursuites judiciaires que contre les hérétiques, si les faits ont été reconnus, qu’ils aient été dénoncés par des chrétiens ou par des Juifs, et de même contre leurs complices et défenseurs, on procédera comme les complices et défenseurs des hérétiques (Poutrin, 2012 : 150).
Jean Duns Scot introduit une nuance subtile entre refuser et ne pas consentir, et défend l’idée selon laquelle la volonté relative équivaut à une forme de consentement dans le cadre du baptême :
Si, en effet, il n’est pas d’accord sous condition, mais qu’il consent dans l’absolu – et cela, non pas à n’importe quelle ablution ou bain, mais à l’ablution telle que l’Église a l’intention de la faire –, il reçoit le sacrement dans l’absolu, car il l’a voulu dans l’absolu, bien qu’il ne l’ait pas voulu sous un certain aspect, et c’est d’un tel individu que parle le concile de Tolède qui est allégué au canon Maiores des Décrétales au titre Du baptême et de ses effets (Scot, Ordinatio, L. 4 ; Poutrin, 2012 : 154).
Dans son Traité sur la récente conversion des païens, rédigé en latin en 1525, le procureur de l’inquisition de Valence, Fernando de Loazes, donne une définition très détaillée des notions de contrainte absolue et de contrainte conditionnelle, définition solidement fondée sur le droit canonique et la théologie :
La contrainte conditionnelle est la suivante : quand l’intention et la volonté de celui qui emploie la contrainte n’est pas précise et absolue, parce qu’il laisse quelque chose à la volonté ou au libre arbitre de celui qui la subit, et l’intention de celui qui subit la contrainte n’est pas de faire opposition de façon totale et absolue. C’est le cas de celui qui est incité à se faire baptiser par quelque contrainte, et qui est menacé de mort ou de quelque dommage au détriment de sa personne et de ses biens, s’il ne se fait pas baptiser, comme il est dit que cela a été fait dans notre cas. Et comme la volonté délibérée de celui qui inflige la contrainte n’est pas de le baptiser qu’il le veuille ou non, mais qu’il laisse à la volonté de celui qui subit la contrainte de décider s’il va choisir la mort ou le baptême, et la volonté de celui qui subit la contrainte n’est pas absolument de ne pas être baptisé, parce qu’il choisit le baptême plutôt que la mort ; ainsi, une telle violence est appelée conditionnelle (Loazes, 1525 : col. 14-14).
Conclusion
Comme nous l’avons vu dans les pages précédentes, le débat sur le baptême forcé s’articule autour de deux questions fondamentales : peut-on obliger un enfant infidèle – et par extension un adulte – à recevoir le baptême contre son gré ? Le Juif qui a reçu le baptême sous la contrainte peut-il revenir à son ancienne religion, ou doit-il observer les rites et les préceptes de l’Église catholique ? À la première question, les thomistes répondent négativement, en se basant, entre autres, sur le droit de la puissance parentale, la coutume de l’Église et la nature même du sacrement, tandis que les scotistes répondent de manière affirmative, en faisant valoir le droit du prince et le statut de sujets ou d’esclaves des Juifs au sein de la société. La seconde question semble remporter un plus large consensus entre thomistes et scotistes. Seul l’individu qui a été conduit aux fonts baptismaux malgré lui, pieds et poings liés, n’est pas considéré comme chrétien, car il s’agit là d’un cas de force majeure et de contrainte absolue. Dans les cas de contrainte conditionnelle – menace de prison, d’exil, voire même de mort –, l’individu, à défaut d’obtenir la grâce sanctifiante, reçoit le caractère du baptême, devenant ainsi membre à part entière du corps mystique du Christ. Le consentement au baptême est alors assimilé à ces « actes mixtes », dont Aristote rappelle qu’ils comportent du volontaire, d’une façon particulière, et de l’involontaire, d’une façon absolue.
Au XVIIIe siècle, M. Gibert, docteur en théologie et canoniste français, rappelait que le consentement était indispensable au baptême, et faisait la distinction entre trois types de baptisés : l’adulte fidèle qui comprend, consent et croit, et bénéficie, à la fois, du caractère et de la grâce sanctifiante du baptême ; le « contradicteur » qui comprend, mais ne consent ni ne croit, et ne reçoit aucun des deux effets du baptême ; et le baptisé sous contrainte conditionnelle qui consent sans croire, et est obligé de respecter les promesses faites au moment du baptême. Laissons-lui le mot de la fin :
On ne doit pas oublier que je ne parle que d’un homme qui ne consent point du tout au Baptême, & non de ceux qui y consentent par la crainte des maux qu’ils jugent plus grands que la réception de ce Sacrement. Tels sont les Juifs, dont parle le Can. 5. Dist. 45. qui furent baptisez par violence sous le roi Sizebut, & contraints ensuite de perséver dans la Foi : les Saxons obligez par Charlemagne de recevoir le Baptême sous peine de mort, cap. de Partib. Saxon. n. 84. 789. & les Hongrois contraints aussi au Baptême sous la même peine, par André I. 1047 (Gibert, 1725 : 197).