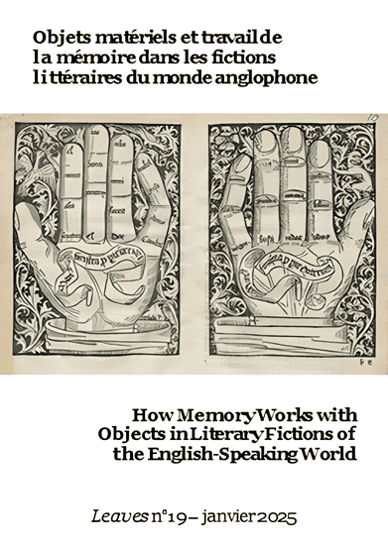Objets matériels et travail de la mémoire dans les fictions littéraires du monde anglophone
Un essuie-plume dans The Years de Virginia Woolf (1937), un porte-document dans Falling Man de Don Delillo (2007), une amphore dans Marine Objects de Suzannah V. Evans (2020). Ces artefacts, qui ont été les outils de l’action humaine, perdent dans les romans et les poèmes une partie de leur valeur instrumentale et deviennent avant tout des objets trouvés ou retrouvés : de possibles points de départ pour le travail du souvenir et celui de l’écriture. Il s’agit bien en l’occurrence d’un travail, d’un effort pour vaincre les résistances d’un matériau : les objets trouvés sont capables de déclencher un mouvement d’anamnèse et de sémiotisation mais ils y font également obstacle par leur matérialité même, qui laisse entrevoir, à travers les objets, l’inhumanité inassimilable des choses muettes et insignifiantes. Dans la perspective phénoménologique de Kant, de Husserl ou de Merleau-Ponty, l’objet existe dans une relation d’interdépendance avec le sujet de la connaissance ; cependant, les textes littéraires qui relient la mémoire et les objets mettent au jour une tension entre l’objet (connaissable et susceptible d’aider le sujet à s’appréhender lui-même) et la chose en soi (inconnaissable par définition et pourtant représentable sur le mode de ce qui fait achoppe, et fait obstacle à la connaissance). En d’autres termes, les textes littéraires qui nous intéressent ici, ceux qui pensent ensemble les objets matériels et le souvenir, font état d’un travail de la mémoire à partir d’un matériau qui lui résiste. C’est l’un des enseignements de la méditation de Marcel dans Du Côté de chez Swann : le choc initial de la reconnaissance qui est procuré au narrateur par la madeleine (petit objet comestible) n’est pas suffisant. Il va falloir se mettre à la tâche, et c’est à l’ « esprit » de Marcel et au texte de la Recherche qu’il revient de faire œuvre d’architecte et de bâtir « l’édifice immense du souvenir » (57). Il est fréquent que les textes littéraires décrivent ainsi les opérations de la mémoire comme un travail. Nous reprenons ici la définition générale que Hegel donne du travail lorsqu’il décrit le rapport entre le sujet au travail et la matière travaillée comme une disjonction, une « séparation, dont part l’esprit au travail, de l’être-en soi, qui devient le matériau qu’il travaille, et de l’être pour soi, qui est le côté de la conscience de soi qui travaille » (576). Précisément parce que le travail est envisagé par Hegel comme une transformation mutuelle (« l’esprit au travail […] devient le matériau qu’il travaille »), cette séparation initiale est amenée à être dépassée de manière dialectique. Or, bien souvent, dans les textes qui articulent objets matériels et travail de la réminiscence, cette dialectique est présente tout en étant problématisée et le travail de la mémoire y apparaît comme un long processus en cours, un work-in-progress empêché, intermittent et fragile. C’est d’ailleurs cette résistance à la subjectivation qui a contribué à faire de l’objet trouvé l’un des thèmes privilégiés des écritures modernistes, dans la mesure où les objets peuvent alimenter une poétique et une esthétique de l’impersonnalité tout en continuant à fonctionner comme des reliquats, des échos métonymiques du passé que le texte récupère à la manière dont le chiffonnier baudelairien collecte des rebuts. C’est l’un des multiples aspects de la fascination du mouvement moderniste pour les objets dont témoigne, entre autres, l’ouvrage dirigé par Cuny et Kalck, Modernist Objects (2020).
Les évocations littéraires de la transformation de certains objets en archives historiques permettent de mettre au jour la complexité et les ambiguïtés d’un autre type de tâche : celle de l’archivage. Dans La Mémoire, l’histoire, l’oubli, Ricoeur montre que l’archivage comporte simultanément une action de conservation (l’enregistrement de la trace documentaire par un auteur institué en position d’autorité) et une action d’interprétation (le document est conservé en tant qu’il est identifié comme une trace révélatrice). Ricoeur insiste par ailleurs sur le caractère nécessairement ancillaire, selon lui, de l’indice matériel dans la démarche historique, du moins lorsque des témoignages oraux ou écrits sont également disponibles, précisément parce que l’objet matériel que l’on archive demeure une trace muette : « La sémiologie indiciaire exerce son rôle de complément de contrôle, de corroboration à l’égard du témoignage oral ou écrit, dans la mesure même où les signes qu’elle décrypte ne sont pas d’ordre verbal : empreintes digitales, archives photographiques et aujourd’hui prélèvement d’ADN — cette signature biologique du vivant — “témoignent” par leur mutisme » (221). Dans l’étude des œuvres littéraires qui mettent en scène les circulations d’un objet matériel, la tension dialectique repérée par Ricoeur entre indice muet et témoignage verbal peut éclairer le rôle spécifique que jouent les objets dans l’élaboration de récits historiques. Dans Mal d’archive, Derrida relève quant à lui que l’archivage est un acte d’appropriation qui recèle toujours une forme de violence : il souligne que la conservation de certaines traces ne va pas sans la destruction de certaines autres, et qu’un tel tri s’inscrit dans un rapport de force imposé par un « archonte », à savoir celui ou celle qui se réclame d’une autorité pré-établie, agit et parle depuis un lieu autorisé, garanti par l’appareil d’une institution. Pour Derrida, la production de nouvelles archives doit donc s’envisager comme l’instauration de nouveaux rapports de force. Ces réflexions d’ordre politique tout autant qu’épistémologique ont une pertinence particulière pour les pans de la littérature anglophone qui retracent l’histoire de l’esclavage et s’interrogent sur les moyens de compenser la rareté des témoignages écrits ou oraux. Elle trouve une résonance avec la réflexion, plus générale encore, que livre Toni Morrison en 1989 sur l’absence de rappels matériels de l’histoire de l’esclavage dans l’espace états-unien : « There is no place you or I can go, to think about, or not think about, or summon the presences of, or recollect the absences of, slaves. […] And because such a place doesn’t exist that I know of, the book had to ».
Pour Toni Morrison, cette absence de lieu et d’objet monumental dans l’espace physique est un appel à produire dans la fiction non seulement une mémoire des corps, des émotions, mais aussi une image des objets de l’esclavage, de façon à produire des lieux de mémoire au sens où l’entend Pierre Nora : des espaces d’ancrage pour une « collectivité » qui les « réinvestit » de ses affects et de ses émotions (Nora 28). Cette dimension collective du travail de la mémoire, si saillante dans les récits de l’esclavage ou de la diaspora, peut être généralisée : on peut poser d’emblée, avec Halbwachs et Bastide, que toute remémoration individuelle s’inscrit dans les cadres collectifs de la mémoire et que le travail qu’elle accomplit sur les objets, ou avec les objets, n’y fait pas exception.
Il y a un intérêt supplémentaire, qui se trouve illustré également dans ce numéro, à envisager le souvenir comme une élaboration à partir d’un matériau perceptif et sensoriel : étudier ce travail mémoriel, qui est accompli dans l’actualité du moment présent, est une manière de souligner la dimension paradoxalement créatrice de l’anamnèse et des écritures de la réminiscence. Lorsque Hirsch développe le concept de « post-mémoire » du traumatisme chez les « générations d’après », elle pose que la post-mémoire n’est pas « une forme particulière de remémoration, mais (un) investissement imaginaire, (une) projection et (une) création » (Hirsch 6). De ce point de vue, le legs d’un objet matériel peut être considéré non pas tant comme une transmission mortifère où quelque chose du trauma se répète à l’identique et se fige, mais plutôt comme le point de départ d’un processus de reconstitution créatrice où s’investissent les expériences de la génération nouvelle dans toute leur nouveauté, et où se dessinent des horizons futurs inespérés. Caruth, en prolongeant la réflexion de Freud sur le traumatisme, souligne, elle aussi, le lien paradoxal qui unit le souvenir traumatique avec un processus de création : dans la mesure où il est impossible, pour celui qui témoigne, de coïncider avec son passé traumatique ou d’accéder à une représentation de ce passé, l’écriture du trauma est le lieu de révélations indéfiniment différées qui ne cessent de relancer la dynamique de l’écriture, comme le souligne aussi l’étude à la fois stylistique et psychanalytique des « écrits en souffrance » chez Amfreville. Caruth rappelle aussi que l’impossible coïncidence du sujet avec son passé traumatique renforce paradoxalement l’ouverture sur l’avenir incarnée dans le présent de l’énonciation par le destinataire du témoignage : « the inherent departure, within trauma, from the moment of its first occurrence, is also a means of passing out of the isolation imposed by the event: that the history of a trauma, in its inherent belatedness, can only take place through the listening of another » (Caruth 10-11). Dans les récits qui sont analysés dans ce numéro, il n’est pas rare qu’un objet matériel perde sa signification première, qu’il subisse un réinvestissement et une réinterprétation à la faveur d’un nouveau moment historique ; il n’est pas rare non plus qu’il change de main et se retrouve pris dans les filets d’une nouvelle biographie, comme le bureau dans Great House de Nicole Krauss (2010), étudié par Paule Lévy dans ce numéro. La dimension de création et d’innovation qui est paradoxalement présente dans le travail du souvenir est alors sensible. C’est ce mouvement de révision que la poésie, le théâtre et la prose narrative sont particulièrement aptes à retracer, lorsqu’ils imaginent la mémoire aux prises avec des objets matériels qui relancent la remémoration et lui résistent tout à la fois.
Ces différents aspects de la mémoire aux prises avec les objets matériels sont abordés successivement dans ce numéro spécial.
La première partie s’intéresse particulièrement au travail de la mémoire comme processus dialectique où les objets sont ressaisis dans un mouvement de subjectivation. Elle met en avant le rôle ambivalent que jouent les objets matériels dans la construction du sujet humain envisagé comme sujet de la mémoire : dans certains textes, l’objet est lieu d’ancrage pour un sujet exilé, dans d’autres, il laisse apercevoir le caractère fondamentalement impersonnel des choses à travers les objets que nous prenons comme supports et étayages de notre subjectivité. Nathalie Vincent-Arnaud et Marie Bouchet s’intéressent aux objets de l’exil. Dans « “Une ample poésie, tissée de mille voix” : La mélodie mnésique des objets dans la poésie de Lotte Kramer », Nathalie Vincent-Arnaud montre que la poésie de Lotte Kramer fait des objets une extension de la voix de leurs anciens propriétaires : les instruments de musique « bruissent des voix éteintes de ceux qui les ont manipulés », les lettres, les billets doux, les télégrammes privés de destinataire sont conservés dans un « musée de l’intime édifié par la mémoire » où la valise devient relique et acquiert une forme de sacralité. La « saisie morcelée qui sous-tend la forme poétique » s’accorde ici mimétiquement avec le caractère parcellaire de ce qui reste des déportés ; toute précaire qu’elle soit, la forme poétique n’en demeure pas moins un geste de saisie, qui réunit, rassemble, pointe les liens entre les objets surgis du passé et les objets présents soudain investis par le souvenir, pour en faire un lieu d’ancrage existentiel. Dans « Writing Objects, Writing Memories: Making Nabokov’s Memory Speak », Marie Bouchet déploie une triple approche des objets chez Vladimir Nabokov. En premier lieu, elle adopte une perspective socio-historique sur les cultures matérielles pour déplier les connotations des objets dans les textes que Nabokov a écrits aux États-Unis. Elle combine cette perspective historiciste à une conception bachelardienne de la mémoire où les souvenirs, pour être conservés et déployés dans la rêverie, ont besoin d’être ancrés dans des lieux ou dans des objets localisés. Enfin, Bouchet analyse la manière dont l’objet matériel fonctionne comme amorce d’un processus d’amplification stylistique et donc comme un foyer poétique. Dans « La fonction mémorielle des objets chez Virginia Woolf et Katherine Mansfield : vers une esthétique de l’objet entre matérialité et surinvestissement symbolique », Elisabeth Lamy-Vialle déplie les interrogations philosophiques et esthétiques contenues dans les romans de Woolf et Mansfield sur la dialectique entre objets et sujets de la mémoire. Selon Lamy-Vialle, Woolf et Mansfield installent un regard ironique sur la charge mémorielle et symbolique excessive que les êtres humains font peser sur les objets, au point que ceux-ci en deviennent des fétiches. Les romans étudiés, empreints d’une « esthétique de la ruine », spauleont jonchés de fragments et de détritus que divers collectionneurs investissent de signification mais dont le texte laisse voir qu’ils sont dépourvus de sens intrinsèque : Lamy-Vialle propose de lire dans les descriptions des maisons vides une métaphore des romans eux-mêmes, envisagés comme textes-tombeaux ou textes-cénotaphes. Dans « “An Amphora Like an Ampersand Found in the Sand”: Found Objects as Traces of Memory in Suzannah V. Evans’s Poetry », les poèmes et collages étudiés par Yasna Bozhkova, les objets trouvés sont les supports de récits d’inspiration surréaliste et l’apparition des objets à la surface devient métaphore du souvenir. La mémoire est envisagée ici comme un processus de transformation : elle est représentée par l’action de la mer sur les objets immergés puis retrouvés sur le sable, à travers une personnification des objets et de la mer. Les objets se font « porte-voix » (« mouthpiece ») en même temps qu’ils résonnent de « la mémoire impersonnelle de la mer », de sorte que les poèmes de Suzannah V. Evans reprennent à leur manière le souci moderniste de quitter les territoires du lyrisme pour inscrire dans l’écriture la terrifiante beauté d’un monde impersonnel.
La deuxième partie du numéro est consacrée aux réflexions de Samantha Lemeunier et de Marie Duic sur l’opération d’archivage, processus de sélection mémorielle qui construit un récit et une image du passé. L’objet est ici envisagé comme trace documentaire susceptible d’être intégrée à un récit historique ou à une vision patrimoniale, de sorte que la dimension collective du souvenir prend une importance centrale. Dans « De l’archive au poème : métamorphoses de la mémoire dans Paterson de William Carlos Williams », Lemeunier propose de penser l’archive avec Michel Foucault comme une articulation entre passé et présent, un « remodelage de l’histoire ayant lieu dans le moment présent de l’énonciation » et qui produit une mémoire façonnée par les discours. À travers les citations, les allusions et les réécritures d’archives qui émaillent le poème, elles apparaissent comme une construction issue d’un processus de sélection et d’omission, une « anarchive » (Derrida) qui remet en question la stabilité de l’archive, sa référentialité, et donc sa garantie de véracité. Lemeunier montre que Williams utilise moins l’archive comme référent que comme signe, faisant écho au rapprochement opéré par Ricoeur entre souvenir et signe linguistique. Il s’agit de concevoir l’archive à la fois en tant qu’objet et en tant que souvenir pour écrire l’absence, l’ « ayant-été » (Ricoeur). En dernière analyse, Lemeunier montre que le poème est conçu, lui aussi, comme une archive : il préserve la mémoire bibliographique de l’écrivain et rend manifeste le processus d’archivage en cours, orienté davantage vers le présent et l’avenir que vers le passé.
Dans « L’autodafé du souvenir : destruction et conservation des lettres dans Cranford (1851-1853) d’Elizabeth Gaskell », Marie Duic montre que les lettres, qui transportent la mémoire des personnages, sont construites dans le texte comme des objets matériels et pas seulement comme des entités linguistiques : ces lettres sont ici des objets d’appréhension sensorielle, des outils efficaces au service de stratégies pragmatiques et des objets doués d’une valeur esthétique. Envisagées avant tout dans leur fragilité, les lettres disparaissent dans les flammes et la précarité du papier fait alors peser un doute sur la pérennité de l’objet-livre ; néanmoins, le texte des lettres survit à leur support originel à travers le texte de Gaskell, qui les archive et les patrimonialise à travers la publication de son roman. La littérature est ici le lieu d’une réflexion sur les notions de trace et d’archive dont la précarité est mise en avant.
Dans la troisième partie du numéro, le travail de la mémoire est envisagé comme une entreprise de longue haleine où se forgent laborieusement des mémoires collectives. L’objet y joue souvent un rôle de médiateur, qu’il s’agisse de créer ou réparer un lien entre plusieurs personnages ou bien de reconstituer les morceaux disjoints d’une histoire transgénérationnelle.
Les articles de Guillaume Braquet, Myriam Ackerville-Sommer et Carla Toquet étudient la transmission et le réinvestissement des objets par la mémoire familiale. Dans « “On the Authority of His Tombstone”: The Double Bind of Memory in Jane Eyre and Great Expectations », Guillaume Braquet explore les paradoxes qui entourent certains objets matériels dans Great Expectations et Jane Eyre : pour Braquet, ces deux récits de formation articulent les objets et la reconstitution d’une généalogie manquante. Il montre comment les deux narrateurs orphelins utilisent certains objets matériels (une pierre tombale, un livre) comme des supports susceptibles d’étayer une image de soi, comme des autorités dont les narrateurs se réclament pour se créer une généalogie et se modeler eux-mêmes. Dans un renversement dialectique, Braquet montre ensuite comment les objets de la diégèse deviennent à leur tour les points de départ de descriptions et de reconstructions où les objets sont à leur tour remodelés par les récits. L’étude serrée des deux textes montre que ce double mouvement de l’écriture autobiographique est essentiel à la compréhension des rapports entre objets, mémoire familiale et roman de formation autobiographique.
Dans « “A Silver Dish” (1978) de Saul Bellow, ou l’objet conflictuel comme substitut métonymique du disparu », Myriam Ackerville-Sommer analyse le rôle d’un objet qui n’est précisément pas un legs d’un père à un fils, mais plutôt un objet de dissension entre père et fils qui cristallise le rejet par le fils de l’héritage du père. Ackerville-Sommer montre le rôle foncièrement ambivalent joué par le plat d’argent dans la nouvelle de Bellow, où l’objet qui a provoqué le corps-à-corps conflictuel entre père et fils est devenu, après la mort du père, une sorte de corrélat et de témoignage d’une absence. Comme l’écrit Ackerville-Sommer, « de même que la postérité du plat d’argent dépend non pas de l’objet lui-même, à jamais perdu, mais du discours sur l’objet, la commémoration du père tient à la préservation d’un portrait en demi-teinte ». Ici à nouveau, l’écriture fait de l’objet matériel le lieu d’une médiation, ou le lieu de la préservation d’un lien inter-générationnel, fût-il placé sous le signe du différend et de l’ambivalence.
Dans « Le gris-gris bag, porte-mémoire ancestral et contemporain dans Sing, Unburied, Sing de Jesmyn Ward », Carla Toquet analyse la manière dont un objet cultuel, un gris-gris vaudou, incarne la passation d’une mémoire traumatique d’une génération à l’autre dans toute son ambivalence. Dans le récit de Ward, la transmission du gris-gris d’un grand-père africain américain à son petit-fils est censée avoir une fonction prophylactique ; l’objet est destiné à conjurer le sort qui semble s’abattre sur les hommes de la famille, tous emprisonnés de façon abusive ou assassinés en toute impunité. Le gris-gris renvoie donc tout autant à l’histoire de la violence raciale qu’au désir d’y mettre fin. Le texte met en relief, par ailleurs, le renversement ironique qui fait du gris-gris un objet incapable de protéger son détenteur contre la violence contemporaine. Comme l’écrit Toquet, « le gris-gris est à la fois ce qui doit perpétuer et mettre fin aux héritages mémoriels ». L’objet joue ici un rôle complexe : c’est un médiateur entre les générations, un symbole de la transmission de la mémoire traumatique, autant qu’un rappel de la partition nouvelle que chaque nouvelle génération doit jouer avec les versions contemporaines de la violence raciale.
Les articles de Caroline Magnin, Patrycja Kurjatto-Renard et Paule Lévy mettent en avant le rôle joué par legs objets dans la transmission d’un trauma mais aussi dans la création d’un souvenir partagé. Dans « “The story […] that goes with the briefcase” : l’objet porteur d’histoire et de mémoire dans Falling Man de Don DeLillo », Caroline Magnin montre comment une mémoire commune se construit à travers le porte-document et d’autres objets (plus discrets) qui passent de main en main dans Falling Man. Magnin montre comment ces objets sont les révélateurs du fonctionnement psychique post-traumatique mais sont aussi des « embrayeurs narratifs » (Tréguer) qui permettent de faire advenir, par le discours, le lien interpersonnel et le souvenir commun, tout en soutenant le travail de deuil. DeLillo, dans ce roman à plusieurs voix, articule les subjectivités pour appréhender un événement d’une portée immense, à la fois nationale et mondiale, dépassant de loin l’échelle individuelle et familiale.
Dans « How Memory Works Through Things: Memory Objects in Phyllis Alesia Perry’s Stigmata », Patrycja Kurjatto-Renard pose la question du lien entre mémoire individuelle et collective, en particulier dans le cas des transmissions intergénérationnelles. Comment la post-mémoire (Hirsch) affecte-t-elle les générations dans le contexte de la littérature africaine-américaine, et quelle est la place de l’histoire propre au sujet individuel lorsque la mémoire des générations antérieures est chargée de souvenirs traumatiques ? Face au manque de sources écrites pour assembler l’histoire de l’esclavage, l’oralité et les objets matériels viennent combler les lacunes de l’Histoire écrite pour dire l’histoire des personnes réduites en esclavage. Malgré la distinction essentielle entre indices matériels muets et témoignages oraux que relève Ricoeur dans La Mémoire, l’histoire, l’oubli, Renard montre que dans Stigmata, les objets matériels et les récits oraux sont travaillés ensemble par la mémoire. L’impossibilité de la représentation du trauma pour lequel le langage fait défaut ou bien se révèle inadapté (Caruth), oblige pour ainsi dire à accorder du crédit et une place de choix à l’objet matériel, quand celui-ci peut constituer une meilleure réponse ou un meilleur outil de travail que le médium linguistique, lorsqu’il s’agit de reconstituer une histoire lacunaire. Dans Stigmata, le quilting symbolise l’activité de rapiéçage par la mémoire d’épisodes disjoints ; son résultat, le patchwork, n’est pas seulement une métaphore élégante du travail de reconstitution du passé : il convoque et provoque le souvenir in vivo chez la protagoniste qui reçoit directement, par le biais de l’objet-médiateur, l’image mnésique que seul le discours du témoignage est, en principe, capable de transmettre. L’objet dit l’histoire de l’aïeule d’une façon plus urgente, plus concrète, plus incarnée que les mots. Ces souvenirs dotés d’une matérialité qui semble échapper au sujet rappellent ce que Sethe dans Beloved (Toni Morrison) appelle les rememories, ces souvenirs qui paraissent doués d’une certaine autonomie par rapport au sujet qui a vécu les événements, qui sont tributaires du territoire où les événements se sont produits, et qui peuvent surgir à tout moment pour heurter et affecter la personne croisant leur chemin.
Dans « Objets sans histoire : l’absence en héritage dans Great House de Nicole Krauss », Paule Lévy mobilise avec Hirsch la notion de post-mémoire, qu’elle définit comme « l’expérience de générations désormais à distance de l’événement mais profondément marquées par lui ». Ce bureau revêt une double fonction : il donne à dire et à voir, mais il dissimule aussi. Matérialisation d’un fardeau mémoriel, il passe de propriétaire en propriétaire et figure la transmission entre les générations d’un deuil inaccompli, tout en demeurant muet. Pour Lévy, la structure du roman ressemble à celle d’un témoignage travaillé par un trauma, fourmillant de réminiscences et de liens plus ou moins ténus entre les différents épisodes qui semblent indiquer, sans le poser explicitement, une analogie secrète entre les moments du présent et ceux du passé : « le passé et le présent sont paradoxalement perçus en termes de contiguïté et non plus de séquentialité ».
Dans les articles de ce numéro consacré aux objets et au travail de la mémoire, on observe que l’objet-porte mémoire révèle souvent la richesse de sa signification au moment où il change de main et tombe en déshérence avant d’être retrouvé par quelqu’un. Morceau détaché du passé, matériau disponible mais pas encore transformé en archive ou en souvenir-fétiche, l’objet trouvé révèle par une mobilité encore sans attache sa force dynamique, sa capacité à émouvoir mais aussi à relancer la remémoration collective qui a lieu, entre autres, dans les textes que nous lisons. Ainsi, dans Falling Man de Don DeLillo, ce porte-document qui passe de main en main et descend en rythme les escaliers d’une des tours jumelles du World Trade Center, le 11 septembre 2001. L’objet est alors récupéré par le protagoniste sans y penser (« blankly »). C’est pourtant dans ce mouvement machinal et anonyme, celui qui a fait circuler l’objet et l’a préservé de la destruction, que s’esquisse le geste de transmission et de partage du souvenir traumatique qui est au cœur du texte.
Pass it down.
This goes down.
This goes down.
The briefcase came down and around the stairwell, hand to hand, somebody left this, this goes down, and he stood looking straight ahead and when the briefcase came to him, he reached his right hand across his body to take it, blankly, and then started down the stairs again. (DeLillo 246)
Bibliographie
- Amfreville, Marc. Écrits en souffrance. Figures du trauma dans la littérature nord-américaine. Michel Houdiard, 2009.
- Bachelard, Gaston. La Poétique de l’espace. PUF, 2020.
- Bastide, Roger. « Mémoire collective et sociologie du bricolage ». L’Année sociologique vol. 21, 1970, pp. 65-108.
- Caruth, Cathy (dir.). Trauma: Explorations in Memory. Johns Hopkins University Press, 1995.
- Cuny, Noëlle, and Xavier Kalck (dir.). Modernist Objects. Liverpool University Press, 2020.
- DeLillo, Don. Falling Man. 2007. Picador, 2011.
- Derrida, Jacques. Mal d’archive. Galilée, 1995.
- Evans, Suzannah V. Marine Objects / Some Language. Guillemot Press, 2020.
- Halbwachs, Maurice. Les Cadres sociaux de la mémoire. Albin Michel, 1925.
- Hegel, Georg Wilhelm Friedrich. Phénoménologie de l’esprit. Trad. Bernard Bourgeois. Vrin, 2018.
- Hirsch, Marianne. « Postmémoire » entretien avec Soko Phay-Vakalis et Pierre Bayard pour Art Absolument n° spécial « Création et Postmémoire », Avril 2013.
- Husserl, Edmund. Méditations cartésiennes et introduction à la phénoménologie. Trad. Emmanuel Lévinas et G. Peiffer. Vrin, 1992.
- Kant, Emmanuel. Critique de la raison pure. Trad. Alain Renaut. Garnier-Flammarion, 2017.
- Krauss, Nicole. Great House. Norton, 2010.
- Merleau-Ponty. Phénoménologie de la perception. Gallimard, 1976.
- Morrison, Toni. Beloved. Alfred Knopf, 1987.
- Morrison, Toni. « A Bench by the Road », World: Journal of the Unitarian Universalist Association, Vol. 3 no.1, 1989.
- Nora, Pierre. « Entre Mémoire et Histoire : la problématique des lieux » in Pierre Nora (dir.), Les lieux de mémoire. Tome 1 : La République. Gallimard.
- Nora, Pierre. Les lieux de mémoire, vol. 1. Quarto-Gallimard, 1997.
- Proust, Marcel. La Recherche du temps perdu. Tome 1 : Du côté de chez Swann. Gallimard, 1954.
- Ricoeur, Paul. La Mémoire, l’histoire, l’oubli. Seuil, 2000.
- Woolf, Virginia, The Years. 1937. Grafton, 1990.