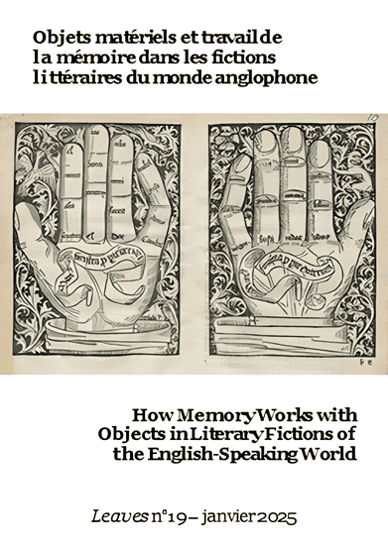« Une ample mélodie, tissée de mille voix » : la mélodie mnésique des objets dans la poésie de Lotte Kramer
Abstract: Born in 1923 in Mainz, Lotte Kramer, of German-Jewish origin, came to England with the Kindertransport at the beginning of the Second World War. She is the author of several collections of poems in English, the only language she has ever used as a writer. While her poems give free play to the painful echoes of exile, they are also a vivid tribute to people and places, to the emotional power of arts and objects. Her poetry could be defined as a series of verbal outbursts gradually breaking through the silence of an individual, familial and collective story while bringing to light various episodes of existential disruption and reconstruction. Objects play a significant part in this dual process, being woven into the fabric of the poems as remnants of a past that needs to be deciphered or details of a daily life that paves the way for further investigation. The present article examines the various occurrences of these objects and questions their poetic scope.
Keywords: Exile, History, Kindertransport, Memory, Objects, Poetry
Résumé : Née en 1923 à Mayence, d’origine allemande et juive, Lotte Kramer est arrivée en Angleterre avec le Kindertransport au tout début de la Seconde Guerre mondiale. Elle est l’auteur de plusieurs recueils poétiques en anglais, qui est son unique langue d’écriture. Si ses poèmes font résonner les échos douloureux de l’exil, ils n’en sont pas moins un hommage vibrant rendu aux êtres et aux lieux, au pouvoir émotionnel des arts et des objets. Sa poésie peut se définir comme une série d’envolées verbales qui, peu à peu, fait se déliter le silence d’une histoire tout à la fois individuelle, familiale et collective, exhumant divers épisodes de fracture et de reconstruction existentielles. Les objets jouent un rôle essentiel dans ce processus duel, s’insinuant dans la texture des poèmes comme vestiges d’un passé à déchiffrer ou détails d’une vie quotidienne qui ouvre la voie à de nouveaux questionnements. Le présent article envisage les diverses modalités d’apparition de ces objets ainsi que leur résonance poétique.
Mots clés : Exil, Histoire, Kindertransport, Mémoire, Objets, Poésie
« Que ce soit le chant d’une lampe ou bien la voix de la tempête, que ce soit le souffle du soir ou le gémissement de la mer, qui t’environne—toujours veille derrière toi une ample mélodie, tissée de mille voix, dans laquelle ton solo n’a sa place que de temps à autre. Savoir à quel moment c’est à toi d’attaquer, voilà le secret de ta solitude » : ce bref extrait de Notes sur la mélodie des choses (1898) de Rainer Maria Rilke (XVI) semble se faire allégorie de la venue à l’écriture, et singulièrement à la poésie, de Lotte Kramer. Cette poésie est dépositaire en tous lieux, dans toutes les bifurcations de la pensée et de la sensation, d’une mémoire hantée. Entre les voix oubliées ou secrètes qui surgissent, le solo en forme d’ostinato de la voix poétique se déploie inlassablement au fil des morceaux épars d’une vie passée épousant pour l’essentiel les remous d’une sombre période de l’Histoire : la Seconde Guerre mondiale, la Shoah, le kindertransport. C’est ce dernier qui a conduit en Angleterre Lotte Kramer, née en 1923, d’origine juive-allemande, arrachée à sa terre, à sa famille plus tard déportée ou exilée, à ses vocables d’origine, et devenue, par l’emploi exclusif de l’anglais comme langue d’écriture, autrice britannique à part entière d’une œuvre dans laquelle « l’intimité de l’écrivain rejoint la dimension tragique de l’Histoire » (Hubier 54).
Viatiques du voyage mémoriel, des retrouvailles avec une altérité édificatrice, exhumant peu à peu un moi « tissé d’autres » (Huston 158) et devenu chambre d’échos, les objets qui jalonnent cette poésie, participant du champ du souvenir ou de la perception immédiate, bruissent des voix éteintes de ceux qui les ont manipulés, qui y ont imprimé leur marque, qui les ont fait résonner et se charger d’une expressivité que le temps et une oreille à l’affût font peu à peu advenir. Au nombre de ces objets figurent sans grande surprise ces extensions privilégiées d’une voix et d’un souffle éteints que sont les instruments de musique, tels, dans le poème « Recorder » (Kramer 337), la flûte à bec pieusement conservée d’une professeur de musique aimée que la montée du nazisme a conduite au suicide, ou encore, dans « Threnody for a piano teacher » (Kramer 47-48), le piano dont la plainte lancinante (« Its long lament »), chant du cygne de l’instrumentiste engloutie de son plein gré par les eaux du Rhin, s’insinue avec obstination dans le souvenir. De même, les éléments les plus ténus, les plus inattendus, les plus censément insignifiants ou anodins du monde alentour peuvent ainsi se faire perturbateurs du quotidien, amorçant un dialogue avec un passé jusque-là relégué au silence, à l’instar de ces pages et images « qu’on ne cherche pas mais qui vous hèlent doucement quand on fouille au hasard » (Delerm 145).
Fragments intimes
Si Lotte Kramer s’est tout d’abord consacrée à la peinture en amateur, art qui a de toute évidence, fourni une grande partie de son socle identitaire et du mode d’inspiration et de réflexion qui en a résulté, elle ne s’en est pas moins tournée, à la fin des années 1960, vers une écriture poétique qui a donné lieu à une production abondante et quasi ininterrompue jusqu’en 2015, date de parution de ses derniers poèmes connus et publiés à ce jour. Le caractère foncièrement autobiographique de cette poésie, qui oscille parfois entre confessionnalisme et mémorialisme par son alternance entre élans intimistes et attention portée à des événements historiques, s’affirme avec force dans la préface autographe du volume More New and Collected Poems (2015) :
In 1968 we moved from the London area to Peterborough because of my husband’s new job. After many years in Cosmopolitan London, it was a big change and although I loved the countryside, I felt isolated. […] It sent me back to the early years, when I was transplanted to England from a close family unit and I was an alien when war broke out.
Memories of childhood in Nazi Germany, which I had buried for many years, came back and insisted on being written about. I tried prose, not successfully, then poetry which I have always loved. There were some very good teachers at our Jewish school in Germany and poetry was my favourite subject. I began to read English poetry, heard a programme on Emily Dickinson on the BBC and that was my start. I began to write seriously and memories came flooding in. (Kramer 7)
Si le goût prononcé pour la poésie s’enracine de toute évidence dans un passé lointain, celui de l’enfance allemande, il est revivifié chez l’adulte par la rencontre fortuite avec une poétesse dont la veine intimiste et l’exploration obstinée de l’infime trouvent, chez Lotte Kramer, une résonance singulière lui permettant, de proche en proche, de céder à l’impulsion de cette « scriptothérapie » (Henke xii ; ma traduction) qui anime sa démarche poétique selon le principe défini par James Pennebaker : « writing about the thoughts and feelings associated with traumas […] forces individuals to bring together the many facets of overwhelmingly complicated events » (Pennebaker, in Pellicer Ortin 49). L’irruption de la poésie dans un quotidien de femme et d’épouse confinée à la solitude de son foyer peut, chez Lotte Kramer, s’entendre comme la découverte soudaine d’une chambre à soi qui se mue peu à peu en cabinet de curiosités où s’accumulent, sous forme de fragments, les instants et objets de la vie capturés et contemplés par la mémoire ou par une observation directe mêlant étroitement le présent et les diverses strates du passé. Même si certains poèmes présentent une dimension narrative patente – itérative ou singulative – qui fait défiler les portraits ou les épisodes cruciaux des vies scrutées (celle de l’autrice, celles des membres de sa famille et d’un entourage à présent disparu), cette saisie morcelée qui sous-tend la forme poétique et régit la succession des événements scripturaux qu’elle déroule met à mal l’ordonnancement temporel et structurel caractéristique de la plupart des écrits autobiographiques. Une évocation de l’année 1933 surgit ainsi en toute fin de volume (« 1st April 1933 (Death of my Grandfather) » [Kramer 405]) selon l’ordre aléatoire imposé par la mémoire et, en amont, par la perception des objets et éléments du décor environnants qui la sollicitent et donnent corps à ce qu’elle renferme. Le recours à la forme poétique implante au sein du genre ainsi recartographié une de ces voix nouvelles voix « alternatives » (Pellicer Ortin 225) dont l’émergence trouve de toute évidence ses origines dans le trauma et dans la désorganisation identitaire qu’il engendre et qui devient palpable. Cette série de fragments, d’instantanés, d’apparitions – au sens où le poème « fait apparition » (Maulpoix 73) sur la page par son unité et son relief graphiques – offre ainsi un écho visuel et structurel à cette identité « morcelée » (« parcelled ») qui forme l’élément central de l’autoportrait présent dans le poème « Dream Train » (Kramer 361) :
This train never stops.
I’m a parcelled person
In its warm movement,
Assured of eventual stations.
Objet emblématique du décor mémoriel, le train des origines de l’exil fait ici retour sous forme de métaphore du mouvement perpétuel de l’identité et des « stations » de la conscience auctoriale et de la voix poétique qui en émane, habitée de fragments à perpétuer et à rassembler. Il contribue à dévoiler, en même temps que l’instabilité constitutive du périple ainsi effectué, la toute-puissance des objets, leur « curieuse aptitude […] à s’animer, à agir, à produire des effets spectaculaires et subtils » (Bennett 6 ; ma traduction), à faire œuvre dans l’esprit et, corrélativement, sur la page qui en manifeste l’empreinte indélébile par un dessin versifié souvent évocateur, appelant le regard et la confrontation sensible.
Surgissements
Attaquer (pour reprendre le terme de Rilke) comme le musicien le fait avec son instrument, le chef d’orchestre avec sa baguette pour rompre le suspens, articuler un langage autrement voué au silence, s’engager dans une lutte avec ce silence par lequel on sait que toute écriture après la Shoah est tentée (Steiner 7) : tel est le moteur d’une écriture dont la voix emplie, via son cheminement intérieur, des échos d’une altérité multiforme, s’élance à travers le cri, l’effraction, la déchirure du silence. Le poème auquel ce geste fondateur donne son titre (« The Cry » [Kramer 43]), paru dans le tout premier recueil et reproduit au tout début du volume général, fait résonner un souvenir pictural, celui d’Edvard Munch dont d’autres échos sont disséminés au fil des poèmes sous forme de mention explicite de certains tableaux, objets d’une contemplation incessante :
So I gave my time to shapes,
To tone and line;
And willed a potent sleep
To thought and word;
I tried to peel the distance,
Choke its voice;
I went into the fields
To count their form;
And rimmed each tree with light
To tell its dark;
And echoed coloured earth
Behind the clouds.
I let my eye decide,
My arm translate;
I froze the ache of silence
Into paint:
Only to hear the cry
Expose a need
That knows no end in us…
La poésie qui s’édifie ainsi se fait le plus souvent anamnèse à l’infini, épousant ce « That knows no end in us » dont la suspension finale augure un processus d’engendrement effréné, Lotte Kramer n’ayant cessé d’écrire à plus de 90 ans au fur et à mesure que les souvenirs l’ont assaillie pour se frayer un chemin impérieux à travers sa conscience. Les poèmes font ainsi advenir ce « retour de fantômes » (Didi-Huberman 9) préalable à l’écriture qui n’est autre que le souvenir ou la présence palpable des objets liés, de manière évidente ou plus diffuse, aux diverses époques traversées : l’’enfance allemande et son cortège d’ombres le plus souvent livrées à des destins funestes, déportations, exactions multiples, exil ou suicide ; les années en Angleterre, lieu d’une seconde naissance ouvrant la voie à un entre-deux identitaire et entraînant à jamais l’autrice dans l’irrésolu. La contemplation, mémorielle ou réelle, des objets, par-delà l’authentique jouissance sensorielle et esthétique qu’elle peut procurer, se fait bien souvent contemplation du mystère, celui des origines, d’un univers disparu dont les parois jusque-là étanches sont sans cesse défiées et le plus souvent ébréchées par les assauts de la voix poétique. Au fil des surgissements aléatoires de la mémoire, cette voix s’acharne à détourer, à singulariser figures et objets ; et l’œil du peintre que fut Lotte Kramer est ici pleinement à l’œuvre, comme le montre le retour régulier, tout au long du volume, de titres faisant signe vers le portrait, la miniature ou encore les éléments de la nature, dont la voix poétique s’attache à exalter la vitalité et la substance édificatrice.
Tel cet « arpenteur » à l’affût des « musées désertés » et autres « collections de curiosités » qu’est, selon Lynne Sharon Schwartz, le narrateur dans les romans de W.G. Sebald (Schwartz 13) où exil et mémoire hantée du kindertransport jouent un rôle majeur, Lotte Kramer multiplie les arrêts sur image, sur ces signaux de vie que constituent les objets de l’enfance allemande ou des années en Angleterre. Perdus ou conservés, enfouis ou retrouvés, remémorés, entraperçus, côtoyés, ceux-ci deviennent pour l’imaginaire autant de contours à épouser, de surfaces à percer, d’espaces à pénétrer pour ranimer, amener à une existence verbale des voix, des regards, des silhouettes. Jaillissant ainsi de l’ombre au détour des errances de la mémoire et du regard, ils s’immiscent dans le flot des poèmes pour donner un corps sensible à la quête identitaire et à ce qui la nourrit, acquérant ainsi une fonction primordiale qui, « débordant toute autre, est de signifier, d’incarner, de réitérer la mémoire d’un temps passé » (Caraion 316).
Viatiques et reliques
Viatique du voyage, initiatique, de ce kindertransport qui fournit le terreau de la mémoire, telle est la fonction évidente que revêt l’un des objets les plus emblématiques de la dynamique de passage, de flux, d’entre-deux incessant qui caractérise les poèmes. Il s’agit de la valise de ce premier voyage, qui subsiste dans un de ces greniers dont l’évocation se répète au fil du recueil, depuis le grenier de la maison d’enfance où la famille se réfugia pour échapper à l’intrusion des Nazis (« Attic » [Kramer 47]) jusqu’à celui de l’adulte exilée (« Suitcase » [Kramer 294]) :
Grey and tattered it stands in the attic
Having accomplished sixty odd years
Of survival and childhood memories,
Stuffed tight with mother love and heartache,
Unable to forget the packed trains
Of ownerless children and platforms of tears
Its pock-marked skin a testimony
And emblem of such histories.
[…]
Courroie de transmission entre deux mondes comme elle l’est dans la pièce Kindertransport de la dramaturge britannique Diane Samuels où, d’une scène à l’autre, elle possède une réalité physique de premier plan, la valise devient de proche en proche, dans les strophes suivantes, la métaphore d’autres exils en gestation dans un monde contemporain livré aux incertitudes des guerres et des arrachements. Elle s’inscrit ainsi dans une chaîne interminable de « reliques » – terme dont l’’quivalent littéral anglais donne son titre à l’un des poèmes (« Relics » [Kramer 117]) – dont l’évocation s’obstine, s’affichant bien souvent dès les intitulés des poèmes ou s’insinuant au détour de la ressaisie d’un moment de vie. S’il est bien difficile de se livrer à un recensement exhaustif de ces reliques, de ces objets surgis du passé, pieusement conservés, ou encore des objets inscrits dans un présent au sein duquel ils font s’engouffrer les souvenirs d’autres objets et scènes du passé, un recensement partiel des seuls titres des poèmes suffit à donner un aperçu éloquent de ce dont s’abreuve la mémoire. Lunettes, lettres d’amour, nappe, jeu d’échecs, cerises, framboises, petits pois, papier peint, arbre, foin, pont, articles de papeterie, cartes de vœux, livres, chocolat noir, baromètre, tapis persan, livres, botte (orpheline, l’autre ayant été emportée par les Nazis au terme d’une exaction), mais aussi, comme on l’a déjà entrevu, instruments de musique et tableaux multiples : tels sont, entre autres éléments d’un décor révolu ou présent, certains des repères qui composent cette « géographie magique » (Richard 13) à laquelle l’esprit s’arrime pour déambuler entre deux mondes, deux strates spatio-temporelles, mais aussi parfois deux personnes animées, à des années d’intervalle, du même geste, du même rituel sensoriel ou d’un état d’esprit similaire. Il en est ainsi du chocolat noir amer dont le goût soudain révélé à l’âge mûr relie l’auteur à sa grand-mère (« Bitter Chocolate » [Kramer 276]) ou encore de ce moulin à café dispensateur de sensations dont la puissance parvient par ricochets à convoquer les images de deux figures tutélaires du passé (« Coffee Grinding » [Kramer 130]), la seconde se chargeant de résonances plus lointaines :
Grinding the coffee in my moulinex
The beans explode their old aroma here.
It clears the ashes out of sleep.
My mind returns to kitchens where I played:
I see our maid, broad on a stool, machine
Placed firmly between thighs:
[…]
I am reminded of another scene:
There, in the synagogue my mother stands
All day to fast and pray;
To keep her from a faintness now I bring
Some coffee finely ground, wafting a strength
Into her silent fears.
L’accueil dans le silence de ces deux facettes féminines contrastées du passé que sont la présence charnelle et protectrice de la bonne et la vulnérabilité inquiète de la mère donne la mesure de la dualité qui a forgé les assises existentielles de l’adulte actuelle livrée simultanément à la jouissance du présent et au sentiment de la perte irréversible. La sensation née de l’objet se fait ainsi tout autant exhumation, magie actualisatrice et dispensatrice d’un authentique plaisir sensuel qu’avènement d’un temps suspendu, tout de nostalgie et de stase réflexive, de communion avec une figure perdue.
Les manifestations de cette toute-puissance suggestive des objets les plus quotidiens se multiplient au fil des poèmes, telle la nappe de la grand-mère utilisée chaque jour dont la trame clairsemée fait surtout affleurer une béance et une déchirure intérieures par contraste avec les temps plus paisibles où l’objet a été fabriqué (« I grieve not for its breach / But for the broken peace, / The rootlessness, our dread » [Kramer 46]). Ce fil intergénérationnel, dont la solidité effective contraste avec les apparences fragiles qu’il peut ainsi parfois endosser, ne cesse de serpenter à travers le tissu tout à la fois dense et parsemé de jours des poèmes. Il enlace au passage maints objets du quotidien tels un coupe-papier patiné au fil des générations (« Letter Opener » [Kramer 157]) ou, de manière plus saisissante encore, le mot d’amour d’une mère à sa fille retrouvé dans une robe de mariée achetée de seconde main (« A Billet-Doux » [Kramer 271]), mot à jamais privé de sa destinataire tels ces dialogues rompus et ces voix soudain brisées par le cours de l’Histoire.
Inscriptions et survivances
C’est bien souvent, comme on peut s’en douter, sur les objets laissés par les parents déportés que l’esprit s’obstine à retourner, et tout particulièrement sur les manifestations scripturales de leur présence au monde et de leur héritage. Du souvenir obsédant de l’ultime télégramme adressé par ses parents via la Croix-Rouge (« The Red Cross Telegram » [Kramer 48]) à la découverte par hasard de leurs lettres d’amour (« Love Letters » [Kramer 132]), en passant par la fascination pour l’écriture du père dramaturge et écrivain dont les lettres arachnéennes et le filigrane élégant subsistent dans leur singularité comme une œuvre d’art à part entière (« My Father’s Writing » [Kramer 341]), tous ces témoins scripturaux font de la voix poétique cette intruse dans la poussière d’un temps perdu dont elle mesure avec ferveur l’inscription édificatrice. Dans ce musée de l’intime édifié par la mémoire, dont chaque élément est célébré de manière répétée comme pour faire rempart à l’oubli, les livres trônent en majesté, mémorial d’un père bibliophile profondément admiré. Ils emplissent l’espace domestique de leur omniprésence matérielle et de leur autorité tout comme leur évocation dans le poème « Books » (Kramer 333) succède immédiatement, sur la même page, au poème « Identity », notion avec laquelle ils semblent ainsi faire corps et dont ils sont l’une des premières incarnations palpables :
Today the books are my sole companions
They all want their faces wiped, their spines
Dusted, their habitats on shelves assured
Whatever their personalities
Or stories might be. They want me to save
Them, to remember their origins
To preserve their languages even if enslaved
In the past, with outdated histories.
But I have a soft spot for them all.
They tell me who I am and who I was.
Even if shelf space is running out, they call
To me not to abandon them […]
Sans pour autant emprunter la voie de la prosopopée qui anime certains poèmes tels que « The Sound of Roots » (Kramer 187), l’agentivité spectaculaire dont Lotte Kramer dote ces livres, objets soudain nantis d’une voix assertive tour à tour exigeante et implorante par le truchement des verbes want, tell et call, n’est pas sans évoquer cette force autonome qui est à l’origine de son propre geste scriptural et dont rien ne peut venir enrayer le déroulement imperturbable. Ainsi, dans tout le premier poème, « Ice-Break » (Kramer 27), dont le Rhin constitue l’armature métaphorique, l’écriture se fait délivrance, ouvrant l’espace d’une parole et d’une mémoire jusque-là prisonnières des glaces et désormais libres de circuler (« But the poem insists on its flow / With the ice-break of words »). Cette même image est d’ailleurs reprise sous une forme voisine, comme on l’a vu, dans la préface du recueil où les souvenirs manifestent leur insistance à se déverser de manière inexorable sur la page, battant résolument en brèche le figement originel de la douleur naguère entrepris par l’activité picturale qui a précédé l’écriture (« I froze the ache of silence / Into paint », écrit Lotte Kramer dans « The Cry » [Kramer 43]).
À cet acharnement des objets à envahir le champ de la conscience et à dicter l’exploration répond le geste scriptural obstinément thésauriseur, collectionneur de Lotte Kramer dont l’une des manifestations est, comme on l’a déjà suggéré, l’abondance des poèmes consacrés à des tableaux et à des musées, emblèmes par excellence de cette « présence de la mort au milieu des vivants » (Certeau 103) que fait advenir l’entreprise conservatrice du passé. Cette abondance y prend les traits d’une ekphrasis réitérée où culminent les effets de miroir entre les éléments constitutifs du tableau et les facettes du moi et des autres figures qui déambulent dans la mémoire. La vigueur de ce dialogue revêt un caractère spectaculaire dans le poème « Black over Red » (Kramer 301), titre également d’un des neuf recueils qui composent le volume et référence explicite à une série de tableaux emblématiques de Rothko, artiste dont on connaît tout à la fois le statut d’exilé et le travail continu sur les processus inconscients. Pour celle qui fut artiste peintre, elle-même rompue aux lignes, aux couleurs et aux empâtements, la toile saturée de couleur se fait miroir d’une épaisseur existentielle à défricher, suscitant « tout à la fois tension et tentation » (Vincent-Arnaud 164). La mise en page du poème reflète pleinement cette dualité, la faisant éprouver au lecteur entraîné à son tour dans les méandres de ce cheminement complexe. En témoigne une forme versifiée vibratile, toute d’essors et de replis, de densité et de brisure, cheminant – tout comme « The Cry » et d’autres poèmes ainsi modelés – à travers rejets et enjambements, mais aussi alternance de vers longs et courts, marques linguistiques récurrentes du surgissement de l’indéfini et de l’inexploré (a / another) :
You move into the chapel of his colours,
Black over red,
And sense the slight manœuvre
Of a black door
Trying to invade the deeper space.
A fragrance away
Another panel invites light
To come forward
Almost closing a shutter on the swing
Of self-knowledge.
[…]
De même, les miniatures ekphrastiques qui jalonnent l’œuvre sont autant d’étapes essentielles de l’itinéraire allégorique d’une démarche poétique en quête de réunification de parcelles d’identité enfouies ou égarées. Depuis les jeunes filles de Munch errant sur un pont à l’aube de leur vie (« Thresholds (Three girls on a bridge, Edvard Munch) » [Kramer 210]) jusqu’à la femme triste et songeuse de Picasso (« “Femme en chemise” (Picasso) » [Kramer 266]) en passant par les figures féminines énigmatiques qui peuplent les espaces silencieux de Hammershøi (« Stillness (Vilhelm Hammershøi) » [Kramer 349]) et de Caspar David Friedrich (« Woman at the window (Caspar David Friedrich, 1822) » [Kramer 301]), s’insinuent des images répétées de rivières, de ponts, de traversées, de rives à atteindre, de portes, de fenêtres et de seuils à franchir, de paysages immobiles, emblèmes d’un territoire identitaire brouillé et hybride, instable et mouvant, lieu habité par d’êtres vulnérables – le plus souvent féminins – en attente et en devenir. Avec sa femme en noir à l’assaut du silence, ses portes à franchir menant vers d’autres portes, ses particules en suspension dans un espace vide traversé d’un rai de lumière, le poème « Stillness » et l’inventaire progressif de l’espace que sa forme donne à voir et à entendre suggèrent à leur tour cette entreprise poétique d’excavation et de déchiffrement, exutoire en même temps qu’extension du domaine d’une intimité livrée en partage par le truchement d’une page rompant le charme muet du tableau :
[…]
Door gleaming white
Open on to other doors,
Corridors enclosed, empty.
Everywhere emptiness,
Only dust motes dancing
On a sunbeam, slanting.
And the woman in black
A column standing
In stillness and peace
Ces surgissements picturaux à la puissance quasi haptique succèdent aux évocations d’objets déjà mentionnées dans un même geste accumulatif d’exhumation et d’exaltation de ce « réseau dense de liens » (Bennett 13 ; ma traduction) de liens entre humanité et de choséité tissés par-delà les époques, les territoires, les frontières de la vie et de la mort. Par ses contours et son allure, chacun des poèmes est lui-même, à sa manière, cette « colonne dressée » sur la page, réceptacle et caisse de résonance des voix et des silences qui s’y coulent et s’y mêlent pour former, d’un poème à l’autre, le concert ininterrompu d’une identité.
Conclusion
Le solo obstiné que fait entendre la poésie de Lotte Kramer ne saurait se concevoir sans cet accompagnement obligé, cette basse continue des objets trouvés, retrouvés ou simplement côtoyés quotidiennement, tous déclencheurs du voyage à rebours qui ouvre l’espace poétique selon des perspectives démultipliées. Générant cet « état de survivance qui n’appartient ni à la vie tout à fait, ni à la mort tout à fait, mais à un genre d’état aussi paradoxal que celui des spectres qui, sans relâche, mettent du dedans notre mémoire en mouvement » (Didi-Huberman 9), ils suscitent une parole mémorialiste qui se fait combat pour la solidité d’un ancrage par ressaisie et recomposition de la matérialité d’existences passées, des sensations et des gestes que celles-ci ont abrités.
Dans cette poésie où chaque objet exploré, chaque toile déchiffrée, chaque voix incorporée à la sienne sont de prime abord autant de fragments pour étayer ses ruines, Lotte Kramer semble faire de cet « équivalent des cimetières dans les villes » (Certeau 103) que constituent les récits du passé un espace liminal de reviviscence et de réenchantement d’un monde que l’on pourrait croire effacé. Si la mémoire des formes demeure, s’incarnant volontiers à travers une respiration et un tracé bien vivants dans la matière visuelle et la réalité plastique, presque tactile, du poème devenu objet de contemplation et de fascination, c’’st par le primat accordé à la sensation et au dialogue permanent établi avec le monde dans tous ses états. C’est ce continuum entre l’humain et un environnement pourvoyeur et catalyseur de mémoire que célèbrent les poèmes de Lotte Kramer, ce continuum qui permet de « donner voix à une vitalité intrinsèque à la matérialité, affranchissant ainsi la matière des liens qu’on lui attribue depuis longtemps avec ce qui n’est qu’automatisme ou mécanisme » (Bennett 3 ; ma traduction).
Bibliographie
- Bennett, Jane. Vibrant Matter. A Political Ecology of Things. Duke University Press, 2010.
- Caraion, Marta. Comment la littérature pense les objets.Théorie littéraire de la culture matérielle. Champ Vallon, 2020.
- de Certeau, Michel. L’Absent de l’histoire. Mame, 1973.
- Delerm, Philippe. Paris l’instant. Fayard, 2002.
- Didi-Huberman, Georges. Génie du non-lieu. Air, poussière, empreinte, hantise. Minuit, 2001.
- Henke, Suzette A. Shattered Subjects: Trauma and Testimony in Women’s Life-Writing. St. Martin’s Press, 1998.
- Hubier, Sébastien. Littératures intimes : les expressions du moi, de l’autobiographie à l’autofiction. Colin, 2005.
- Huston, Nancy. L’espèce fabulatrice. Actes Sud, 2008.
- Kramer, Lotte. More New and Collected Poems. Rockingham Press, 2015.
- Maulpoix, Jean-Michel. La Musique inconnue. Corti, 2013.
- Pellicer Ortin, Silvia. Eva Figes’ Writings. A Journey through Trauma. Cambridge Scholars Publishing, 2015.
- Richard, Jean-Pierre. Poésie et profondeur. 1955. Seuil, 1976.
- Rilke, Rainer Maria. Notes sur la mélodie des choses. Traduit par Bernard Pautrat, Allia, 2010.
- Samuels, Diane. Kindertransport. Nick Hern Books, 1992.
- Schwartz, Lynne Sharon, et al. L’Archéologue de la mémoire. Conversations avec W.G. Sebald. Traduit par Delphine Chartier et Patrick Charbonneau, Actes Sud, 2009.
- Steiner, George. Language and Silence: Essays on Language, Literature, and the Inhuman. Atheneum, 1967.
- Vincent-Arnaud, Nathalie. « Révolution de soi, révélation de l’autre : figures du transport dans quelques poèmes de Lotte Kramer ». Études de Stylistique Anglaise n°13, 2018, pp. 161-172. https://journals.openedition.org/esa/3379
About the author(s)
Biographie : Nathalie Vincent-Arnaud est professeur à l’Université Toulouse-Jean Jaurès (Département des Études du Monde Anglophone). Ses domaines de spécialité sont la stylistique, la traductologie ainsi que les relations entre musique, danse et littérature. Elle est co-directrice de l’un des trois axes de son équipe d’accueil, le CAS (Centre for Anglophone Studies), ainsi que du programme interdisciplinaire Musique et Littérature. Elle est également membre associée de l’équipe de recherche LLA-CREATIS, consacrée à la littérature, aux langues et aux arts. Elle dirige la collection Amphi 7 aux Presses Universitaires du Midi et elle est membre du comité éditorial ou du comité scientifique de plusieurs revues (Miranda, Caliban, Lexis, Leaves, Études de Stylistique Anglaise, La Main de Thôt). Elle a dirigé ou co-dirigé une vingtaine d’ouvrages et numéros de revues (parmi lesquelles Anglophonia, Miranda, Captures, Textes et Contextes, Revue Musicorum, Champs du Signe). Elle a publié deux ouvrages pour les étudiants et plus de soixante articles et chapitres d’ouvrages scientifiques dans ses domaines de recherche. Elle a traduit en français plusieurs essais sur l’art, le langage et le style, deux ouvrages (Saussure de John E. Joseph et Bad Vibrations: The History of the Idea of Music as a Cause of Disease de James Kennaway), et une sélection de soixante poèmes de Lotte Kramer, parue en 2024. Elle traduit actuellement la pièce Kindertransport de Diane Samuels.
Biography: Nathalie Vincent-Arnaud is Professor at the University of Toulouse-Jean Jaurès (Department of English). Her teaching and research areas are stylistics, translation studies, as well as the links between music, dance and literature. She co-directs one of the three axes of her research team, the CAS (Centre for Anglophone Studies), along with the interdisciplinary research programme Music and Literature. She is also an associate member of the research team LLA-CREATIS, devoted to literature, languages and arts. She directs the Amphi 7 series at the Presses Universitaires du Midi and is a member of the editorial board or scientific committee of several journals (Miranda, Caliban, Lexis, Leaves, Études de stylistique anglaise, La Main de Thôt). She has directed or co-directed some twenty books or journal issues (among which Anglophonia, Miranda, Captures, Textes et Contextes, Revue Musicorum, Champs du Signe). She has published two books for students and more than sixty scholarly articles and book chapters in her research fields. She has translated into French a number of essays on art, language and style, two books (Saussure by John E. Joseph and Bad Vibrations: The History of the Idea of Music as a Cause of Disease by James Kennaway), gand a selection of sixty poems by Lotte Kramer, published in 2024. She is currently translating Diane Samuels’s play Kindertransport.