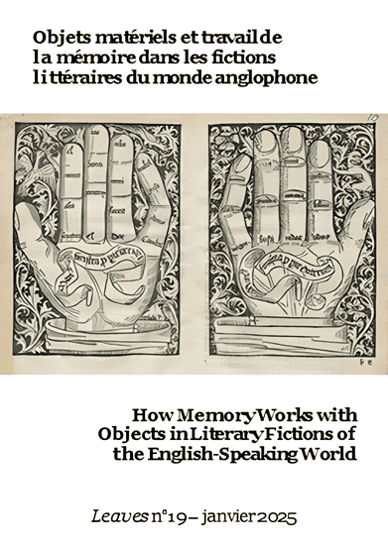Le gris-gris bag, porte-mémoire ancestral et contemporain dans Sing, Unburied, Sing de Jesmyn Ward
Abstract: In Jesmyn Ward’s 2017 novel Sing, Unburied, Sing, which focuses on the life of an African-American family, the gris-gris bags may seem to have a somewhat marginal function in the narrative as they seem to be a detail appearing in an embedded narrative. The gris-gris bag appears indirectly, as an object of discourse or as an object that is being remembered by River and Philomène, to whom the gris-gris bag is an invaluable symbol of protection, as well as the relic of an ancestral culture they hold dear. Leonie, River and Philomène’s daughter, refuses to accept this legacy: on the contrary Jojo, Leonie’s son, is receptive to his grandfather’s stories, culture and traditions. Thus, when he embarks with Leonie on a roadtrip to drive Jojo’s father back from Parchman prison, it is Jojo who receives the only tangible gris-gris bag in/of the work. This article examines the gris-gris bag and its ambivalence as a memory-bearer in Ward’s work. The object stands for the rehabilitation of African American voodoo cults and cultures and yet, it also holds a traumatic memory harking back to slavery and mass incarceration. Our aim is thus to analyze the representation of transmission in the text by focusing on the deep-rooted ambivalence surrounding the gris-gris bag.
Keywords: Gris-gris Bags, Voodoo, Memory, Slavery, Police Brutality, Prison, Object
Résumé : Dans le roman Sing, Unburied, Sing de Jesmyn Ward (2017), qui met en scène la vie d’une famille africaine-américaine, le gris-gris semble au premier abord jouer un rôle marginal dans la narration. C’est un détail apparaissant au détour d’un récit enchâssé ; l’objet est moins une présence rendue palpable par la description qu’un objet indirectement évoqué, un objet de discours et de souvenir chargé de valeurs subjectives pour les personnages de River et Philomène : le gris-gris est à leurs yeux garantie de protection et symbole d’une culture ancestrale qui leur est chère. C’est à ce titre que le gris-gris est au centre de la réflexion sur une transmission tissée de détours, d’interruptions et de reprises : Leonie, la fille de River et Philomène, refuse de prendre en charge l’héritage de ses parents ; inversement, Jojo, le fils de Leonie, se révèle très réceptif aux histoires de son grand-père River, à sa culture et à ses traditions. Ainsi, lorsqu’il doit accompagner Leonie au moment où le père de Jojo est libéré du pénitencier de Parchman, c’est Jojo qui reçoit le gris-gris. Cet article se propose d’étudier la façon dont le gris-gris fonctionne comme objet porte-mémoire dans l’œuvre de Ward : instrument de la réhabilitation des cultes et cultures vodous afro-américains, le gris-gris véhicule aussi une mémoire traumatique qui renvoie à l’esclavage et à l’incarcération de masse. À travers cet objet chargé d’une profonde ambivalence, il s’agira pour nous d’interroger la manière dont la transmission est représentée dans le texte.
Mots-clés : Gris-gris, Vodou, Mémoire, Esclavage, Violences policières, Prison, Objet
Introduction
Le roman Sing, Unburied, Sing (2017) de Jesmyn Ward met en scène une famille africaine américaine sur trois générations. Leonie, qui représente la deuxième génération, est la compagne d’un homme blanc et elle incarne une relation problématique à la tradition vodou1 ; pour elle en effet, le gris-gris n’est pas littéralement un objet « tabou » au sens où il renverrait à une forme de sacré appréhendé et défini collectivement. Le gris-gris entre plutôt dans la catégorie des objets que Leonie ne peut, du fait d’une névrose individuelle, ni nommer ni toucher : une sorte d’objet phobique qui est, comme l’objet tabou, entouré d’un ensemble d’interdits, mais que Freud distingue de l’objet tabou au sens propre, dans le sens où l’objet phobique manifeste la force d’un inconscient individuel et non plus la puissance d’un système de pensée collectif2. En se tenant à l’écart du gris-gris, Leonie reste symboliquement en retrait d’une tradition ancestrale et d’une identité familiale dont l’objet est le support matériel : la mère de Leonie, Philomène, était autrefois guérisseuse et confectionnait des gris-gris pour garantir la santé des membres de sa communauté et les protéger. Quant au père de Leonie, River, il est également défini comme un représentant de la tradition : à ses yeux, le gris-gris est gage de protection et il raconte à Jojo, son petit-fils (le fils de Leonie), avoir porté quotidiennement un gris-gris à sa ceinture lorsqu’il était détenu dans la prison de Parchman pour survivre aux atrocités auxquelles il était confronté (73). Lorsque Philomène et River soulignent dans leurs récits respectifs la valeur que revêtait le gris-gris dans leur existence d’autrefois, ils paraissent reléguer l’usage traditionnel de l’objet au rang de souvenir lointain ; le détachement de leur fille Leonie vis-à-vis de la tradition familiale semble confirmer le caractère désuet, voire révolu, de cette valeur sacrée qui était collectivement attribuée à l’objet. Cependant, à mesure que l’intrigue progresse, le gris-gris réintègre la diégèse du récit principal et finit par y jouer un rôle décisif en tant qu’objet matériel et symbolique lors d’une scène cruciale. Celle-ci réunit une partie de la famille dans une voiture : Jojo est aux côtés de sa jeune sœur Kayla, de sa mère Leonie et de Misty, une amie blanche de Leonie. En route pour la prison de Parchman dont son père blanc, Michael, est sur le point d’être libéré, Jojo découvre un gris-gris parmi ses affaires et devine que c’est son grand-père, River, qui a placé l’objet à cet endroit. Bien que le lecteur n’identifie pas immédiatement la raison pour laquelle le grand-père a procédé à cette discrète transmission, la scène où Jojo sera victime de violence policière va révéler la valeur mémorielle de l’objet dans toute sa complexité. En effet, le gris-gris est à la fois un support de la mémoire traumatique du grand-père et un objet protecteur qui est censé conjurer la répétition du trauma ; le gris-gris s’avèrera être ce par quoi la mémoire d’un traumatisme lié à l’incarcération et à l’esclavage se trouve en réalité prolongée, à travers une scène de violence policière contemporaine. Comment le gris-gris, porte mémoire ancestral par excellence, résiste-t-il alors à sa propre disparition et comment réaffirme-t-il sa fonction protectrice dans un contexte contemporain ? En mettant en regard les scènes où l’objet est seulement évoqué comme un souvenir, et celles où il est décrit comme une présence tangible et actuelle, nous verrons comment le gris-gris devient la preuve qu’une pratique cultu(r)elle ancestrale se transmet et perdure ; cependant, nous verrons aussi qu’il est le signe d’une mémoire traumatique que le voyage de Jojo à Parchman vient réactiver. Le grand-père projette son souvenir du lieu qui le hante sur l’histoire de son petit-fils et éprouve le besoin de dissimuler l’objet protecteur dans ses affaires : le gris-gris évoque le danger que représente ce trajet vers Parchman pour un jeune homme africain américain alors même que l’objet vise à conjurer une sorte d’héritage de la prison (une fatalité de la prison) chez les hommes noirs. La fonction mémorielle du gris-gris est donc singulièrement doublée d’une fonction relationnelle, car elle tisse une généalogie masculine entre Jojo, River et leurs ancêtres. En faisant porter l’accent sur cet héritage mémoriel, le gris-gris matérialise le lien entre esclavage et incarcération de masse. Enfin, nous verrons que le gris-gris endosse un rôle très ambivalent quand il passe du statut d’objet discursif au statut d’objet matériellement présent dans la diégèse. Entre perpétuation et rupture d’héritage, entre protection et danger, son « efficacité » est (re)mise en question. Il s’agira donc de définir la place du gris-gris dans l’œuvre, à l’œuvre et pour l’œuvre.
Le gris-gris comme objet discursif : du souvenir et de la difficulté à transmettre
Pour commencer, notons que le gris-gris apparaît pour la première fois dans Sing, Unburied, Sing comme un objet de discours : non comme un objet apparaissant dans la diégèse mais comme le signifié du discours de Philomène, lui-même enchâssé dans un récit de sa fille Leonie. L’objet subit une sorte de double, voire de triple dématérialisation : non seulement il est l’objet d’un discours mis en abyme dans le récit d’une autre narratrice, mais il est, de plus, relégué au rang de souvenir, puisque Philomène évoque sa fabrication comme une habitude appartenant désormais au passé : « I was busy birthing babies and doctoring folks and making gris-gris bags for protection » (40). Philomène semble consigner l’objet à un espace temporel qui n’est plus, excluant la potentialité de son existence dans le présent de la narration. Lorsque le gris-gris est appréhendé pour la première fois par le lecteur, c’est donc sur le mode d’une lointaine réminiscence et non sous la forme d’un objet du quotidien. Le gris-gris semble appartenir aux seules sphères discursive et mémorielle : des sphères qui ne sont rattachées à aucune espèce de référence palpable dans la diégèse.
Ainsi, la narration de Leonie fait du gris-gris un objet désuet, témoignage d’une culture déjà marginalisée et qui, à l’image de Philomène, s’éteint progressivement, d’autant plus que Leonie refuse de s’en faire le relais. Philomène avait d’ailleurs elle-même déclaré au sujet de ses pouvoirs de guérisseuse : « But it’s slow now. Don’t nobody but the old folks come to me for remedies » (41). Elle confirmait ainsi l’aspect obsolète de la culture du soin, dont elle est l’héritière, mais aussi le caractère dépassé du gris-gris, que seule sa génération semblait encore confectionner et utiliser. Dans Sing, Unburied, Sing, le gris-gris révèle donc, à première vue, une rupture générationnelle qui se manifeste notamment dans la (non-)transmission de la culture vodou où il s’inscrivait. Philomène, en dépit de l’ironie tragique de la maladie qui la consume au moment de la narration de Leonie, est une guérisseuse, descendante d’une lignée de femmes dont elle a hérité les dons : « I think it runs in the blood, like silt in river water. […] Rises up over the water in generations. My mama ain’t have it, but heard her talk one time that her sister, Tante Rosalie, did » (40). Ce pouvoir de guérison a été développé grâce à Marie-Thérèse, la sage-femme qui s’est occupée de sa mère au moment de la naissance de sa sœur : c’est au milieu de ce cercle féminin, entourée des « mères » vodous et catholiques auxquelles s’adressent les prières de la maternité, que Philomène a construit son héritage culturel et cultuel, qu’elle aurait souhaité transmettre à Leonie : « [she] made me say my rosary before I went to sleep with the words Make sure you pray to the Mothers » (42). Pourtant, Leonie écarte totalement cet héritage féminin et semble ne pas vouloir s’inscrire dans cette descendance. Le refus de cette filiation se traduit en partie par la mise en exergue, dans la narration de Leonie, du silence par lequel elle accueille l’évocation du gris-gris dans la conversation avec sa mère : elle ne relève qu’un seul élément du propos de sa mère, déniant de facto au gris-gris une quelconque existence : « You could deliver a baby ? » (42). Ainsi, le dialogue entre mère et fille, qui aurait précisément pu constituer pour Leonie l’occasion d’en apprendre davantage sur le(s) culte(s) et la (ou les) culture(s) auxquels le gris-gris est rattaché, ainsi que sur son propre héritage, devient le lieu où s’exerce une mémoire sélective. La conversation devient le lieu d’un effacement d’une partie de l’héritage familial plutôt que le lieu de sa perpétuation : l’une des locutrices nie l’existence du gris-gris comme objet de discours et participe ainsi à son oblitération. En excluant le gris-gris du dialogue, Leonie impose le silence autour de l’objet : elle annule symboliquement sa potentielle reprise dans la mémoire et le discours, créant une rupture radicale entre sa sphère personnelle et la sphère culturelle du vodou. Leonie refuse de se faire le réceptacle mémoriel de la tradition cultu(r)elle maternelle ; loin de se concevoir comme le véhicule de la tradition, elle s’est « vidée » (« drained ») d’un héritage vodou qu’elle identifie métaphoriquement à un liquide indésirable : « I forgot so much of what she taught me. I let her ideas drain from me so that the truth could pool instead » (104). Lorsque Leonie adulte s’exprime en tant que narratrice, elle donne parfois au gris-gris un aspect tangible dans ses descriptions, mais c’est pour mieux le déspiritualiser et le désacraliser, en le reléguant au rang d’une « chose » banale. Après avoir fait référence au gris-gris comme objet du discours (« the other thing3 she’d said »), Leonie décrit l’aspect matériel de l’objet placé devant elle : «[it]sat unspoken on the table between us, as matter-of-fact as a butter dish or a sugar bowl » (42). La description aplanit l’objet : son existence devient « plate » au sens où toute saillance symbolique lui est refusée. Le comparatif en « as…as » et l’adjectif composé « matter-of-fact » placent le gris-gris sur le même plan que des objets quotidiens dont personne ne relève l’existence tant leur présence est tenue pour acquise : un beurrier, un sucrier. La description dédramatise le rôle que revêt l’objet dans l’imaginaire de Leonie : son récit nie le lien à la culture vodou et refuse de voir la sacralisation paradoxale auquel elle soumet le gris-gris.4 Elle « chosifie » l’objet dans l’espoir de le vider de son sens spirituel.
Tout au contraire, les discours de River, le père de Leonie, visent à souligner la saillance de certains objets et leur capacité à contenir un pouvoir spirituel. Lors d’une conversation, le grand-père confie à son petit-fils Jojo que son ancêtre (l’arrière-arrière-grand-père du jeune garçon) lui a appris qu’il y avait un esprit dans chaque chose :
“Everything got power.”
[…]
“My great-granddaddy taught me that.”
[…]
“Said there’s spirit in everything. In the trees, in the moon, in the sun, in the animals. […] But you need all of them, all of that spirit in everything, to have balance.”
[…]
“You need a balance of spirit. A body, he told me, is the same way.”
[…]
“Like this. I’m strong. I can split this wood. But maybe if I had some of the boar’s strength, a little bit of wild pig’s tusk at my side, something to give me a little bit of that animal’s spirit, then maybe, just maybe,” he huffed, “I’m better at this. Maybe it come a little easier to me. Maybe I’m stronger.” (74)
River sous-entend que le contenu du gris-gris a le pouvoir d’augmenter ses propres capacités. Et Jojo, observateur sagace, de lui demander: « That’s what you keep in your pouch? » Jojo ajoute en tant que narrateur : « I’d noticed his small pouch when I was four or five, and I’d asked him what he kept in it. He never told me » (74). Le lecteur devine que River a gardé le secret du contenu de sa petite besace parce que celui-ci est trop lourd, non pas matériellement mais moralement : lourd d’une mémoire qu’il est difficile de communiquer à son petit-fils, jugé sans doute trop jeune pour devenir le dépositaire de cette mémoire transgénérationnelle. En effet, aux yeux de River, le gris-gris n’est pas seulement un objet spirituel dans le sens où il contient l’esprit des choses qui le constituent de façon métonymique, mais aussi parce qu’il représente et incarne les esprits des ancêtres (ceux de River, et donc ceux de Jojo également). Le gris-gris est un héritage ancestral que les esclaves, arrachés à la Côte-de-l’Or, ont apporté avec eux lors de leurs traversées transatlantiques pour s’assurer une protection d’ordre divin. Le gris-gris est donc un héritage non seulement transmis dans le temps mais aussi transporté dans l’espace : il est le témoignage d’une mémoire littéralement déplacée puisqu’il a lui-même a subi ce déplacement et porte en lui le souvenir du Passage du milieu, qu’il a subi en tant qu’objet, ce qui fait potentiellement de lui un trait d’union entre cultures afro-américaines. River instille dans le gris-gris le poids symbolique d’une filiation esclavagisée, victime de migrations forcées et de tortures indicibles, de sorte qu’il ne dévoile pas à l’enfant cet objet et sa signification avant que ce dernier n’atteigne ses onze ans. Cependant, lorsqu’à cet âge, et après que Philomène lui a adressé « the talk »5 (preuve qu’il a grandi, qu’il est entré dans l’adolescence et qu’il est en mesure d’assimiler le discours de sa grand-mère), Jojo lui pose la question : « “Will you tell me again?” […] “What happened, Pop? When you went to jail?” » (68). La réponse du grand-père mobilise alors une temporalité qui excède de loin l’histoire personnelle de son emprisonnement. River se fait vecteur de transmission d’une mémoire généalogique meurtrie et révèle à Jojo l’Histoire de ses ancêtres :
Once my grandmama told me a story about her great-grandmama. She’d come across the ocean, been kidnapped and sold. Said her great-grandmama told her that in her village, they ate fear. […] Said everyone knew about the death march to the coast, that word had come down about the ships, about how they packed men and women into them. […] But still, they came for her. Kidnapped her from her home in the middle of the day. Brought her here, and she learned the boats didn’t sink to some watery place, sailed by white ghosts. She learned that bad things happened on that ship, all the way until it docked. That her skin grew around the chains. That her mouth shaped to the muzzle. That she was made into an animal under the hot, bright sky […]. (69)
Le caractère digressif de la réponse peut surprendre : le grand-père établit, à travers ce détour narratif, un lien logique entre une mémoire traumatique collective et ce qu’il a lui-même personnellement vécu en prison. En parlant notamment d’une animalisation du corps noir, River établit un lien entre l’esclavage et son propre emprisonnement : « I knew what that was, to be made an animal » (69). Plus loin, Jojo fait état d’un autre souvenir que River lui confie à un moment incongru et qui associe de nouveau l’expérience de la prison à un traumatisme collectif : alors que le grand père et son petit-fils partageaient un moment de pure américanité représentée par le visionnage de westerns, River ne peut s’empêcher, face aux images d’un mythe fondateur de l’identité euro-américaine, d’exprimer ce qui est véritablement fondateur dans sa propre expérience intime d’un système américain délétère. Il lâche au sujet de Parchman : « It was murder. Mass murder » (73). Jojo établit alors en tant que narrateur un lien – signalé par l’absence de rupture dans la syntaxe ou dans la typographie – entre l’incarcération de masse et la présence d’un gris-gris à la ceinture de son grand-père : « When Pop told me about the small pouch he kept tied to one of his belt loops, it was cold outside […] » (73). Le gris-gris fait ici figure de trait d’union dans la diégèse : le passage où Jojo recueille les souvenirs de son grand-père, à travers lesquelles s’établit un écho concret entre esclavage et incarcération de masse, est précisément le passage où le gris-gris devient saillant et remarquable en tant qu’objet matériel dans le récit. Le gris-gris apparaît alors comme le témoignage d’une résistance à la violence de l’incarcération : d’une résistance à ce que Michelle Alexander appelle « the new racial caste system » (Alexander and West 3), c’est-à-dire la capacité de l’état fédéral à maintenir un système qui domine et contrôle les africains-américains.6
Le gris-gris comme objet palpable : mémorialisation d’un traumatisme en héritage
Dans la narration de Jojo, qui décrit la famille en route pour la prison de Parchman, le gris-gris se fait attendre à travers la syntaxe d’une phrase qui retarde son apparition : « It’s not until an hour later, when I figure the shirt’s as dry as it’s going to get in the humid-close car, that I see it » (70). Puisque l’entrée du gris-gris dans la narration se fait au travers de la perception de Jojo, qui ignore ce qu’est le petit sac, l’objet n’est pas nommé : il est seulement décrit en détail pendant une page entière. Au moment où Jojo déchiffre l’inscription sur le papier que contient le gris-gris, le jeune garçon comprend que son grand-père est à l’origine de la dissimulation de l’objet dans ses affaires. C’est alors que le lecteur saisit que le grand-père a projeté des souvenirs personnels sur son petit-fils et que c’est précisément pour cette raison qu’il a éprouvé le besoin de lui confectionner cet objet protecteur. La fabrication du gris-gris à l’attention de Jojo n’est pas seulement l’expression de la bienveillance d’un grand-père ; elle est aussi une manifestation de sa peur, qui prend à travers l’objet une consistance matérielle. Ici, c’est le souvenir de l’expérience personnelle de River qui a donné lieu à la confection du gris-gris : ce n’est pas tant l’objet qui rappelle le souvenir ; c’est plutôt le souvenir qui précède et appelle la fabrication de l’objet. River ne peut s’empêcher d’envisager le road trip de Jojo vers Parchman comme un retour par procuration vers cet endroit maudit et détestable où il a été animalisé ; le trajet en direction de la prison est conçu comme un inévitable héritage, transmis à son petit-fils en vertu d’une sorte de fatalité.
Lorsque le gris-gris apparaît comme un objet tangible sur lequel la description s’attarde, cet objet est la forme matérielle que prend la réactivation d’un traumatisme : celui de l’incarcération de River. A l’intérieur du gris-gris, le grand-père a d’ailleurs placé une pierre et une dent, dont la dureté symbolise la persistance dans le temps, comme le souligne Zora Neale Hurston: « God made everything to pass and perish except stones. God made stones for memory » (Hurston 184). En permettant à son petit-fils de récupérer un objet renvoyant à la fois au passé, au présent et à une projection future, River tisse entre Jojo et lui une continuité temporelle, comme si son petit-fils était le prolongement de lui-même. La besace contient d’ailleurs un message intimant à l’adolescent de garder l’objet près de lui, tout contre son corps, créant une proximité symbolique entre les deux personnages masculins ; en le dissimulant dans ses affaires, le grand-père atteste d’une forme de secret partagé entre Jojo et lui ; le gris-gris symbolise une passation secrète de traditions cultuelles que les pratiquants tendent à cacher, comme l’explique Hurston : « […] the worship is bound in secrecy. It is not the accepted theology in the Nation and so believers conceal their faith. […] Mouths don’t empty themselves unless the ears are sympathetic and knowing » (Hurston 185). De plus, l’objet contribue à créer une intimité et une complicité qui s’éprouvent à distance, d’autant plus que la découverte du gris-gris fait suite à un rare moment de proximité physique entre les deux protagonistes avant le départ de Jojo pour Parchman : « I stepped in to Pop and hugged him. I couldn’t remember the last time I had, but it seemed important to do it then » (61). Le lecteur discerne, à travers la modalisation de l’énoncé (« seemed »), le lien entre narration, interprétation et pressentiment : Jojo paraît anticiper un danger dont il n’a pourtant pas réellement conscience, tandis que River lui adresse, sans raison apparente, un énigmatique « You a man, you hear? » (61). Jojo n’étant qu’un garçon de treize ans, le lecteur s’interroge sur la nature du rapport entre un déplacement dans le nord de l’état et une transition supposée vers l’âge adulte.
La découverte du gris-gris suscite chez Jojo un questionnement intéressant : « I wonder if Pop ever did something like this for her [Leonie] when she made this trip before. If he snuck out […] and secreted something in her car some little collection of things he thought might be able to keep her safe, […] to protect her on her trips to north Mississippi » (71). La réponse à cette interrogation, même si elle reste implicite, n’en est pas moins évidente aux yeux du lecteur : il est certain que River n’a jamais préparé d’amulette à l’attention de Leonie, qui est si opposée à la culture de ses parents. Néanmoins, la réticence de Leonie face à son héritage vodou ne semble pas être la raison principale pour laquelle River ne lui aurait jamais confectionné de gris-gris. En effet, alors que le gris-gris semble être, a priori, un objet de soin vodou, traditionnellement confectionné par les femmes et utilisé par les femmes (« that could help women, specifically, (…) mostly women that searched her out », 103), l’objet semble avoir perdu ici ses connotations féminines : la notion de protection qui lui est traditionnellement attachée semble porter, dans ce cas précis, sur une masculinité noire en danger. L’opposition genrée qui lie le gris-gris à la masculinité noire de Jojo se matérialise par la dissimulation dans la voiture de deux « sacs » qui sont radicalement différents l’un de l’autre. D’une part, Leonie transporte un sac de drogue, qu’elle désigne comme un sac de « tampons », un signifiant qui renvoie à la féminité et qui est censé embarrasser Jojo :
Me and Misty already talked about it when I picked her up: we’re not going to refer to it by name, not going to use any words that hint to what’s in the bag […] we going to call it the most embarrassing thing we can so Jojo will lose all interest. If we get pulled over and they find those goddamn tampons, Misty, I’m going to kill you.” (Sing 94)
D’autre part, Jojo est porteur, lui aussi, d’un sac (le gris-gris), qu’il s’efforce de soustraire à la vue de toutes les passagères, en formant avec son corps une frontière physique entre leur féminité et sa masculinité : « I hunch over my lap, turning toward the door, making a small room with my body, a screen » (70). Le type de sang évoqué en rapport avec chacun des sacs achève de confirmer le gris-gris dans son statut d’objet lié à la masculinité : en effet, tandis que Leonie fait allusion au sang des règles féminines en parlant de son propre sac, Jojo remarque que la dent contenue dans le sien a dû connaître le goût du sang : « Whatever animal it came from knew blood, knew how to tear knotty muscle » (70). Jojo rattache ainsi inconsciemment le gris-gris à des caractéristiques de virilité, communément admises comme masculines dans la société occidentale, ce qui colore nécessairement ses acceptions. Notre propos n’est pas ici d’affirmer que le gris-gris serait un objet « masculin », au contraire. Cependant, dans le contexte de ce trajet d’un adolescent africain-africain en direction de Parchman, l’objet revêt, en contexte, des connotations masculines : il indique au lecteur l’anticipation d’un danger qui semble concerner essentiellement les hommes noirs.
En effet, grâce au gris-gris, Jojo anticipe, en se souvenant des souvenirs de son grand-père, le danger qui l’attend en tant que jeune africain américain. Tandis que ce sont des souvenirs traumatiques qui ont conduit le grand-père à fabriquer le gris-gris, c’est à l’inverse la manipulation du gris-gris qui conduit le petit-fils à retrouver des souvenirs enfouis. Le gris-gris remplit alors pleinement son rôle de porte-mémoire. C’est d’abord le souvenir de propos tenus à mots couverts par ses camarades qui refait surface : « Some of my friends at school have people living up there, in Clarksdale or outside of Greenwood. What they say: You think it’s bad down here. What they do: frown. What they mean: Up there? In the delta? It’s worse » (71). Cette réminiscence est empreinte d’une crainte qui dépasse les frontières de la fiction et en appelle à une mémoire extra-diégétique. Les lecteurs de Ward sont invités à suivre une digression métapoétique qui convoque la mémoire générationnelle de l’auteure elle-même. En effet, ce passage rappelle l’extrait de Men We Reaped dans lequel Ward faisait part de la dangerosité du nord du Mississippi pour les personnes racisées, en évoquant sa propre ascendance : « Harry’s children ranged from cinnamon to nutmeg to vanilla, and on that trip north, the children […] rode through the hot bright Mississippi wilderness under blankets » (Ward, Men We Reaped 11). La mémoire traumatique activée par l’apparition du gris-gris dans la narration de Jojo se déploie ainsi sur plusieurs niveaux ; Jojo en conclut, alors même qu’il n’a personnellement ni d’expérience ni de souvenir traumatique du Nord de l’état : « I think I know what my friends mean when they talk about north Mississippi » (Ward, Sing 72). Ce souvenir d’une conversation avec ses camarades semble actualiser pour Jojo les dangers du racisme qu’il se prépare à affronter. Lorsqu’il poursuit sa narration après un léger blanc narratif, matérialisé typographiquement par un simple saut de ligne, surgit le souvenir du début de l’histoire de Richie, que son grand-père lui a plusieurs fois raconté. C’est par l’enchaînement de ces souvenirs que la narration de Jojo trace implicitement un lien direct entre Jojo et un jeune homme noir victime d’un système raciste. Richie a été emprisonné très jeune, traité comme un esclave, et le grand-père de Jojo lui a donné une mort qui rappelle au lecteur celle de Beloved, le personnage éponyme du roman de Toni Morrison, afin de lui éviter une torture létale. Ainsi, même quand le gris-gris apparaît de façon matérielle dans le récit, l’objet semble ontologiquement lié à la notion de souvenir au sens où il est lié à l’activité mémorielle présente, au « remembering » tel que Kwint le définit : « objects stimulate remembering, […] by the serendipitous encounter, bringing back experiences which otherwise would have remained dormant, repressed or forgotten » (Kwint 2). C’est effectivement l’effet que génère l’objet ici, à ceci près que ce ne sont pas les expériences personnelles de Jojo qui lui reviennent, mais celles de ses ascendants – dont il hérite – et que « l’heureuse trouvaille » n’est pas due véritablement au hasard et que ce dernier n’est pas véritablement « heureux ». L’objet revêt avant tout une fonction relationnelle : il établit une relation forte entre River et Jojo et il est emblématique du lien qui unit les hommes noirs, à travers les générations, face à leur condition d’hommes noirs dans un monde dominé par les blancs. C’est précisément parce que le grand-père a conscience de la mémoire traumatique dont il est porteur que le petit-fils reçoit un gris-gris. Toutefois, l’objet joue un rôle pour le moins ambivalent, oscillant toujours entre protection et danger.
Le gris-gris, porte-mémoire ambivalent
Selon Serge Tisseron, « [t]outes [l]es commémorations correspondent au désir de créer un lien autant qu’à celui d’entretenir la mémoire. Elles peuvent cependant le créer de deux façons bien différentes : en permettant de se souvenir de ce qui a existé ou au contraire en essayant de le faire oublier » (49). Le gris-gris que River a dissimulé dans les affaires de Jojo illustre parfaitement cette ambivalence. Il vise une transmission : la transmission d’un héritage culturel et cultuel à un héritier susceptible de perpétuer une tradition ancestrale (contrairement à son ascendante directe, sa mère, qui rejette cette tradition). Pourtant, le gris-gris semble aussi viser l’inverse, à savoir la fin de la transmission. En effet, le don du gris-gris manifeste le désir du grand-père que soit conjuré ce qui semble s’abattre sur ses descendants à la manière d’un sort. Tous les hommes de la famille ont été soit emprisonnés de façon abusive, soit assassinés sans que justice ne soit rendue (c’est le cas de son fils Given, tué par le cousin de Michael, alors qu’ils étaient encore très jeunes). L’objet est donc donné à Jojo dans l’espoir que les cycles de violence cessent et que cet héritage délétère ne leur soit précisément pas transmis (ni à Jojo, ni aux générations qui suivront). En cela, le gris-gris est à la fois ce qui doit perpétuer les héritages mémoriels et ce qui doit y mettre fin.
S’il ne fait aucun doute que River a confectionné l’objet dans le but de protéger son descendant, la narration montre pourtant que le contexte contemporain dans lequel s’insère l’objet ancestral déforme et détourne cette fonction. Lorsqu’au retour de Parchman, Leonie, Michael, Misty, Kayla et Jojo se font arrêter, comme River le craignait, le jeune garçon connaît sa première confrontation avec un agent de police et celle-ci s’avère, malgré la présence du gris-gris à la ceinture de Jojo, extrêmement violente. Ainsi, bien que cette arrestation soit pour lui la première, et que ce soit également la première fois qu’il dispose d’un gris-gris censé le protéger des potentielles bavures, la peur que génère la situation crée chez Jojo un besoin de se rassurer : « It’s my first time being questionned by the police. […] The man telling me sit, like I’m a dog » (170). Instinctivement, le jeune garçon pense que toucher le gris-gris, le prendre dans sa main, lui apporterait la sécurité que représente son grand-père protecteur : « Figure if I could feel the tooth, the feather, the note, maybe I could feel those things running through me. Maybe I wouldn’t cry » (170). L’objet a d’ailleurs vocation à incarner River, qui déclare au retour de Jojo : « It was the only way I could send a little of me with y’all. With Mam […] sick. And that being a place I can’t go back to. Parchman » (221). River est littéralement le gris-gris ; en cherchant le contact avec l’objet, c’est en réalité un contact avec son grand-père que cherchait Jojo. Selon Susan Stewart « touch is the most ‘liminal’ and taboo-laden of the senses since it directly involves the thresholds of self and the other. The act of touching, […], exerts pressure on both toucher and touched, and therefore threatens the distinction between subject and object » (qtd. in Kwint 5-6). Toucher le gris-gris représente donc « une sorte de communion métaphysique »7 avec River. Cette quête d’une communion salvatrice avec son grand-père est pourtant est un leurre, car River ne saurait lui être d’aucune aide dans cette situation à juste titre redoutée. Au contraire, le geste que fait Jojo pour saisir son gris-gris est paradoxalement ce qui le met en danger : « I feel Pop’s bag in my shorts, and I reach for it. […] But then the cop has his gun out, pointing at me. Kicking me. Yelling at me to get down in the grass. Cuffing me » (170). Le vocabulaire utilisé par Jojo pour évoquer la confrontation avec le policier est révélateur : il fait écho à une terminologie connotée dans ce type de contexte, où le verbe « to reach for », quelle que soit son objet, est assimilé à une situation perçue comme dangereuse pour un jeune homme noir en état d’arrestation. L’expression est un déclencheur dans tous les sens du terme : le geste déclenche une série de gestes menaçants chez l’officier de police, et le verbe « to reach for » est en lui-même un déclencheur d’associations linguistiques pour le lecteur. Il convoque une mémoire extra-diégétique qui abolit les frontières entre la diégèse et son environnement direct, de sorte que le lecteur est invité à rapprocher cette scène avec d’autres scènes équivalentes (mais bien réelles) qui se sont soldées par la mort de jeunes hommes noirs. Mellis parle, de façon euphémisée, de « malentendu » : « The drastic misunderstanding displayed here, reminiscent of so many real-life encounters, thankfully ends with no physical violence» (Mellis 11). Même si Jojo est épargné sur le plan physique, Mellis relève que le policier, une fois conscient du « malentendu », requalifie le gris-gris de « foutue pierre » et inflige alors une blessure symbolique à la culture que représente l’objet : « that his protective talisman is regarded as a “damn rock” by the potentially deadly agent of the state, speaks to the wide cultural differences between Jojo, Pap, Leonie, Kayla and the deadly white power structure they must survive within, here embodied by the young police officer » (Mellis 11). La blessure s’étend ensuite dans la sphère familiale, et à travers elle, puisque Michael va jusqu’à remercier l’agent, après que ce dernier a provoqué une scène de violence qui a traumatisé toute sa famille, dont il est le seul membre blanc. Le gris-gris tient un rôle particulièrement paradoxal ici : à la fois symbole de protection et porteur de danger, il est l’objet par lequel la scène aurait pu basculer dans une violence incontrôlable.
À son retour de Parchman, River demande à Jojo : « Did you find it ? » (221). Le pronom « it » utilisé par le grand-père fait écho à celui que son petit-fils a lui-même utilisé au sujet de l’objet énigmatique découvert dans ses affaires. Si la scène du retour permet à River de parachever une forme de transmission en nommant enfin l’objet pour Jojo, elle permet surtout d’interroger ce que Mellis appelle « l’efficacité du talisman » : « Pop asks Jojo if he found the bag and asks, “Did it work? It’s a gris-gris bag.” Jojo’s response of “I think so. We made it. Got stopped by the police though” speaks to the efficacy of the bag » (Mellis 11). Nous proposons une interprétation légèrement de la réponse de Jojo, qui commence par hausser les épaules : « I shrug » (221) et qui semble avouer qu’il ne sait pas si le gris-gris a fonctionné (« ‘we made it’ »). D’aucuns seraient tentés d’entendre dans cette affirmation qu’ils s’en sont tout juste sortis ; la formulation de Jojo, qui pourrait être traduite par « on a évité le pire », peut renvoyer à la puissance du gris-gris, capable de conjurer le pire, à savoir la mort ; cependant, la formule traduit avant tout la peur de la mort qui, elle, ne lui a pas été épargnée et qui se cristallisera en répétition d’une crainte originelle, celle-là même que River désirait éviter à son petit-fils. Envisagé sous cet angle, le gris-gris n’a pas fonctionné. Il n’a pas permis à Jojo de se soustraire à une violence inouïe pour son jeune âge. Jojo aura plutôt hérité d’un traumatisme que le geste de River voulait conjurer mais auquel ce même geste aura donné une inscription matérielle et une force paradoxalement redoublée. Jojo avoue : « The image of the gun stays with me » (170). Or, c’est précisément parce que les images de Parchman et de sa violence sont inoubliables pour River, précisément parce qu’elles « restent avec lui », qu’il a initialement confectionné un gris-gris à Jojo. La violence se répète donc sous de nouvelles formes, finalement assez peu éloignées l’une de l’autre.
Conclusion
Alors que River semble avoir voulu mettre son héritage cultu(r)el au service de la destruction d’un autre héritage (celui qui est imposé par l’histoire de sa communauté, et qu’il ne contrôle pas, celui de la violence des représentants des institutions de l’état), le gris-gris semble présenté comme un objet au pouvoir insuffisant : de fait, il ne suffit pas à détruire l’origine du problème, ni ses conséquences sur la vie quotidienne des jeunes hommes noirs aux États-Unis aujourd’hui. Toutefois, l’œuvre de Ward révèle, ne serait-ce que par la persistance de l’objet et de son usage dans le temps, sa puissance de résistance. L’œuvre en elle-même, par son traitement de l’objet ancestral, est un manifeste contre l’effacement et pour la réactualisation d’une culture marginalisée, dont les pratiques semblent avoir toujours été définies, nommées et circonscrites par un discours dominant. Le gris-gris est ici la forme matérielle que prend le rappel d’une identité culturelle qui agit contre la perte de croyances et de pratiques héritées des ancêtres. Il symbolise une réappropriation de la liberté des africain.e.s américain.e.s, celle de ne pas circonscrire les pratiques dont ils ont hérité en les enfermant dans des dénominations. En effet, relevons que, bien que nous ayons délibérément rattaché le gris-gris à la culture vodou, les personnages de l’œuvre, quant à eux, ne nomment jamais le culte ou la culture dont ils se revendiquent. Loin de constituer un reniement de leurs origines, le fait de ne pas nommer ces pratiques relève, en réalité, d’une forme de réappropriation. En effet, selon Zora Neale Hurston, le vocable même de voodoo aurait été linguistiquement construit par les Blancs : « Hoodoo, or voodoo, as pronounced by the whites » (Hurston 183). Partant, le fait de ne pas circonscrire par une dénomination unique les pratiques auxquelles ils et elles répondent, exprime aussi la liberté des africain.e.s américain.e.s de s’approprier ou de se réapproprier des traditions ancestrales dans un contexte contemporain, en s’autorisant des hybridations propres à l’époque présente.
Ainsi, en insérant le gris-gris dans une œuvre contemporaine tout en conservant l’aspect ancestral qui est culturellement et cultuellement inhérent à cet objet, Jesmyn Ward lui confèr une importance indéniable. Comme l’avance Mellis, c’est un modèle de résistance autant qu’un objet matériel qui est transmis : « Using the […] spiritual traditions (voodoo, hoodoo, conjure) as a means and model for resisting physical and psychological violence, cultural annihilation and institutional racism in the Americas has been present since the first slaves were transported to the New World via the Middle Passage » (Mellis 3). En matérialisant, à travers le gris-gris, l’héritage de ces luttes intra-diégétiques et extra-diégétiques, le texte fait entendre la voix de cultures marginalisées ; Ward s’affirme, par le choix de la mise en récit d’un objet aussi particulier et symbolique que le gris-gris, comme une activiste en lutte contre des violences policières qu’on peut lire comme des héritages indirects du système esclavagiste. En performant, à travers la fiction, la continuité des pouvoirs de protection du gris-gris, mais surtout en faisant le lien entre passé esclavagisé et filiation masculine du corps emprisonné, violenté et menacé de mort, le gris-gris semble devenir le support d’un propos politique qui dépasse les frontières de la diégèse pour défendre, en creux, la cause de l’abolition du système carcéral, telle que celle-ci a été formulée par Angela Davis dans Are Prisons Obsolete et Abolition Democracy, par Michelle Alexander et Cornel West dans The New Jim Crow, ou encore par Angela Davis, Gina Dent, Erica R. Meiners et Beth E. Richie dans Abolition. Feminism. Now.
Notes
- 1Nous nous appuyons sur les travaux de Michaël Toulza (et notamment la section de sa thèse intitulée « Une question d’orthographe ? ») pour le choix de l’orthographe du mot « vodou » de préférence à celle de « vaudou ».
- 2Freud établit dans Totem et tabou une distinction entre le tabou (fait social) et la névrose obsessionnelle (fait individuel). C’est à une névrose obsessionnelle au sujet du gris-gris que Leonie semble confrontée.
- 3Nous soulignons.
- 4Puisque le gris-gris a une dimension spirituelle à laquelle Leonie ne veut pas être assimilée, elle le tient à distance, ce qui confère paradoxalement, en retour, une sorte de dimension sacrée à l’objet.
- 5Discours qui revêt un caractère rituel pour les parents de garçons noirs aux États-Unis : il s’agit de prévenir ces derniers du danger qu’ils encourent à l’extérieur de chez eux, notamment lors de confrontations avec la police.
- 6Dans son ouvrage The New Jim Crow, Alexander note : « Since the nation’s founding, African Americans repeatedly have been controlled through institutions such as slavery and Jim Crow, which appear to die, but then are reborn in new form, tailored to the needs and constraints of the time » (Alexander and West 16).
- 7(Kwint 5-6, nous traduisons)
Bibliographie
- Alexander, Michelle, and Cornel West. The New Jim Crow: Mass Incarceration in the Age of Colorblindness. 2010. Revised edition, New Press, 2012.
- Davis, Angela Y. Are Prisons Obsolete? Seven Stories Press, 2003.
- Davis, Angela Y. Abolition Democracy: Beyond Empire, Prisons and Torture. Seven Stories Press, 2005.
- Davis, Angela Y., Gina Dent, Erica R. Meiners, Beth E. Richie. Abolition. Feminism. Now. 2020. Haymarket Books, 2022.
- Freud, Sigmund. Totem et tabou. Trad. J. Altounian, A. Bourguignon, P. Cotet, A. Rauzy, avec F. Baillet. Œuvres complètes, XI. 1913. Paris, 1998.
- Hurston, Zora Neale. Mules and Men. 1935. Perennial Library, 1990.
- Kwint, Marius. Material Memories. Bloomsbury Academic, 1999. DOI.org (Crossref), https://doi.org/10.5040/9781474215206.
- Mellis, James. “Continuing Conjure: African-Based Spiritual Traditions in Colson Whitehead’s The Underground Railroad and Jesmyn Ward’s Sing, Unburied, Sing.” Religions, vol. 10, no. 7, June 2019. DOI.org (Crossref), https://doi.org/10.3390/rel10070403.
- Morrison, Toni. Beloved. 1987. Vintage, 2007.
- Tisseron, Serge. Comment l’esprit vient aux objets. Aubier, 1999.
- Toulza, Mikaël. Le vaudou louisianais dans les fictions audiovisuelles- représentation, identité, subversion. 2021. Université de Toulouse, thèse de doctorat.
- Ward, Jesmyn. Men We Reaped. A Memoir. 2013. Bloomsbury Publishing, 2018.
- Ward, Jesmyn. Sing, Unburied, Sing. 2017. Bloomsbury Publishing, 2018.
About the author(s)
Biographie : Carla Toquet est ATER en anglais, à l’UFR LLCE de l’Université de la Réunion et doctorante au CREA (Université Paris Nanterre). Son travail porte sur les récits contemporains de Jesmyn Ward (Men we Reaped, 2013 and Sing, Unburied, Sing, 2015) et d’Ava DuVernay (13, 2016 and When They See Us, 2019). Sa recherche doctorale vise à définir ces œuvres comme des oeuvres documentaires – bien que leur recours à la fiction semblent à première vue les exclure de cette catégorie– et à en proposer une lecture féministe. Elle articule les textes de Ward et de DuVernay à la dénonciation d’un système juridique et carcéral gangréné par le racisme d’État, ainsi qu’à l’affirmation d’un féminisme noir étatsunien contemporain.
Biography: Carla Toquet is a Teaching and Research Assistant at the Department of English at the University of La Réunion. She is also a PhD student at Paris Nanterre University (CREA). Her thesis explores the intersection of contemporary African American literature and cinema. She is particularly interested in analyzing the way contemporary African American women’s discourses aim at fighting racial injustice and the criminalization of young African American men, by drawing from artistic and historical filiation. The research she conducts on Jesmyn Ward and Ava DuVernay aims at questioning the documentary value of their work, as well as the type of feminist activism that emerges from the affirmation of such voices.