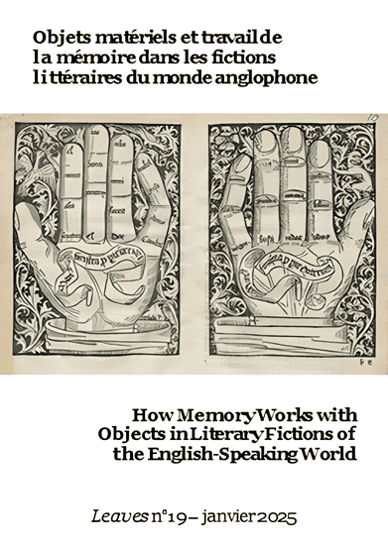De l’archive au poème : métamorphoses de la mémoire dans Paterson de William Carlos Williams
Abstract: This paper studies the way William Carlos Williams resorts to archives in Paterson and explores whether the transformation of archives into poetry metamorphoses memory. The numerous instances of censorship indeed trigger a system of memorial obliteration. Yet, this phenomenon is counterbalanced by poetic techniques aimed at recreating memory. As a result, the memory at stake in Paterson is reminiscent of Paul Ricoeur’s theory according to which memory is a reappropriation of the past. Public archives (referring to the history of the city of Paterson), private documents (such as medical notes on patients) or even personal archives (correspondences) are juxtaposed to verse. In the end, if Paterson is an object of memory, it is not because it contains archives but because it generates them to eventually become a poetic archive that is less oriented towards the past than towards the present, if not the future, as Williams transforms his own death into an archive in the final book. Such passages convey autothanatographic undertones that anticipate the future while challenging the linearity of memory: memory is less related to the past than to the present and the future at the end of Paterson.
Keywords: Archive, Paterson, William Carlos Williams, Memory, Autothanatography, History
Résumé : Cet article étudie la mise en poème des archives dans Paterson de William Carlos Williams. Les diverses censures observables donnent en effet lieu à un phénomène d’oblitération compensé par des techniques poétiques visant à reconstituer l’événement. Ce processus de reconstitution repose sur l’imagination du poète, et la mémoire apparaît comme transformée sous la plume de l’écrivain. Cette configuration rapproche Paterson des théories de Paul Ricoeur, qui considère la mémoire comme réappropriation du passé. Archives publiques (histoire de la ville), privées (comptes rendus médicaux du poète-médecin) ou intimes (correspondances personnelles) se mêlent au texte poétique. In fine, ce ne sont pas les archives que Paterson contient qui font de l’œuvre un objet de mémoire, mais les archives créées par l’œuvre. Williams projette par exemple sa propre mort dans le dernier livre de l’ouvrage. De tels passages aux échos autothanatographiques anticipent l’avenir et remettent en question la linéarité de la mémoire : elle dépend moins du passé que du présent et de l’avenir à la fin du poème.
Mots-clés : Archive, Paterson, William Carlos Williams, Mémoire, Autothanatographie, Histoire
–the angle of a forehead or far less makes him remember when he thought he had forgot –remember confidently only a moment, only for a fleeting moment– with a smile of recognition . . (Paterson 205)
Objets concrets et matériels provoquent la remémoration dans Paterson, poème épique de William Carlos Williams dont les cinq livres ont été publiés entre 1946 et 1958. Le premier livre élève la ville de Paterson au rang de mythe. Dans le livre II, l’art, l’imagination et surtout la mémoire sont sources de renouveau linguistique et poétique. Néanmoins, ce point de vue sur la mémoire est contredit au livre III : le poète se rend compte que le passé ne représente que la stérilité, la désolation et la mort. La quête de sens du poète ne se situe donc plus dans le passé mais dans le présent de la société moderne au livre IV. Le livre V, qui n’était pas prévu dans le projet initial de Williams, est plus métatextuel : le poète âgé porte un regard rétrospectif sur son texte. La structure de Paterson, œuvre dans laquelle l’esthétique du collage est perceptible, oscille ainsi entre passé et présent. Le critique Roy Harvey Pearce note à ce titre que le poème constitue une méditation sur l’histoire de la ville (Pearce 119) au sein de laquelle la temporalité évolue. Le passé cède le pas au présent, puis à l’avenir : « In the poem the Giant and the poet whose true progenitor he is have relived the past so that they might live in the present and into the future » (Pearce 120). À la lumière de ces analyses, les archives que Williams cite dans son texte rappellent la définition qu’en formule Michel Foucault. Selon Foucault, l’archive représente un entre-deux temporel, elle est « à la fois proche de nous, mais différente de notre actualité, c’est la bordure du temps qui entoure notre présent, qui le surplombe et qui l’indique dans son altérité » (172). Des archives, ces objets « porte-mémoire », le passé de la ville de Paterson resurgit. Ainsi, l’archive est à la fois objet en soi et pour soi, matérialité pure insérée dans le texte de Paterson, mais également lieu de mémoire rendant hommage aux figures absentes qui font signe à travers elle. Il est également essentiel de prendre en compte la dimension linguistique des archives mentionnées par l’auteur : elles constituent un système de signifiants qui pallient l’absence du référent. Il convient d’observer que l’absence du référent est seulement palliée, et non pas entièrement comblée, par la présence de ce signifiant. Il convient également de remarquer que ces signifiants sont marqués en eux-mêmes par une forme d’incomplétude, les archives en question étant des extraits, donc des textes parcellaires ayant parfois été censurés. De tels remaniements textuels posent la question d’un éventuel remodelage de l’histoire ayant lieu dans le moment présent de l’énonciation. Le poème de Williams peut ainsi être lu à la lumière des écrits de Paul Ricoeur, qui considère « la mémoire, non plus comme simple matrice de l’histoire mais comme réappropriation du passé » (21). En d’autres termes, lorsqu’ils sont remémorés, les événements passés forgent l’identité présente.
Bien que la critique des années 1970 et 1980 suggère que Paterson transmet les archives dans toute leur matérialité (« [Williams] […] represented not their image but their very objecthood » Klinkowitz 126) afin de créer ce que David Walker nomme une « expérience directe » des objets (176), à partir des années 1990, des critiques tels que Neil Easterbrook affirment que si cette expérience directe apparaît dans les premiers poèmes de Williams, ce n’est pas le cas pour Paterson. Cet article s’inscrira dans la veine critique qui se développe depuis les années 1990 et 2000 ; un nombre croissant de chercheurs notent en effet que les objets évoqués par le poète forment des systèmes de signification qui ne sont pas en prise avec le réel : « In Paterson, Williams dissects and re-examines what Clifford Geertz has called “webs of significance”—the interlocking grids of semiotic contingency that constrain, as well as empower, both individual and community » (Meyer 65). Ces réseaux de signification sont intimement liés à la pensée, à la psyché et à l’imagination, et les objets se présentent ainsi comme des éléments porte-mémoire plutôt que comme des médiateurs d’une expérience directe avec le réel ou le souvenir. Les objets, et plus précisément ceux directement insérés dans le texte de Paterson à l’instar des archives, sont ainsi moins des référents que des signifiants. Cette perspective rappelle la définition que (Paul) Ricoeur formule à propos du souvenir. Ce dernier serait un « signe » similaire à un signe linguistique (Ricoeur 21-22). Le théoricien met également l’accent sur le rôle joué par la narration : les souvenirs sont reconstitués à travers des récits et des histoires, approche qui rappelle le lien que Pierre Janet établit entre mémoire, récit et langage :
Le phénomène essentiel de la mémoire humaine, c’est l’acte du récit. Le récit est un langage […] qui a des propriétés particulières, celle de permettre à des individus qui ont été absents au moment de certains événements de se comporter cependant comme s’ils avaient été présents, le récit transforme les absents en présents. (Janet 163-64)
Il s’agira donc d’analyser les systèmes de significations des archives et le rapport que ces derniers entretiennent avec la mémoire et les actes de mise en récit du passé dans le poème de Williams.
Cet article procèdera à un classement typologique des archives afin de montrer que dans tous les types d’archives sur lesquelles portera notre étude, la mise en poème de l’archive suppose une réappropriation du passé : une analyse des archives publiques montrera que le poème reconstitue moins l’histoire locale qu’il ne la réécrit. Ensuite, si les archives privées se présentent de prime abord comme des bribes biographiques, la censure à laquelle elles sont soumises les dépouille de leur dimension mémorielle, et ces dernières s’apparentent donc plus à des cénotaphes poétiques. Enfin, les archives intimes laissent penser à un ton autobiographique, mais la mise en scène du moi qu’elles supposent révèlent une manipulation de la mémoire suggérant, in fine, que le passage de l’archive au poème relève d’une intention eidétique : Paterson recrée moins la mémoire qu’il ne la transmute.
Archives publiques : de la reconstitution à la réécriture historique
Cet article s’intéressera à trois passages emblématiques de l’ouvrage où les archives pointent respectivement vers le passé, le présent et l’avenir. Si les livres I et II chérissent la mémoire car elle est gage d’innovation poétique, les difficultés de santé du poète à partir de 1948, année de publication du livre III, le poussent à profiter davantage du moment présent, d’où un revirement notable au livre III duquel est extrait le premier passage analysé dans ce travail. Il s’agit de la scène de l’incendie de la bibliothèque de Paterson. Elle représente des archives qui brûlent et disparaissent. La quête poétique de Williams qui vise donc à simuler poétiquement l’objet mémoriel et n’est pas sans rappeler l’analyse que (Paul)Ricoeur fait du souvenir. Ce dernier est un signe dont le référent est absent. Écrire la mémoire, c’est écrire ce qui n’est plus, ce qui a disparu à l’instar des livres et des archives de la bibliothèque de Paterson :
Un souvenir surgit à l’esprit sous la forme d’une image qui, spontanément, se donne comme signe de quelque chose d’autre, réellement absent mais que l’on tient pour ayant existé dans le passé […]. C’est là l’énigme que la mémoire laisse en héritage à l’histoire : le passé est en quelque sorte présent dans l’image comme signe de son absence, mais une absence qui, bien que n’étant plus, est tenue pour ayant été. (Ricoeur 21-22)
Pour recréer cet « ayant été », le livre III, qui évoque l’incendie de la bibliothèque publique Danforth à Paterson le 8 février 1902, est parsemé d’artéfacts historiques, notamment d’archives et de témoignages issus de la monographie de William Nelson et Charles A. Shriner intitulée History of Paterson and its Environs: The Silk City (1920).
Si la première partie du livre III commence par faire l’apologie de la lecture, la bibliothèque est ensuite décrite comme obsolète et putréfiée, désignée à travers des noms péjoratifs comme « staleness », « rot » ou « stench » (« The place sweats of staleness and of rot / a back-house stench . a / library stench » [103]). Les livres appartiennent à un passé en apparence inaccessible, confiné derrière les murs de la bibliothèque (« Dead men’s dreams, confined by these walls » [100]).
L’épisode de l’incendie succède à l’évocation d’un passage de la monographie History of the City of Paterson and the County of Passaic New Jersey (1901) de William Nelson. Dans cet ouvrage, l’historien décrit les rites purificateurs et pratiques liturgiques des Amérindiens. Williams traite le texte de Nelson non pas comme une source secondaire mais comme une source primaire, déterminant ainsi son statut d’archive dans Paterson. Le poète reprend notamment le passage dans lequel Nelson explique la manière dont les Amérindiens utilisaient le feu (« Now here is where one sits who will address the Spirit of Fire » apparaît à la page 37 de la monographie de Nelson et à la page 114 de Paterson de Williams), et la fumée produite par les Amérindiens au XVIIe siècle sert de transition à Williams pour évoquer l’incendie qui a frappé la ville de Paterson en 1902, ce qui crée une ellipse temporelle dans le poème :
(breathing the books in) the acrid fumes, for what they could decipher . warping the sense to detect the norm, to break through the skull of custom to a place hidden from affection, women and offspring — an affection for the burning . (Paterson 115)
Bien qu’il s’agisse d’un souvenir qui survient de manière associative, cette description arrive de façon anachronique, si ce n’est impromptue, ce qui permet au poète de recréer l’inattendu de l’événement dans le présent et de se le réapproprier de manière poétique. Cette lecture ricoeurienne des vers de Williams est renforcée par la prosodie du premier vers de cet extrait : l’allitération de plosives reconstitue le caractère surprenant et violent de cet incendie.
Au-delà de la volonté de reconstituer l’incendie, Williams utilise ce souvenir comme point de départ d’un commentaire esthétique. La destruction des livres appartenant au passé est représentée comme une libération poétique, l’occasion de s’éloigner du canon. Si le vers « breathing the books in » est une référence synesthétique à l’idée d’apprentissage ou d’étude par les livres, l’adjectif péjoratif « acrid » qui suit suppose une expérience sensorielle déplaisante, ce qui crée un contraste entre les deux premiers vers. Le savoir transmis par les livres en question n’est donc pas toujours bénéfique, d’où la nécessité de transcender leurs limites (« to detect the norm, to break / through the skull of custom »), de remettre en question la pensée conventionnelle, c’est-à-dire le discours transmis par les livres, ces textes anciens qui se constituent archives et objets de mémoire, que Williams considère comme archaïques, comme l’image du crâne le suggère. L’antépiphore portant sur le mot « affection » à l’avant-dernier vers de ce passage représente également ce rejet du passé. L’affection ne porte pas sur les livres mais sur le brasier qui les détruit et qui, par la même occasion, détruit les écrits normatifs. Cet incendie, aussi destructeur soit-il, permet donc une libération, si ce n’est un renouveau, poétique. Dans une lettre à Parker Tyler datant du 10 mars 1948, Williams explique le rôle innovant de la prose dans Paterson. Elle lui permet notamment de s’éloigner de la norme poétique établie par T. S. Eliot : « Poetry does not have to be kept away from prose as Mr. Eliot might insist, it goes along with prose » (Selected Letters 263).
Ce n’est qu’après ces quelques vers évoquant l’incendie que l’archive authentique est citée par le poète :
It started in the car barns of the street railway company, in the paint shop. The men had been working all day refinishing old cars with the doors and windows kept closed because of the weather which was very cold. There was paint and especially varnish being used freely on all sides. Heaps of paint soaked rags had been thrown into the corners. One of the cars took fire in the night. (Paterson 115)
Cette archive issue de la monographie de William Nelson et Charles A. Shriner mentionnée précédemment fournit des informations quant à la cause et la localisation du départ d’incendie. Le passage progresse de manière logique : il passe d’une échelle macroscopique (les granges) à une échelle microscopique (les chiffons imbibés de vernis inflammable), comme pour cartographier l’incident de manière méthodique. Cet extrait explique le sinistre par le rythme de travail éreintant qui fatigue les employés comme le signale l’utilisation de l’aspect perfectif couplé à l’aspect continu : « The men had been working all day ». Toutefois, il s’agit uniquement d’un fragment qui ne permet qu’une remémoration parcellaire de l’événement. L’utilisation du pronom « one » dans une structure en « of » (« one of the cars ») donne certes lieu à un phénomène d’extraction mais ne précise par exemple pas de quelle voiture il s’agit. Dès lors, le texte de Williams, qui allie vers poétique et prose historique, est un collage qui pointe moins vers l’événement historique (l’incendie) que vers ce qui a disparu : les objets matériels (livres), les monuments (la bibliothèque) ou encore la référentialité linguistique (comme le signale « one of the cars »). L’archive pointe donc vers ce que Ricoeur nomme cet « ayant été » qui, chez Williams, non seulement n’est plus, mais n’est pas non plus évocable au travers du langage. Le poète joue ainsi avec l’énonçabilité de l’archive telle qu’elle est définie par Foucault :
L’archive, c’est d’abord la loi de ce qui peut être dit, le système qui régit l’apparition des énoncés comme événements singuliers. […] L’archive, ce n’est pas ce qui sauvegarde, malgré sa fuite immédiate, l’événement de l’énoncé et conserve, pour les mémoires futures, son état civil d’évadé ; c’est ce qui, à la racine même de l’énoncé-événement, et dans le corps où il se donne, définit d’entrée de jeu le système de sonénonçabilité. (Foucault 169-70)
L’archive définit ainsi la manière dont le discours se construit. La deuxième partie du livre III réemploie le motif de l’incendie dans un contexte plus métaphorique : l’acte d’écriture est comparé à un feu (« to write / is a fire » Paterson [113]). Comme l’incendie, l’écriture se fait ainsi acte de destruction nécessaire à la reconstruction, poétique.
Puisque les archives choisies par Williams sont censurées, incomplètes, ou encore combinées de manière anachronique, elles se lisent sous le prisme de ce que Jacques Derrida nomme des « anarchives ». Derrida remet en question l’idée traditionnelle selon laquelle les archives sont des dépôts neutres et transparents de connaissances et de vérités. En effet, selon le théoricien, « rien n’est moins sûr, rien n’est moins clair, aujourd’hui que le mot d’archive. […] Rien n’est plus trouble et plus troublant » (Mal d’archives 141). Une anarchive est une archive qui perturbe, déstabilise et subvertit les conceptions traditionnelles de l’archive en tant qu’entité stable et linéaire. Il soutient que les archives ne sont pas des entités fixes et complètes, mais plutôt des constructions sociales et historiques, soumises à des forces politiques, idéologiques et culturelles. L’anarchive est donc un concept qui met en évidence les failles, les silences et les contradictions inhérentes à toute archive et la théorie derridienne met en lumière les exclusions, les omissions et les biais qui peuvent exister dans les archives, ainsi que les processus de sélection et de censure qui façonnent leur contenu. Sélection et censure, c’est exactement ce que fait Williams lorsqu’il juxtapose des bribes d’archives à son texte poétique, comme l’illustre l’extrait suivant où les mots se métamorphosent en flammes ascendantes similaires à celles du brasier décrit, actualisant la déclaration du poète selon laquelle l’écriture est un feu :
When discovered it was a small blaze, though it was hot but it looked as tho’ the firemen could handle it. But at dawn a wind came up and the flames (which they thought were subsiding) got suddenly out of control—sweeping the block and heading toward the business district. Before noon the whole city was doomed—
Beautiful thing —the whole city doomed! And the flames towering . like a mouse, like a red slipper, like a star, a geranium a cat’s tongue or — thought, thought that is a leaf, a pebble, an old man out of a story by Pushkin . Ah! rotten beams tum- bling, . an old bottle mauled The night was made day by the flames, flames on which he fed—grubbing the page (the burning page) (Paterson 116-17)
La césure typographique de « tum-/bling » revêt un aspect métapoétique en ce que ce ne sont pas seulement les poutres mais également les mots du poète qui s’écroulent, mimésis typographique permettant de recréer l’expérience de l’incendie. Au même titre, une référence métatextuelle dans le dernier vers de l’extrait signale que la page s’enflamme (« (the burning page) »). Le passage en prose, quant à lui, commence par une proposition adverbiale suivie du pronom « it ». Le placement de l’adverbiale en position initiale ainsi que le choix d’un pronom indéfini constituent une stratégie de retardement de l’apparition du référent. Cela permet de rendre compte de la difficulté à nommer l’incendie. Comme le pronom indéfini, ce dernier est d’ailleurs indéfinissable tant il est protéen, au même titre que le texte poétique dont la forme varie. Si la verticalité du poème rappelle le mouvement ascendant des flammes (« the flames towering »), les points isolés ainsi que les tirets cadratins ont une dimension métatextuelle : ils représentent visuellement la destruction causée par l’incendie de la bibliothèque, nommément la disparition des livres et du langage qu’ils contiennent. Lin Su les considère d’ailleurs comme des écrans qui, comme la fumée de l’incendie, dissimulent le paysage : « The dash […] is the misty, glimmering horizon beyond the immediately visible landscape » (Su 130). Les tirets cadratins matérialisent également le lien entre la mémoire portée par l’archive et le poème. Si l’archive en prose se termine par un tiret, le deuxième vers du texte qui suit est quant à lui initié par un tiret. Précédée ou succédée par un tiret, l’expression « the whole city was doomed » est également répétée, ce qui crée un effet d’écho entre l’archive en prose et le poème en vers, à la différence près que lorsqu’elle est réitérée, une ellipse du verbe « be » a lieu, ce qui renforce d’autant plus le lien entre le nom « city » et le participe à valeur d’adjectif « doomed ». Ces raccourcis linguistiques montrent comme la mémoire s’érode et comme l’archive est subvertie par sa mise en poème. Enfin, les épizeuxes tels que « thought, thought » ou « flames, flames » contribuent à l’esthétique du double qui habite ce passage. En effet, ces tropes reposent sur un rythme binaire qui est également identifiable dans les associations telles que « mouse » et « cat ». De la même manière, l’atmosphère nocturne est évoquée par « slipper » et « star », couple qui, au-delà d’une similitude thématique, est renforcé par l’allitération en /s/ et la rime en /r/ qui lient les deux mots. Cette esthétique duelle est aussi identifiable dans le passage en prose : ce dernier est divisé par l’adverbe contrastif « but ». Tout est comme si le lecteur assistait à un dédoublement de l’événement : en étant raconté, l’incendie est reproduit, multiplié. D’ailleurs, si le passage en prose est au prétérit, le texte versifié a recours à des participes présent (« towering »), des présents simples (« that is a leaf ») et une interjection (« Ah! ») qui ancrent l’événement dans le présent. Cette double temporalité renforce l’hypothèse d’une duplication de l’événement : l’incendie est à la fois objet de mémoire et événement actualisé par le poème. L’archive seule, non actualisée par le poème, est d’ailleurs stérile, sorte de « monument funéraire » chez Williams, « Dès lors que l’on franchit le seuil de la bibliothèque, sanctuaire du sceau de la tradition recélant la masse du savoir thésaurisé, les livres deviennent des monuments funéraires et le lecteur, vampirisé, peut au mieux espérer se faire nécrophage » (Bucher 188).
Somme toute, le texte poétique vient créer un trouble dans la soi-disant « objectivité » de l’archive initiale et se la réapproprie afin de restituer une histoire collective par l’intervention de l’imagination poétique. À cette histoire collective issue des archives publiques viennent ensuite s’ajouter les histoires individuelles des habitants de Paterson. L’exploitation des artéfacts publics se voit donc complétée par l’évocation d’archives privées.
Archives privées : du récit biographique au cénotaphe poétique
Puisque l’incendie de la bibliothèque représente la destruction du passé, c’est ensuite le présent qui prime dans Paterson. Le quotidien moderne est ainsi archivé par le poète, comme le suggère le deuxième passage (du poème) que cet article se propose d’analyser, nommément la retranscription d’une consultation médicale du poète-médecin. Étant donné que Paterson repose sur une poésie du quotidien, il est peu étonnant de constater que l’un des principaux objets d’étude du poète-médecin est sa patientèle. Au même titre que les comptes rendus d’interventions et autres rapports médicaux qui figurent dans Paterson, les multiples conversations, orales ou écrites, entretenues avec ses patientes et transcrites dans l’œuvre constituent des archives privées relatant des scènes du quotidien. Ces archives s’érigent ainsi en fragments biographiques. Néanmoins, pour des raisons aussi bien éthiques que juridiques, Williams ne peut communiquer le nom de ses patientes. Les archives privées transcrites dans Paterson sont donc des bribes anonymes. Le poème qui conserve la mémoire des patientes est ainsi moins un monument qu’un cénotaphe, ce tombeau vide élevé à la mémoire d’un mort. Tout comme le cénotaphe qui ne contient pas l’objet qu’il commémore, le poème de Williams n’inclut pas l’identité des personnes évoquées. Dès lors, une telle censure de l’archive correspond-t-elle à une oblitération de la mémoire ? La description de la consultation que le docteur Paterson effectue dans une maison close repose sur les codes de l’archive. Le poète commence par cartographier les lieux de l’événement, à la manière des historiens du XXe siècle tels que William Nelson et Charles A. Shriner, dont l’ouvrage sert d’intertexte à Paterson :
Yes, said the Lady of the House to my questioning. Downstairs (by the laundry tubs) and she pointed, smiling, to the basement, still smiling, and went out and left me with you (alone in the house) (Paterson 125)
L’emploi de « you », pronom qui fait ici référence à la patiente qui attend le médecin au sous-sol, témoigne d’une certaine intimité partagée entre cette dernière et le médecin. Dans ce passage, Williams adopte néanmoins un style similaire à celui employé dans les archives qu’il cite dans Paterson. Comme dans le cas des archives publiques décrivant le départ d’incendie, le poème suit un mouvement allant de l’échelle macroscopique (la maison) à l’échelle microscopique (les bacs à lessive). En outre, il a recours au prétérit, ce qui différencie ce passage des nombreuses autres instances au présent. Enfin, cet extrait consiste en une retranscription de la conversation entretenue par le docteur Paterson avec la matrone d’une maison close. Il est donc question pour le poète de fixer l’échange sur le papier, de l’archiver. Cette entrée en matière laisse ainsi supposer qu’au travers du poème, le médecin élabore une archive, ou une note médicale, l’écriture devenant ainsi un objet mnémonique. Le texte poétique, par sa forme, ajoute une dimension scopique à l’archive. En effet, le vers triadique initié à partir de « Downstairs » reproduit textuellement la forme d’un escalier. De fait, la mise en poème de l’événement fait du texte un outil d’archivage médical.
Cet archivage médical correspond à la mise en mémoire d’un segment de vie et peut apriori être lu comme bribe biographique. Néanmoins, le processus d’archivage initié par le poète n’est pas total. Comme dans le cas des archives publiques, les archives privées qu’il produit sont censurées, et l’objet de mémoire devient anonyme. Le nom de la patiente violée n’est jamais mentionné, tout comme le nom des nombreux autres citadins évoqués dans Paterson, raison pour laquelle Anna Aublet décrit ce lieu comme une « ville anonyme » (Aublet 249) dans sa thèse. La censure du nom des patientes rencontrées par le médecin s’explique par des raisons juridiques liées au respect du secret médical. Par conséquent, il n’est pas rare de trouver des noms d’emprunt dans les œuvres de Williams, Paterson y compris. Les femmes qu’il soigne sont également parfois traitées comme des allégories, à l’instar de la prostituée citée au livre III de l’ouvrage. Cette dernière est en effet désignée comme « Perséphone », personnifiant ainsi le mythe de la catabase :
Persephone gone to hell, that hell could not keep with the advancing season of pity. (Paterson 126)
Du fait du changement de nom de la patiente de Williams, le cas médical dépeint par le poète excède sa dimension pragmatique pour suggérer des considérations mythologiques et cosmogoniques. Selon le mythe, Perséphone, qui cueillait des fleurs dans un champ, se fit enlever par Hadès, dieu des Enfers. Chez Williams, tout semble faire référence à ce mythe. Par exemple, la cave souterraine dans laquelle se trouve la prostituée symbolise les Enfers, démontrant que l’archive initialement médicale est métamorphosée et esthétisée par sa mise en poème. Si le nom de la patiente est censuré, cette dernière est également réifiée dans le poème. La patiente est par exemple comparée à des objets matériels inanimés :
You showed me your legs, scarred (as a child)
by the whip .
Read. Bring the mind back (attendant upon
the page) to the day’s heat. The page also is
the same beauty: a dry beauty of the page —
beaten by whips
A tapestry hound
with his thread teeth drawing crimson from
the throat of the unicorn
. . . a yelping of white hounds
—under a ceiling like that of San Lorenzo, the long
painted beams, straight across, that preceded
the domes and arches
more primitive, square edged (Paterson 126-27)
Dans cet extrait, les cicatrices qu’affiche la patiente amènent le poète à l’assimiler tour à tour à une page blanche écorchée par l’écriture, à un motif de tapisserie ou au plafond de la Basilique San Lorenzo à Florence. L’assimilation de la patiente à de tels objets considérés comme appartenant au patrimoine renforcent le sentiment d’une transformation de cette dernière en monument. Si le rôle d’un monument est d’honorer la mémoire comme semble le suggérer le vers « for memory’s sake » (Paterson 128) une page plus loin, nous avons observé que la prostituée était rendue anonyme, faisant du pseudo-monument bâti par Williams un cénotaphe. Privée d’identité, la femme décrite perd son caractère spécifique et est transformée en allégorie générique comme semble d’ailleurs le suggérer la fin de la description, qui invoque l’adjectif totalisant « all » : « […] all / desired women have had each / in the end / a busted nose » (Paterson 128). Si dans cette citation le pronom « each » propose une vision individualisante et analytique des femmes évoquées, c’est bien au groupe que ce passage fait référence puisqu’il est ouvert par un adjectif synthétique faisant référence au tout. Du cas particulier d’une archive médicale à propos d’une prostituée, Williams formule une conclusion généralisante sur les femmes. Par conséquent, la censure de l’archive privée correspond à une oblitération de la mémoire individuelle au profit de la création d’une mémoire collective et universelle sur la condition des femmes. Cette dernière est permise par l’anonymat ainsi que la référence à une figure mythologique, nommément Perséphone.
Ce mouvement allant de la mémoire individuelle à la mémoire universelle rappelle les réseaux mnémoniques que T. Hugh Crawford identifie dans Paterson. Dans son article « Paterson, Memex, and Hypertext », il montre comme le texte de Williams crée un réseau semblable à un système d’indexation mémorielle, le « memex », ancêtre de l’hypertexte imaginé par l’ingénieur américain Vannevar Bush dans son essai « As We May Think » (1945). Le « memex », mot-valise associant les termes « mémoire » et « index », est une machine capable de stocker d’énormes quantités d’informations afin de les indexer et de les lier. Hugh T. Crawford remarque que le système williamsien d’organisation de l’information dans Paterson est élaboré au même moment que le « memex » de Bush : « At precisely the period of the proposed memex […], Williams was wrestling with his own information » (Crawford 667). Dans Paterson, les mots et les archives sont en effet organisés en réseau, dessinant une mémoire du texte. Par exemple, dans le passage ci-dessus qui décrit la consultation avec la prostituée, les dents mentionnées ne sont pas évoquées pour la première fois. Leur évolution dans Paterson est à l’image des altérations de la mémoire : les dents changent plusieurs fois de fonction avant de se dissiper dans la masse de signifiants constituée par le poème, passant ainsi du statut d’objet de mémoire particulier à celui de mémoire universelle. D’abord associées à des pronoms personnels sujets (« I have a new set of teeth » [Paterson 27]; « A tapestry hound / with his thread teeth drawing crimson from / the throat of the unicorn » [Paterson 126]), les dents sont progressivement précédées de déterminants moins spécifiques (« The sullen, leaden flood, the silken flood / —to the teeth / to the very eyes » [Paterson 130]). Elles finissent par s’effacer du texte lorsqu’elles réapparaissent au sein d’une polysyndète évoquant un cadavre : « its identity and its sex, as its hopes, and its / despairs and its moles and its marks and / its teeth and its nails be no longer decipherable / and so lost . » (Paterson 160). Plus déchiffrables, fondues dans la masse, les dents disparaissent pour laisser un vide, ce blanc typographique séparant le texte de son point final. Les dents, et la mémoire qu’elles portent, se sont donc universalisées. À ce titre, Roy Harvey Pearce note que Paterson sépare l’individu de l’histoire dans un mouvement universalisant : « The theme is divorce, as Williams puts it: separation of man from his history » (Pearce 115). Néanmoins, peut-être une mémoire individuelle reste-t-elle intacte dans l’œuvre, nommément celle du poète. En effet, les récits médicaux inclus dans Paterson laissent penser à des fragments autobiographiques constituant des archives intimes qu’il convient d’analyser.
Archives intimes : de la confession autobiographique à la mise en scène du moi
Situé après le livre IV qui archive le présent williamsien, notamment la société moderne et ses effets dévastateurs sur la nature, le dernier passage que cet article étudiera est issu du livre V. Le poète y fait référence non plus au présent mais à l’avenir. Il insère toutefois des archives intimes telles que des correspondances personnelles dans son texte à la manière d’un collage, juxtaposant ainsi le passé et l’avenir. Williams y évoque également ses réalisations passées, à l’instar de sa traduction de 1929 des Dernières Nuits de Paris de Philippe Soupault :
What has happened since Soupault gave him the novel the Dadaist novel to translate— The Last Nights of Paris. “What has happened to Paris since that time? and to myself”? (Paterson 207)
Si le poète porte un regard rétrospectif sur sa vie, la forme de cet extrait laisse peser un doute quant à son caractère autobiographique : si Philippe Lejeune déclare qu’une autobiographie est un « récit à la première personne » (Lejeune 16), Williams parle de lui à la troisième personne (« Soupault gave him the novel ») tandis que la voix de l’auteur est placée entre guillemets, comme s’il se mettait lui-même en scène. La mémoire se transforme ainsi en un récit et dans Paterson, le poète se présente presque comme un personnage théâtral. Puisque la ville est personnifiée, le personnage de Paterson est considéré par de nombreux critiques comme un double de Williams. Par exemple, Stephen Tapscott remarque que Paterson, tout comme le poète, exerce en tant que médecin : « Paterson himself as a doctor is more than an autobiographical intrusion on Williams’s part » (Tapscott 77). Au livre V, ce personnage adopte un regard rétrospectif sur sa propre vie :
Paterson, from the air above the low range of its hills across the river on a rock-ridge has returned to the old scenes to witness
What has happened (Paterson 207) Dans ce passage, le poète se situe sur un promontoire (« rock-ridge ») dans une position surplombante lui permettant d’adopter un point de vue global ou synthétique sur sa vie passée (« old scenes »). De fait, la dimension autobiographique de l’œuvre est palpable, notamment lorsque Williams évoque sa propre vieillesse :
In old age the mind casts off rebelliously an eagle from its crag (Paterson 205)
Dans cet extrait, qui marque le début du dernier livre de Paterson, l’aigle symbolise les critiques de Williams que le début de ce livre s’attache à contrer. Le mouvement non pas progressif (vers la droite), mais régressif (vers la gauche) des vers annonce un retour en arrière, vers le passé. À la lecture de telles scènes, Vincent Bucher propose de considérer Paterson comme une archive en soi : « dès lors que ce corpus est pris synthétiquement comme archive, comme trame à négocier, il contribue non seulement à la constitution du lieu commun qu’est la ville de Paterson mais représente aussi l’idiome partagé dans lequel le poète trouve justement sa voix et sa place » (Bucher 201). Pour Vincent Bucher, cette archive passée définit la ville dans le présent et établit l’identité à venir du poète. Les temporalités se croisent donc et le poème remet en question la linéarité de la mémoire et permet un renouvellement poétique qui rappelle l’ambition du livre II qui voyait en la mémoire la possibilité d’un renouvellement poétique :
Memory is a kind of accomplishment a sort of renewal even an initiation, since the spaces it opens are new places inhabited by hordes heretofore unrealized, of new kinds— since their movements are towards new objectives (Paterson 78)
Véritable réflexion ontologique sur la nature de la mémoire, cet extrait montre que l’acte de remémoration n’est pas passif mais nécessite des compétences tant il constitue une réalisation active (« accomplishment »), un mouvement (« movement »). Comme la mémoire, les vers sont en mouvement grâce au recours au vers triadique typiquement williamsien. Pourtant, une variation du vers triadique est observable : après « an initiation, since the spaces it opens are new », le poète opère un retour à la ligne avec le terme « places » aligné à gauche. La variation du vers triadique suggère que le mouvement du poème est comme suspendu l’espace d’un instant tandis que les vers perdent en fluidité. En effet, le vers suivant initie une allitération en /h/ (« hordes / heretofore ») qui hachure la prosodie du poème. Le rythme est donc variable, les vers jouant avec le passage du temps. Dans cet extrait, la mémoire fait ainsi le lien entre diverses temporalités. Elle est un objet liminal, entre le révolu et l’inédit, le passé et le présent. C’est ainsi que peut s’interpréter la métaphore de l’initiation employée par Williams : se souvenir implique un voyage, un rite de passage. À la fin de l’extrait, les nouveaux objectifs (« new objectives ») suggèrent que la mémoire a un aspect prospectif : le rappel du passé influence et façonne les objectifs à venir. La mémoire se voit ainsi transformée sous l’effet des vers de Williams : cette notion évoquant initialement le passé devient un outil prophétique. Selon Thomas Pison, Williams remet en question la linéarité du temps et le lien de causalité liant le passé et le présent en ce qu’il éclate le vers (traduit par « line » en anglais, et donc partageant une racine étymologique avec le terme « linearity »). Le vers triadique est donc une réaction à la linéarité du temps, mais également du langage : « Williams effected a new liberation for his poetry from the age-old imperatives of the line » (Pison 330). Malgré ses références à la mémoire, Paterson n’est donc pas fondé sur une perspective historiciste, et l’archive s’oriente vers l’avenir : « the content of the whole poem […] is whatever comes out of the future » (Pison 331). L’archive et la mémoire se métamorphosent donc sous la plume du poète : moins attachées au passé qu’à l’avenir, elles pointent vers le futur, le non réalisé.
Ce mouvement vers l’avenir culmine en une projection de la propre mort du poète. Cela s’explique par le lien de parenté unissant la mémoire et la mort, comme le signale (Paul) Ricoeur : « Se remémorer est une forme de travail ; le travail de deuil auquel Freud consacre un autre essai important, Deuil et mélancolie, n’en est pas éloigné » (Ricoeur 28). Chez Williams, tout est comme si l’auteur projetait sa propre mort, transformant ainsi l’ouvrage non pas en archive orientée vers le passé mais en matérialisation de l’avenir, sorte d’archive inversée. En effet, si les archives publiques ou privées précédemment étudiées sont toutes initiées par un effort cartographique visant à localiser l’événement évoqué, le livre V affiche au contraire l’égarement du poète avant de convoquer la mort :
What but indirection will get to the end of the sphere? Here is not there, and will never be. The Unicorn has no match or mate . the artist has no peer . Death (Paterson 209)
L’évocation d’éléments fantastiques à l’image de la licorne couplés à des références cosmogoniques symbolisées par la sphère signale que le poète s’éloigne des considérations physiques et matérielles pour se consacrer à la métaphysique et à l’immatériel. À ce titre, la rime suivie des mots « sphere » et « here » signale que le poète se situe présentement dans cet espace de pensée cosmogonique, comme semble également le suggérer le jeu typographique impliquant un espace blanc laissé avant et après le mot « death » simulant la mort du poète, et donc de l’écriture. Une telle projection vers la mort est à rapprocher du concept d’autothanatographie, notamment théorisé par (Jacques) Derrida dans Demeure (1998). Ce terme désigne selon lui une pratique d’écriture où l’auteur se confronte à sa propre mortalité et à sa propre disparition. L’auteur se trouve face à la difficulté de représenter et de rendre compte de sa propre mort dans son écriture, tout en étant conscient de l’inéluctabilité de cette fin. L’autothanatographie met ainsi en évidence la tension entre la présence et l’absence de l’auteur, entre l’émergence de sa voix dans l’écriture et la conscience de sa propre disparition imminente. C’est donc en mettant en avant l’universalité de la mort que Williams tente de résoudre ce paradoxe :
We shall not get to the bottom:
death is a hole
in which we are all buried
Gentile and Jew (Paterson 209-10)
La paronomase prosodique rapprochant « death is a hole » de « death is a whole » se présente comme une première tentative de montrer que la mort est universelle, hypothèse renforcée non seulement par l’utilisation de pronoms inclusifs (« we ») et totalisants (« all ») au vers suivant mais également par l’addition des non-juifs aux juifs dans le dernier vers de cet extrait. Le dernier livre de Paterson se présente ainsi comme anticipation non seulement de la propre mort de l’auteur, mais également d’une mort collective, universelle. C’est pour cette raison que la critique tend à analyser le livre V comme le passage du particulier à l’universel : « Local history has become in book 5 part of a wider cultural heritage across time and continents » (MacGowan 59). Le texte constitue dès lors une anti-archive, ou une archive inversée : il ne rappelle pas le passé mais est orienté vers l’avenir. Plus qu’une mise en archive du moi, le livre V de Paterson constitue ainsi une mise en scène non seulement poétique mais également prophétique. L’évolution des thèmes abordés, notamment le passage de la physique à la métaphysique, marque une rupture quant au traitement réservé à la mémoire : l’évocation des vestiges du passé ne sont qu’un prétexte à l’élaboration de la mémoire que le poète veut que son lecteur garde de lui. De fait, il va jusqu’à projeter sa propre mort, sorte de mémoire par anticipation.
Somme toute, la mise en poème de l’archive, qu’elle soit publique, privée ou encore intime, donne lieu à une métamorphose de la mémoire dans Paterson. Ces évolutions rappellent les écrits de (Michel) Foucault qui déclare que l’archive se situe « entre la tradition et l’oubli, elle fait apparaître les règles d’une pratique qui permet aux énoncés à la fois de subsister et de se modifier régulièrement » (Foucault 171). Dans Paterson, les archives de la ville sont premièrement mises au service de la création poétique et d’une réécriture de l’histoire pointant vers l’impossibilité d’actualiser le passé au travers du discours poétique. Pour reprendre les termes de Christopher MacGowan, l’histoire n’est pas le maître mais le guide de Williams (« Paterson defines the forces of history as guide, not master » [MacGowan 50]). Des métamorphoses similaires de la mémoire ont lieu à partir des archives privées que l’auteur choisit d’inclure dans l’ouvrage. Au premier abord, Paterson semble en effet être un objet d’archivage, le poète-médecin relatant les cas médicaux auxquels il est confronté et donnant ainsi l’impression de compiler des bribes biographiques. Ces descriptions sont néanmoins incomplètes et censurées, stratégie poétique oblitérant la mémoire. La seule mémoire qui semble alors persister est celle du poète lui-même qui, dans le dernier livre, adopte un regard rétrospectif sur son œuvre. Toutefois, ce commentaire du poète âgé sur son travail est aussi l’occasion d’évoquer l’avenir, notamment sa propre mort. Ainsi, Paterson se fait objet d’anticipation, sorte d’anti-archive ou d’archive inversée qui pointe vers la mort de l’auteur, puisqu’après tout, comme Williams le déclare lui-même à la toute fin de son poème, le passé est le règne de la répétition, et non de la nouveauté recherchée par le poète, comme le suggère cette antépiphore : « The past is for those that lived in the past » (Paterson 235).
Bibliographie
- Aublet, Anna. « L’Oracle en son jardin : William Carlos Williams et Allen Ginsberg ». Thèse de doctorat sous la direction d’Hélène Aji. Université Paris Nanterre, 2018.
- Bucher, Vincent. « Désirs de monuments chez Ezra Pound, William Carlos Williams et Robert Smithson ». Monument et modernité dans l’art et la littérature britanniques et américains, dirigé par Catherine Lanone et. Al. Presses Sorbonne Nouvelle, 2015.
- Crawford, T. Hugh. « Paterson, Memex, and Hypertext. » American Literary History, vol. 8, no. 4, 1996, pp. 665-82.
- Derrida, Jacques. Demeure. Galilée, 1998.
- Derrida, Jacques. Mal d’archives. Galilée, 1995.
- Easterbrook, Neil. « “Somehow Disturbed at the Core”: Words and Things in William Carlos Williams. » South Central Review, vol. 11, no. 3, 1994, pp. 25-44.
- Foucault, Michel. L’Archéologie du savoir. Gallimard, 1969.
- Janet, Pierre. L’intelligence avant le langage. Flammarion, 1936.
- Klinkowitz, Jerome. « Avant-garde and After ». Sub/stance, vol. 27, 1980, pp. 125-38.
- Lejeune, Philippe. Le Pacte autobiographique. Seuil, 1975.
- MacGowan, Christopher. « Paterson and Local History. » William Carlos Williams Review, vol. 24, no. 2, 2004, pp. 49-60.
- Meyer, Kinereth. « William Carlos Williams, Paterson, and the Cultural Uses of Pastoral ». William Carlos Williams Review, vol. 25, no. 1, 2005, pp. 63-78.
- Nelson, William, et Charles A. Shriner. History of Paterson and its Environs: The Silk City. Newark, Lewis Historical Publishing Company, 1920.
- Nelson, William. History of the City of Paterson and the County of Passaic New Jersey. Paterson, Press Printing and Publishing Co., 1901.
- Pearce, Roy Harvey. The Continuity of American Poetry. Princeton University Press, 1961.
- Pison, Thomas. « Paterson: The Discontinuous Universe of The Present ». The Centennial Review, vol. 19, no. 1, 1975, pp. 325-337.
- Ricœur, Paul. « Mémoire, Histoire, Oubli ». Esprit, vol. 3, 2006, pp. 20-29.
- Su, Lin. « “Say it! No ideas but in things—”: Punctuation Marks and American Locality in William Carlos Williams’s Paterson. » William Carlos Williams Review, vol. 35, no. 2, 2018, pp. 128-150.
- Tapscott, Stephen J. « Williams’s Paterson: Doctor and Democrat. » The Yearbook of English Studies, vol. 8, 1978, pp. 77-94.
- Walker, David. The Transparent Lyric. Princeton University Press, 1984.
- Williams, William Carlos. Paterson. 1958. New Directions, 1995.
- Williams, William Carlos. The Selected Letters of William Carlos Williams. Ed. John C. Thirlwall, New Directions, 1957.
About the author(s)
Biographie : Samantha Lemeunier est doctorante à l’École normale supérieure (Ulm) au sein de l’ED540 et membre de l’UAR République des Savoirs où elle fait partie de l’équipe CRRLPM qui s’intéresse au rapport entre littérature, philosophie et morale. Notamment consacrées à William Carlos Williams, ses recherches ont abouti à une monographie, L’improvisation chez William Carlos Williams : expérience-limite du modernisme (éditions L’Harmattan, 2020). Dans sa thèse, « William Carlos Williams et l’hypermodernité : au-delà de la défiguration », dirigée par Mme Hélène Aji, Samantha Lemeunier adopte une approche culturelle de la littérature moderniste américaine tout en se nourrissant de réflexions ayant trait à la philosophie et à la psychanalyse afin de circonstancier la délicate classification de l’auteur.
Biography: Samantha Lemeunier is a PhD student at the Ecole normale supérieure (Ulm); she is a member of the services and research unit République des Savoirs in which she is part of the CRRLPM group studying the links between literature, philosophy and morals. She has notably worked on William Carlos Williams and published a monograph entitled L’improvisation chez William Carlos Williams : expérience-limite du modernisme in 2020. Her multidisciplinary works adopt a cultural approach towards American Modernism and also draw inspiration from philosophy and psychoanalysis as illustrated by her PhD dissertation entitled “William Carlos Williams et l’hypermodernité : au-delà de la défiguration” and supervised by Hélène Aji.