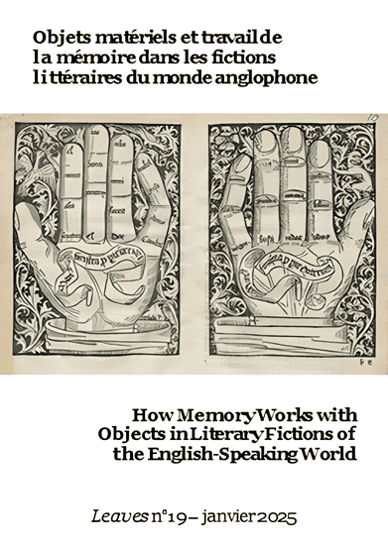« The death of an old father ». Deuil et mémoire du père dans « A Silver Dish » (1978) de Saul Bellow
Abstract: A silver dish: thus is the relic that comes to embody Woody Selbst’s conflicted relationship with his deceased father in Bellow’s short story. From its very title, the story “keeps the materiality of the missing object at the heart of the narrative” (Camps-Robertson 156). This dish is the one that “Pop” had stolen decades earlier from the Christian missionary family who had taken Woody in, hoping to make him a seminarian, thus compromising his son’s relationship with his protectors and leading to his expulsion. After his father’s death, the object alludes to the son’s ambivalent memory of his father and recalls his hand-to-hand struggle with Pop. Now deprived of the presence of his father, the dish acts as a kind of metonymic substitute and testifies to Pop’s absence. Just as the posterity of the silver plate depends not on the object itself, forever lost, but on the discourse about the object and its value, the commemoration of the father is based on an ambivalent portrait that combines longing and the overt mention of conflict between father and son.
Keywords: Jewish American Literature, Father-Son Relationship, Short Story, Mourning, Memory, Saul Bellow
Résumé : Un plat d’argent : telle est la relique qui en vient à incarner pour Woody Selbst ses relations conflictuelles avec son père défunt dans la nouvelle bellovienne. Dès son titre, la nouvelle « maintient au cœur du récit la matérialité de l’objet disparu » (Camps-Robertson 156). Ce plat, c’est celui que « Pop » avait dérobé des décennies plus tôt à la famille chrétienne missionnaire qui accueillait Woody dans l’espoir d’en faire un séminariste, compromettant ainsi les relations de son fils avec ses protecteurs et entraînant son expulsion. Après la mort du père, c’est donc à un souvenir ambivalent que cette relique fait allusion, cristallisant le rejet de l’héritage et rappelant sa lutte au corps-à-corps avec Pop, chacun tentant de retenir le plat d’argent. Privé de la référence au père désormais, le plat fait en quelque sorte office de corrélat et de témoignage d’une absence. De même que la postérité du plat d’argent dépend non pas de l’objet lui-même, à jamais perdu, mais du discours sur l’objet, la commémoration du père tient à la préservation d’un portrait en demi-teinte.
Mots-clés : Littérature juive américaine, Relation père-fils, Nouvelle, Deuil, Mémoire, Saul Bellow
« Un père », « un plat » : en quête du référent perdu.
« What do you do about death–in this case, the death of an old father? » (Bellow 12). L’incipit de la nouvelle de Saul Bellow « A Silver Dish » déroute le lecteur d’entrée de jeu à travers une interrogation lapidaire : que faire à la mort d’un père ? Tout en introduisant la thématique centrale de la perte, le narrateur pose d’emblée une question sur l’agir, comme si l’interrogation de nature métaphysique portant sur la mort n’était finalement qu’un prétexte à l’émergence d’une éthique agissante qui rend nécessaire la remémoration. Il faut, pour comprendre l’énigme du titre et de l’objet auquel il fait allusion, s’attarder sur le double article indéfini (« an old father » / « a silver dish ») : ce dont il semble être question, ce n’est pas la mort du père (celui du protagoniste, Woody Selbst), mais la mort d’un père, comme si le narrateur de la nouvelle bellovienne feignait la simple curiosité intellectuelle ou affectait de poser un problème théorique pour mieux dévoiler dans un deuxième temps le caractère intime et unique de la perte évoquée. Cette généralisation apparente de la perte ne doit pas tromper le lecteur : il y a bien hiatus entre une préoccupation universelle de la mort et le vécu singulier d’un deuil. C’est ce dernier que l’on entend déjà poindre à travers un incipit en apparence très abstrait et décentré de l’expérience de Woody. Ce qui fait saillie ici, c’est une question inquiète : « que faire ? », qui résonne comme un cri de l’impuissance. L’interrogation de fond, de nature éthique, sera laissée en suspens au profit d’un parcours mémoriel centré sur le père lui-même, sa vie, sa mort et son legs. Le deuil ne s’appréhende ici qu’au singulier, à travers l’évolution spécifique d’une relation entre un fils et son père. En ce sens, la nouvelle, à travers des choix esthétiques et des effets stylistiques qu’il s’agira ici de commenter, permet la représentation d’un travail de deuil. L’expression doit ici s’entendre au sein freudien :
En quoi consiste donc le travail que le deuil accomplit ? Je crois qu’il n’est pas excessif de le décrire comme suit : l’épreuve de la réalité a montré que l’objet aimé n’existe plus et elle somme alors l’endeuillé de soustraire toute sa libido de ses attachements à cet objet. […] Mais sa mission ne peut pas être remplie sur-le-champ. Elle sera seulement accomplie en détail, par une grande dépense de temps et d’énergie d’investissement, et entre-temps l’existence de l’objet perdu est conservée dans le psychisme. Chacun des souvenirs et des espoirs qui liaient la libido à l’objet est repris et surinvesti jusqu’à ce que la libido se détache de lui. (Freud 30)
Cette « grande dépense de temps et d’énergie », ce surinvestissement de l’objet aimé qui laisse sa marque jusque dans la chair de Woody, sont précisément l’objet et la matière de la nouvelle elle-même, consacrée à la sédimentation du deuil du père dans la conscience du fils, et marquée par ses différentes étapes, qui permettent une réconciliation post-mortem de ces deux protagonistes qui semblent en tous points opposés au premier abord.
« A Silver Dish » est donc une nouvelle sur le travail de deuil. La question d’école à la fois abrupte et insolite qui ouvre la nouvelle révèle en profondeur la centralité de la problématique pragmatique qui succède à la mort de l’être aimé. Ainsi, « what do you do […]? » est préféré à la spéculation théorique d’un « what is death? », qui guidera pourtant le narrateur avant qu’il ne s’attaque à l’essentiel : la mort de « Pop », figure haute en couleurs, telle qu’elle a été perçue au fil des ans par son fils Woody. Du « do » auxiliaire au « do » verbe d’action, c’est donc bien le faire qui est ramené au centre du propos ; c’est cette question du faire qui, par ailleurs, ne trouve pas de résolution claire au sein du récit bellovien puisque, à la fin de la nouvelle, Woody n’a guère fait qu’enterrer son père et se remémorer les instants fondateurs de sa relation avec lui.
« Un vieux père » : la mention de l’article indéfini invite à une lecture prospective. Il faudra, à travers l’entreprise mémorielle qui consiste à rendre hommage au père, découvrir qu’« un père » était en réalité « le père » de Selbst, le seul dont il sera question à travers la focalisation interne qui nous donne accès à une relation houleuse entre père et fils. Or, l’article indéfini est aussi mobilisé dans le titre : « A Silver Dish », alors qu’une première lecture de la nouvelle permet d’identifier clairement « the silver dish », le seul, l’unique, sorte de centre de gravité matériel de la nouvelle. De fait, au sein de la diégèse, le syntagme ne peut faire allusion qu’au plat d’argent bien reconnaissable qui fit longtemps office de pomme de la discorde entre père et fils, et devint cependant le support d’une paradoxale réconciliation dont le fils ne comprit bien les enjeux qu’à la mort du père. « Un » plat d’argent, tout comme « un » père, s’érige donc d’emblée en référent à décoder, mais aussi en métonymie parlante du deuil. Régine Camps-Robertson affirme en ce sens que : « le titre est […] porteur d’une interrogation sur le statut de l’objet disparu » (155). Il faut voir dans l’article indéfini, « a », comme une incertitude, à laquelle la nouvelle viendra partiellement répondre, sans toutefois restituer à ce qui a été perdu le statut d’une pleine présence. C’est de la conceptualisation de l’objet comme prolongement métonymique du père, et plus généralement comme figuration matérielle du vide de la perte, qu’il sera question dans cet article. Ainsi, le plat d’argent à première vue insignifiant permet de catalyser le deuil parté par le protagoniste et de réactiver la mémoire de la relation problématique entre père et fils. Nous verrons ici comment l’objet matériel, en tant qu’il comporte un aspect phallique et renvoie à la fois à la virilité paternelle et à l’impuissance filiale (sans doute n’est-ce pas un hasard si le jeune Woody est accueilli par un groupe de femmes chrétiennes, dont son père cherchera à l’extirper), sert de support afin de de pallier les manquements de la langue à dire le deuil du père.
Précisons que « A Silver Dish » s’inscrit dans le cadre d’un corpus de nouvelles belloviennes qui n’ont pas encore fait l’objet d’une attention critique soutenue, ce que ce travail s’emploie à contribuer à rectifier en mettant à l’honneur la fiction brève de l’auteur. En effet, Bellow est essentiellement connu (en Amérique comme en France) pour son œuvre romanesque : « Even at the zenith of his fame, Bellow’s short fiction tended to receive short shrift » (Brauner 159). Au sujet de Mosby’s Memoirs and Other Stories (1968), le principal biographe de l’écrivain note laconiquement : « it wasn’t major Bellow » (Atlas 372). Dans le domaine de la critique littéraire, Marianne Friedrich fut la première à déplorer que les perspectives sur l’œuvre brève de Bellow soient très limitées (Friedrich 3, 159)1. En 1984, Daniel Fuchs consacre enfin un chapitre aux nouvelles de l’auteur dans Saul Bellow: Vision and Revision (280-304). Parmi les quelques critiques qui entendent mettre à l’honneur la fiction brève bellovienne, il faut également citer David Brauner (voir Brauner 159). Notre travail se situe dans la continuité de ces efforts de réhabilitation de la fiction courte de Bellow, et tout particulièrement de la nouvelle « A Silver Dish ».
« A Silver Dish » nous paraît, dans une large mesure, représentatif du corpus de la fiction brève bellovienne. En effet, plusieurs des nouvelles de l’auteur américain témoignent d’une méditation sur le deuil, sa transmission et ses difficultés d’expression. La plupart du temps, la perte est pensée à l’échelle intra-familiale : mentionnons, dans les Collected Stories, « By the Saint Lawrence », « Cousins », « The Old System » ou encore « Something to Remember Me By » (ce corpus ne serait pas complet sans mentionner « Leaving the Yellow House », où il est question du deuil d’une amie proche de la protagoniste, Hattie). La structure narrative de toutes ces nouvelles témoigne du parcours rétrospectif de narrateurs souvent âgés qui se remémorent divers membres de leur famille, déjà décédés ou à l’agonie. À plusieurs reprises, la nouvelle elle-même a pour fonction de suspendre la mort du personnage en question, en rappelant directement ou indirectement les derniers instants de celui-ci : ainsi, « The Old System » présente les interrogations d’un protagoniste soucieux de se réconcilier avec sa cousine Tina, qui est sur le point d’expirer mais refuse qu’il lui rende visite à moins qu’il ne lui donne une forte somme d’argent. De même, « Something to Remember Me By » est le témoignage d’un père vieillissant qui entend léguer à son fils un récit bien particulier : celui d’une journée de son adolescence où, peu avant que sa propre mère ne succombe à un cancer, il avait été confronté aux mystères de la mort et était rentré très tardivement à la maison, comme pour empêcher que l’inévitable n’advienne. La spécificité de « A Silver Dish », outre l’éclairage qu’apporte la nouvelle sur le deuil du père, thématique qui n’est abordée nulle part ailleurs chez Bellow de façon aussi dense et riche, n’est autre que la désignation d’un objet (le plat d’argent) qui en vient à concentrer les significations liées au deuil par glissement métonymique. La mémoire se construit à travers l’objet en question, éminemment conflictuel et soumis à des réévaluations au fil des décennies, jusqu’à en venir à faire office de relique, de vestige de la vie du père.
Le plat d’argent : support du conflit dans la relation père-fils
Tout commence par un vol. Ce plat auquel le titre fait allusion, c’est celui que « Pop », père hédoniste, opportuniste et matérialiste, avait dérobé des décennies avant sa mort à la riche famille chrétienne missionnaire qui accueillait Woody dans l’espoir d’en faire un séminariste – un acte apparemment irréfléchi et égoïste que son fils peinera à lui pardonner. Dans la scène suivante, le fils Selbst reçoit la visite de son père, chez les Skoglund, dont il a déjà honte parce qu’il voit en lui un juif rustre.
Pop went over to the Chinese-style cabinet or étagère and tried the handle, and then opened the blade of his penknife and in a second had forced the lock of the curved glass door. He took out a silver dish. “Pop, what is this?” said Woody. Pop, cool and level, knew exactly what this was. He relocked the étagère, crossed the carpet, listened. He stuffed the dish under his belt and pushed it down into his trousers. He put the side of his short thick finger to his mouth. So Woody kept his voice down, but he was all shook up. (Bellow 27)
Woody somme alors son père de rendre l’objet à ses protecteurs. Se heurtant au refus obstiné de son géniteur, il se jette sur lui et essaie de lui reprendre l’objet, mais en vain.
Before he knew it, Woody had jumped his father and begun to wrestle with him. It was outrageous to clutch your own father, to put a heel behind him, to force him to the wall. Pop […] began to resist, angry, and they turned about several times, when Woody, with a trick he had learned in a Western movie and used once on the playground, tripped him and they fell to the ground. Woody, who already outweighed the old man by twenty pounds, was on top. They landed on the floor beside the stove, which stood on a tray of decorated tin to protect the carpet. In this position, pressing Pop’s hard belly, Woody recognized that to have wrestled him to the floor counted for nothing. It was impossible to thrust his hand under Pop’s belt to recover the dish. And now Pop had turned furious, as a father has every right to be when his son is violent with him, and he freed his hand and hit Woody in the face. He hit him three or four times in midface. Then Woody dug his head into Pop’s shoulder and held tight only to keep from being struck and began to say in his ear, “Jesus, Pop, for Christ’s sake remember where you are. Those women will be back!” But Pop brought up his short knee and fought and butted him with his chin and rattled Woody’s teeth. Woody thought the old man was about to bite him. And because he was a seminarian, he thought: Like an unclean spirit. (Bellow 27-28)
La lutte avec le père semble tourner en faveur du fils : celui-ci, plus lourd, prend le dessus, et semble combiner une supériorité physique (notons ici la mention du Western, genre américain par excellence, là où le père est pour Woody un rappel embarrassant de sa judéité) et morale (références au Nouveau Testament, allusion implicite aux Dix Commandements qui devraient conditionner le respect dû au père). Cependant, Woody est pris en défaut : tout d’abord, sa méthode est encore celle d’un enfant (« used once on the playground ») intimidé par la bosse que produit le pantalon de son père, en dépit de sa relative faiblesse physique. En effet, quelque chose retient la main de Woody : l’impossibilité d’accéder aux parties génitales de son père, comme si le fils projetait encore que le père était le seul détenteur du phallus. Du point de vue religieux, qu’il revendique être son domaine de supériorité, il n’honore pas non plus son père, puisqu’il choisit de s’attaquer à lui afin de récupérer le précieux plat. L’échec du fils est au moins double.
Ses efforts sont d’autant plus inefficaces que, à l’issue de la lutte, Woody ne retrouvera jamais le plat d’argent. Les Skoglund auront tôt fait d’apprendre que c’est Pop, le père juif compromettant, qui a emporté l’objet, ce qui entraîne l’expulsion du fils. Des années durant, Woody en veut à son père de lui avoir volé, non pas le plat, mais son avenir de séminariste, et de l’avoir humilié. Les échanges animés entre père et fils sur les raisons qui sous-tendaient ce vol se poursuivent au fil du temps : là où Woody n’y voit que la preuve ultime du caractère impulsif d’un père rivé à la matérialité, Pop affirme qu’il a volé le plat pour préserver in extremis l’identité juive de son fils, comme si le vol avait valeur de résistance spirituelle à l’acculturation, une résistance qu’il faut à la fois comprendre dans le cadre de l’histoire de l’assimilation juive en Amérique et remettre en question, dans la mesure où Pop lui-même vit en ménage avec la très chrétienne Halina. Le plat interroge donc d’emblée sur le legs paternel et sur la judéité : Pop a-t-il sauvé Woody de la perdition en le rappelant à ses origines ou l’a-t-il privé de ses chances de s’intégrer pleinement à une Amérique chrétienne ? Les références mêmes de Woody, jusque dans ses jurons (« Jesus », « for Christ’s sake »), témoignent bien des velléités d’assimilation du jeune homme en pleine conversion. L’objet reliquaire, précisément en tant qu’il est volé par le père (et par conséquent introuvable), est donc paradoxalement un vestige de judéité embarrassant ; il représente tout ce que Woody ne peut pas être, et notamment un Américain chrétien bien intégré (qu’il eût peut-être été sans cette désastreuse intervention). Là où le fils s’interpose physiquement avec son corps massif pour sauver l’objet des mains avides de Pop, c’est en obstacle symbolique que s’érige le père, séparant le fils de la jouissance tant désirée : celle de correspondre pleinement au modèle fantasmé de l’identité étasunienne. Ainsi, la problématique de l’héritage est d’emblée marquée par la question du vide et du manque : ce que transmet le père, c’est une impossibilité d’être. L’accès du fils à la société d’accueil symbolisée par la famille ouvertement prosélyte des Skoglund lui ferme définitivement ses portes à cause de Pop, dont la présence même rappelle incessamment Woody à des origines qui lui pèsent. Pop est donc présenté comme le parasite d’une Amérique qu’il vient piller par pur opportunisme – portrait qui résulte dans une large mesure de la condamnation morale du fils lui-même.
Cette condamnation a quelque chose d’ironique, dans la mesure où Woody est là encore, et bien plus qu’il ne consent à l’admettre, un reflet de son père. Une autre scène tirée du début de la nouvelle nous le présente en effet forçant les placards de la mission afin d’y voler de la nourriture. Le rapport spéculaire entre les deux scènes, outre le comique de répétition qu’il installe dans la nouvelle en relativisant les aspirations de Woody à dépasser (et par conséquent à juger) la figure paternelle, nous invite à voir dans le couteau qu’utilise alors le fils une nouvelle représentation de l’appendice paternel, signe de virilité. En somme, il s’agit d’un nouveau phallus portatif qui permet de forcer l’accès pour accéder à l’objet désiré, en l’occurrence des conserves et du bacon – celui-ci étant l’aliment interdit par excellence dans les prescriptions alimentaires de la religion juive. Le vol du bacon renvoie également à l’animalité de Woody, à un désir d’intégration chez les missionnaires qui ne serait alimenté que par le seul appât du gain, alors que le fils se pose pourtant souvent en opposition avec son père hédoniste, parasite et profiteur. En effet, Woody consomme ce mets cru, goulument, mu par un besoin primaire (« he had a big frame to fill out », Bellow 17) et admet, en une référence implicite à la figure paternelle : « he was also a thief » (ibid.).
Les deux scènes de vol sont comiques et renvoient finalement à ce qui rapproche Pop et Woody : une forme d’impulsivité qui tolère difficilement la frustration. Tel père, tel fils : il s’installe même entre les deux une concurrence implicite dans la transgression, ce qui invite Woody à observer au sujet de Pop : « it was all petty stuff: Pop’s sinning was on a boy level » (Bellow 16). Voilà qui n’empêchera toutefois pas le fils de continuer à reprocher à son père le vol du plat d’argent, alors que, de son propre pillage de petite envergure, il ne sera plus question – sans doute parce qu’il aspire à dépasser l’image paternelle pour imposer à la place celle d’un Américain respectable. Il y parviendra en partie : au début de la nouvelle, le fils est en effet posé en père de famille responsable, qui prend soin de toute sa famille et partage avec eux ses ressources financières (Bellow 14), en homme d’affaires qui réussit (Bellow 12) et qui utilise ses gains financiers à des fins éthiques. À l’inverse, les agissements de son père et leurs conséquences sur le long terme (et notamment la question récurrente du plat d’argent) ramènent Woody au souvenir d’une vie de larcins et de petits profits qui fut un temps la sienne et demeura celle de son père.
Le plat comme signifiant ambivalent de la poursuite du dialogue entre père et fils : une valeur variable.
Le plat d’argent passe donc par différentes descriptions ou incarnations conceptuelles. Avant de faire office, par son absence même, de signifiant évoquant l’absence du père, il représente toute l’ambiguïté morale de Pop. Il s’agit d’un élément récurrent qui, de débat en débat, marque une continuité dans la relation pourtant houleuse entre père et fils, dans la mesure où chacun continue à évoquer ce qui s’est passé, à partager sa version des faits. La trahison qui aurait pu signer la brisure d’une relation devient l’élément qui assure la continuité, précisément en tant qu’il appelle à être expliqué, justifié, réinterprété. L’objet devient au fil du temps trait d’union et simultanément de désunion, jusqu’au moment épiphanique de la mort du père. Après qu’il décède, c’est à un souvenir toujours ambivalent que cette relique fait allusion, cristallisant le rejet de l’héritage et rappelant sa lutte au corps-à-corps avec Pop, chacun tentant de retenir le plat d’argent. Dans son hommage posthume, Woody choisit de présenter un portrait authentique et en demi-teinte de la figure paternelle. Le refus de l’édulcorer est à la fois un hommage au père et un motif comique : Pop, tel qu’il nous est présenté, est par bien des aspects un personnage grotesque.
La nouvelle se termine d’ailleurs sur une épitaphe ironique, dernier débat sur le plat d’argent qui remet à l’honneur l’objet du deuil devenu symbole paternel et « substitut métonymique » (Camps-Robertson 165), non seulement de Pop, mais aussi du discours de la fiction bellovienne. Le référent « plat » demeure énigmatique, tout comme le père reste une figure insaisissable et mystérieuse. Privé de la référence au père, l’objet fait en quelque sorte office de corrélat et de témoignage d’une absence : il n’y a plus personne pour se battre avec Woody au sujet du vol. De même que la postérité du plat d’argent dépend non pas de l’objet lui-même, à jamais perdu, mais du discours sur l’objet, la commémoration du père tient à la préservation d’un portrait en demi-teinte.
Ce qui est révélateur en ce sens, c’est que, lorsque le fils réclame de nouveau l’objet qui l’a fait renvoyer, son père lui révèle que celui-ci n’avait en réalité aucune valeur monétaire, ou presque.
“You want in again? Here’s the ticket. I hocked that thing. It wasn’t so valuable as I thought.”
“What did they give?”
“Twelve-fifty was all I could get. But if you want it you’ll have to raise the dough yourself, because I haven’t got it anymore.” (Bellow 31)
Tout comme la figure énigmatique du père, tantôt avilie, tantôt magnifiée, le plat n’a pas d’autre valeur que celle que le fils lui confère. S’il est investi d’une signification aussi profonde, c’est donc à double titre, en tant que métonymie de la virilité du père qui suscite l’ambivalence du fils, symbole de puissance phallique, et en tant que sujet de conversation qui, fût-ce sur le mode de l’opposition, rassemble père et fils. De façon symétrique, on peut voir là une allusion métatextuelle à la réception, qui veut que le lecteur détermine in fine la valeur de l’objet livre, y compris de la nouvelle qu’il a alors sous les yeux.
Un dernier corps-à-corps
Le passage de la lutte entre père et fils trouve une seconde rime textuelle à la fin de la nouvelle lorsque le fils en vient aux mains pour tenter d’empêcher son père d’arracher les tubes qui le maintiennent encore en vie. L’écho entre les deux passages est d’ailleurs assumé : « Then it was like the wrestle in Mrs. Skoglund’s parlor, when Pop turned angry like an unclean spirit and Woody tried to appease him » (34 ; nous soulignons). Là où la première scène qui évoquait la lutte entre père et fils, celle du vol dans les placards de la mission, créait un effet de répétition comique, il y a ici de l’amertume dans cette scène d’adieu où Pop se joue une dernière fois de son fils. Woody échoue en effet à soumettre le père à sa volonté et celui-ci expire dans ses bras. Le fils choisit alors de faire de cette première scène de lutte autour d’un plat volé le cœur de son hommage posthume, comme par fidélité à la complexité morale de la figure paternelle, mais aussi à ses propres ambiguïtés. De lutte en lutte, le père l’emporte et empoche le plat d’argent qu’il a volé, selon lui, pour « donner à son fils une bonne leçon ».
“It was too strange of a life. That life wasn’t you, Woody. All those women … Kovner was no man, he was an in-between. Suppose they made you a minister? Some Christian minister! First of all, you wouldn’t have been able to stand it, and second, they would have thrown you out sooner or later.”
“Maybe so.” (Bellow 31).
De débat en débat, jusqu’à ce « maybe so » qui indique le début d’un compromis, le dernier triomphe du père sur le fils quand, des années après, ce dernier comprend enfin son action, le plat incarne toute l’ambiguïté morale de Pop. D’une part, celui-ci agit ostensiblement dans son propre intérêt tout au long de la nouvelle. D’autre part, il pense sincèrement avoir épargné à son fils la vie que lui promettaient les Skoglund, et réaffirme au passage sa virilité en se navrant de la présence de « toutes ces femmes » chrétiennes, dans un contexte où il avait lui-même caché le plat sous son pantalon, comme pour augmenter par contraste sa propre puissance phallique.
La lutte physique qu’a engendré le plat se prolonge donc, marquant la transition de la vie à la mort, du plat comme symbolisation de la présence matérielle du père à son absence, faisant écho à celle du géniteur disparu. Le récit apparemment anecdotique de la lutte dans le salon des Skoglund sert de fil rouge à la commémoration narrative du père : le portrait est assuré par la permanence, non pas de l’objet lui-même (qui au fond importe peu, ou seulement en tant qu’il n’est jamais retrouvé) mais du discours sur un manque, sur le manque d’un corps qui jadis fut présent, comme s’il y avait chez le fils nostalgie du corps-à-corps avec le père. Une fois Pop décédé, ce qui reste dans les bras vides de Woody, c’est en effet une simple trace sensorielle : « there remained one thing more this morning, which was explicitly physical, occurring first as a sensation in his arms and against his breast and, from the pressure, passing into him and going into his breast » (Bellow 33). Woody retient dans ses bras la trace d’une absence. Son père lui échappe, transcende sa propre existence matérielle, l’emportant à un nouveau titre sur son fils, à savoir dans le domaine spirituel qui était jusqu’ici la prérogative de Woody.
Then, as Woody did his best to restrain him, and thought he was succeeding, Pop divided himself. And when he was separated from his warmth, he slipped into death. And there was his elderly, large, muscular son, still holding and pressing him when there was nothing anymore to press. You could never pin down that self-willed man. When he was ready to make his move, he made it—always on his own terms. And always, always, something up his sleeve. That was how he was. (Bellow 34)
La nouvelle, en terminant sur ces mots, scelle l’ultime victoire du père dans sa capacité à affirmer ses choix, dans la vie comm dans la mort. L’objet dont il est question dans le titre devient alors le signifiant presque inaccessible qui dit le deuil impossible : le plat d’argent qu’on ne peut empêcher le père de subtiliser, comme le corps de Pop qui choisit la mort contre la volonté du fils. La réaction du fils traduit son impuissance face à la perte, mais aussi la victoire finale du père sur sa progénitude et le renouvellement de l’injonction mémorielle d’inspiration juive adressée à ce dernier, c’est-à-dire le Zakhor (souviens-toi) dont Janis Bellow rappelait danssa préface aux Collected Stories l’autre nom, Yizkor (que Dieu se souvienne, à la troisième personne de l’inaccompli), nom d’une prière pour les morts traditionnellement récitée à l’occasion de plusieurs grandes fêtes.
As Jews we remember what was told to us at Sinai; at the Seder we remember the Exodus; Yiskor is about remembering a father, a mother. We are told not to forget the Patriarchs; we admonish ourselves, “If I forget thee, O Jerusalem …” And we are constantly reminding God not to forget his Covenant with us. This is what the “chosenness” of the Chosen People is all about. (Janis Bellow, citée dans Bellow xi)
Et pourtant, ce qui rappelle Woody à la mémoire de son père dans la nouvelle constitue également un objet symbolique ambigu : des cloches d’église, qui évoquent l’enterrement de Pop. Les cloches et le plat se disputent en quelque sorte le rôle de madeleine de Proust : d’un côté, les premières évoquent clairement la spiritualité chrétienne que le fils a toujours perçue comme éminemment désirable, et à laquelle il a tenté d’adhérer en vain en voulant rejoindre le séminaire. De l’autre, le plat d’argent, objet en apparence précieux, représentait lui aussi dans un premier temps la richesse et l’américanité auxquelles Woody aspirait, mais une fois volé en vient à représenter le signifiant absent, c’est-à-dire le père. Par conséquent, cet objet renvoie à une double énigme. Cette énigme, du vivant du père, est celle des motifs du larcin et des multiples justifications supposées par le fils ou présentées par le père, à commencer par ce qui, chez Pop, relève de l’évaluation de la valeur du plat (en réalité, « il » ne valait rien, ce à quoi il faut attribuer une portée symbolique : le monde auquel aspirait Woody est en fait un monde de faux-semblants, un mirage) mais aussi des velléités paternelles de préserver la judéité du fils. Là encore, la prose bellovienne est marquée par l’ironie puisque la compagne de Pop est elle-même chrétienne, et que celui-ci se sert de justifications hasardeuses pour rendre légitime a posteriori un vol sans doute motivé par le seul appât du gain. C’est seulement dans un deuxième temps, après la mort de Pop, que le plat disparu en vient à faire écho à l’absence du père, rappelant la relation conflictuelle préservée au fil du temps.
L’agonie du père : ultime itération de la thématique du double
Après l’enterrement, Camps-Robertson note que « Woody, jusque-là aux prises avec le corps omniprésent de son père, reste seul. Pourtant une forte impression physique demeure en lui, comme la trace laissée par le passage du corps de son père à la mort » (163). Transmettre cette trace, sur un mode doublement médié : telle serait l’éthique de la caresse, ou de l’empreinte, que le père laisse en mourant.
Un nouveau glissement métonymique vient ici substituer au corps du père la sensation physique qu’il a laissée dans les bras de son fils, comme une empreinte. Du corps réel à sa trace, le lien de nature métonymique est semblable au lien entre l’objet volé et son signe. (Camps-Robertson 163)
En ce sens, Woody reconnaît qu’il n’a pas réussi à se saisir de son père, à le retenir. Toujours le mort se soustrait à un discours cohérent et unanime du fils, résiste à la synthèse du lieu de son absence. En mourant, Pop se divise (« Pop divided himself », Bellow 34), se scinde en deux parties pour mieux échapper à son fils, entérinant dans la mort la distinction idéaliste entretenue par Woody entre le domaine matériel et le domaine spirituel, vers lequel le père s’élève dans la mort, ne laissant à sa progéniture qu’un cadavre à étreindre. Ultime triomphe de Pop sur son fils. Voilà qui ne fait que confirmer ce que l’on devinait déjà : la figure paternelle cristallise un ensemble d’oppositions binaires qui ne sont pas résolues à la fin de la nouvelle, mais restent en tension : matériel/spirituel, judéité/chrétienté, force/faiblesse, égoïsme/don de soi. De quel côté fut « Pop » ? Woody est bien en peine de le déterminer. Ce n’est pas un hasard si le père finit par avouer à son fils, au sujet du plat : « it was a double, Woody » (Bellow 30), ce par quoi le père entend signifier qu’il s’agissait d’un faux. Là encore, la question du modèle et de la copie est structurante, rappelant la rivalité entre père et fils et la quête d’authenticité de chacun d’entre eux, entreprise à travers deux modèles culturels et religieux opposés – le judaïsme paternel d’une part, et le christianisme du fils d’autre part. Notons au sujet du plat factice que ce dernier modèle, justement, était en quelque sorte « un faux » du point de vue du père qui y voyait un travestissement de l’identité.
Au-delà de cette allusion au plat, les effets de paires et de doubles structurent la nouvelle de part en part : ainsi, Camps-Robertson (159) répertorie les « both », « also » et « as well as » qui structurent le texte et témoignent non seulement de l’ambivalence du fils vis-à-vis de son père, mais aussi d’un effet de miroir qui le contraint à se reconnaître dans le géniteur dont il avait tenu à se distinguer par tous les moyens. « Tout se passe comme si la narration était prise au piège d’une incessante reproduction, où le même ne peut échapper à son double » (Camps-Robertson 160) : si la première lutte entre père et fils exprimait la velléité de se dissocier de son père, d’interrompre le vol, la seconde (rime, et par conséquent double de la première), rappelant la lutte de Jacob avec « l’ange »2 à l’issue de laquelle le patriarche se découvre une identité nouvelle, celle d’Israël (Gen 32 :22-32), révèle au contraire une volonté de fusion. Le fils peine à laisser partir le père qu’il a tant haï, et pourtant tant aimé, son autre et cependant son double. La figure du père demeure donc jusqu’au bout une figure de l’insaisissable, de l’indicible. La nouvelle évoque un travail de deuil dont elle signale simultanément les limites, car du père, nous ne percevons en somme qu’un portrait fragmentaire. L’objet métonymique qui en vient à le représenter n’est autre qu’un plat d’argent, signifiant flottant, intangible, à la valeur fantasmée, à l’instar du père, figure ambiguë dont le fils ne parvient à étreindre que le spectre. Lorsque, dans la scène finale, Pop se divise et échappe aux prises de son fils, sans doute facilite-t-il d’ailleurs le désinvestissement des liens d’affection qui permet le début du travail de deuil. C’est ce travail qui rend possible le regard rétrospectif porté par Woody sur sa relation avec son père. Une nouvelle fois, l’arrachement imposé par le père, y compris dans la mort, est en réalité une sorte de mal pour un bien : c’est ce départ forcé qui permet à Woody de s’extraire d’une relation fusionnelle d’amour-haine avec son père, et de présenter de lui un portrait composite, ne négligeant aucune des dimensions, sublimes ou abjectes, de sa personnalité, quitte à laisser intacts les éléments les plus contradictoires de son identité. La relation avec le « double » qu’est Pop garde un caractère conflictuel ; mais ce conflit rappelle simultanément l’affection sincère de Woody pour ce père : « un » père, c’est-à-dire le sien, qu’il a tant haï et pourtant tant aimé.
Conclusion : au-delà du discours sur la mort, le vécu de la perte. Vers une éthique de la caresse et une littérature de l’insaisissable.
L’interrogation philosophique sur la mort sur laquelle la nouvelle avait débuté cède donc sa place à l’histoire d’un deuil singulier, de sorte que la mort n’est pensée, pour paraphraser Emmanuel Levinas, qu’à travers le défunt, l’aimé.3 La mort, chez Bellow, se conceptualise et s’écrit toujours en tant que deuil, en dépit des généralités énumérées à son sujet par le narrateur dans la deuxième partie de l’incipit, dans un soliloque qui se poursuit à la deuxième personne,4 comme pour confirmer la nécessité de l’implication du lecteur dans cette réflexion liminaire sur la perte.
Take this matter of mourning, and take it against a contemporary background. How, against a contemporary background, do you mourn an octogenarian father, nearly blind, his heart enlarged, his lungs filling with fluid, who creeps, stumbles, gives off the odors, the moldiness or gassiness, of old men. I mean! As Woody put it, be realistic. Think what times these are. The papers daily give it to you—the Lufthansa pilot in Aden is described by the hostages as being on his knees, begging the Palestinian terrorists not to execute him, but they shoot him through the head. Later they themselves are killed. And still others shoot others, or shoot themselves. That’s what you read in the press, see on the tube, mention at dinner. We know now what goes daily through the whole of the human community, like a global death-peristalsis. (Bellow 12)
Géraldine Chouard analyse ainsi ce recours au catalogue : « pour dire le manque, des listes envahissent le récit, comme autant de signes d’un désir d’occuper le terrain (en l’occurrence celui de la parole), avec un effet de surenchère » (Chouard 79). Les listes présentées ici ne font que masquer la disparition d’un objet unique : la figure paternelle, et le plat qui symbolisait le lien conflictuel, qui fut pourtant maintenu au fil du temps. La théorie de la mort posée ici revêt un aspect d’autant plus gauche que le narrateur se répète (« take it/ take it », « a contemporary background » est utilisé à deux reprises). La mort arrive sans que l’on puisse lui donner un sens, elle affecte et gangrène toute la communauté humaine (« like a global death-peristalsis »). Ce phénomène-là (phénomène de masse, qui afflige les foules dans l’indifférence générale) ne sera plus guère traité dans la nouvelle. C’est à la toute première question posée dans l’incipit, celle de la mort de Pop, que l’analepse viendra répondre. Comme si le glissement s’opérait pleinement de la mort prise dans sa généralité au deuil dans toute sa singularité.
Il s’agissait d’insister ici sur la centralité de l’objet pour penser le deuil du père, précisément en tant que le plat d’argent fait retour sur un mode proche de la hantise. Chez les Skoglund, le fils veut arracher au père ce qu’il a caché dans son pantalon, en une démarche résolument castratrice, mais n’y parvient pas. A l’hôpital, c’est le corps du père tout entier que Woody veut retenir dans ses bras, mais ce corps s’envole et échappe une nouvelle fois aux prises, devenant cette fois-ci objet de deuil, et support d’une commémoration dont la nouvelle retrace toutes les étapes. Le fils est in fine contraint de se rattacher à des traces de traces pour sentir encore la présence de son père, au souvenir d’un plat qui représente à la fois ce que Woody détestait le plus chez son père, et ce qu’il ne pouvait s’empêcher d’admirer et de redouter : sa détermination, son obstination, sa judéité (à en croire le père), sa puissance phallique. On pourra trouver un parallèle entre le plat et le bol à raser du père dans Patrimony de Philip Roth. On retrouve dans ces mémoires publiées en 1991 la centralité du deuil paternel, mais aussi la thématique chère à Bellow de la lente agonie d’un proche, bien que l’approche de Roth ne soit pas fictionnelle. L’objet, sous la plume de Roth, est également investi d’une valeur symbolique et transactionnelle, et il évoque là encore la virilité paternelle.
L’objet demeure donc in fine la clef de voûte de la nouvelle, et est à l’origine d’une quête ironique – quête du mort, quête du plat qui en est devenu le symbole, mais aussi quête de la référence chez un lecteur qui doit s’interroger sur « un » plat d’argent et sur la mort d’« un vieux père » – retrouver le plat d’argent, c’est-à-dire non seulement évaluer sa valeur fluctuante, mais aussi décoder, comme le fils eut à le faire, le comportement du père, déterminer ce qui le conduisit à dérober cet objet. Faire disparaître le plat qui représente tout ce à quoi tient à ce moment de sa vie le jeune Woody, c’est aussi pour le père annoncer son propre départ, là encore contre la volonté de son fils impuissant. La référence au plat, mystère du titre, n’est donc déchiffrable qu’en tant que « l’avenir projette son ombre sur le passé » (Anne Michaels, citée dans Amfreville 196), c’est-à-dire que la première lutte ne prend tout son sens que lorsqu’on la relit à l’aune du dernier corps-à-corps. La conceptualisation de l’objet, qui évolue au fil de la lecture et rend possible la transmission d’une mémoire du père à travers la réception, finit par déboucher, non sur la représentation du père lui-même, mais, parce que l’objet a disparu, sur son insaisissabilité, dans la vie comme dans la mort. Ce que l’on retrouve à travers la rime textuelle des deux luttes, c’est le spectre d’un père et le spectre d’un plat, dont la valeur matérielle et symbolique réelle demeure à jamais indéterminée, soumise aux réévaluations successives de la mémoire, reconduisant ainsi le travail de deuil ad infinitum.
Notes
- 1L’analyse de Friedrich mérite d’être reproduite ici, car elle me (le “nous” est utilisé dans le reste de l’article) paraît synthétiser la sous-exploitation critique des nouvelles belloviennes : « measured against the immense body of scholarship dealing with Saul Bellow’s novels, criticism of Bellow’s short fiction has been remarkably limited to this date. A few interpretations of a number of his short stories are available, but these vary in quality. There are no comprehensive monographs on Bellow’s short stories, and, in fact, no studies of his short fiction which could be characterized as thorough or methodologically productive. […] Until the mid-1980s the opinion was widely accepted in Bellow research that, perhaps with a few exceptions, the short story form was not genuinely Bellow’s strength. Bellow’s uncollected stories and the ones collected in Mosby’s Memoirs and Other Stories (1968) were frequently dismissed as more or less marginal by-products of Bellow’s novelistic writing […]. Thus overshadowed by the great novels, Bellow’s short stories were not perceived as valid works of art in their own right. Critics often looked to the short stories to illuminate one or another aspect of a character from his novels, and it is likely this perspective was a factor in his critics’ failure to recognize Bellow’s short fictions independently as unique and complex works of art » (Friedrich 3).
- 2Dans la littéralité du texte biblique, il s’agit d’ailleurs d’un אִישׁ, c’est-à-dire d’un homme. C’est la littérature prophétique, et notamment Osée, qui reliront cette scène en mentionnant l’intervention d’un ange.
- 3Dans Dieu, la mort et le temps, le philosophe montre comment « le rapport avec la mort » devient relation « avec le mort » (Levinas 96) et ne peut être conçu que comme tel. Il précise qu’il s’agit là d’ « une relation avec le mort, et non pas avec le cadavre » (97).
- 4Dans le cadre du vocabulaire du théâtre, Patrice Pavis propose la distinction suivante : « le monologue est le discours que le personnage se tient à lui-même, tandis que le soliloque est adressé à un interlocuteur restant muet » (Pavis 216).
Bibliographie
- Amfreville, Marc. Écrits en souffrance. Figures du trauma dans la littérature nord-américaine. Michel Houdiard, 2009.
- Atlas, James. Bellow: A Biography. Random House, 2000.
- Bellow, Saul. Collected Stories. Penguin, 2013.
- Brauner, David. « Bellow’s Short Fiction ». The Cambridge Companion to Saul Bellow, dirigé par Victoria Aarons. Cambridge University Press, 2017, pp. 159-170.
- Camps-Robertson, Régine. « L’écriture métonymique de la perte dans “A Silver Dish” de Saul Bellow ». Profils Américains 9 : Bellow, dirigé par Claude Lévy, 1997, pp. 155-167.
- Chouard, Géraldine. « “Kind has a price tag” : de l’argent et autres gageures dans “A Silver Dish” de Saul Bellow ». Autour de Saul Bellow dirigé par Paule Lévy, Presses universitaires de Rennes, 2011, pp. 75-86.
- Freud, Sigmund. Deuil et mélancolie. Payot et Rivages, 2011.
- Friedrich, Marianne M. Character and Narration in the Short Fiction of Saul Bellow. Peter Lang, 1995.
- Fuchs, Daniel. Saul Bellow: Vision and Revision. Duke University Press, 1984.
- Levinas, Emmanuel. Dieu, la mort et le temps. Livre de poche, 1991.
- Pavis, Patrice. Dictionnaire du théâtre. Dunod, 1996.
- Roth, Philip. Patrimony. Simon & Schuster, 1991.
About the author(s)
Biographie : Myriam Ackermann-Sommer est normalienne, agrégée d’anglais et doctorante en littérature américaine. Elle travaille sous la direction de Marc Amfreville (Paris IV) et Paule Lévy (Saint-Quentin-en-Yvelines). Ses recherches portent sur la littérature juive américaine, et notamment la fiction brève de Saul Bellow, Cynthia Ozick, Bernard Malamud et Isaac Bashevis Singer.
Biography: Myriam Ackermann-Sommer is a graduate of the Ecole Normale Supérieure, holds an agrégation in English and a doctorate in American literature. She works under the supervision of Marc Amfreville (Paris IV) and Paule Lévy (Saint-Quentin-en-Yvelines). Her research focuses on American Jewish literature, in particular the short fiction of Saul Bellow, Cynthia Ozick, Bernard Malamud and Isaac Bashevis Singer.