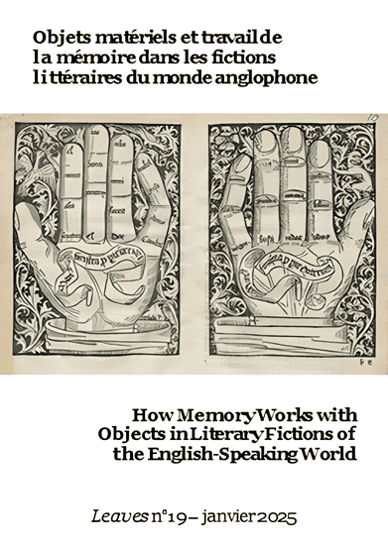L’autodafé du souvenir : destruction et conservation des lettres dans Cranford (1851-1853) d’Elizabeth Gaskell
Abstract: In Cranford, Victorian novelist Elizabeth Gaskell makes a singular use of letters, notably in the episode “Memory at Cranford,” in which the narrator and her friend Miss Matty go through old family letters together. As memorial artefacts replete with memories and history, these letters are nonetheless subjected to an autodafé, resulting in the disappearance of all material traces of past correspondents. The way Gaskell conceives of the writing of memory is therefore paradoxical: based on the destruction of the object, it simultaneously foregrounds the possibility of preserving it, particularly in the body of the text. Therefore, this questions the very materiality of a text concerned with memory-work, where letters are not simply objects that carry memory, but also “emissaries” of a bygone past. Cultivating Cranford’s kinship with the epistolary genre, Gaskell questions the durability and posterity of her text, the materiality of which proves to be just as precarious and flammable as letters are. The scenes of reading and destroying letters allow Gaskell to reflect on her own authorship and on the way her reade-recipients will receive this text.
Keywords: Cranford, Elizabeth Gaskell, Material Memory, Writing the Past, Letters, Victorian Novel
Résumé : Dans Cranford, la romancière victorienne Elizabeth Gaskell accorde une place bien particulière aux lettres, notamment dans l’épisode « Memory at Cranford » où la narratrice parcourt avec son amie Miss Matty d’anciennes lettres de famille. Artefacts mémoriels riches en souvenirs et en histoire, celles-ci font néanmoins l’objet d’un autodafé qui entraîne la disparition des traces matérielles des correspondants passés. L’écriture mémorielle que propose Gaskell est donc paradoxale : reposant sur la destruction de l’objet, elle dessine en même temps la possibilité de conserver celui-ci, notamment dans le corps du texte. Il s’agit donc d’interroger la matérialité même d’un texte animé par un travail mémoriel, où les lettres ne sont pas de simples objets porte-mémoire, mais aussi des objets « émissaires » nous parlant d’un passé révolu. Cultivant la porosité de Cranford avec le genre épistolaire, Gaskell questionne ici la pérennité et la postérité de son texte dont la matérialité s’avère tout aussi précaire et combustible que le sont les lettres. Dès lors, les scènes de lecture et de destruction de lettres permettent à la romancière de réfléchir à sa propre auctorialité ainsi qu’à la réception qu’en feront ses lecteurs-destinataires.
Mots clés : Cranford, Elizabeth Gaskell, Mémoire matérielle, Écriture du passé, Correspondance, Roman victorien
« Oh Mr Forster if you don’t burn my /own/ letters as you read them I will never forgive you! »
(Elizabeth Gaskell, lettre à John Forster, 17 mai 1854, Chapple et Pollard 290)
Intimement liées au souvenir et à la mémoire, les lettres constituent un matériau sensible qui porte la trace des correspondants et devient, à leur mort, comme une empreinte posthume. En effet, cette surface de papier travaillée par l’encre et la plume agit à la manière d’un objet porte-mémoire dans lequel on peut lire une histoire et une mémoire matérielle plus large1. Si les lettres sont souvent chéries et précieusement conservées, passant de mains en mains d’une génération à une autre, c’est une tout autre approche que suggère ici la romancière victorienne Elizabeth Cleghorn Gaskell (1810-1865) dans cette lettre adressée à l’éditeur et biographe John Forster.
Cette requête singulière de Gaskell, qui demande à son correspondant de brûler les lettres qu’elle lui envoie à mesure qu’il les reçoit, annonce un mode de réception apparemment paradoxal. D’une part, on peut comprendre cette volonté de détruire les lettres au regard d’une inquiétude quant à sa réputation et à sa postérité : déjà célèbre en 1854, Gaskell semble anticiper la circulation de ses lettres au-delà du correspondant à qui elles sont adressées, que ce soit de son vivant ou après sa mort, et semble forger là le projet d’une image posthume contrôlée. Faut-il toutefois prendre cette requête au pied de la lettre ? De toute évidence, son correspondant, lui, ne l’a pas fait, puisque l’objet a été conservé et même publié. Mais Gaskell elle-même, dans son ton quelque peu espiègle et ironique, ménage peut-être déjà la possibilité que ses lettres survivent et ne soient pas détruites, alors même qu’elle demande régulièrement à ses correspondants de les brûler2.
Une telle préoccupation trouve un écho frappant dans Cranford, œuvre de Gaskell bien connue et appréciée, qui présente de manière savoureuse la vie d’un petit village anglais entre la fin des années 1830 et le début des années 1840. L’un des épisodes de ce feuilleton publié entre 1851 et 1853 dans le magazine Household Words, intitulé « Memory at Cranford », est en effet entièrement consacré à la lecture et à la destruction d’anciennes lettres de famille de Miss Matilda Jenkyns, dite Miss Matty, chez qui la jeune narratrice Mary Smith séjourne. En effet, la vieille dame décide à cette occasion de s’atteler à une tâche qu’elle avait jusque là repoussée : « looking over all the old family letters, and destroying such as ought not to be allowed to fall into the hands of strangers » (53). Gaskell suggère ici une méthode de réception des lettres bien particulière, qui coordonne de manière implacable la lecture des missives à leur destruction (« burn my /own/ letters as you read them », « looking over all the old family letters, and destroying such […] », mes italiques). Or, de même que le projet de réception-destruction échoue dans le cas de la lettre adressée à John Forster, dans Cranford Gaskell ménage la possibilité d’une sauvegarde de l’objet : alors même qu’elles se consument dans la diégèse, la narratrice préserve dans le corps du texte les lettres que Miss Matty détruit sous ses yeux. Dans un épisode entièrement consacré à la mémoire familiale des Jenkyns, ce sont les objets qui la portent et qui en témoignent qui sont donc paradoxalement brûlés.
C’est en effet sur des objets matériels, particulièrement fragiles dans le cas des lettres, que repose la mémoire. Lorsqu’elle prépare la publication de Cranford en un volume, en 1853, Gaskell semble en avoir pleinement conscience : l’épisode « Memory at Cranford » devient en effet deux chapitres, l’un mettant en avant l’objet dépositaire de la mémoire (chapitre V, « Old Letters »), l’autre les souvenirs que la lecture des lettres a évoqués (chapitre VI, « Poor Peter »). Dès l’époque victorienne, on trouve donc dans la fiction les prémisses des Material Culture Studies qui apparaissent dans les années 1980 et qui manifestent un intérêt renouvelé pour les objets (Hicks 25-26). L’historien Asa Briggs, dans Victorian Things (1988), a ainsi montré comment l’idée même de « culture matérielle » émerge à l’époque victorienne (Briggs 30), dans des ouvrages aussi divers que des traités d’anthropologie ou des livres pour enfants, à l’instar de The Wonders of Common Things (1880) d’Annie Carey qui retrace l’histoire matérielle des choses de la vie quotidienne, du morceau de charbon (« A Lump of Coal ») à la feuille de papier (« A Sheet of Paper »). Briggs souligne d’ailleurs la manière dont les romans victoriens, en ce qu’ils regorgent de détails concrets et de références très précises aux objets contemporains, fonctionnent à la manière d’une archive précieuse pour les historiens qui travaillent sur l’époque victorienne3. L’attention portée aux objets du roman victorien a permis plus avant de mettre en valeur l’importance de leur matérialité, non seulement d’un point de vue historique et culturel, mais aussi dans l’élaboration d’une théorie des choses romanesques, que celle-ci emprunte à l’analyse marxiste de la marchandise ou à l’approche interdisciplinaire de la Thing Theory (Sattaur). À cet égard, l’œuvre de Gaskell est un champ de recherche particulièrement fertile, notamment dans le cas de Cranford, où ont entre autres été étudiés les artefacts de papier (Schor, Schaffer 2011), les objets de la vie quotidienne, considérés en tant que marchandises (Huett) ou dans leurs différents usages domestiques (Clarke, Lutz), et plus largement la culture matérielle que l’on peut déceler dans cette œuvre (Miller, Dolin). S’inscrivant dans la continuité de ces travaux, notamment ceux de Talia Schaffer et de Hilary Schor qui ont analysé l’importance des lettres dans Cranford, nous souhaitons ici articuler plus précisément la réflexion autour de la spécificité de la mémoire matérielle portée par l’objet épistolaire, dont la matérialité singulière façonne une écriture mémorielle tendue entre conservation et destruction.
Ce paradoxe est d’autant plus frappant que la matérialité de l’objet lettre est particulièrement instable : dans Cranford, les feuilles de papier se consument en quelques secondes à peine, ce qui les place dans un équilibre émouvant entre la richesse mémorielle et affective qu’elles recèlent et la possibilité imminente de leur destruction. Ces fragiles dépositaires de la mémoire renvoient plus largement au paradoxe d’un « âge du papier » (« age of paper », Briggs 22) où ce matériau était à la fois chéri et jeté en grandes quantités : « More paper was thrown than preserved. Yet it was also the main recording medium, for everything from printed diaries to business accounts, and from newspapers to photographs » (Briggs 290) — liste à laquelle pourraient s’ajouter les lettres. Dans Cranford même, le personnage de Miss Matty brûle régulièrement du papier, se servant des factures et des lettres reçues dans la semaine pour allumer ses bougies. Ainsi, le papier a une existence précaire et menacée dans le texte lui-même, interrogeant par là la matérialité des feuilles du livre que nous tenons entre les mains. Dès lors, la réflexion sur la mémoire matérielle embrasse également le texte de Cranford, ce feuilleton qui présente, nous le verrons, des qualités tout épistolaires. Il s’agira ainsi d’étudier dans un premier temps la matérialité spécifique du souvenir des lettres au sein de la diégèse, avant de considérer l’autre matérialité à laquelle elles ouvrent la voie dans un second temps : la matérialité du texte, dont l’histoire éditoriale s’avère particulièrement riche. Occupant une place de choix dans la matérialité de la mémoire en tant qu’objet mémoriel précieux qu’il faudrait conserver, mais dont la disparition ou la destruction est toujours imminente, la lettre interroge ainsi les modalités de l’encrage du souvenir.
« We must burn them, I think » : la destruction paradoxale des lettres de famille, témoins affectifs du passé
1. « The only relics of her that I have » : les lettres, objets porte-mémoire qui donnent vie au souvenir
L’épisode « Memory at Cranford » nous fait parcourir près d’un demi-siècle d’histoire familiale à travers les lettres des Jenkyns qui, soigneusement conservées pendant des décennies et organisées en différents paquets (« bundles »), remontent pour la plupart au tournant du siècle précédent, des lettres d’amour des parents de Miss Matty datant des années 1770 (« yellow bundles of love letters, sixty or seventy years old » [53]) à l’imposante correspondance de leur fille aînée Deborah, du début des années 1800 jusqu’à sa mort dans les années 1830. La scène de lecture de ces lettres présente ici une attention toute particulière pour l’objet épistolaire : en effet, la narratrice ne se contente pas de résumer le contenu de la correspondance familiale, mais en décrit minutieusement l’apparence, nous offrant ainsi une lecture matérielle de l’objet. S’intéressant tout d’abord à la texture et même à l’odeur de ces vieilles lettres (« The paper was very yellow, and the ink very brown » [58] ; « there was a faint pleasant smell of Tonquin beans in the room » [53]), elle se penche également sur la manière qu’a chaque correspondant d’investir l’espace de la lettre et de laisser son empreinte individuelle sur le papier. Ainsi, si les parents de Miss Matty avaient tendance à écrire de manière très resserrée sur la page (« written in a straight hand, with the lines very close together » [58]), leur fille aînée Deborah occupe plus largement ses feuillets avec une précision millimétrique (« Her hand was admirably calculated, together with her use of many-syllabled words, to fill up a sheet » [59]). La narratrice distingue aussi le style épistolaire propre à chacun : les lettres pleines d’ardeur du jeune Mr Jenkyns (« short homely sentences, right fresh from the heart » [54]), plus tard mâtinées de latin et d’accents johnsoniens (« ‘I shall ever hold the virtuous qualities of my Molly in remembrance, dum memor ipse mei, dum spiritus regit artus’ » [56]), offrent un contraste saisissant avec celles de sa femme, dont l’orthographe est parfois fautive (« Without any pershality, I do think she will grow up a regular bewty! » [55-56]). Dans ces modalités d’encrage propres à chacun (graphie, style, orthographe), s’esquisse ainsi une phénoménologie qui passe par les lettres, sur lesquelles les correspondants ont laissé une trace unique et reconnaissable.
La réception de ces lettres est en outre éminemment sensible et affective. Gaskell elle-même était particulièrement attentive à cette matérialité tactile de la mémoire, notamment dans le cas des lettres de sa mère, décédée alors que sa fille avait tout juste un an, qui agissent pour elle à la manière de reliques : « the only relics of her that I have, and of more value to me than I can express, for I have so often longed for some little thing that had once been hers or touched by her » (lettre à George Hope, 13 février 1849, 796-97). Si l’on considère les lettres des Jenkyns comme des reliques, le toucher est donc primordial dans la matérialité du souvenir, puisque c’est cette sensibilité haptique au matériau mémoriel, en l’occurrence au papier des lettres, qui fait revenir la mémoire. En effet, dans « Memory at Cranford », Miss Matty parcourt de ses doigts les lettres de famille qui réactivent ses souvenirs, notamment celui de son jeune frère Peter, dont la narratrice n’avait jusque-là jamais entendu parler. Ainsi, à la lecture de la correspondance familiale (chapitre V, « Old Letters ») succède le récit des mésaventures de Peter (chapitre VI, « Poor Peter »), qui, après s’être enfui suite à une mauvaise plaisanterie, a disparu quelque part en Inde sans laisser de traces. C’est donc par l’intermédiaire de l’objet épistolaire qu’est révélé ce secret de famille et que Peter revient à la mémoire de Miss Matty4. La découverte parmi sa correspondance d’une lettre destinée à Peter, que celui-ci n’avait jamais ouverte, souligne tout le pouvoir évocateur et émotif de l’objet épistolaire : ouvrant elle-même ce court billet, qu’elle reproduit d’ailleurs dans son intégralité dans le texte (69), la narratrice rejoue à des décennies d’écart une scène de réception qui ravive la présence du frère disparu et renouvelle le sentiment de tristesse qu’a Miss Matty de ne l’avoir jamais vu revenir, contrairement à ce qu’annonçait la lettre en question (« Come back, and make us happy, who love you so much. I know you will come back » [69]). La lettre en tant qu’objet porte-mémoire réactive ainsi le sentiment paradoxal que ces êtres passés sont encore bien présents (« There was in them a vivid and intense sense of the present time, which seemed so strong and full, as if it could never pass away » [53]).
2. Les lettres, objets « émissaires » : l’archive documentaire des pratiques épistolaires de la fin du XVIIIe et du début du XIXe siècle
Miss Matty et la narratrice lisent les lettres non seulement comme des reliques d’une histoire familiale, mais aussi comme des vestiges de pratiques passées : « some of the sheets were (as Miss Matty made me observe) the old original Post, with the stamp in the corner, representing a post-boy riding for life and twanging his horn » (58). Dès lors, les lettres des Jenkyns font l’objet d’une analyse matérielle et historique au sein-même de la diégèse, puisque les deux femmes accordent une valeur d’archive à la correspondance familiale. Se penchant sur des pratiques épistolaires datées pour les lecteurs et lectrices contemporains de Gaskell, la narratrice fournit un travail d’enquête où elle examine les lettres qu’elle a sous les yeux et formule des hypothèses concernant les correspondants (« I concluded that he had died young » [57]), leur âge (« I should guess that the Rector of Cranford was about twenty-seven years of age when he wrote those letters » [54]), ou encore la raison de l’interruption des échanges à un moment donné (« Shortly afterwards they were married,—I suppose, from the intermission in their correspondence. » [54]). Les lettres de la famille Jenkyns offrent donc une étude de cas frappante illustrant le changement des pratiques épistolaires en l’espace de moins d’un siècle, c’est-à-dire entre la fin du XVIIIe siècle et le début des années 1850, agissant ainsi tels des objets « émissaires » nous parlant d’une époque révolue (Briggs 115).
Ces lettres soulignent la manière dont un contexte plus large (la réglementation de la Poste, les techniques de production de papier, les habitudes épistolaires à la mode à une époque) informe directement la matérialité de l’objet « lettre » ainsi que les pratiques qui l’entourent. En effet, avant l’introduction de la Penny Post en 1840 qui uniformise le fonctionnement du système postal (notamment en établissant le tarif unique d’un penny pour toutes les lettres), l’envoi de courrier est particulièrement coûteux. D’une part, le papier est un matériau relativement précieux puisqu’il est soumis à une taxe jusqu’en 1861 et n’est produit qu’en petit format avant la mise au point de techniques permettant de fabriquer des feuilles plus larges (Schaffer 2011, 69). D’autre part, l’affranchissement des lettres est onéreux : avant la Penny Post, le coût d’envoi est calculé en multipliant la distance parcourue par le nombre de feuilles envoyées (sachant qu’une enveloppe, dont l’usage se répand à partir de 1800, compte également comme une feuille)6. De multiples techniques sont donc employées afin de limiter le coût des lettres : parmi celles-ci, on pouvait acheter des franks, c’est-à-dire un affranchissement dont les parlementaires bénéficiaient gratuitement et qu’ils revendaient fréquemment à moindre prix — pratique à laquelle la mère et la grand-mère de Miss Matty font référence (« It was evident, from the tenor of what was said, that franks were in great request, and were even used as means of paying debts by needy Members of Parliament » [58]). D’autre part, afin d’économiser le papier, il était d’usage de remplir toute la feuille en écrivant de manière resserrée et en occupant le recto et le verso de la page, comme le font les parents et grands-parents de Miss Matty ; de même, on pratiquait régulièrement le crossing, à l’instar de Deborah (« the pride and delight of crossing » [59]), technique qui consiste à tourner la page à quatre-vingt-dix degrés après l’avoir remplie et à continuer sa lettre à la perpendiculaire, par-dessus les lignes précédemment écrites7.
On passe ainsi d’un système de production de papier et d’envoi postal qui repose sur une économie du matériau, ou du moins sur un usage parcimonieux des feuilles afin de limiter le coût des lettres, à un système qui banalise l’emploi de multiples pages dans la correspondance. Les différentes lettres dont il est question dans cet épisode de Cranford soulignent en effet ce changement de paradigme et ce changement de relation au papier dans l’évolution du support matériel de la correspondance : des petits morceaux de papier sur lesquels écrivaient les parents et grands-parents de Miss Matty (« Sometimes the whole letter was contained on a mere scrap of paper», [58]), on en vient à un format plus large chez Deborah (« She wrote on the square sheet, which we have learned to call old-fashioned » [58-59]) et enfin, pour la génération de la narratrice, à un usage peu économe des feuilles désormais produites de manière moins coûteuses (« they send a whole inside of a half-sheet of note paper, with the three lines of acceptance to an invitation, written on only one of the sides » [51]). On assiste ici au passage d’un rapport économe au papier dans le contexte de la fin du XVIIIe siècle (Schaffer 2011, 77-81), à l’avènement d’un « âge du papier » (« age of paper », Briggs 22) au milieu du XIXe siècle, où la production plus aisée de ce matériau permet d’en fabriquer de plus en plus et ainsi d’en faire un usage dispendieux (Prest 15-23). La scène de lecture de lettres dans cet épisode de Cranford s’inscrit donc dans un contexte où l’on produit plus et où l’on gaspille plus de papier, là où on en économisait auparavant. Dès lors, ce gaspillage (« this little unnecessary waste of paper » [51]) rend précaire et instable l’existence-même du matériau. Les précieuses lettres de famille, dans lesquelles on lit une histoire épistolaire et matérielle plus large, sont donc elles aussi soumises à ce mouvement de gaspillage et de destruction.
3. Archive et destruction des lettres : la sauvegarde partielle de l’objet qui se consume dans la diégèse
Dès lors, comment comprendre la destruction paradoxale des lettres des Jenkyns, patrimoine familial jusque-là précieusement conservé ? Le projet d’autodafé de Miss Matty s’inscrit en effet en nette rupture avec la tradition familiale, puisqu’un premier travail d’archivage et de conservation des lettres avait été opéré par les Jenkyns eux-mêmes. Les lettres ont été lues et relues, successivement étiquetées et annotées8, avant d’être regroupées en paquets par Deborah qui y a apposé ses propres étiquettes (« Letters interchanged between my ever-honoured father and my dearly-beloved mother, prior to their marriage, in July, 1774 » [54]). C’est ce travail minutieux qui a permis aux lettres d’être conservées pendant des décennies, alors même que d’autres objets ayant appartenu à la famille n’ont pas survécu au passage du temps : ainsi la lettre qui accompagnait le trousseau envoyé par Mr Jenkyns à sa future épouse a été préservée, tandis qu’il ne reste paradoxalement plus aucune trace des objets qui le composaient (« and then he sent her a letter, which had evidently accompanied a whole box full of finery, and in which he requested that she might be dressed in everything her heart desired » [54]). Pour la famille Jenkyns, les lettres sont bien une relique à conserver et transmettre en héritage.
Si Miss Matty chérit ce patrimoine familial et hésite à plusieurs reprises à brûler les lettres, elle met néanmoins son projet à exécution : « And one by one she dropped them into the middle of the fire, watching each blaze up, die out, and rise away, in faint, white, ghostly semblance, up the chimney, before she gave another to the same fate » (55). La destruction des lettres est donc paradoxale, mais Miss Matty place d’emblée son geste dans une inquiétude quant à la postérité de ce trésor familial, comme nous l’avons déjà souligné : la crainte de voir ces lettres de famille tomber dans des mains étrangères. Or, cette raison explicitement invoquée, et répétée deux fois avec une emphase modale frappante au cours de l’épisode (« ought not to be allowed to fall into the hands of strangers » [53] ; « it seemed as if it would have hurt her to allow them to fall into the hands of strangers » [57-58]), est immédiatement contredite : c’est en effet dans les mains de la narratrice, qui s’identifie elle-même comme une étrangère à Cranford (« I, a stranger » [69]) et que Miss Matty considérera ainsi plus tard (« you are a stranger in the town » [105]), que celle-ci place les lettres de sa famille. Dès lors, Miss Matty se situe en porte-à-faux avec l’héritage familial, refusant de perpétuer la transmission du patrimoine épistolaire. Talia Schaffer considère à cet égard la destruction des lettres comme une manière pour Miss Matty d’affirmer sa propre autorité et son indépendance contre les membres de sa famille, dont elle s’assure qu’ils ne reviendront pas la hanter (« turn the dead back into ghosts », 2011, 79). On peut également lire dans les hésitations de Miss Matty une tentative de transmission détournée de cet héritage, à l’intention de la narratrice elle-même. C’est bien en sa présence qu’elle décide de lire les lettres de famille, et c’est bien elle qu’elle associe à son projet : « ‘We must burn them, I think,’ said Miss Matty, looking doubtfully$ at me » (55). Dans la dimension subjective et interpersonnelle de ce « must », associé à la première personne du pluriel, un autre projet apparaît en creux : celui de ne pas brûler les lettres.
C’est là le point aveugle de la narration : malgré les hésitations de Miss Matty, la narratrice ne s’oppose en rien à l’idée de brûler les lettres et ne commente pas les suggestions à peine voilées de la vieille dame. Les lettres brûlent car Miss Matty n’a pas trouvé en son interlocutrice une personne qui se soucie de préserver l’objet porte-mémoire. C’est donc une réception manquée des lettres qui se lit dans cet épisode : de même que la mère de Miss Matty reçoit sans les comprendre les vers latins de son mari, la narratrice reçoit ces lettres familiales sans comprendre l’intention de celle qui les a placées entre ses mains. Dès lors, la narration rétrospective apporte un correctif en ce que la narratrice y ménage un espace de sauvegarde des lettres désormais perdues : c’est le texte qui devient ainsi le dépositaire de la mémoire des lettres. Cette sauvegarde est toutefois sélective et parcellaire, largement incomplète, puisqu’elle ne reproduit pas l’intégralité de la correspondance des Jenkyns, et surtout ne nous met pas en contact immédiat avec la matérialité de l’objet épistolaire qui s’est consumé. Cependant, la narratrice rejoue sa propre réception des lettres des Jenkyns dans le texte, plaçant entre nos mains d’étrangers et d’étrangères à Cranford les lettres familiales qui ne nous étaient pas destinées. Paradoxalement, le passage d’une matérialité épistolaire de la mémoire (les lettres de la famille Jenkyns, consumées dans la diégèse) à une autre forme de matérialité, textuelle et imprimée cette fois-ci (le texte de Cranford, publié en feuilleton puis en livre), achève de sauvegarder pour de bon le souvenir des Jenkyns (Menke 252). Transformer les lettres manuscrites et uniques en un texte imprimé à plusieurs milliers d’exemplaires empêche la destruction irréversible et totale de la mémoire.
« No one will care for them when I am gone » : réception et postérité de Cranford, objet littéraire
« I, like her, was fascinated into watching the destruction of those letters, into which the honest warmth of a manly heart had been poured forth. » (55)
Le spectacle hypnotique des lettres qui brûlent attire notre attention sur la matérialité fascinante de l’objet littéraire que nous tenons entre les mains et que l’on peut considérer à son tour comme un « paquet de vieilles lettres » (« bundle of old letters »). Car si la pérennité de Cranford est aujourd’hui assurée, sa forme matérielle, notamment au tout début, ne garantissait en rien que ce texte animé par un travail de mémoire soit conservé. En effet, dans Cranford, toute réception de lettres est à double tranchant, pouvant à tout moment entraîner la destruction de l’objet épistolaire — et par extension du texte lui-même.
1. « ‘Cranford’ was one paper […] and I never meant to write more »9 : l’épopée éditoriale d’un drôle d’objet littéraire
Qu’est-ce que « Cranford » ? Un objet littéraire dont l’histoire éditoriale recèle une richesse textuelle et matérielle particulièrement signifiante. Cranford est tout d’abord un épisode paru dans Household Words en décembre 1851 (« Our Society at Cranford »), avant de devenir un feuilleton de huit épisodes au total qui paraît jusqu’en mai 1853 (Delafield 73-80). Le feuilleton est publié en un volume cette même année et ré-édité de multiples fois du vivant de Gaskell (Easson 7), avant de faire l’objet de plusieurs éditions illustrées, la première datant de 1864, ainsi que de publications bon marché, notamment à partir des années 1890. Aujourd’hui, on connaît aussi Cranford sous un autre format, celui de son adaptation télévisée pour la BBC réalisée par Simon Curtis et Steve Hudson en 2007 et en 2009, qui réunit plusieurs récits de Gaskell sous l’ombrelle de « Cranford » (« Mr. Harrison’s Confessions » (1851) et « My Lady Ludlow » (1858) sont en effet intégrés à l’intrigue). Ces différents formats éditoriaux et matériels, textuels et à présent audiovisuels, contribuent à brouiller l’identité générique de cet objet littéraire, comme l’avance Thomas Recchio qui a consacré un ouvrage entier à l’histoire éditoriale de Cranford : « its generic character was unstable and changing in relation to its material forms » (2). Ainsi, Cranford a pu être considéré au départ comme un récit ethnographique authentique sur un petit village anglais (« field reports from a provincial town », Knezevic 409), une compilation d’histoires rappelant le genre de l’annale (McDonagh 139) ou encore celui de l’album (« souvenir album », Lutz), deux genres mémoriels populaires dans les années 1820 et 1830. Si l’on considère la première version de Cranford dans Household Words, la catégorie générique du texte s’avère encore plus floue : le magazine lui-même entretient une confusion quant à la nature des contributions qui y paraissent, puisqu’on y trouve mélangés des poèmes, de courts récits, des anecdotes humoristiques, ainsi que des articles qui font la part belle aux choses.
C’est d’ailleurs en tant que feuilleton dans Household Words que Cranford se rapproche le plus d’une autre forme textuelle : celle de la correspondance. En effet, l’objet matériel que parcourent les premiers lecteurs est un ensemble de feuillets, paraissant à intervalle plus ou moins régulier sur une période de deux ans. Le texte lui-même cultive la porosité avec le genre épistolaire, s’adressant directement à ses lecteurs-destinataires dès le tout premier épisode : « Have you any red silk umbrellas in London? » (6) ; « Do you have cows in grey flannel in London? » (10)10. Identifiant distinctement un lectorat métropolitain à qui il semble être destiné, Cranford a ainsi pu être lu dès le départ comme les lettres d’une correspondante à la campagne (« It most likely was read as a series of auto-ethnographic observations by an unnamed correspondent for the periodical », Recchio 2). L’affinité de Cranford avec les lettres se retrouve également dans l’attention portée à la matérialité d’un support qu’ils ont tous deux en commun : le papier (Schaffer 2005 36). Initialement baptisée « The Cranford Papers », cette œuvre qui fait foisonner — y compris dans son adaptation télévisée — les papiers, lettres, notes, billets, cartes et invitations, souligne de manière autoréflexive qu’elle est elle aussi faite de papier, de pages, de feuillets, potentiellement aussi fragiles et combustibles que les lettres que Miss Matty brûle dans « Memory at Cranford ». Cela est d’autant plus frappant lorsque l’on considère que le papier sur lequel est imprimé Household Words est particulièrement fin (« thin, acidic 12mo paper », « Household Words »), au point que l’on peut presque voir par transparence le verso de la page que l’on est en train de lire (notamment dans la version qui en est numérisée sur le site Dickens Journals Online). L’image du paquet de lettres (« bundle of […] letters » [53]) opère donc à l’échelle de l’œuvre entière : récit épisodique et hybride présentant une affinité avec la forme épistolaire, Cranford (dans tous ses formats) partage également la matérialité fragile et notoirement combustible des lettres.
Dès lors, l’importance du matériau qu’est le papier dans Cranford, ainsi que la porosité du texte que nous lisons avec le genre épistolaire, soulève la question de sa propre pérennité à la fois en tant qu’objet littéraire et objet matériel. Comme le rappellent Hughes et Lund, c’est en effet par le prisme d’objets tels que les lettres que Gaskell réfléchit à sa propre auctorialité et au statut de l’œuvre qu’elle est en train de composer (68-95) : à quoi ressemblera cette série d’épisodes, ce paquet de feuilles tout d’abord nommé « The Cranford Papers », dont la forme définitive est encore incertaine ? Cette œuvre sera-t-elle viable ou prompte à être détruite et brûlée, comme son roman Ruth l’a été (Hughes et Lund 69) ? Comment y apposer sa trace auctoriale, sachant que son nom n’apparaît nulle part dans Household Words alors que celui de Dickens est imprimé en haut de chaque double page (Schor 92-93) ? Ces questions sont d’autant plus pertinentes que Cranford occupe une place singulière aux yeux de Gaskell : inspirée de ses propres souvenirs d’enfance à Knutsford, cette œuvre était l’une de celles qu’il lui arrivait de relire avec plaisir et qu’elle a d’ailleurs continué à faire vivre dans sa correspondance11.
2. « No story at all […] only a bundle of recollections »12 : l’objet littéraire mu par un projet mémoriel de sauvegarde du passé
Cranford témoigne d’un projet de conservation d’un passé récent, déjà ébauché quelques années auparavant dans un court récit intitulé « The Last Generation in England » (1849) où Gaskell formulait le désir de préserver de l’oubli des pratiques en train de disparaître : « put upon record some of the details of country town life, either observed by myself, or handed down to me by older relations » (189). Ce projet est d’autant plus signifiant que la vie rurale telle que Gaskell a pu la connaître dans son enfance est en proie à des changements de taille à une époque d’urbanisation massive et d’innovations technologiques, notamment en matière de transport, qui bouleversent la société victorienne (Burchardt 7-8). Ainsi, l’objet littéraire se fait réceptacle de la mémoire, conservant un passé relativement proche (« a remembered past » Kingstone 2) qui remonte à la génération précédant celle de Gaskell mais qui risque toutefois de s’évanouir sans laisser de traces écrites. C’est donc un « paquet de souvenirs » (« bundle of recollections » Gaskell 1859 20) que nous propose Gaskell : une série de souvenirs et d’anecdotes de la vie dans un petit village, une version épisodique et fragmentaire de l’histoire, à l’opposé des récits surplombants et totalisants qu’ont pu écrire les historiens contemporains de la romancière tel Macaulay avec son History of England (1848-1849). En effet, Cranford n’écrit pas l’histoire d’après les événements historiques majeurs ou les figures éminentes de l’époque, mais par le biais de l’anecdotique, du domestique et du quotidien comme l’a montré Hilary Schor (86).
Ce regard mémoriel accorde une place d’honneur aux objets qui fourmillent dans le texte, comme le démontre Josephine McDonagh : « The sense of the past […] is mainly conveyed through the many references to material culture which clutter the fabric of the text » (136). C’est à travers ces « reliques » (« relics » [194]) ou « reliquats » (Farge 8-9) de la vie domestique que l’on retrace la chronologie du temps passé : un vieux livre de recettes du XVIe siècle, une soucoupe percée remontant à l’introduction du thé en Angleterre, une robe achetée par l’une des dames l’année où l’on entend parler de Peter pour la dernière fois, ou encore les lettres et les pratiques épistolaires dont nous avons déjà retracé les nombreuses mutations entre la fin du XVIIIe siècle et le milieu du XIXe siècle. C’est donc une histoire par le prisme des objets et de la culture matérielle qui se lit dans Cranford ; c’est bien cet ensemble hétéroclite de choses, dont on pourrait considérer qu’elles sont banales et peu importantes, qui sous-tend tout le projet mémoriel de Gaskell. À cet égard, celle-ci s’inscrit pleinement dans l’esthétique du roman provincial : elle attire notre attention sur des petits riens, des détails qui pourraient nous sembler triviaux mais dont le caractère insignifiant est précisément ce qui leur confère une importance (« significantly insignificant », Plotz 369).
Les lettres de la famille Jenkyns mettent parfaitement en perspective le genre de regard mémoriel que Cranford nous invite à adopter. Lisant une lettre de Deborah datant de 1805, qui qualifie de « triviales » les craintes d’une invasion napoléonienne, Miss Matty rétorque : « But indeed, my dear, they were not at all trivial or trifling at the time » (59-60). Conserver le passé, c’est non seulement replacer les objets dans leur contexte historique, mais aussi nous apprendre à les considérer dans le contexte affectif et émotionnel qui les entoure. De là, Schor met en évidence deux formes d’histoire qui s’écrivent dans Cranford : d’un côté, une Histoire au masculin (« masculine history » [98]), factuelle, concise, peu intéressante aux yeux de la narratrice ; de l’autre, une histoire au féminin (« feminine story » [98]), qui nous plonge dans les détails de la vie domestique ordinaire dont la narratrice est très friande. On en trouve d’ailleurs la corrélation dans les lettres, notamment dans une missive envoyée par ses grands-parents à la mère de Miss Matty au moment de la naissance de Deborah : au recto, les injonctions du grand-père, pleines de remontrances moralisatrices ; et au verso, dans l’ombre de la feuille, les mots affectueux de la grand-mère (55). Il s’agit donc de lire Cranford comme Miss Matty et la narratrice lisent les lettres : en prêtant attention à des objets et des détails qui pourraient nous sembler insignifiants, à des personnages dont on pourrait penser qu’ils sont « anhistoriques » et donc peu intéressants (Kingstone 175), et enfin à un texte qui s’apparente à un bric-à-brac mémoriel décousu qui nous offre une archive imparfaitement documentaire de la vie provinciale et qui opère, comme les lettres de la famille Jenkyns, à la manière d’un objet émissaire porte-mémoire.
3. « I dare say you would not care for them; but you might » : mémoire et éthique de la réception
Cranford, objet littéraire travaillé par une écriture mémorielle tournée vers le passé, anticipe aussi sa propre postérité, et la lecture des lettres est à cet égard une matrice herméneutique pertinente qui permet de réfléchir à la question de la réception du texte lui-même. Comme nous l’avons déjà évoqué, la réception des lettres est presque toujours placée sous le signe d’un échec partiel : elles sont difficiles à déchiffrer (en raison du crossing chez Deborah), arrivent en retard (dans le chapitre « Poor Peter »), ne sont pas comprises de la même manière par les correspondants (l’ode latine du recteur, lue comme des vers en hébreu, « Hebrew verses », par son épouse), sans oublier la réception manquée que la narratrice fait des lettres de famille que lui présente Miss Matty. La scène où la narratrice envoie une lettre à Peter, espérant qu’elle réussisse à lui parvenir, souligne de manière frappante cette problématique :
It was gone from me like life, never to be recalled. It would get tossed about on the sea, and stained with sea-waves perhaps, and be carried among palm-trees, and scented with all tropical fragrance; the little piece of paper, but an hour ago so familiar and commonplace, had set out on its race to the strange wild countries beyond the Ganges! (151-52)
C’est ainsi une image de la publication du livre, de son parcours du monde, qui est ici suggérée, à un moment où le développement des technologies en termes d’imprimerie, de système postal et de transport change radicalement les modes de production, de diffusion et aussi de réception de l’imprimé. On ne lit plus les lettres, et par extension les textes littéraires, de la même manière qu’auparavant : « but letters were letters then; and we made great prizes of them, and read them and studied them like books » (« My Lady Ludlow », 23). Dans ce contexte changeant, les pages de Cranford vont-elles trouver leurs destinataires et arriver dans des mains étrangères qui se préoccuperont de ce drôle de texte ? Si Miss Matty semble affirmer que ses lettres de famille n’intéresseront personne (« No one will care for them when I am gone » [55]), Gaskell quant à elle, dans une lettre adressée à sa belle-sœur, ménage la possibilité que de vieilles lettres (« old bundles of odd letters ») trouvent en sa correspondante une lectrice : « I dare say you would not care for them, but you might » (lettre à Elizabeth Holland, 8 décembre 1852, 218). Du « will not » catégorique au « might » plein d’espoir, s’ouvre ainsi une nouvelle possibilité : une réception où le texte de Cranford serait accueilli avec intérêt et affection.
Si Gaskell formule ici une éthique de la lecture et de la réception, nous appelant à accorder de la valeur au texte qu’elle place entre nos mains, une première difficulté apparaît néanmoins : pour Miss Matty comme pour la narratrice, on ne peut s’intéresser aux lettres que si l’on connaît personnellement les personnes qui les ont écrites (« She said all the others had been only interesting to those who loved the writers » [57]). De plus, s’il s’agit de recevoir Cranford comme on recevrait des lettres, une différence fondamentale oppose ces deux formes de textes : l’un est imprimé et circule à des milliers d’exemplaires, l’autre est écrit à la main et personnellement adressé à un destinataire unique. C’est précisément cette idée qui est mise en évidence dans une scène de la série télévisée (épisode 4, « April 1843, Dr Harrison Visits the Rectory ») où Miss Matty reçoit en même temps un courrier imprimé de sa banque, qui ne l’intéresse nullement (« Some sort of printed sheet, not personally meant for me at all. It’s very dull communication »), et une invitation de Mr Johnson, écrite à la main, qui la réjouit particulièrement (« This is pleasant »). Il en va de même lorsque les dames de Cranford, toujours dans l’adaptation de la BBC, examinent des cartes de Saint-Valentin imprimées à l’identique et se demandent quel genre de sentiment une telle carte, produite en plusieurs exemplaires, peut bien communiquer (« What sentiment can such a card convey? », épisode 3, « November 1842, Winter Approaches Cranford »). Un texte imprimé, diffusé en plusieurs exemplaires, peut-il réellement susciter des émotions en nous et nous aller droit au cœur ? Si la série télévisée émet un doute à ce sujet, la question est résolue différemment dans la version textuelle de Cranford : Miss Matty considère que le courrier de sa banque, adressé à tous les actionnaires, lui est tout personnellement destiné (« [My letter] is a very civil invitation […] I am sure, it is very attentive of them to remember me » [141-42]). Il faut donc que nous lisions Cranford comme Miss Matty lit le courrier de sa banque pour que ce texte imprimé nous parle et nous touche comme le ferait une lettre. C’est sans doute grâce à l’« environnement affectif » (McDonagh 140) que Gaskell parvient à créer dans Cranford, grâce à sa forme quasi épistolaire, épisodique et anecdotique, que nous devenons en quelque sorte les correspondants du texte, comme en atteste une critique de Cranford, « […] read only a dozen pages, and you are among real people, getting interested about them, affected by what affects them, and as curious to know what will come of it all as if it were an affair of your own »(Examiner, 23 juillet 1853, Easson 195).
Comment reçoit-on Cranford aujourd’hui ? À nouveau l’adaptation télévisée de la BBC interroge la réception que l’on peut faire de l’œuvre, car contrairement à ce qui se passe dans « Memory at Cranford », ici, on ne brûle pas les lettres : Miss Matty et la narratrice se contentent de les lire ensemble et de se remémorer l’histoire de la famille Jenkyns dans une scène empreinte d’une douce nostalgie (épisode 3, « November 1842, Winter Approaches Cranford »). Du point de vue des auteurs de cette adaptation, il n’est sans doute plus nécessaire de brûler les lettres, d’attirer l’attention sur leur fragilité matérielle, car Cranford est à présent un objet littéraire dont la place est assurée dans le canon gaskellien et victorien. Cette scène signale également la réception mémorielle que l’on fait de Cranford aujourd’hui : de même que la narratrice et Miss Matty se souviennent avec amusement des jours passés, Cranford est souvent présenté dans les stratégies éditoriales comme une œuvre renvoyant à une époque et à un mode de vie pittoresque révolus, celui d’un petit village au milieu du XIXe siècle. Ce que nous percevons aujourd’hui dans Cranford tend donc à être une version générique du passé qui se trouve au cœur d’un imaginaire culturel rural nostalgique (Helsinger 3) : c’est une image relativement vague et homogène (« an amorphous nineteenth century bedecked with corsets and carriages », Kingstone 141) que les contemporains de Gaskell auraient lue de manière bien plus spécifique (Kingstone 141). Or si la réception de Cranford passe aujourd’hui par le filtre nostalgique des period dramas, il n’empêche que son adaptation télévisée, tout comme le texte d’ailleurs (Schor 85), vient nuancer cette idée. On trouve en effet au cœur de Cranford un équilibre constant entre la nostalgie d’un passé qui ne peut revenir d’une part, évoquée par exemple dans le générique d’ouverture de la série, avec ses cartons représentant des champs verdoyants sur lesquels paissent des moutons, le tout accompagné d’un thème musical paisible aux accents doucement pastoraux ; et d’autre part la conscience de changements historiques majeurs qui bouleversent la société (l’un des mots-clefs du premier épisode de la série étant « Change »), notamment avec l’arrivée du chemin de fer qui devient dans cette adaptation le fil conducteur de l’intégralité des deux saisons. Ce ne sont donc pas les lettres que l’on détruit dans la série Cranford, mais une partie du paysage bucolique de Cranford (les champs, quelques cottages, une portion du domaine de Lady Ludlow) afin de laisser la place à ce nouveau mode de transport qui change en profondeur la société. Se souvenir, c’est donc aussi faire apparaître la destruction et les absences creusées dans son sillage ; c’est brûler des lettres pour mieux se les rappeler. Ainsi les différents formats sous lesquels existe Cranford, y compris dans les nouvelles modalités de réception que l’on en fait aujourd’hui, articulent tous à leur manière le lien complexe et singulier qui unissent l’écriture mémorielle à la matérialité de l’œuvre.
Notes
- 1Selon Marius Kwint, les objets remplissent trois fonctions mémorielles : ils servent de supports à nos souvenirs, stimulent la remémoration du passé et agissent comme une archive de la mémoire (2-3). Voir également l’ouvrage précurseur de Jones et Stallybrass quant à l’idée de mémoire matérielle.
- 2Cette idée apparaît une dizaine de fois dans sa correspondance : « Oh, please burn this letter as soon as you have read it » (lettre à John Forster, septembre 1853, 243) ; « Pray burn any letters. I am always afraid of writing much to you, you are so careless about letters » (lettre à sa fille Marianne, début mars 1854, 185) ; « please when I write a letter beginning with a star like this on its front [drawing of a star], you may treasure up my letter; otherwise please burn them » (lettre à son éditeur George Smith, décembre 1856, 324).
- 3« Given such varied evidence [in Victorian novels], much of it detailed and dated, the historian of the archaeology of Victorian Britain […] is more fortunate than those archaeologists who are concerned with periods where there are no written materials or than those anthropologists who are concerned with cultures without a preserved historical record » (20).
- 4Dans Cranford, ce sont les lettres qui font revenir Peter : d’abord son souvenir, dans cet épisode ; puis Peter lui-même, qui réapparaît comme par enchantement à la fin de Cranford grâce à une lettre envoyée par la narratrice (chapitre XV, « A Happy Return »).
- 5Briggs emprunte l’idée d’objets « émissaires » (« Things as Emissaries » 11) à T. S. Eliot, qui les définit ainsi dans Notes towards the Definition of Culture (1947) : « Even the humblest material artefact, which is the product and symbol of a particular civilization, is an emissary for the culture out of which it comes » (cit. Briggs 11).
- 6Précisons également que dans l’ancien système postal, c’était au destinataire de payer la lettre au moment de la recevoir ; certaines personnes étaient donc amenées à emprunter de l’argent, voire à s’endetter, afin de recevoir leur courrier (Golden 3-4).
- 7Gaskell elle-même, quoiqu’elle semble éviter la pratique (« but I must not cross », lettre à Charles Eliot Norton, 16 avril 1861, 651), était coutumière du fait, comme l’indiquent les éditeurs de sa correspondance qui ont rétabli une géométrie lisible dans leur édition (xxvii).
- 8C’est le cas par exemple d’une lettre du recteur, contenant un poème en latin idéalisant « Maria » (sa femme Molly), qui est d’abord endossée par celle-ci (« ‘Hebrew verses sent me by my honoured husband. I thowt to have had a letter about killing the pig, but must wait’ » [56]), avant d’être annotée par le pasteur lui-même (« in a post-scriptum note in his handwriting, it was stated that the Ode had appeared in the ‘Gentleman’s Magazine’, December, 1782 » [56]) — deux inscriptions sur la même lettre dont le contraste s’avère particulièrement comique et savoureux.
- 9Lettre à John Ruskin, fin février 1865, 748.
- 10Quand Gaskell écrit un nouvel épisode de Cranford en 1863, dix ans après la publication du volume, c’est toujours dans une veine épistolaire qu’elle s’inscrit : « Have I told you anything about my friends at Cranford since the year 1856? I think not. » (« The Cage at Cranford », 195).
- 11Dans la lettre, citée au début de cet article, où elle demande à John Forster de brûler ses missives, elle écrit quelques lignes plus loin : « Shall I tell you a Cranfordism. An old lady a Mrs Frances Wright said to one of my cousins “I have never been able to spell since I lost my teeth” » (290).
- 12Round the Sofa, 20.
Bibliographie
- Briggs, Asa. Victorian Things. University of Chicago Press, 1988.
- Burchardt, Jeremy. Paradise Lost. Rural Idyll and Social Change in England since 1800. I. B. Tauris Publishers, 2002.
- Carey, Annie. The Wonders of Common Things. Cassell, Petter, Galpin & Co., 1880.
- Chapple, J. A. V., and Arthur Pollard, editors, The Letters of Mrs Gaskell. Mandolin, 1997.
- Clarke, Julia. « “A Regular Betty!” ». The Gaskell Journal, vol. 33, 2019, pp. 37-50.
- Cohen, Deborah. Household Gods: The British and Their Possessions. Yale University Press, 2009.
- Curtis, Simon and Steve Hudson. Cranford. BBC, 2007.
- Curtis, Simon. Return to Cranford. BBC, 2009.
- Delafield, Catherine. Serialization and the Novel in Mid-Victorian Magazines. Routledge, 2015.
- Dolin, Tim. « Cranford and the Victorian Collection. » Victorian Studies, vol. 36, no. 2, 1993, pp. 179-206.
- Easson, Angus. Elizabeth Gaskell. The Critical Heritage. Routledge, 1991.
- Eliot, T. S. Notes on the Definition of Culture. Faber and Faber, 1948.
- Farge, Arlette. Vies oubliées. La Découverte, 2019.
- Gaskell, Elizabeth. Cranford. 1853, edited by Patricia Ingham, Penguin Classics, 2005.
- Gaskell, Elizabeth. Round the Sofa. 1859. Nonsuch Publishing, 2007.
- Golden, Catherine. Posting It. The Victorian Revolution in Letter Writing. University Press of Florida, 2009.
- Helsinger, Elizabeth. Rural Scenes and National Representation. Britain, 1815-1850. Princeton University Press, 2016.
- Hicks, Dan. “The Material-Cultural Turn: Event and Effect .” The Oxford Handbook of Material Culture Studies, edited by Dan Hicks and Mary C. Beaudry. Oxford University Press, 2010, pp. 25-98.
- “Household Words.” Dickens Journals Online, https://www.djo.org.uk/household-words.html. Consulté le 31 mai 2023.
- Huett, Lorna. “Commodity and collectivity: Cranford in the context of Household Words .” The Gaskell Society Journal, vol. 17, 2003, pp. 34-49.
- Hughes, Linda and Michael Lund. Victorian Publishing and Mrs. Gaskell’s Work. University of Virginia Press, 1999.
- Jones, Ann Rosalind and Peter Stallybrass. Renaissance Clothing and the Materials of Memory. Cambridge University Press, 2000.
- Kingstone, Helen. Victorian Narratives of the Recent Past. Memory, History, Fiction. Palgrave Macmillan, 2017.
- Knezevic, Borislav. “An Ethnography of the Provincial: The Social Geography of Gentility in Elizabeth Gaskell’s ‘Cranford’.” Victorian Studies, vol. 41, no. 3, 1998, pp. 405-26.
- Kwint, Marius, Christopher Breward et Jeremy Aynsley, editors. Material Memories. Design and Evocation. Bloomsbury Publishing, 1999.
- Lutz, Deborah. Victorian Paper Art and Craft. Oxford University Press, 2022.
- Macaulay, Thomas Babington. The History of England, from the Accession of James II. Routledge, 1848-1849.
- McDonagh, Josephine. “Women Writers and the Provincial Novel: Cranford and the Culture of Annuals.” Palgrave History of British Women’s Writing: Volume 6, 1830-1880, edited by Lucy Hartley, Palgrave Macmillan, 2017.
- Menke, Richard. Telegraphic Realism. Victorian Fiction and Other Information Systems. Stanford University Press, 2007.
- Miller, Andrew. H. “The fragments and small opportunities of Cranford.” Novels Behind Glass. Commodity Culture and Victorian Narrative. Cambridge University Press, 1995, pp. 91-118.
- Plotz, John.“ The Provincial Novel.” A Companion to the English Novel, edited by Stephen Arata, Madigan Haley, J. Paul Hunter and Jennifer Wicke. John Wiley & Sons, 2015, pp. 360-72.
- Prest, Céline. Le Spectre du document : support, signes et sens dans l’œuvre romanesque de Charles Dickens. 2016. Sorbonne Paris Cité, thèse.
- Recchio, Thomas. Elizabeth Gaskell’s Cranford. A Publishing History. Routledge, 2009.
- Sattaur, Jennifer. “Thinking Objectively: An Overview of ‘Thing Theory’ in Victorian Studies.” Victorian Literature and Culture, vol. 40, no. 1, 2012, pp. 347-57.
- Schaffer, Talia. “Craft, Authorial Anxiety, and ‘The Cranford Papers’.” Victorian Periodicals Review, vol. 38, no. 2, 2005, pp. 221-39.
- Schaffer, Talia. Victorian Domestic Handicraft and Nineteenth-Century Fiction. Oxford University Press, 2011.
- Schor, Hilary. Scheherazade in the Marketplace. Elizabeth Gaskell and the Victorian Novel. Oxford University Press, 1992.
About the author(s)
Biographie : Marie Duic est une ancienne élève de l’École Normale Supérieure de la rue d’Ulm. Agrégée d’anglais, elle est en troisième année de doctorat sous la direction de Frédéric Regard à Sorbonne Université (ED 020, Unité de recherche VALE) et membre du bureau du laboratoire doctoral OVALE. Sa thèse, portant sur « Le savoir des petits riens. Épistémologie et sémiotique du roman provincial anglais chez Harriet Martineau, Elizabeth Gaskell et George Eliot », vise à montrer comment ce sous-genre du roman victorien, dans son ancrage local spécifique, permet d’inventer une épistémè et une sémiotique de l’étroit mettant à l’honneur ce qui est apparemment trivial et insignifiant.
Biography: Marie Duic is an alumna of the École Normale Supérieure and an agrégée in English. She is a third-year doctoral student working under the supervision of Frédéric Regard at Sorbonne Université and an organizing member of the doctoral laboratory OVALE (ED 020, VALE). Her thesis, entitled “Le savoir des petits riens. Épistémologie et sémiotique du roman provincial anglais chez Harriet Martineau, Elizabeth Gaskell et George Eliot,” focuses on the way in which the English provincial novel foregrounds an épistémè highlighting the value of apparently trifling and insignificant details.