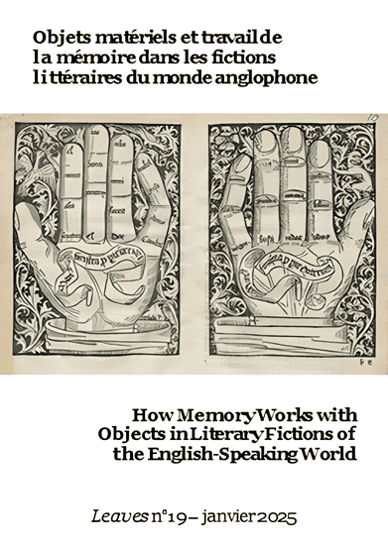« The story […] that goes with the briefcase » : l’objet porteur d’histoire et de mémoire dans Falling Man de Don DeLillo1
Abstract: This paper proposes to examine the role of the briefcase in Don DeLillo’s Falling Man and the way in which it crystallizes traumatic memory. Initially a mere accessory that indirectly reveals fault-lines in the character’s psyche, the object soon takes on the role of a mediator, of an intermediary that creates a link with the other and weaves the testimony into being. A true actor in the novel, it acts as a vehicle for socialization, language and narrative. Eventually, the symbolic object ends up standing for the abandoned body of the friend; a sign of guilt but also of preserved memory, it becomes a memorial pointing to loss and to the survivor’s sense of inadequacy. The briefcase thus reveals the mourning process at work in the novel, and the process of substituting the object for the friend marks a form of symbolization that remains incomplete because unconscious.
Keywords: Delillo, Memory, Trauma, Briefcase, 9/11
Résumé : Cet article se propose d’étudier le rôle du porte-documents dans Falling Man de Don DeLillo, et la façon dont il cristallise le souvenir traumatique. D’abord simple accessoire qui exprime indirectement un état de faillite psychique du personnage, il se fait ensuite médiateur, intermédiaire qui crée du lien avec l’autre et fait advenir le récit par le biais d’un tissage à la fois narratif et humain. Véritable acteur du roman, il agit à la fois comme vecteur de sociabilité, de langage et de récit. Enfin, l’objet symbolique finit par se substituer au corps abandonné de l’ami ; trace de culpabilité mais aussi de mémoire conservée, il se fait mémorial de la perte et du sentiment d’insuffisance du survivant. Le porte-document est ainsi révélateur du travail de deuil à l’œuvre dans le roman, et le procédé de substitution de l’ami par l’objet marque une forme de symbolisation incomplète parce qu’elle demeure inconsciente.
Mots-clés : Delillo, Mémoire, Trauma, Porte-documents, 11-Septembre
Publié le 15 mai 2007, Falling Man, quinzième roman de Don DeLillo, fait partie des tout premiers ouvrages américains de fiction consacrés aux attentats du 11 sptembre. L’intrigue se déroule dans les semaines et mois suivant la tragédie, et dépeint le quotidien d’un rescapé, Keith Neudecker, dans le monde de l’ « après » (« These were the days after and now the years » [DeLillo 230]). S’il retrouve d’abord sa place dans la vie de son fils en se réfugiant chez la femme dont il est séparé, il fuit bientôt à nouveau la cellule familiale, d’abord pour passer des après-midis entiers dans l’appartement de Florence, une autre rescapée, puis finalement pour rejoindre le désert de Las Vegas et ses tournois de poker.
La question de la mémoire de l’événement joue un rôle prépondérant au sein du récit qui adopte souvent le point de vue du rescapé par le biais de la focalisation interne : Keith souffre visiblement de troubles de la mémoire, ou tout du moins éprouve de grandes difficultés à replacer ses bribes de souvenir au sein d’une narration stable, cohérente et chronologique. Le texte le rappelle sans cesse, notamment en retardant l’explicitation des pronoms, comme pour imiter un certain effet de latence psychique. On peut le constater dès les premières pages du roman, où l’image insoutenable de la chemise qui tombe du ciel, et s’avèrera être une synecdoque de l’homme qui la porte, n’apparaît nettement qu’au bout de trois phrases : « There was something else then, outside all this, not belonging to this, aloft. He watched it coming down. A shirt came down, out of the high smoke » (DeLillo 4, nous soulignons). Les symptômes du personnage rappellent en tout point la théorie freudienne du trauma, qui fait de l’événement traumatique une effraction soudaine, imprévisible et d’une telle violence que l’appareil psychique se voit incapable de décharger l’afflux d’excitation :
Nous appelons ainsi une expérience vécue qui apporte, en l’espace de peu de temps, un si fort accroissement d’excitation à la vie psychique que sa liquidation et son élaboration par les moyens normaux et habituels échoue, ce qui ne peut manquer d’entraîner des troubles durables dans le fonctionnement énergétique. (Freud, Introduction à la psychanalyse 331)
L’événement excède les facultés d’assimilation du sujet, et n’est ainsi pas « vécu » au sens psychique, c’est-à-dire intégré à la conscience, au moment où il se produit. Freud explique que « les plus intenses et les plus tenaces de ces souvenirs sont souvent ceux laissés par des processus qui ne sont jamais parvenus à la conscience » (Essais de psychanalyse 30). cela ne signifie pas pour autant que le trauma est synonyme d’amnésie, mais plutôt d’un fonctionnement anarchique de la mémoire, de sorte que la scène traumatique revient hanter sa victime de manière littérale et violente, ce que constate Freud au sujet des rescapés d’accidents ferroviaires : « la vie onirique des névroses traumatiques se caractérise en ceci qu’elle ramène sans cesse le malade à la situation de son accident, situation dont il se réveille avec un nouvel effroi » (Au-delà du principe de plaisir 49).
Nous suggérons ici que le texte, loin de se contenter d’« imiter » la clinique freudienne, nous amène plutôt à la relire à la lumière des intuitions du romanesque. Par le truchement d’un dispositif tout à fait singulier, un porte-documents – objet trivial mais aussi symbolique de l’hégémonie américaine attaquée le 11 septembre 2001 – vient cristalliser le souvenir de l’expérience traumatique en tissant tout un réseau de significations. L’objet devient l’indice et le marqueur textuel d’une effraction de la mémoire par l’événement traumatique. Il agit d’abord comme un révélateur de la conscience malade du personnage dont la mémoire ne procède plus que de manière confuse et désordonnée. Il se fait aussi « embrayeur narratif » (Tréguer 181), et devient même symboliquement une sorte de témoin prêt à recueillir le souvenir pour permettre l’émergence d’un récit moins parcellaire. Enfin, l’objet se substitue à l’image de l’ami perdu dans les attentats, signe de ce sentiment de culpabilité qui ronge Keith alors même que le souvenir de la scène lui échappe.
L’objet comme indice de l’altération psychique
Si le trauma est souvent associé à une forme d’amnésie, c’est surtout « un débordement, […] une effraction qui submerge le sujet », qui trouve son expression dans l’hypermnésie, un « fonctionnement excessif et incontrôlé de la mémoire », ancré dans le « rappel incontrôlé de nombreux souvenirs fragmentés et hétérogènes » (Waintrater 197). Le souvenir n’est ainsi pas nécessairement oublié, mais surgit plutôt de manière anarchique et répétée, sans s’inscrire dans l’agencement perceptible d’une chronologie. C’est de cette façon que se manifeste la hantise de l’événement chez Keith Neudecker, personnage pour le moins silencieux qui ne partage avec personne ce qu’il a vécu en ce jour de septembre. Keith est particulièrement sensible au surgissement des images lorsqu’il doit renoncer à la stricte discipline qu’il s’impose2, et perd alors pour un temps la maîtrise de son corps et de ses pensées. Les traces de l’événement traumatique refont notamment surface au moment où il est sur le point de perdre conscience sous l’effet de l’anesthésie précédant l’opération qu’il doit subir à la main. Lui apparaît alors l’image de Rumsey, le collègue et ami perdu dans les attentats, assis à son bureau, au cœur des cendres et de la fumée. Le phénomène est analysé en termes presque cliniques par le narrateur :
On the table he thought of his buddy Rumsey, briefly, just before or after he lost sensation. The doctor, the anesthetist, injected him with a heavy sedative or other agent, a substance containing a memory suppressant, or maybe there were two shots, but there was Rumsey in his chair by the window which meant the memory was not suppressed or the substance hadn’t taken effect yet, a dream, a waking image, whatever it was, Rumsey in the smoke, things coming down. (DeLillo 22)
L’image fonctionne ici à la manière d’une apparition figée dans le temps, comme l’indique l’aspect inaccompli du verbe en fin de citation. La chute perpétuelle de ces objets encore indéfinis, qui rappelle celle de l’homme de la célèbre photographie de Richard Drew inspirant le titre du roman, accompagne l’effet désarticulé des images qui surgissent sans lien entre elles. La juxtaposition des syntagmes nominaux apposés à « a dream » crée au niveau de la phrase entière le sentiment que la structure pourrait continuer à produire indéfiniment de nouvelles définitions de cette image. L’apparition de l’ami émerge ainsi en dehors de tout contexte, contre la volonté du personnage, dans toute sa littéralité, et le paragraphe dont est tirée la citation constitue à lui seul une très courte vignette au sein du chapitre, insérée entre deux blancs, sans lien évident avec les sections qui l’encadrent, mimant ainsi le surgissement du souvenir traumatique. La confusion qui prévaut est soulignée par le parallélisme de structure qui suggère tour à tour deux possibilités (« just before or after he lost sensation », « a heavy sedative or other agent ») et l’effet de brouillage vient trancher avec l’image parfaitement nette de Rumsey qui n’appelle aucune hésitation de la part du narrateur.
Or si Keith emporte malgré tout quelque chose avec lui au moment de l’évacuation de la tour, c’est, à défaut d’un récit, un objet bien concret : un porte-documents. Celui-ci contribue d’abord à procurer au lecteur quelques informations au sujet de l’identité du personnage principal dès les premières lignes du roman : vêtu d’un costume, une serviette de cuir à la main, il s’agit selon toute vraisemblance d’un homme d’affaires. L’objet nous renseigne également indirectement sur son état de santé, puisqu’il révèle que Keith est visiblement blessé au bras gauche : « He put down the briefcase to take it, barely aware that he wasn’t using his left arm, that he’d had to put down the briefcase before he could take the bottle » (DeLillo 5). De la même façon que l’expérience est vécue ici de manière complètement détachée et que le personnage semble évoluer dans un état proche du somnambulisme, l’on apprend que Keith n’est en réalité pas le propriétaire du porte-documents et qu’il l’a emporté avec lui sans vraiment en être conscient, sans raison apparente :
The briefcase was smaller than normal and reddish brown with brass hardware, sitting on the closet floor. He’d seen it there before but understood for the first time that it wasn’t his. Wasn’t his wife’s, wasn’t his. He’d seen it, even half placed it in some long-lost distance as an object in his hand, the right hand, an object pale with ash, but it wasn’t until now that he knew why it was here. […] It was here because he’d brought it here. It wasn’t his briefcase but he’d carried it out of the tower and he had it with him when he showed up at the door. (DeLillo 35)
L’objet lui apparaît désormais comme tout à fait singulier, et les propositions elliptiques de style oralisé (« Wasn’t his wife, wasn’t his »), caractéristiques du discours indirect libre, inscrivent dans la syntaxe la fragmentation de l’expérience du personnage évoquée au plan sémantique. À la manière d’un événement traumatique, l’expérience n’est pas assimilée au moment où elle se produit, et c’est seulement après un certain moment de latence que Keith commence à tisser à nouveau quelques liens logiques, bien que peu satisfaisants car la raison de son geste n’est pas éclaircie. Selon Cathy Caruth en effet, c’est ainsi que fonctionne l’expérience traumatique :« traumatic experience […] is an experience that is not fully assimilated as it occurs » (Caruth 5). Ou, pour le dire en reprenant les termes d’Anne Whitehead, s’il existe une forme d’inscription de l’expérience dans la conscience, c’est précisément en tant que négation de l’expérience elle-même : « trauma emerges as that which, at the very moment of its reception, registers as a non-experience » (Whitehead 5). Le processus est décrit précisément dans les dernières pages du roman : « He was losing things as they happened. He felt things come and go » (DeLillo 240). Le personnage vit ainsi dans un perpétuel présent qui ne lui permet pas de se situer autrement que dans l’ici et maintenant, comme l’indique le glissement du déictique « there » (« he’d seen it there before ») à « here » (« it was here »), indice du passage vers le discours indirect libre.
C’est ainsi, dans un second temps, que Keith commence à identifier la raison pour laquelle l’objet étranger se trouve dans le dressing. L’objet couvert de cendres (« she’d cleaned it since then, obviously » [DeLillo 35]), n’est pas sans rappeler son propre état à son retour, et donc son statut d’objet étranger en quelque sorte rapporté, artificiellement greffé à nouveau à la cellule familiale qu’il avait quittée. C’est ce décalage temporel qu’il croit bon de devoir immédiatement justifier à deux reprises lorsqu’il prend contact avec la véritable propriétaire : « he started to explain, as he had on the telephone the day before, that he hadn’t meant to delay returning the briefcase » (DeLillo 52). L’explication qu’il fournit à la jeune femme est particulièrement symptomatique de la non-inscription de l’événement traumatique dans la psyché : « See, what happened is I didn’t know I had it. It wasn’t even a case of forgetting. I don’t think I knew » (DeLillo 53). Le polyptote (« know », « knew ») marque une insistance sur la spécificité du mal qui l’afflige, et l’utilisation du mot « case », terme presque médical, montre que le personnage est instruit sans que ses connaissances l’aident réellement à appréhender les symptômes. Si son interlocutrice est probablement quelque peu décontenancée par ses propos, elle n’en laisse rien paraître, et reprend simplement sa formule à l’identique afin de l’interroger plutôt sur son nom : « I don’t think I know your name » (DeLillo 53).
Curieusement, lorsque Keith pénètre dans l’appartement de Florence Givens (dont l’onomastique suggère qu’elle lui a en quelque sorte été donnée3), plutôt que de tendre le porte-documents à la jeune femme, il le dépose dans un endroit liminaire, près de la porte d’entrée, comme s’il hésitait encore à se défaire réellement de l’objet. Son geste rappelle le tiraillement auquel il était déjà en proie tout au long du trajet, où il envisageait tour à tour de rebrousser chemin, puis de jeter l’objet dans le Reservoir de Central Park (DeLillo 51-52). On pourra y lire là aussi une manifestation de la condition des êtres victimes de trauma, tiraillés entre la nécessité absolue de reconstruire un récit et le silence qui les oppresse, mais aussi touchés par une forte impression de dépersonnalisation ; Keith est comme poussé par une force qui ne lui appartient pas à traverser Central Park, comme l’atteste l’utilisation surprenante de la forme impersonnelle au début du chapitre 5 : « There was somewhere to go but he was in no hurry to get there » (DeLillo 51). Par ailleurs, lorsque Keith s’apprête à prendre congé après n’avoir échangé que quelques mots avec Florence, il s’empare machinalement du porte-documents, comme pris d’une sorte de compulsion de répétition dont il semble ici encore bien conscient : « I was ready to walk out the door with your property. All over again » (DeLillo 53, nous soulignons). On remarquera enfin que Keith ne dépose cette fois plus l’objet sur le sol (« The briefcase was […] sitting on the closet floor » [DeLillo 35]) mais choisit plutôt de le faire trôner sur une chaise (DeLillo 52), lui conférant ainsi le statut d’interlocuteur, comme sur le point de prendre part à la conversation. Or c’est précisément le retour de l’objet qui va déclencher chez sa propriétaire le souvenir et son récit. Il est en quelque sorte prêt à recueillir son témoignage, comme le rappelle la présence à l’intérieur de deux instruments idoines, dédiés à la prise de notes : un carnet aux pages vierges et un dictaphone (DeLillo 36). La multiplication de ces objets suggère la mise en abyme de l’acte de consigner l’expérience individuelle, et fait par là même référence au rôle du roman de préserver la mémoire collective de l’événement historique. Comme le résume Karim Daanoune : « Le trauma est dans l’attente de sa mise en récit, et c’est au roman, bien entendu, qu’incombe cette tâche » (Daanoune 91).
Vers la reconstruction d’un récit : l’objet témoin et passeur
La conversation entre les deux rescapés est d’abord guidée par le contenu du porte-documents : ils en font ensemble l’inventaire minutieux, et commentent les idiosyncrasies qu’il révèle chez la jeune femme. Suit une ellipse temporelle qui vient révéler en creux que la discussion s’est désormais faite plus grave : « An hour later they were still talking. The cookies were small and awful but he kept nipping into them, unthinkingly, eating only the first baby bite and leaving the mutilated remains to litter the plate » (DeLillo 54). La violence du souvenir contamine le vocabulaire utilisé pour désigner les biscuits à peine entamés, et c’est l’image des corps des victimes qui se projette pour le lecteur sur une scène de domesticité a priori parfaitement anodine. L’expérience de lecture vient ainsi directement concurrencer celle des personnages, Lianne et Martin décelant malgré eux la silhouette des tours jumelles dans les natures mortes de Morandi (DeLillo 50).
Florence commence alors à évoquer pour la première fois au discours direct ses souvenirs de l’attentat, dans un style paratactique haché qui marque le fait que, pour le moment, les quelques éléments dont elle dispose ne lui permettent pas d’élaborer un récit construit :
“I was at my screen and heard the plane approach but only after I was thrown down. That’s how fast,” she said.
“Are you sure you heard the plane?”
“The impact sent me to the floor and then I heard the plane. I think the sprinklers, I’m trying to recall the sprinklers. I know I was wet at some point, all through.” (DeLillo 54)
L’image des arroseurs anti-incendie ne trouve pas sa place au sein de la linéarité du temps chronologique, ne parvient pas à s’ancrer dans un avant et un après : les liens de cause à conséquence entre l’impact de l’avion, le déclenchement du système de secours et ses vêtements trempés résistent à toute assimilation. Le récit tourne en rond, comme l’illustre le chiasme : « She saw a woman with burnt hair, hair burnt and smoking » (DeLillo 55). Florence semble plongée dans une sorte de transe qui la coupe complètement du monde extérieur, si bien qu’elle ne s’adresse bientôt plus réellement à Keith, et que sa posture physique reflète l’effondrement intérieur : « She was slumped in the chair now, talking into the tabletop » (DeLillo 56). Le discours de la jeune femme est marqué par de nombreuses pauses, comme si elle luttait d’une certaine façon contre le silence, ou plutôt qu’elle revivait les événements en temps réel :
She went through it slowly, remembering as she spoke, often pausing to look into space, to see things again, the collapsed ceilings and blocked stairwells, the smoke, always, and the fallen wall, the drywall, and she paused to search for the word and he waited, watching. (DeLillo 55)
Comme l’expliquait déjà le psychologue Pierre Janet à la fin du XIXe siècle au sujet de sa patiente Irène, ce type de réminiscence est bien trop long, ce qui indique qu’il ne s’agit pas de mémoire narrative : « trois ou quatre heures pour raconter cette histoire, c’est absurde et ce n’est pas pratique. Le souvenir qu’elle me raconte par la suite se fait en une demi-minute : elle dit ce qui s’est passé en quelques paroles » (Janet 212). On peut ainsi interpréter de deux façons la remarque au discours indirect : « She was dazed and has no sense of time, she said » (DeLillo 55) ; l’ambiguïté permet de supposer qu’au moment où elle raconte elle se trouve à nouveau plongée dans cet état d’hébétude qui fut le sien au moment de l’évacuation de la tour. Et lorsque le récit atteint enfin une certaine forme d’achèvement, c’est pour mieux reprendre là où il avait débuté : « That was all she said for a time. […] After a while, she began to speak again. But he didn’t know where she was, somewhere back near the beginning, he thought » (DeLillo 58).
Malgré tout, il est manifeste qu’un certain travail d’élaboration est à l’œuvre. Comme Florence le remarque elle-même, se confier lui permet d’accéder à un nombre croissant de souvenirs qui lui échappaient jusqu’alors : « Now that I’m talking, it’s coming back a little bit » (DeLillo 55). Ces derniers se précisent dans son esprit, pour devenir de moins en moins flous. On observe un mouvement progressif de définition au sein même de sa narration grâce à l’intervention de son interlocuteur jusqu’ici très silencieux qui l’aide à compléter son récit : elle passe par exemple d’une périphrase très vague pour faire référence à un outil (« a long iron implement » [DeLillo 57]) au nom précis (« Finally he said, “Crowbar.’” “Crowbar,” she said, thinking about it, seeing it again » [DeLillo 57]). Le psychiatre et psychanalyste Dori Laub insiste sur l’importance d’un interlocuteur témoin pour recueillir la parole, et sur la nécessité d’une part de dialogue, ou du moins d’un discours adressé et non pas seulement d’un monologue :
For the testimonial process to take place, there needs to be a bonding, the intimate and total presence of an other—in the position of one who bears. Testimonies are not monologues; they cannot take place in solitude. The witnesses are talking to somebody: to somebody they have been waiting for for a long time. (Laub 70-71)
En devenant témoin, l’interlocuteur participe au processus de guérison :
The emergence of the narrative which is being listened to—and heard—is, therefore, the process and the place wherein the cognizance, the “knowing” of the event is given birth to. The listener, therefore, is a party to the creation of the knowledge de novo. The testimony to the trauma thus includes its hearer, who is, so to speak, the blank screen on which the event comes to be inscribed for the first time. (Laub 57)
En ce sens, Keith, qui a lui-même vécu l’événement, ne peut pas jouer pour elle ce rôle d’écran vierge susceptible d’enregistrer pour la première fois le souvenir. Malgré tout, c’est bien son action de porter, de s’encombrer d’un objet, qui fait symboliquement advenir la parole : « What we carry. This is the story in the end » (DeLillo 91). C’est peut-être ce que suggère l’utilisation du pronom interrogatif en WH-, qui fait référence à un objet encore indéfini qui reste à nommer : ce que Keith porte, c’est à la fois l’attaché-case à rapporter à sa propriétaire et son histoire à raconter.
Si Florence est la seule que l’on entend parler au discours direct de son expérience de rescapée au sein du roman, elle se fait porte-parole de toutes les victimes. C’est au sein de sa narration que résonne toute une polyphonie de voix et qu’apparaît une multitude de visages. Le texte est notamment contaminé par l’irruption soudaine du discours direct libre4 qui fait signe vers une certaine faillite du langage :
There was a man talking about a giant earthquake. She forgot all about the plane and was ready to believe an earthquake even though she’d heard a plane. And someone else said, I been in earthquakes, a man in a suit and tie, this ain’t no earthquake, a distinguished man, an educated man, an executive, this ain’t no earthquake. (DeLillo 56)
Plusieurs indices signalent qu’il ne s’agit plus de la voix du narrateur de troisième personne : la disparition de « have », du verbe de parole, mais aussi l’utilisation de « ain’t » en lieu et place de « isn’t ». Le contraste singulier est souligné par les commentaires sur l’apparence physique du locuteur puis par le rythme ternaire de la gradation (« a distinguished man, an educated man, an executive ») qui laisse entendre que son statut social devrait appeler un certain sociolecte. L’expression vient se cristalliser dans l’esprit de Florence, pour émerger à nouveau dans son discours quelques paragraphes plus loin : « We were struck together. I wanted my mother. This ain’t no earthquake, making ten million dollars a year » (DeLillo 57). L’intervention de l’homme est ici parfaitement intégrée à son discours sans guillemets, comme si c’était elle qui cette fois se l’appropriait.
Or, en prêtant sa voix à celle de toutes les victimes, Florence permet à Keith de retrouver la sienne. Bien qu’il ne partage pas avec elle le récit de son expérience, et demeure parfaitement silencieux à ce sujet jusqu’à la fin de leur série d’entrevues (« It would be fine, not speaking, breathing the same air, or she speaks, he listens, or day is night » [DeLillo 89]), il parvient à se situer au sein des souvenirs de la jeune femme lorsqu’il y repère un élément qui vient faire la jonction entre leurs deux destins : l’homme au pied de biche.
Keith thought he’d also seen the man, going up past him, a guy in a hard hat and wearing a workbelt with tools and flashlights and carrying a crowbar, bent end first.
No reason ever to remember this if she hadn’t mentioned it. Means nothing, he thought. But then it did. Whatever had happened to the man was situated outside the fact that they’d both seen him, at different points in the march down, but it was important, somehow, in some indeterminate way, that he’d been carried in these crossing memories, brought down out of the tower and into this room. (DeLillo 57)
En s’appuyant sur l’évocation de Florence, il parvient à ajouter un certain nombre de précisions qui rendent le souvenir d’autant plus précis : le casque de chantier, les outils et les lampes de poche viennent parfaire la description de la jeune femme, et Keith semble prendre soin d’apporter une contribution aussi exhaustive que possible, allant jusqu’à mentionner le sens dans lequel l’homme tenait le pied de biche, en une sorte de surenchère langagière. Il établit finalement un lien direct entre objet et souvenir : dans son esprit, l’homme dont on ne connaîtra en réalité jamais le destin se trouve désormais à leurs côtés ; en emportant avec lui le porte-documents et en retrouvant sa propriétaire, Keith recouvre l’accès à son passé, et c’est en quelque sorte lui aussi qui peut enfin se délivrer de la tour et commencer à regagner une véritable présence au monde. C’est peut-être ce que suggère l’utilisation du déictique de l’ici et maintenant, « this room » (nous soulignons), qui trahit un glissement vers le discours indirect libre. À défaut de pouvoir entreprendre à son tour le récit de son expérience, Keith pourra commencer par se situer dans les souvenirs de Florence : « He listened carefully, noting every detail, trying to find himself in the crowd » (DeLillo 59).
Objet de substitution et syndrome du survivant
La dernière section du roman, intitulée « In the Hudson Corridor », fait se télescoper les récits du terroriste Hammad depuis l’avion sur le point de percuter la tour et celui de Keith à son bureau. C’est le choc de l’impact qui semble réveiller textuellement un récit auquel le lecteur n’a jusqu’ici jamais eu accès, puisqu’il précède de quelques heures la scène qui ouvre le roman, où Keith se trouve déjà dans la rue :
A bottle fell off the counter in the galley, on the other side of the aisle, and he watched it roll this way and that, a water bottle, empty, making an arc one way and rolling back the other, and he watched it spin more quickly and then skitter across the floor an instant before the aircraft struck the tower, heat, then fuel, then fire, and a blast wave passed through the structure that sent Keith Neudecker out of his chair and into a wall. He found himself walking into a wall. The floor began to slide beneath him and he lost his balance and eased along the wall to the floor. (DeLillo 239)
La collision textuelle5 se manifeste à travers l’utilisation du pronom « he » qui, d’une phrase à l’autre, fait d’abord référence à Hammad (« he watched it roll this way and that »), pour finalement en venir à désigner Keith (« He found himself walking into a wall »). La narration rapporte alors comment Keith se dirige immédiatement vers le bureau de son ami Rumsey, et fait état des nombreux obstacles qui les séparent physiquement : « He had to climb in. He climbed over chairs and strewn books and a filing cabinet on its side » (DeLillo 241). Le texte signale que l’on se trouve au cœur du souvenir traumatique, au plus profond du sentiment de culpabilité qui ronge Keith : « He saw the mark on his head, an indentation, a gouge mark, deep, exposing raw tissue and nerve » (DeLillo 241). La blessure physique est décrite à travers la métaphore d’une déchirure du texte, d’une interruption ou d’une marque qui affecte le texte autant que le corps, comme le rappellent les termes « mark » et « indentation » qui renvoient directement à l’écriture.
Keith remarque que Rumsey respire encore, mais doit vite se rendre à l’évidence qu’il ne pourra pas le sortir de sa situation tant les obstacles sont nombreux :
He got to his feet and looked at him. He talked to him. He told him he could not wheel him out in the chair, wheels or not, because debris everywhere, he talked quickly, debris blocking door and hall, talking quickly to get himself to think in like manner. (DeLillo 242)
Le langage est ici réduit au strict minimum, et la disparition d’éléments syntaxiques essentiels mime la scène de destruction qui se joue sous ses yeux : « Things began to fall, one thing and then another, things singly at first, coming down out of the gap in the ceiling » (DeLillo 242). La difficulté physique qu’éprouve Keith qui tente alors de le porter est décrite dans le plus grand détail :
It took some time to push himself up and out. His face felt like a hundred pinpoint fires and it was hard to breathe. He found Rumsey in the smoke and dust, facedown in the rubble and bleeding badly. He tried to lift him and turn him and found he couldn’t use his left hand but was able to turn him partly.
He wanted to raise him onto his shoulder, using his left forearm to help guide the upper body while he grabbed the belt with his right hand and tried to snatch and lift.
He began to lift, his face warm with the blood on Rumsey’s shirt, blood and dust. The man jumped in his grip. There was a noise in his throat, abrupt, a half second, half gasp, and then blood from somewhere, floating, and Keith turned away, hand still clutching the man’s belt. He waited, trying to breathe. He looked at Rumsey, who’d fallen away from him, upper body lax, face barely belonging. The whole business of being Rumsey was in shambles now. Keith held tight to the belt buckle. He stood and looked at him and the man opened his eyes and died.
This is when he wondered what was happening here. (DeLillo 243, nous soulignons)
L’omniprésence des verbes de mouvement insiste sur l’effort intense que représente chacun de ses gestes, et même l’action de respirer requiert de sa part la plus grande concentration. L’on voit là aussi qu’à mesure que la scène progresse, l’événement résiste à toute assimilation puisque le nom de Rumsey alterne bientôt avec l’expression « the man », comme si le personnage focal perdait déjà conscience de ce qu’il était en train de faire, et la dernière phrase du passage achève de nous plonger dans la conscience défaillante du personnage : les déictiques « this » et « here » sont des indices de focalisation interne et indiquent que Keith est à nouveau en train vivre une expérience qui s’efface au moment même où elle a lieu.
Or, ce passage offre un contrepoint manifeste à la facilité avec laquelle le porte-documents va arriver entre les mains de Keith. Alors que l’homme âgé qui a assisté à la chute de Florence dans les escaliers donne de sa personne pour que l’objet lui soit restitué, il arrive ensuite jusqu’à Keith de manière presque miraculeuse :
There was a briefcase on its side and the man had to lean to reach it. He extended a hand and pushed it with some effort toward the advancing line. […]
Rumsey was the one in the chair. He understood that now. He had set him back down in the chair and they would find him and bring him down, and others. […]
The briefcase came down and around the stairwell, hand to hand, somebody left this, somebody lost this, this goes down, and he stood looking straight ahead and when the briefcase came to him, he reached his right hand across his body to take it, blankly, and then started down the stairs again. (DeLillo 244-45, nous soulignons)
L’objet est personnifié et semble se mouvoir de lui-même (« the briefcase came down », « the briefcase came to him »), pour parvenir avec la plus grande fluidité jusqu’à Keith, qui le saisit de manière parfaitement instinctive puisqu’il n’entre même pas dans son champ de vision (« he stood looking straight ahead »). Le texte entérine ainsi un remplacement de l’homme par l’objet à plusieurs égards. La personnification de l’objet fait directement suite à l’évocation de Rumsey replacé dans son fauteuil de bureau (on se souviendra par ailleurs que Keith dépose ensuite le porte-documents sur une chaise lorsqu’il se rend pour la première fois chez Florence), et l’adverbe « down », répété à non moins de cinq reprises dans ce court passage, lie textuellement l’homme et l’objet. Enfin, la boucle de la ceinture (buckle) de Rumsey à laquelle se raccroche Keith jusqu’au moment où son ami meurt sous ses yeux fait symboliquement le lien avec l’objet qui ne cessera de le ramener vers la scène traumatique :
[H]e stood and looked at it, full-grain leather with a pebbled texture, nicely burnished over time, one of the front buckles bearing a singe mark. He ran his thumb over the padded handle, trying to remember why he’d carried it out of there. He was in no hurry to open it. He began to think he didn’t want to open it but wasn’t sure why. He ran his knuckles over the front flap and unbuckled one of the straps. Sunlight fell across the star map on the wall. He unbuckled the second strap. (DeLillo 35-36, nous soulignons)
L’élément n’est ici pas anodin puisqu’il fait directement écho au bruit de la chute tel que décrit dans les premières pages du roman : « the buckling rumble of the fall » (DeLillo 3). Outre les allitérations qui convoquent les sonorités du vacarme, la collocation est en effet si surprenante que l’on ne peut qu’y voir l’établissement d’un réseau de significations qui dépasse les préoccupations esthétiques. Enfin, la marque de brûlure (« singe mark ») sur la fermeture fait directement écho à la blessure que Rumsey porte à la tête (« gouge mark »), et au moment où Keith détache la première sangle, la lumière tombe sur une carte du ciel, comme une évocation de l’au-delà. Ainsi, le texte suggère enfin, rétrospectivement, une explication au geste de Keith : à défaut d’avoir pu sauver la vie de son ami et collègue, ou au moins rapporter son corps à ses proches, c’est cet objet anodin qu’il emporte avec lui et qui constamment vient lui rappeler cette culpabilité qui le ronge alors même que le souvenir de la scène traumatique lui échappe.
Il y a ainsi une progression claire du rôle que joue l’objet dans le roman. D’abord simple accessoire qui exprime indirectement un état de faillite psychique du sujet face à un événement qui le dépasse, il se fait ensuite médiateur. Le porte-documents est en effet l’intermédiaire qui permet de créer du lien avec l’autre et ainsi de faire advenir le récit par le biais d’un travail de tissage à la fois narratif et humain. Véritable acteur dans le roman, qui acquiert des postures humaines, il agit à la fois comme un vecteur de sociabilité, de langage et de récit. Enfin, l’objet symbolique finit par se substituer au corps abandonné de l’ami ; trace de culpabilité mais aussi de mémoire conservée, il se fait mémorial de la perte et du sentiment d’insuffisance du survivant face aux exigences du moment. Le porte-documents est ainsi révélateur du travail de deuil à l’œuvre dans le roman. Le procédé de substitution de l’ami par l’objet marque une forme de symbolisation immédiate, mais incomplète puisqu’elle demeure inconsciente. Keith ne commence à comprendre ce qu’elle signifie pour lui qu’à retardement ; la prise de conscience reste en souffrance6, bien qu’il constate son impuissance à se défaire de l’objet, quand le texte met à jour son incapacité à le traiter autrement que comme une personne humaine, révélant ainsi la présence occulte du corps mort derrière l’objet.
Notes
- 2Keith concentre généralement toute son attention sur des activités qui lui occupent l’esprit, comme les parties de poker mais aussi la répétition des gestes mécaniques nécessaires à sa rééducation : « He found these sessions restorative, four times a day, the wrist extensions, the ulnar deviations. These were the true countermeasures to the damage he’d suffered in the tower, in the descending chaos. It was not the MRI and not the surgery that brought him closer to well-being. It was this modest home program, the counting of seconds, the counting of repetitions, the times of day he reserved for the exercises, the ice he applied following each set of exercises » (DeLillo 40).
- 3« It suggests the various gifts with which she is associated, ranging from the suitcase (with its CD player and its Brazilian music) to the human contact she gives Keith, perhaps hinting at a new “gift economy” of human relations, rather than social relations based on property and commodities » (Rowe 128).
- 4Celui-ci correspond à une citation sans guillemets et sans verbe introducteur. (Mattia-Viviès 7)
- 5Marc Amfreville remarque à ce sujet : « Le télescopage des deux espaces, celui de la tour et celui de la cabine de l’avion qui fond sur elle, n’est jamais visualisé, il n’est jamais extérieur. Le lecteur n’en ressent que les répliques au moment même où les deux blocs de la narration se percutent » (Amfreville 138).
- 6Nous reprenons ici le titre si stimulant de l’ouvrage de Marc Amfreville, qui dit à la fois la douleur mais aussi la latence, le retard, l’attente.
Bibliographie
- Amfreville, Marc. Écrits en souffrance. Michel Houdiard, 2009.
- Caruth, Cathy. Unclaimed Experience: Trauma, Narrative and History. Johns Hopkins University Press, 1996.
- Daanoune, Karim. Don DeLillo, « Falling Man ». Atlande, 2015.
- DeLillo, Don. Falling Man. 2007. Picador, 2011.
- Freud, Sigmund. Au-delà du principe de plaisir. 1920. Traduit par Jean Laplanche et J.-B. Pontalis, Payot & Rivages, 2010.
- Freud, Sigmund. Essais de psychanalyse. 1927. Traduit par S. Jankélévitch, Payot, 1977.
- Freud, Sigmund. Introduction à la psychanalyse. 1917. Traduit par S. Jankélévitch, Payot & Rivages, 2001.
- Janet, Pierre. L’Évolution de la mémoire et la notion du temps. A. Chahine, 1928.
- Laub, Dori et Shoshana Felman. Testimony: Crises of Witnessing in Literature, Psychoanalysis and History. Routledge, 1992.
- Mattia-Viviès, Monique de. « Monologue intérieur et discours rapporté : parcours entre narratologie et linguistique ». Bulletin de la Société de stylistique anglaise, 2005.
- Rowe, John Carlos. « Global Horizons in Falling Man ». Don DeLillo: Mao II, Underworld, Falling Man, dirigé par Stacey Olster, Continuum Publishing, 2011, pp. 121-34.
- Tréguer, Florian. Terreur, trauma, transferts : l’écriture de l’événement dans « Falling Man » de Don DeLillo. Presses Universitaires de France, 2015.
- Waintrater, Régine. « Génocide et survivance : un après interminable ». Le Traumatisme dans tous ses éclats : clinique du traumatisme, dirigé par Laurent Tigrane Tovmassian et Hervé Bentata, In Press, 2012, pp. 195-205.
- Whitehead, Anne. Trauma Fiction. Edinburgh University Press, 2004.
About the author(s)
Biographie : Caroline Magnin est l’autrice d’une thèse sur le trauma et ses écritures dans le roman américain consacré aux attentats du 11-Septembre. Elle s’intéresse plus largement aux liens entre dimensions cliniques et littéraires du trauma, aux relations entre texte, image et son, et à l’écriture de l’histoire récente. Elle a publié plusieurs articles au sujet de l’œuvre de fiction de Jonathan Safran Foer, notamment sur la fragmentation et sur l’écriture de l’absence. Elle est membre associé du laboratoire VALE (Sorbonne Université) et enseigne actuellement à la Faculté de Droit de l’Université Paris-Est Créteil.
Biography: Caroline Magnin is the author of a dissertation devoted to the writing of trauma in 9/11 fiction. Her research focuses more generally on the links between clinical and literary dimensions of trauma, the relationships between text, image and sound, and the writing of recent history. She has published several articles on Jonathan Safran Foer’s fiction, notably on fragmentation, and the writing of absence. She is an associate member of the VALE research team (Sorbonne Université) and currently teaches at the Faculty of Law of Paris-Est Créteil University.