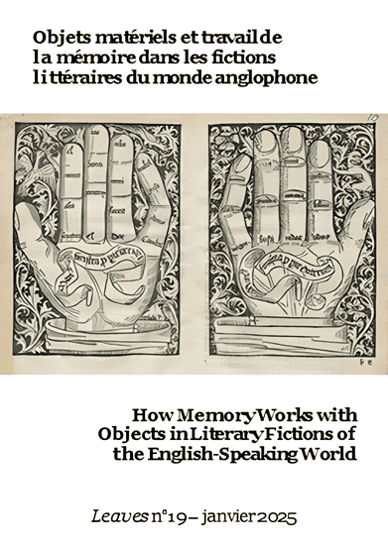Objets sans histoire : l’absence en héritage dans Great House de Nicole Krauss
Abstract: Resistant to all attempts at categorization, Nicole Krauss’s Great House (2010) constitutes a groundbreaking contribution to the abundant literature of “postmemory” (Mariane Hirsch), which focuses on the experience of generations now distanced from, yet still profoundly affected by, the Shoah. At once elegiac, polyphonic and kaleidoscopic, the novel, written on the mode of fragmentation and exile, spans over three continents and more than half a century. It features vulnerable, introverted characters, riddled with guilt, regrets and doubts, whose apparently disjointed monologues turn out to revolve around a mysterious piece of furniture–a desk, which functions as repository of all sorts of fascinating legends or unspeakable secrets. Torn from its original owners during World War II, this item which has since then been passed from hand to hand, is alternately perceived by the characters as an inalienable asset or as a burden to be disposed of. This article will analyze in turn the aesthetical and ethical stakes of the narrative, its ambiguous symbolism and metafictional overtones. While asserting herself as an insightful “witness through the imagination” (Lilian Kremer) Nicole Krauss proposes a sensitive and nuanced reflection on the role of objects as conveyors of memory in literary texts as well as on the possibilities of redemption for the unwitting inheritors of the trauma.
Keywords: Shoah, Trauma, Postmemory, Pyschoanalysis
Résumé : Réfractaire à toute tentative de catégorisation, Great House (2010) de Nicole Krauss constitue une contribution inédite à l’abondante littérature de la Shoah, aujourd’hui de plus en plus centrée sur ce que l’on a appelé « la post-mémoire » (Mariane Hirsch), à savoir l’expérience de générations désormais à distance de la tragédie mais encore profondément marquées. Roman élégiaque et kaléidoscopique, écrit sur le mode de la fragmentation et de l’exil, Great House balaie trois continents et plus d’un demi-siècle. Le récit, polyphonique, met en scène des personnages vulnérables et introvertis, criblés de regrets et de doutes, rongés par d’obscures culpabilités, dont les monologues, à première vue disjoints, se révèlent reliés par un objet mystérieux, réceptacle d’autant de légendes que d’inavouables secrets : un bureau, tout à la fois massif, branlant et biscornu, étrangement agencé car pourvu de dix-neuf tiroirs dont un fermé à clé. Arraché par la Shoah à ses propriétaires d’origine et désormais rétif à toute assignation à résidence ou appropriation définitive, ce meuble a transité et de mains en mains et de continent en continent, constituant pour certains personnages un bien inaliénable, pour d’autres un fardeau dont il importe de se débarrasser au plus vite. Seront tour à tour étudiés les enjeux esthétiques et éthiques de la structure narrative du roman, le symbolisme ambigu du bureau et sa fonction métafictionnelle. En s’affirmant avec Great House comme « témoin par l’imagination » (Lillian Kremer) et en choisissant de meubler de la sorte sa « maison d’écriture » (« House of Fiction »), Nicole Krauss nous propose une réflexion tout à la fois sensible et nuancée sur le rôle de l’objet dans le processus de transmission de la mémoire individuelle ou collective ; elle s’interroge dans le même temps sur les modalités d’une hypothétique et fragile rédemption pour les générations héritières du traumatisme.
Mots-clés : Shoah, Trauma, Postmémoire, Psychanalyse
“” […] There are tears in things; but we all cry for different reasons.
Daniel Mendelsohn, The Lost
Réfractaire à toute tentative de catégorisation (son auteur lui-même le dépeint comme « a very hard book to describe, » cité par Milbauer and Berger 72), Great House, troisième roman de Nicole Krauss, publié en 2010 et finaliste du National Book Award, constitue une contribution inédite à l’abondante littérature de la Shoah, aujourd’hui de plus en plus centrée sur ce que l’on a appelé « la post-mémoire » (Hirsch 1997), à savoir l’expérience de générations désormais à distance de l’événement mais profondément marquées. Des générations en quelque sorte porteuses de la cicatrice sans avoir subi la blessure, héritières malgré elles d’une mémoire qui ne saurait être que lacunaire et dispersée : « une mémoire trouée », nous dit Henry Raczymov, ou pour reprendre les termes de Nadine Fresco, « une douleur fantôme où l’amnésie fonctionne comme un lieu de mémoire » (Fresco 212). « Maybe it’s something inherited in the blood, a sense of loss of a thing and a longing for it, » résume Nicole Krauss (cité par Aarons et Berger 149) dont les arrière-grands-parents ainsi que de nombreux grands-oncles et grands-tantes périrent pendant la tragédie (cité parcite par Peck)1. Comme l’explique Mariane Hirsch :
The “post” in “postmemory” signals more than a temporal delay and more than a location in an aftermath. [It implies] both a critical distance and a profound interrelation […] an uneasy osqutcillation between continuity and rquupture. I see it rather as a structure of inter-and transgenerational return of traumatic knowledge and embodied experience […] a consequence of traumatic recall […] at a generational remove (Hirsch 2012, 5-6).
Pour la deuxième génération née après la Shoah,2 et plus encore pour la troisième, le passé se résume bien souvent à quelques artéfacts : lettres, photos jaunies, objets divers, pour la plupart mystérieux, indéchiffrables (« keepsakes […] but no memories to go with them », nous dit Daniel Mendelsohn, [182]), qu’il importe plus que jamais de faire parler à l’heure où s’éteignent les derniers survivants. C’est, entre autres, un bureau, arraché pendant la tragédie à ses propriétaires d’origine, qui occupe cette fonction dans Great House. Un meuble tout à la fois massif, branlant et biscornu, étrangement agencé car pourvu de dix-neuf tiroirs dont un fermé à clé. Le récit en dépeint les imprévisibles pérégrinations, tandis qu’apparemment rétif à toute assignation à résidence ou appropriation définitive, il passe de main en main et de lieu en lieu.
Roman polyphonique et kaléidoscopique, écrit sur le mode de la fragmentation et de l’exil, Great House balaie trois continents et plus d’un demi-siècle. Il met en scène des personnages vulnérables et introvertis, criblés de regrets, de doutes, ou d’obscures culpabilités qui, un peu comme dans une fugue de Bach, apparaissent et disparaissent au fil des pages. Le lien entre leurs monologues apparemment disjoints est ce bureau, réceptacle d’autant de légendes que d’inavouables secrets, qui constitue pour certains d’entre eux un bien inaliénable, mais pour d’autres un fardeau dont il importe de se débarrasser au plus vite. Seront tour à tour étudiés la structure narrative du roman, le symbolisme ambigu du bureau et sa fonction métafictionnelle.
Genèse et construction : « the mysterious poetry of the mind’s associations » (Great House 251)
La genèse de Great House illustre à merveille la fonction de l’objet en tant que vecteur d’assimilation de l’expérience et support de nos symbolisations. Dans un entretien accordé au Huffington Post (Estrin), Nicole Krauss, priée de commenter la structure complexe de son roman, élude la question pour évoquer en revanche les objets hétéroclites qui furent, nous dit-elle, déclencheurs de l’intrigue. Un bureau, le sien, dont elle ne comprendra qu’a posteriori qu’elle en a proposé dans sa fiction une réplique exacte, le curieux tableau peint par l’une de ses amies et représentant un requin auquel serait rattachés, par une série d’électrodes, divers êtres malades, ou encore les mares ou bassins dans lesquels plongent certains promeneurs dans le parc de Hampstead Heath à Londres, et enfin des chambres ou plutôt des chambres dupliquées, transplantées : la chambre de Francis Bacon à Londres, pieusement reconstituée dans un musée de Dublin ou celle de Freud, aménagée par son épouse et sa fille à l’image exacte de celle qu’il occupa à Vienne jusqu’en 1938, et à présent également transformée en musée.
Ces divers éléments furent les noyaux narratifs qui, en l’absence d’idée préconçue, nous dit l’auteur (cité par Estrin), fécondèrent au fil du temps son imagination pour être finalement rassemblés en une architecture virtuose, vigoureuse mais délibérément ouverte. L’ouvrage se présente comme une audacieuse expérimentation, une étonnante constellation « postmémorielle ». Structuré en diptyque, il propose en première partie quatre récits hétérogènes qui trouvent leur prolongement dans une seconde partie où ils sont agencés suivant un ordre différent. Le lecteur se voit, à chaque fois, projeté dans une temporalité et un univers nouveaux : « I began to write in the voices of four characters with very different lives, happening far from each other in space and sometimes time. I had no sense of why they should live together under the same roof: even if they should live together at all » (cité par Estrin). C’est, nous l’avons vu, le bureau ou plutôt sa disparition qui fait office de pivot de l’intrigue, même si l’équilibre structurel est à dessein compromis par un volet narratif (le second, dont l’action se déroule en Israël) sans rapport direct avec ce meuble. Les récits, en forme de confession, de ces personnages hantés par leur passé apparaissent comme autant de variations sur la mémoire et la perte. Une perte dont l’archétype semble être la Shoah pour Nicole Krauss qui, par respect ou pudeur, ne l’aborde pourtant que sur un mode oblique, décalé, et la met en parallèle avec d’autres formes de cataclysmes, individuels ou collectifs : par exemple, ceux induits par la dictature militaire d’Augusto Pinochet ou par le conflit israélo-arabe au Moyen Orient. Le roman semble à cet égard illustrer le constat de Cathy Caruth : « in a catastrophic age, trauma itself may provide the link between cultures » (Caruth 11). Ces rapprochements pourraient toutefois interpeller. Ne risque-t-on pas l’amalgame ou la banalisation ? L’auteur se serait-elle laissée séduire par ce « démon de l’analogie » (Decout, Levy et Mole) réduisant au bout du compte la Shoah à quelque trope universalisant ? Ce qui intéresse Nicole Krauss au premier chef, cependant, ce sont les répercussions de ces tragédies historiques sur les consciences individuelles (« the response to catastrophic loss », cité par Gritz) au fil du temps et des générations. Quel type de survie et éventuellement de reconstruction pour des sujets ainsi affectés ? Se gardant de toute réponse univoque (« Great House is a novel about uncertainty, ambiguity […] more than anything else », cité par Estrin) l’auteur fait dialoguer des expériences très diverses dont il appartient au lecteur de rassembler les fils. Une critique évoque le caractère déroutant de cette expérience de lecture : « Reading Great House is like being lost in a pitch-dark room […] and then suddenly having a dusty corner of that room brilliantly lit up and exposed » (Corrigan).
Dans le premier récit, intitulé « All Rise, » que l’auteur rédigea nous dit-elle un an avant les autres (cité par Estrin), Nadia, écrivaine New Yorkaise autrefois reconnue mais à présent rongée par la dépression, s’adresse à un interlocuteur invisible qu’elle appelle « Your Honor », et qui se trouve hospitalisé. Elle évoque l’influence déterminante qu’eut sur elle sa rencontre avec un poète chilien, Daniel Varsky, qui lui confia ses meubles en 1972 avant de repartir dans son pays où il fut assassiné par la junte. Profondément désemparée quand une jeune Israélienne, Lea Weisz, qui se prétend la fille de Varsky, lui réclame le bureau du poète dont elle avait fait durant vingt-cinq ans sa propre table d’écriture, Nadia se rend à Jérusalem en 1999 pour le récupérer mais sa quête se solde par un accident de voiture. Dans le deuxième récit « Lies Told by Children », qui se déroule en Israël entre 1975 et 1999, un avocat qui vient de perdre sa femme adresse à son fils Dov, qu’il s’employa jadis à empêcher de devenir écrivain, une lettre bouleversante visant à se rapprocher de lui. À la suite d’un épisode traumatique survenu pendant la guerre du Kippour ce fils a tenté de se reconstruire en Angleterre où il est devenu juge. Rentré au pays pour les funérailles de sa mère, il se fait renverser par une voiture et le lecteur devine qu’il est le « Votre Honneur » destinataire du récit précédent. Dans le troisième récit, Arthur Bender, professeur d’Oxford à la retraite, découvre à la mort de son épouse, Lotte Berg, que celle-ci, écrivaine et survivante de la Shoah dont il avait scrupuleusement respecté les silences, les colères ou les brusques replis, lui a dissimulé un terrible secret : l’abandon d’un bébé de trois semaines, proposé à l’adoption, tel un article mobilier dans une petite annonce. Le professeur, autrefois jaloux de l’inexplicable affection qui avait poussé son épouse à céder son bureau, unique vestige de son passé, à Daniel Varsky, comprend après coup que le tout jeune poète la renvoyait au fils qu’elle s’était refusé. Dans le quatrième récit, Isabel, une jeune Américaine venue étudier la littérature à Oxford, s’éprend de Johan Weisz, un garçon mystérieux très lié à sa sœur, Lea, que nous avions rencontrée dans la première histoire. Tous deux semblent prisonniers de leur père, un curieux antiquaire rescapé de la Shoah, qui a dédié sa vie à la récupération des biens juifs confisqués par les Nazis. C’est Weisz qui prend la parole dans le dernier chapitre, évoquant ce qui motive sa quête.
Dans ce roman élégiaque et crépusculaire, l’unité est assurée non seulement par le bureau, non seulement par ces personnages d’une tristesse infinie qui s’entrecroisent ou s’ignorent de façon hautement improbable, mais aussi par tout un jeu de correspondances mystérieuses, de reflets ou d’échos (l’auteur parle de « métaphores narratives ou structurelles », cité par Estrin). Obérant tout travail de deuil et tout apaisement, la disparition pure et simple du poète chilien ne renvoie-t-elle pas à celle des parents de Weisz à l’époque nazie ? Le fils de Lotte Berg ne semble-t-il pas le portrait de Daniel Varsky (« as if […] slipped through a hole, fallen into an abyss and resurfaced » [219]), de même que leur sosie en Israël, sur lequel compte Nadia pour retrouver le bureau ? L’arrachement et la solitude, l’objet ou l’enfant perdu, la communication impossible apparaissent comme des constantes. On notera également la récurrence du motif de la destruction par les flammes dans divers micro-épisodes : dans l’un, une femme périt dans un incendie (242-43), dans un autre une mère s’immole par le feu avec ses deux enfants (25), dans un troisième la vision hallucinée de son épouse brûlant livres et documents éveille chez Arthur Bender une angoisse incoercible (268). Notons également le trope obsédant de la vitre brisée, allusion transparente à la « Nuit de Cristal, » sur laquelle s’ouvre le récit de Weisz : « A stone is thrown in Budapest on a winter night in 1944 […] The glass shatters, the boy covers his head, the mother screams. At that moment the life they know ceases to exist. Where does the stone land? » (283)3. L’usage du présent simple projette l’épisode dans une dimension intemporelle et l’on retrouve la même image dans le récit du professeur d’Oxford, dont le logis a été vandalisé (271), [ainsi que dans l’ouvrage Broken Windows (253) composé par son épouse et qu’il entend remettre au fils de cette dernière. Parallèlement, une tension métaphorique entre surface et profondeur traduit l’affleurement d’un passé toujours susceptible de submerger le présent. Arthur Bender a l’impression que sa femme est littéralement happée par les « trous de nage » où elle s’immerge chaque matin et qui renvoient bien entendu à des gouffres purement intérieurs (« A corner of her like a black hole that through some sorcery I never understood » [274]). Dov, le jeune garçon israélien, imagine un requin dans un aquarium qui serait le réceptacle des cauchemars de divers personnages reliés à lui par un système d’électrodes. Ne pourrait-on voir dans cet étrange appareillage une mise en abyme de la structure du roman ?
Corrélations ambiguës (« indirect relation to reference », pour reprendre une expression de Cathy Caruth [7]), répétitions ou mystérieuses résurgences, brouillage des frontières entre la relation et l’écart, entre l’inconnu et le reconnu, entre l’ici et l’ailleurs, entre le passé et le présent paradoxalement perçus en termes de contiguïté et non plus de séquentialité4. Tout se passe comme si la construction de l’ouvrage, évocatrice de la dislocation psychique des personnages, des trous de mémoire ou des ratés de la transmission, épousait la structure même du trauma tel que le définissent les psychanalystes : un événement trop bouleversant pour être immédiatement assimilé par le sujet s’imprime à retardement dans sa conscience où il n’affleure plus que sous forme de rêves, d’obsessions, ou de comportements aberrants, susceptibles d’être transmis de façon transgénérationnelle. Dans ce roman que Nicole Krauss compose après la naissance de son second enfant et qu’elle dédie à sa descendance tandis que son précédent ouvrage (A History of Love, 2005) était dédié à ses grands-parents, le bureau incarne ce fardeau mémoriel (« The burden of the emotional furniture we inherit and pass on to our children », cité par Estrin), ses imprévisibles répercussions et les diverses modalités de sa transmission. Il relance page après page une dynamique tout à la fois psychique, narrative et poétique.
L’objet mémoriel : paradoxes et avatars. « Unlike people… the inanimate doesn’t simply disappear » (Great House 114)
Hériter, nous dit le psychanalyste Serge Tisseron, ce n’est pas recevoir quelque chose qui est donné et qu’on peut alors « avoir » (102), c’est la réappropriation active d’un legs. Suivant le regard que l’on pose sur lui, le bureau, objet toujours fuyant de la nostalgie des personnages, peut renvoyer à un processus d’assimilation de l’expérience et de structuration de la psyché, ou se constituer au contraire en « placard psychique » (pour reprendre à nouveau une expression de Tisseron [101]), en « crypte » ou «caveau secret » (les termes sont empruntés cette fois à Nicolas Abraham et Maria Torok [266]) où demeureraient verrouillés, sclérosés et susceptibles d’être transmis tels quels des contenus douloureux non assimilés, des symbolisations défaillantes, des deuils inaccomplis.5 Peut-être le tiroir du bureau, fermé à clé et inaccessible même à son propriétaire d’origine (284), renvoie-t-il à ce processus dans Great House. « The secrets of the dead have a viral quality and find a way to keep themselves alive in another host » (259), nous dit en tout cas Nicole Krauss.
Plus que tout autre, l’objet mémoriel est partie prenante de nos identités, compagnon de nos existences, « support de la symbolisation de nos expériences du monde » (Tisseron 221). On pense par exemple au bol à raser du père de Philip Roth dans son ouvrage autobiographique Patrimony. S’il est de surcroît vestige de la Shoah, cet objet est, encore plus que tout autre, présence et absence dans le même temps. Tel ces photos ou documents jaunis inlassablement compulsés par Daniel Mendelshon, il est témoin incontestable du « ça a été » (Barthes 120) dont parle Roland Barthes à propos de la photographie et de l’effet poignant du punctum qui lui est associé (Barthes 49) ; l’objet est talisman, rempart contre l’oubli mais également scandaleux renvoi à une époque à jamais révolue, à une culture, un univers, éradiqués. Dans sa concrétude prosaïque et massive, dans son immédiateté impénétrable et mutique, dans sa présence élusive, le bureau de Great House (« that monstrous piece of furniture » [251]) signale tout à la fois l’intensité du souvenir et l’énormité de la perte, la ténacité de la mémoire et sa fragilité (le meuble n’est-il pas branlant malgré sa taille imposante ?). Support de l’anamnèse, il confère couleurs et contours à la réminiscence et constitue une irrésistible invitation à la rêverie : « Come it seemed to say and the little mouse jumps up into it and away they go together over hills and plains, through forests and vales » 202). S’il est source de fascination, ce meuble, par moments associé à des images de putréfaction, peut toutefois évoquer une menace, susciter une répulsion : « Once I dreamed that I opened one of the drawers to find that it held a festering mummy » 248). C’est un trope de substitution mais également de disruption. Pour Nadia, l’écrivaine new-yorkaise, ce bureau censé avoir appartenu à Garcia Lorca renvoie à l’inspiration perdue. De même, il renvoie Lotte Berg, qui refusa d’être mère, à sa culpabilité, et il évoque aux yeux de son mari tout ce qui ébranle leur couple et pèse sur leur vie. Enfin, il rappelle à Weisz ses parents assassinés et l’effondrement du monde de son enfance.
Quoi qu’il en soit, et par-delà ce que Jean Baudrillard appelle « la densité des vieilles choses » (117), l’objet mémoriel est un puissant vecteur d’affect, susceptible de ressusciter l’intensité de la vie même. Weisz, l’antiquaire, le sait bien, lui dont les trouvailles, ou plutôt les retrouvailles, ravissent, exaltent et comblent ses clients.
It’s true, I can’t bring the dead back to life. But I can bring back the chair they once sat in, the bed where they slept […] I produce the object they have been dreaming of for half a lifetime, that they have invested with the weight of their longing […] It’s like a shock to their system. They’ve bent their memories around a void and now the missing thing has appeared. (275)
À tel point qu’il n’hésite pas à recourir au simulacre :
So even if it no longer exists I find it […] I produce it. Out of thin air if need be. And if the wood is not exactly as he remembers, or the legs are too thick or too thin, he’ll only notice it for a moment […] Because he needs it to be that bed where she once lay with him more than he needs to know the truth. You understand? And if you ask me […] whether I feel guilty the answer is no. (276)
S’il se prétend pour sa part réfractaire à ce type d’illusion, Weisz n’en pas moins passé quarante ans de sa vie à rassembler un à un les objets qui se trouvaient dans la chambre de son père et à reconstituer jusque dans ses moindres détails l’univers paternel, tel qu’il était avant le saccage de leur appartement de Budapest. Comme s’il s’agissait de récuser le temps, de maîtriser l’irréversible, de restaurer cette totalité autrefois intacte dont l’objet est le fragment, la métonymie. Seul manque à Weisz ce bureau, que sa fille a récupéré, mais dont elle lui refuse obstinément l’accès.
Or la démarche de la jeune fille vise en fait à protéger son père, à le préserver de toute clôture mortifère. On a souvent évoqué le rapport entre la collection et la mort. Comme le souligne Baudrillard, l’objet manquant à la collection est précisément ce qui préserve le jeu dans la série, donc l’ouverture garante d’une continuité :
[L]e manque est ce par quoi le sujet se ressaisit objectivement : alors que la restitution de l’objet final signifierait au fond la mort du sujet, l’absence de ce terme lui permet de jouer seulement sa propre mort en la figurant dans un objet, c’est à dire de la conjurer. Ce manque est vécu comme une souffrance mais il est aussi la rupture qui permet d’échapper à l’achèvement de la collection qui signifierait l’élision définitive de la réalité. (130)
Baudrillard se réfère au jeu de la bobine évoqué par Freud (43), à cette tension entre le « Fort » et le « Da » qui pallie l’angoisse de l’absence maternelle par la réapparition toujours renouvelée de la balle et par le dynamisme d’un mouvement, un salutaire déplacement. Faute de ce dynamisme, les significations s’abolissent, s’enkystent ou se figent. S’il est conçu comme désaveu résolu d’un manque, comme remède littéral et définitif à l’absence, comme recours au concret en l’absence de toute métaphorisation, l’objet se mue en fétiche, en fixation mortifère6. Comme le souligne la psychanalyste, Rachel Weisel Barth :
The fetish is like a drug which promises rescue from pain, surcease of tension and the fulfillment of one’s heart’s desires. It delivers enslavement instead […] The creation of a fetish reflects temporal, affective and cognitive dislocation. This psychic process occurs initially in response to anxiety and a sense of lifelessness in the present; and at the same time, in its temporal turning toward the past it confirms the present […] as emotionally empty, lacking in interest and any sense of agency. (Weisel-Barth 181)
Tout entier à sa quête, déraciné et solitaire, insensible aux besoins de ses enfants, Weisz est un homme exilé de lui-même et des autres, muré dans le passé : « partially erased », « his memory is more real than the life he lives, which becomes more and more vague to him » (276). Les objets qu’il s’emploie à rassembler ne sauraient combler le vide qui motive leur récupération. Ce bureau qui incarne à ses yeux la promesse d’une rédemption, voire la possibilité d’un retour à la vitalité et à la plénitude du passé pré-traumatique, fonctionne en fait comme instance persécutrice, obérant toute possibilité de vie affective ou de projection dans l’avenir : « It sucked up all the air. We lived in its shadow. As if death itself were living in that tiny room with us, threatening to crush us » (278), résume Arthur Bender. Lui choisira pour sa part de brûler le document où se trouve l’adresse du propriétaire originel du bureau (281).
Lorsqu’à la fin du roman l’antiquaire parvient à remettre la main sur ce meuble tant convoité, celui-ci lui ne lui apparaît plus que comme un bloc de bois inerte, exempt de toute magie : « But the tremendous desk stood alone, mute and uncomprehending » (289). Dès lors que le fantasme revêt une réalité tangible, l’illusion est détruite. On apprendra du reste que Weiz s’est suicidé après son retour à Jérusalem.
Sans doute ce personnage n’a-t-il pas saisi la pleine signification de cet épisode de l’histoire juive, qu’il évoque pourtant longuement lors de sa visite chez Arthur Bender. À la veille de la destruction du second temple de Jérusalem par les Romains, un guide spirituel de l’époque, Rabbi Yochanan Ben Zakkai, obtint la permission de fonder une école dans la ville voisine de Yavné où les sages de la communauté retranscriraient dans un livre, le Talmud, la loi orale, préservant ainsi la mémoire et la culture juive de la dispersion et de l’éradication :
What is a Jew without Jerusalem? […] Turn the Temple into a book, a book as vast and holy and intricate as the city itself. Bend a people around the shape of what they have lost and let everything mirror its absent form. Later this school became known as the Great House, after the phrase of the Book of Kings: “He burnt the house of God, the king’s house, and all the houses in Jerusalem, even every great house he burned with fire”. (279)
À la ville en flammes se substitue donc le livre, garant de la mémoire, miraculeux rempart contre l’annihilation (« Le feu ne peut s’éteindre dans le mot qu’il écrit. Eternité du livre, d’incendie en incendie », Jabès cité par Ouaknine 358). La patrie perdue se trouve en quelque sorte recréée dans le texte (« The text is home; each commentary a return », Steiner 77), susceptible d’être transporté d’exil en exil et transmis de génération en génération : « a memory of the House so perfect that it would be in essence, the original self » (Great House 279). L’évocation de cet épisode biblique nous renvoie de façon explicite au titre même de ce roman, éminemment réflexif puisqu’il gravite autour d’un meuble associé à l’écriture et puisqu’il met en scène des personnages qui sont pour la plupart des auteurs ou des lecteurs assidus. C’est par le livre, ou plus précisément par le livre en train de s’écrire, et par les commentaires que ses zones d’ombres, ses ellipses, ses ambiguïtés, voire ses contradictions, de même que son lot de pages blanches et d’intrigues à tiroirs sont propres à susciter, que se profile une survie, fût-elle précaire et menacée.
À condition toutefois que ce livre soit maintenu vivant, ouvert, soustrait à toute pétrification ou chosification délétère8 et conçu avant tout comme un espace virtuel, propice aux projections, offert à l’infini de l’interprétation. Avec son tiroir verrouillé, le bureau de Great House, conservera à jamais une part de son mystère. Car pour l’homme, « grand rêveur de serrures », nous dit Gaston Bachelard, « [l]a vérification fait mourir les images. Toujours imaginer sera plus grand que vivre » (83 ; 90).
À l’heure de la « postmémoire » tout particulièrement (« mediated not by recall but by imaginative investment, projection and creation », Hirsch 2008 [106-07]), l’invention se fait clé de voûte de l’édifice mémoriel. Pour peu qu’elle s’assortisse d’un doigté délicat, elle s’inscrit tout à la fois comme hommage aux disparus et comme vecteur du souvenir, et procède à ce titre d’un engagement et d’une éthique (« an ethical engagement with the ongoing texts of history », Aarons 2020 [246]). Great House est à la fois un Kaddish inspiré pour ceux qui ne sont plus et un fervent plaidoyer pour la littérature : les livres, suggère Nicole Krauss, « sont une invitation à pénétrer dans l’intimité d’un autre jusqu’à devenir cet autre. En nous inculquant l’empathie, ils nous ouvrent des horizons infinis » (cité par Trappenard). Ils sont tout à la fois transcription d’une absence et affirmation de vie. « No matter how bleak or tragic her stories were, their effort, their creation could only ever be a form of hope, a denial of death or a howl of life in the face of it » (Great House 256).
En s’affirmant avec Great House comme « témoin par l’imagination » (Lillian Kremer) et en choisissant de meubler de la sorte sa « maison d’écriture » (« House of Fiction »9), l’auteur nous propose une réflexion tout à la fois sensible et nuancée sur le rôle de l’objet dans le processus de transmission de la mémoire individuelle ou collective ; elle s’interroge dans le même temps sur les modalités d’une hypothétique et fragile rédemption pour les générations héritières du traumatisme.
Notes
- 1Selon Alan Berger et Asher Z. Milbauer, Lotte Berg, l’un des personnages les plus tragiques de Great House, aurait été calquée sur Sasha Mereminski, grand-mère paternelle de Nicole Krauss (Milbauer and Berg 66).
- 2Voir After Such Knowledge de Eva Hoffman.
- 3En italiques dans le texte.
- 4Cf. par exemple Marc Amfreville : « [L]e temps […] est dissous dans la stase du traumatisme […]. Le passé n’est plus passé dès lors qu’il vous hante ; il devient le double du présent. C’est dans ses interstices qu’il se glisse, à la manière de signifiés qui se bousculeraient non pas sous le linceul du signifiant mais dans sa trame même » (149).
- 5Sur la crypte, on se référera en particulier au chapitre 4 de l’ouvrage d’Abraham et Maria Torok : « Dans la crypte repose, vivant, reconstitué à partir de souvenirs, de mots, d’images et d’affects, le corrélat objectal de la perte […] ainsi que les moments traumatiques – effectifs ou supposés […]. Il s’est créé ainsi tout un monde fantasmatique inconscient qui mène une vie séparée et occulte. Il arrive cependant que […] le fantôme de la crypte vienne hanter le gardien du cimetière, en lui faisant des signes étranges et incompréhensibles, en l’obligeant à accomplir des actes insolites, en lui infligeant des sensations inattendues » (266).
- 6Si à l’origine Freud relie le fétiche à l’expérience traumatique de la différence des sexes (la mère n’a pas de pénis), on peut toutefois opter pour une définition plus large : « a material object used […] to ally and regulate, not just castration anxiety, but all sorts of relational, cultural and personally mortal terrors » (Weisel-Barth 182).
- 7Cette phrase est extraite d’un essai de George Steiner sur ce que l’on pourrait appeler la textualité de la condition juive.
- 8Pour préserver le renouvellement du sens, pour que la fidélité aux écritures ne se pétrifie pas en refus aveugle du temps et de l’Histoire, peut-être le livre lui-même devra-t-il un jour être détruit, suggère la tradition juive. Dans son ouvrage, Le Livre Brûlé, le rabbin et philosophe Marc-Alain Ouaknine évoque la légende selon laquelle un maître hassidique, Rabbi Nahman de Braslav, sentant la mort venir, détruisit par le feu l’un de ses écrits…
- 9L’image est proposée par Henry James dans sa préface à Portrait of a Lady. pas de pagination c’est une adresse internet (site en bibliographie)
Ouvrages cités
- Aarons, Victoria, editor. Third Generation Holocaust Writing. Lexington Press, 2016.
- Aarons, Victoria. “Found Objects. The Legacy of Third-Generation Holocaust Memory.” Translated Memories, Transgenerational Perspectives on the Holocaust, edited by Hofmann Bettina and Ursula Reuter, Lexington, 2020, pp. 231-50.
- Aarons, Victoria and Alan Berger. Third Generation Holocaust Representation. Northwestern University Press, 2017.
- Amfreville, Marc. Écrits en souffrance. Figures du trauma dans la littérature nord-américaine. Michel Houdiard, 2009.
- Bachelard, Gaston. La Poétique de l’espace. PUF, 1957.
- Baudrillard, Jean. Le Système des objets. Gallimard, 1968.
- Barthes, Roland. La Chambre claire : Notes sur la photographie. Gallimard, 1980.
- Caruth, Cathy. Unclaimed Experience: Trauma, Narrative and History. John Hopkins UP, 1996.
- Corrigan, Maureen. “Narratives Of Grief Fill Krauss’ Great House.” NPR, October 12, 2010. https://www.npr.org/2010/10/12/130509654/narratives-of-grief-fill-krauss-great-house. Accessed 18 September 2023.
- Decout Maxime, Nurit Levy et Gary D. Mole, éditeurs. Écrire la Shoah et le démon de l’analogie. Mémoire en jeu, n°27, décembre 2022, pp. 45-118.
- Estrin, Elana. “Q&A With Nicole Krauss, Author of Great House and The History of Love.”https://www.huffpost.com/entry/qa-with-nicole-krauss-aut_b_965230
- Fresco, Nadine. “La Diaspora des cendres.” Nouvelle Revue de Psychanalyse, n°24, 1981, pp. 205-22.
- Freud, Sigmund. “Au-delà du principe de plaisir.” Essais de psychanalyse. Payot, 1985.
- Gritz Rothenberg, Jennie. “Nicole Krauss on Fame, Loss, and Writing About Holocaust Survivors.” The Atlantic, 21 October 2010.
- Hirsch, Mariane. Family Frames: Photography, Narrative and Postmemory. Harvard University Press, 1997.
- Hirsch, Mariane. “The Generation of Postmemory.” Poetics Today, vol. 29, n°1. Spring 2008, pp. 103-128.
- Hirsch, Mariane. The Generation of Postmemory. Writing and Visual Cuture After the Holocaust. Columbia University Press, 2012.
- Hoffman, Eva. After Such Knowledge. Vintage, 2004.
- James, Henry. Portrait of a Lady (New York Edition, 1908) https://www2.newpaltz.edu/~hathawar/portrait1.html
- Krauss, Nicole. The History of Love. Norton, 2006.
- Krauss, Nicole. Great House. Penguin, 2010.
- “Krauss’ ‘Great House’ Built On ‘Willful Uncertainty.’” NPR, 14 October 2010. https://www.npr.org/2010/10/14/130564695/krauss-great-house-built-on-willful-uncertainty. Accessed 19 September 2023.
- Kremer, Lillian S. Witness Through the Imagination. Jewish American Holocaust Literature. Wayne State University Press, 1989.
- Mendelsohn, Daniel. The Lost: A Search for Six of Six Million. Harper Collins, 2006.
- Milbauer, Asher Z and Alan L. Berger. “The Burden of Inheritance.” Shofar, vol. 31, n°3, Spring 2013, pp. 64-85.
- Ouaknine, Marc-Alain. Le Livre brûlé : Philosophie du Talmud. Seuil, 1994.
- Peck, Claude. “A New ‘House’ for Krauss.” Star Tribune, 9 October 2010. http://www.startribune.com/entertainment/books/104534684.htlm. Consulté le 5 Septembre 2022.
- Raczymow, Henri and Alan Astro. “Memory Shot Through With Holes.” Yale French Studies n°85, Discourses of Jewish Identity in Twentieth-Century France, 1994, pp. 98-105.
- Roth, Philip. Patrimony. Simon and Schuster, 1991.
- Steiner, George. “Our Homeland the Text.” Salmagundi, n°66, Winter-Spring 1985, pp. 4-25.
- Tisseron, Serge.Comment L’esprit vient aux objets. Aubier, 1999.
- Torok, Nicolas Abraham et Maria Torok. L’écorce et le noyau. Flammarion, 2001.
- Trappenard, Augustin. “La grande maison de Nicole Krauss.” Elle, 18 mai 2011. https://www.elle.fr/Loisirs/Livres/Genre/Roman/La-grande-maison, consulté le 19 septembre 2023.
- Weisel-Barth Joye. “The Fetish in Nicole Krauss’ Great House and in Clinical Practice.” The International Journal of Relational Perspectives, vol 23, n°2, pp. 180-96.
- Wood, Gaby. “ ‘Have a Heart,’ Interview with Nicole Krauss.” The Guardian, 4 May 2005.
About the author(s)
Biographie : Paule Lévy est Professeur émérite de littérature américaine à l’Université Paris-Saclay. Sa recherche porte sur les écritures de l’ethnicité, la littérature juive américaine, l’écriture féminine et l’autobiographie. Elle est l’auteur de deux monographies : Figures de l’artiste : identité et écriture dans la littérature juive américaine (PU Bordeaux, 2006) et American Pastoral de Philip Roth: La Vie réinventée (PUF, 2012). Elle a par ailleurs dirigé ou codirigé divers volumes collectifs : Profils Américains: Philip Roth (PU Montpellier, 2002), Ecritures contemporaines de la différence (RFEA, 2003), Mémoires d’Amérique (Houdiard, 2009), Autour de Saul Bellow (PU d’Angers, 2010), American Pastoral de Philip Roth (PU de Rennes, 2011) ainsi qu’un numéro spécial sur Grace Paley (Journal of the Short Story in English, 2015) et un autre sur Philip Roth (Revue Française d’Etudes Américaines, 2021). Elle contribue à la publication de l’œuvre de Philip Roth (volumes 1, 2, 3) aux Editions de La Pléiade.
Biography: Paule Lévy is Professor Emerita of American literature at the University of Paris-Saclay. Her research focuses on Jewish American literature, ethnic studies, and women’s writing, on which she has written extensively. Her publications include two monographies (Figures de l’artiste : identité et écriture dans la littérature juive américaine de la deuxième moitié du vingtième siècle, 2006 ; American Pastoral: La Vie réinventée, 2012) and the edited or co-edited volumes: Profils américains : Philip Roth (2002), Ecritures contemporaines de la différence (2003), Mémoires d’Amériques (2009), Autour de Saul Bellow (2010), American Pastoral: Lectures d’une oeuvre (2011), a Special Issue on Grace Paley (Journal of the Short Story in English, 2015) and a volume entitled Speaking of Philip Roth. She has also participated in the edition of the first three volumes of Philip Roth’s writings in La Pléiade.