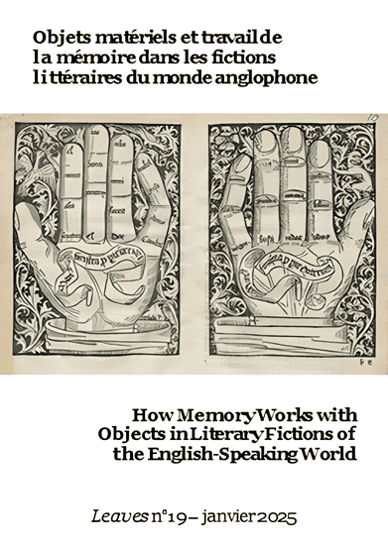La fonction mémorielle des objets chez Virginia Woolf et Katherine Mansfield : vers une esthétique de l’objet entre matérialité et surinvestissement symbolique
Abstract: At a pivotal moment in history and in the evolution of European society after WWI, modernist authors—among whom Katherine Mansfield and Virginia Woolf more specifically here—made objects a privileged material in the memorial process. Paradoxically, however, these highly symbolic material objects speak of absence rather than presence: they are part of a dialectical writing of the trace and of an aesthetic of the negative that speaks of an absence to the world. If objects are invested with a memorial power and sometimes, when part of ritualized mourning, become fetish objects, it is essential to see how they mainly express emptiness. This raises the question of the tension between the symbolic and the material, as well as that of the resistance of objects, in the diegesis as in the writing, to the over-investment of the imaginary and of memory.
Keywords: Modernism, Woolf, Mansfield, Objects, Memory
Résumé : À un moment charnière de l’histoire et de l’évolution de la société européenne après la Première Guerre mondiale, les auteurs modernistes, Katherine Mansfield et Virginia Woolf en particulier, font des objets un matériau privilégié du processus mémoriel. Ces objets matériels à la forte charge symbolique disent toutefois paradoxalement l’absence plus que la présence : ils s’inscrivent dans une écriture dialectique de la trace et une esthétique du creux pour dire une absence au monde. Si les objets sont ainsi bien investis d’un pouvoir mémoriel et deviennent parfois, au cœur d’une ritualisation du deuil, des objets fétiches, il est essentiel de voir comment ils ne font souvent que dire le vide. Se pose alors la question de la tension entre symbolique et matérialité ainsi que celle de la résistance des objets, dans la diégèse comme dans l’écriture, au surinvestissement de l’imaginaire et de la mémoire.
Mots clés : Modernisme, Woolf, Mansfield, Objets, Mémoire
La littérature, à partir du XIXe siècle, a accordé un statut privilégié aux objets qui portent en eux « une évidence ontologique universellement perceptible », au cœur de laquelle « l’entité volatile et indescriptible qu’est le souvenir […] trouve un ancrage concret » (Caraion 321). Cette évidence mémorielle des objets dont parle Marta Caraion ne va pas toutefois sans de multiples tensions qui suivent l’évolution de la place des objets dans la littérature comme celle de leur matérialité dans la société. Ces tensions sont particulièrement sensibles chez les auteurs modernistes britanniques, que nous évoquerons ici, Virginia Woolf et Katherine Mansfield (originaire de Nouvelle-Zélande), qui font toutes deux des objets un matériau privilégié : cet article s’attachera à montrer comment la charge mémorielle des objets oscille entre une matérialité réceptacle et une absence.
Avant d’étudier, sous le signe de la trace, la façon dont les objets cristallisent la mémoire de ce qui fut, il sera nécessaire de revenir sur la définition de l’objet, notamment dans sa relation d’interdépendance avec le sujet, pour tâcher de comprendre le processus mémoriel dont la littérature tente de se faire l’écho, et de voir comment le changement de statut des objets permet de préciser la nature de la rupture avec la/les littératures précédentes.
Nous évoquerons également les objets « résidus » dont parle Georges Perec dans Espèces d’Espace (1974) et qui sont la mémoire non seulement de ce qu’ont été les personnages – dans un processus où les objets deviennent fétiches1 ou reliques – mais également de ce qu’ils auront été alors que le présent est déjà un futur antérieur. Relier objets et mémoire, c’est en effet toujours évoquer le deuil et le néant, dans un monde paradoxalement « éternellement plein »2 mais toujours pris dans une instabilité que ni l’objet ni la mémoire ne peuvent parvenir à figer. Les objets se font la mémoire de ce qui sera après notre mort mais ils scellent pourtant le divorce du sujet et du monde comme dans la partie centrale de To the Lighthouse (1927) de Virginia Woolf, « Time Passes ». Le refus de ce divorce peut se réfugier avec violence dans un fétichisme que l’on trouve par exemple dans la nouvelle de Woolf, « Solid Objects » (1920) ou celle de Katherine Mansfield, « The Escape » (1921).
Nous verrons comment la littérature moderniste pratique une économie de l’objet qui en renforce le pouvoir symbolique : paradoxalement, les objets disent l’absence plus que la présence et s’inscrivent dans une écriture dialectique de la trace pour dire une absence au monde. Si les objets sont ainsi bien investis d’un pouvoir mémoriel, il sera essentiel de voir comment, chez Mansfield et Woolf plus particulièrement, ils ne font souvent que dire le vide, ou la ruine. Ainsi les textes des deux écrivaines deviennent-ils à leur tour des tombeaux au sens musical du terme, un tombeau dont les objets eux-mêmes deviennent la mémoire.
« Object and subject, and the nature of reality »3
C’est au début du XIXe siècle que la philosophie entérine une définition de l’objet dont l’évolution commence avec Descartes au XVIIe siècle : est alors théorisé un sens technique du mot objet qui, d’une part, met en avant sa matérialité, et d’autre part, l’inscrit dans un rapport d’interdépendance avec le sujet. L’objet, contrairement à la chose, n’existe que pour une conscience, pour un sujet devant lequel il est placé (comme le rappelle l’étymologie du mot : objectum, littéralement « ce qui est placé devant ») et, dans un mouvement réciproque, le sujet n’existe que par rapport à un objet. Il se structure par rapport à lui et sa conscience est toujours conscience de. Si la phénoménologie du siècle suivant interroge avec Maurice Merleau-Ponty ce système d’interdépendance, la littérature du XIXe siècle, inscrite dans une société de plus en plus matérielle, voire matérialiste, s’empare des objets dans leur relation au sujet comme symptomatique aussi d’un rapport au monde et à la société :4
Notre littérature a mis très longtemps à découvrir l’objet : il faut attendre Balzac pour que le roman ne soit plus l’espace de purs rapports humains, mais aussi de matières et d’usages appelés à jouer leur partie dans l’histoire des passions : Grandet eût-il été avare (littéralement parlant), sans ses bouts de chandelles, ses morceaux de sucre et son crucifix d’or ? (Barthes « Les planches » 89)
C’est ainsi que la littérature de cette période accorde à l’objet une fonction multiple – descriptive, ontologique, narrative – qui parfois met à l’épreuve sa matérialité susceptible de s’effacer sous la charge symbolique. C’est au sein de ce mouvement constant que nous devons réévaluer l’équilibre entre l’objet matériel, sa référence au sujet et son ancrage dans les textes modernistes où l’utilisation du courant de conscience rend cet équilibre plus problématique.5
À partir des années 1910, le mouvement moderniste britannique s’efforce en effet de poser la rupture avec ce qu’elle considère comme une culture et une société traditionnalistes désormais obsolètes, mais éprouve, face au monde « moderne » et la production de masse des biens matériels (par rapport à l’objet artisanal ou l’œuvre d’art) des sentiments très ambivalents comme le rappelle Douglas Mao dans Solid Objects : l’œuvre d’art est l’objet privilégié, ce qui accentue encore le fossé entre les intellectuels et la culture de masse de la période (Mao 18)6. Son étude de la nouvelle de Woolf de 1920 à laquelle il emprunte le titre, « Solid Objects », montre comment le personnage principal à partir d’un morceau de verre trouvé sur la plage, devient un collectionneur obsessionnel de fragments de toute sorte (verre, porcelaine, fer). Woolf, par l’ironie de son narrateur, privilégie la présence sensorielle de ces « détritus » qui n’ont plus de fonction utile mais ne se chargent pas non plus d’une signification existentielle. Le narrateur n’entérine jamais le sens que le personnage de John confère aux objets qui peu à peu perdent la solidité trompeuse du titre de la nouvelle (Lepaludier 186). Le personnage se structure dans sa relation illusoire aux objets à qui il reste leur matérialité et leur fonction poétique : « La voix narrative donne la juste perspective qui conforte la relation quasi physique à l’objet et décourage l’investissement imaginaire. Ainsi, l’écriture woolfienne fait de l’objet dérisoire un repère psychologique, éthique et esthétique » (Lepaludier 186).
La résistance de l’objet, « qui s’entête à exister un peu contre l’homme » (Barthes 1994 66)7 et ce désinvestissement du subjectif n’apparaît pas sur le mode d’un paisible dévoilement, pas plus que chez Woolf que chez ses contemporains ; le désinvestissement des objets par le sujet s’éprouve plutôt sur le mode de la crise existentielle : « If Woolf’s fictions bring out with peculiar clarity the stakes of the modernist encounter with the object, they do so in part because they include an especially naked exploration of what has to be called existential crises » (Mao 17). Le rapport à l’objet ét à sa matérialité s’écrit en miroir de ces crises existentielles.
Dans The House in Paris, le roman de 1935 d’Elizabeth Bowen, Karen Michaelis s’interroge sur ce monde « quand je ne suis pas là » : « To look round [a strange house] is like being, still conscious, dead: you see a world without yourself… » (77). Dans The Years, le dernier roman de Woolf publié de son vivant en 1937, l’un des personnages, Martin, pose cette même question existentielle : « What would the world be […] without “I” in it? » (185). Cette question sur le divorce entre l’objet et le sujet occupe une place centrale dans l’œuvre de Woolf dès 1927 et la parution de To the Lighthouse. En effet, redonner à l’objet un statut de chose, existant en soi, en dehors de toute conscience est ce à quoi se consacre Mr Ramsay, double du père de Woolf, le philosophe Leslie Stevens, héritier de l’épistémologie réaliste de David Hume.8 Lorsque Woolf s’attaque à la célèbre partie centrale du roman – « Time Passes » – elle écrit dans son journal à la date du 30 avril 1926 : « here is the most difficult abstract piece of writing–I have to give an empty house, no people’s characters, the passage of time, all eyeless and featureless with nothing to cling to […] » (Woolf Diary 118). Woolf cherche alors une réponse poétique et esthétique à cette question existentielle du rapport entre sujet et objet dans un roman semi-autobiographique dont l’écriture elle-même s’inscrit dans un processus de remémoration. Si dans son journal elle évoque une maison vide, abandonnée par la famille Ramsay, c’est pourtant paradoxalement dans ces quelques pages que les objets abandonnés sont les plus présents, les plus visibles et que leur matérialité est mise en avant. Contrairement aux première et troisième parties aux multiples focalisations, un narrateur omniscient, une instance abstraite,9 semble prendre le relais et partager une réalité objective. Celle-ci est toutefois immédiatement connotée par l’esthétique de la ruine que nous considérons ici à la fois dans le sens traditionnel de débris d’un édifice et dans celui que lui accorde Pablo Cuertas : « Si la ruine se définit comme une totalité soudain inexistante, on pourrait considérer certains objets du quotidien comme étant les vestiges d’un temps qui n’existe plus. […] Ils seraient […] une complétude en soi-même renvoyant, non pas à un espace, mais à un temps perdu » (Cuertas 36). La maison des Ramsay menace ruine dans To the Lighthouse et les objets du quotidien sont rendus à une matérialité brute, amputés de leur fonctionnalité ce qui rappelle les détritus de « Solid Objects » :
So with the house empty and the doors locked and the mattresses rolled round, those stray airs, advanced guards of great armies, blustered in, brushed bare boards, nibbled and fanned, met nothing in bedroom or drawing-room that wholly resisted them but only hangings that flapped, wood that creaked, the bare legs of tables, saucepans and china already furred, tarnished, cracked. What people had shed and left—a pair of shoes, a shooting cap, some faded skirt and coats in wardrobes—those alone kept the human shape and in emptiness indicated how once they were filled and animated; how once10 the looking-glass had held a face; had held a world hollowed out in which a figure turned, a hand flashed, the door opened. […]
So loveliness reigned and stillness, and together made the shape of loveliness itself, a form from which life had departed […]. (105-06)
Ce qui frappe dans ce passage est l’accumulation des objets dans l’espace diégétique comme dans l’espace textuel. Si toute présence humaine est évacuée et l’instance narrative « abstraite », les objets sont bien, à l’intérieur d’une maison où semble déjà enclenché un processus de ruine, la trace de l’existence de la famille Ramsay. Ils deviennent les résidus de l’histoire des personnages ou leur « fortune » pour utiliser les mots de Georges Perec dans Espèces d’espace : « Le temps qui passe (mon Histoire) dépose des résidus qui s’empilent : des photos, des dessins, des corps de stylo-feutre […], des livres, de la poussière et des bibelots : c’est ce que j’appelle ma fortune » (Perec 37). Au présent des objets se superpose le passé des personnages (inscrit dans le plus-que-parfait et la réitération de « how once ») dans un mouvement paradoxal où les objets disent à la fois la présence et l’absence des personnages. Malgré la saturation des signes dans le passage, c’est une esthétique du creux qui s’installe. La place des vêtements est particulièrement importante puisqu’ils évoquent ou convoquent l’empreinte des corps qui les ont depuis longtemps abandonnés et qui ne sont plus présents que par une trace fantomatique sur la surface d’un miroir. La maison n’est pas seulement abandonnée, elle a été évidée (« hollowed out ») et ce symbole archétypal féminin est plus loin décrit comme un coquillage vide, bientôt rempli de sable, pareille à un cénotaphe qui n’abriterait pas le corps de la mère, Mrs Ramsay, dont la mort hante toute la deuxième et la troisième parties du roman. Ces objets-reliques ne se prêtent toutefois pas à un processus mémoriel en raison de l’absence des voix subjectives que l’on trouve dans le reste du roman (ce processus sera réactivé dans la troisième partie lors de la traversée, enfin accomplie, vers le phare).
On voit combien la maison, ici comme dans la littérature en général, occupe une fonction primordiale dans la remémoration ; les souvenirs qui y sont attachés viennent remplir le vide créé par le temps et d’une certaine façon remplacer les êtres qui y ont vécu, notamment par un processus métonymique. Lorsque Woolf décrit dans To the Lighthouse une maison devenue coquille vide bientôt remplie par des grains de sel (« left like a shell on a sand-hill to fill with dry salt-grains now that life had left it » [112]), elle évoque un moment charnière où une maison est rendue à sa matérialité mais pas encore tout à fait désinvestie d’une charge existentielle. C’est également ce moment intermédiaire que Katherine Mansfield évoque quelques années plus tôt, dans « Prelude » (1918), récit lui aussi semi-autobiographique. La famille Burnell déménage et la fille aînée, double de Mansfield, fait un dernier tour dans la maison vidée de ses meubles et de ses habitants dont il ne reste que quelques traces : « in her father’s and mother’s room she found a pill box black and shiny outside and red in, holding a blob of cotton wool » (14) ; « In the servant girl’s room there was a stray-button stuck in a crack of the floor, and in another crack some beads and a long needle » (14-15). Les fissures du plancher évoquent ici irrésistiblement le passage du temps et le travail de la mémoire, et la façon dont celle-ci s’entrebâille pour que s’y logent les souvenirs qui attendent de pouvoir remonter à la surface de la conscience des personnages comme à celle du texte.
Le pouvoir mémoriel des objets : The Years (1937) de Virginia Woolf
Roman souvent négligé par la critique et auquel on reproche une écriture plus classique, loin du caractère expérimental de The Waves (1931) ou de Between the Acts (le roman posthume de 1941), The Years naît pourtant d’un projet mêlant essais et passages de fiction. Il s’agissait pour Woolf de s’attaquer aux fondements d’une société patriarcale pour promouvoir l’éducation et l’emploi des femmes (après avoir défendu les artistes femmes dans A Room of One’sOwn de 1929). Woolf décide finalement de séparer les essais (publiés sous le titre Three Guineas) et l’histoire des Pargiter11 qui sera publiée sous le titre The Years. Le roman retrace les bouleversements sociaux de la Grande-Bretagne mais, loin du mode épique, Woolf choisit plutôt la chronique et se concentre sur la vie intime des personnages.12 Cette vision de l’histoire s’inscrit dans la crise épistémologique que connaît l’Europe occidentale et que l’on retrouve également dans le mouvement contemporain de l’École des Annales fondée par Marc Bloch et Lucien Febvre. Ce courant s’attache à intégrer les autres sciences humaines13 dans l’historiographie et à utiliser, au-delà des sources écrites, le quotidien et ses objets notamment pour incarner l’histoire et interroger le passé. Le traumatisme de la Première Guerre mondiale illustre à quel point on ne peut plus écrire l’histoire sous le signe du progrès et de la continuité.
Cette révolution épistémologique, fondatrice de la littérature moderniste, est particulièrement perceptible dans The Years : le roman de Woolf retrace la vie de la famille Pargiter sur plus de cinquante années qui bouleversent la société européenne et, comme son titre l’annonce, il travaille la question de la mémoire et du temps. La structure même du texte exhibe ces deux fils conducteurs : le titre de chaque chapitre est une année de la vie de la famille Pargiter, depuis le premier « 1880 » jusqu’au dernier « Present Day », et mêle mémoire collective et mémoire individuelle, ainsi que les deux temporalités qui y sont associées.
Dans le roman, la mémoire vient s’incarner dans les objets qui sont réinvestis par le subjectif dans la conscience des personnages et qui ? occupent des fonctions narratives et symboliques extrêmement fortes :
Eleanor was sitting at her14 writing-table with her pen in her hand. It’ss awfully queer, she thought, touching the ink-corroded patch of bristle on the back of Martin’s walrus with the point of her pen, that that should have gone on all these years. That solid object might survive them all. If she threw it away it would still exist some way or other. But she had never thrown it away because it was part of other things—her mother for example. (Woolf 1937 71)
Le processus mémoriel est déclenché par une intentionnalité qui réinvestit l’objet de son lien avec le sujet. Ce qui survit, c’est – pour l’instant du moins – tout autant l’objet que le souvenir de la mère. Le « morse » est en effet un essuie-plume offert par l’un des enfants, Martin, à sa mère et l’objet revient à plusieurs reprises, doté à chaque fois d’une charge mémorielle différente. La première référence à l’objet survient ainsi dans le premier chapitre (« 1880 ») lorsqu’Eleanor, songeant à sa mère mourante, s’approprie déjà son bureau : «It’ll be my table now, she thought, looking at the silver candlestick, […] and the spotted walrus with a brush in its back that Martin had given his mother on her last birthday» (28-29). Lors de la deuxième occurrence que nous venons de citer, Eleanor, en s’interrogeant sur le destin des objets « solides », se situe à une étape intermédiaire dans l’investissement mémoriel des objets. Si le bureau de sa mère est bien devenu le sien, le morse (qui est toujours désigné comme « le morse de Martin ») garde une charge affective modérée alors que la mère n’est qu’un exemple parmi d’autres des choses auxquelles l’objet est associé. Celui-ci prend la place de la mère, reléguée au rang de chose, la matérialité de l’objet remplaçant la mère (corps et sujet). La fonction symbolique même de l’objet, chargé de faire disparaître l’encre de la plume, prend une dimension encore plus forte dans la disparition diégétique et narrative du personnage. Un peu plus loin, au chapitre intitulé « 1908 », l’essuie-plume, objet solide, disparaît à son tour un instant de l’espace diégétique et n’est plus qu’un souvenir entièrement désinvesti cette fois de l’identité maternelle : « She glanced […] at her writing-table. The walrus, with a worn patch in its bristles, no longer stood there» (120). L’objet devient signifiant par son absence et, de façon implicite – par un écho ironique au passage precedent –, cette absence dit la rupture entre sa charge mémorielle associée à la mère et cette dernière. On peut imaginer qu’Eleanor a fini par le jeter pour en évacuer tout résidu symbolique.
C’est par une même ironie qu’est confirmée la certitude d’Eleanor que les objets nous survivent et continuent à exister quelque part, quelques chapitres – et années – plus tard, en 1913. Alors que le père est mort et la maison vendue, la vieille servante Crosby doit quitter la maison et la famille qu’elle a servie pendant quarante-cinq ans. Elle emporte avec elle certains objets dont le morse de Martin, qui continue bien d’exister : « the walrus she found in the waste-basket one morning, when the guns were firing for the old Queen’s funeral » (168). Le personnage croit se rappeler que le sauvetage de l’objet coïncide avec les funérailles de la « vieille reine » ; or, entre 1908 et 1913, nulle reine ne décède et la mémoire de Crosby lui fait défaut. Soit elle confond avec la mort d’Edward VII en 1910, soit la mise au rebut de cet objet ayant appartenu à la mère crée en elle un rapprochement symbolique avec la mort de la reine Victoria en 1903 (l’analogie se fait entre deux femmes recluses et retirées de la vie publique, mêlant histoire collective et histoire personnelle). Il est ainsi tentant de voir dans l’image de l’essuie-plume une nouvelle mise à mort, symbolique cette fois, de la mère tout autant que de la société victorienne, puis la réactivation de la valeur mémorielle de l’objet grâce à la servante.
Crosby semble en effet la gardienne de la mémoire familiale ancrée dans une réalité objectale. Au fil des années, elle récupère – y compris à partir de rebuts – des objets qui ont appartenu aux Pargiter et, à la retraite, les installe dans la petite chambre qui est désormais la sienne, loin de la famille et d’Abercorn Terrace où elle a vécu pendant quarante-cinq ans :
Her room was at the top and at the back, overlooking the garden. […] It had a look of Abercorn Terrace. Indeed for many years she had been hoarding odds and ends with a view to her retirement. Indian elephants, silver vases, the walrus she found in the waste-basket one morning […] She ranged them all askew on the mantlepiece, and she had hung the portraits of the family—some in wedding dresses, some in wigs and gowns, and Mr Martin in his uniform in the middle because he was his favourite—it was quite like home. (168)
Crosby constitue ici une collection disparate (« odds and ends ») qui redéfinit la valeur sémantique que chaque objet possède séparément.15 Si la relation symbolique entre l’objet et son signifié est toujours sous le signe du déplacement (Barthes « Sémantique de l’objet » 70), la collection redouble ce déplacement pour créer un nouveau système signifiant, ce qui est aussi le propre du musée. Le musée est ici organisé, mis en scène, à la mémoire de la famille Pargiter et la juxtaposition des objets n’a pas de sens en dehors de cette volonté mémorielle. Il n’est pas étonnant que la nouvelle chambre de Crosby se trouve à l’arrière (sinon en arrière) et tout en haut, près du grenier, siège symbolique de la mémoire dans une maison que Gaston Bachelard décrit comme un être vertical.16 Ce musée assume des connotations quasi mystiques où la cheminée fait office d’autel et s’opère alors un nouveau jeu de déplacement lié à l’appropriation. Lorsque Crosby récupère des objets et s’approprie les photographies de la famille, elle les réinvestit d’un nouveau récit et tente de superposer à son nouvel environnement le souvenir ou le double mémoriel de la « maison », vendue par les enfants Pargiter à la mort de leur père : « it was quite like home ». Le terme « askew » est en ce sens très signifiant : l’espace personnel de Crosby semble trop étroit pour les souvenirs des Pargiter alors disposés de travers et ajoutant ainsi au pathos de la situation (elle a emmené avec elle le chien de la maison qui dépérit aussitôt et meurt) qui n’est pas sans rappeler le conte de Gustave Flaubert « Un cœur simple » et sa fétichisation des objets ayant appartenu à la famille que Félicité a servie toute sa vie. Elle fait ainsi du perroquet Loulou qu’elle fait empailler un objet fétiche en qui elle voit l’incarnation du Saint Esprit. Dans The Years, la collection vient à la fois remplir un vide dans la vie du personnage et accentuer pour le lecteur ce même vide d’une vie passée à servir une famille dont elle ne récolte que les débris (Eleanor n’éprouve qu’un instant de remords en songeant aux quarante-cinq années passées par Crosby dans un sous-sol obscur).
Le morse revient une dernière fois à la toute fin du roman lors d’une ultime réunion de famille. Eleanor est soudain envahie par un sentiment de bonheur alors que la sensation de ses mains resserrées autour de pièces de monnaie en convoque une autre : « Was it because this had survived—this keen sensation (she was waking up) and the other thing, the solid object—she saw an ink-corroded walrus—had vanished? She opened her eyes wide. Here she was ; alive ; in this room, with living people » (325). Le refus de la nostalgie victorienne pour le passé et de la nostalgie victorienne (qu’incarne au contraire sa cousine Maggie) se trouve symbolisé pour Eleanor, qui prend le parti de la modernité, par la mort de l’objet corrodé (« ink-corroded ») et la prééminence de la sensation et du moment présent.17 La fonction première – technique – de cet essuie-plume incongru en forme de morse se trouve ici doublée d’une valeur autoréflexive. Outil de l’écrivain, il est chargé de débarrasser la plume de son excédent d’encre et vient ainsi incarner le travail même de la littérature, ce qui reste une fois le texte, comme l’objet, désinvesti d’un excédent mémoriel. (Katherine) Mansfield partage elle aussi cette ironie et cette distance par rapport au surinvestissement des objets par l’imaginaire, une distance qui serait une des réponses possibles à la crise épistémologique et aux recherches esthétiques de la période de l’entre-deux-guerres.
Objets et rites funéraires : entre surinvestissement et perte de sens
La nouvelle de (Katherine) Mansfield, « The Daughters of the Late Colonel », est exemplaire à plus d’un titre et illustre à la fois la ritualisation de la mort par les objets – fonction récurrente dans la littérature18– mais également la résistance des objets dans ce processus de rite funéraire. Publié tout d’abord dans le London Mercury en 1921 puis au sein du recueil The Garden Party and Other Stories de 1922, le récit s’articule autour du deuil du père et de sa ritualisation, mise en scène autour des objets qui assurent une fonction mnémonique à la fois narrative et symbolique.
Les deux sœurs du titre, Constantia et Josephine, ne parviennent pas à échapper à la tyrannie de leur père, même après son décès. Elles se trouvent enfermées dans une circularité que l’on retrouve également dans la structure narrative de la nouvelle composée de douze sections qui renvoient elles-mêmes au cadran de la montre du père, objet à la forte charge mémorielle. Cette montre joue en effet le rôle de déclencheur de la mémoire lorsqu’elles se demandent à qui la léguer et songent d’abord à leur frère (à la fin de la section VI) avant que le début de la section VII n’ouvre une nouvelle séquence narrative analeptique : « Josephine made no reply. She had flown on one of her tangents.19 She had suddenly thought of Cyril. Wasn’t it more usual for the grandson to have the watch? » (274). Suit alors le souvenir d’une visite de Cyril à ses tantes et à son grand-père, souvenir qui occupe tout le passage avant que la section suivante ne revienne au présent de l’histoire et de la mort du père. Nous avons ici un exemple classique de remémoration et d’ouverture de fenêtre narrative provoquées par un objet, mais l’image de la « tangente » offre une métaphore géométrique particulièrement intéressante d’un point de vue narratif : elle évoque le point de contact entre le récit et le souvenir, contact qui fait alors événement dans le récit : le point – le souvenir provoqué par l’objet – où la droite vient toucher (l’étymologie de tangere en latin) la courbe du récit dont on va vu la circularité structurelle. Il est tentant de filer la métaphore géométrique : le contact du souvenir vient à peine ébranler le récit (la section se referme avec la décision d’envoyer la montre à Cyril) et le retour au présent confirmera la fuite des deux sœurs qui ne peuvent se décider à agir et se réfugient dans l’évitement.
En effet, dans la section VI, au centre du récit, les deux sœurs entrent à contrecœur dans la chambre du colonel pour mettre de l’ordre dans ses affaires, une semaine après ses funérailles. La pièce est décrite comme une chambre funéraire où le familier et le quotidien sont détournés de leur fonction pour obéir à des traditions ancestrales. Toutes les ouvertures, par lesquelles l’âme du mort pourraient s’échapper puis revenir hanter les vivants, sont obstruées. Les stores sont baissés pour empêcher la lumière de pénétrer et les miroirs recouverts afin que nulle vie ne s’y reflète et que l’âme du mort ne puisse quitter son enveloppe corporelle pour s’y réfugier : « It was the coldness which made it awful. Or the whiteness–which? Everything was covered. The blinds were down, a cloth hung over the mirror, a sheet hid the bed; a huge fan of white paper filled the fire-place » (270). La cheminée, associée au feu et à la vie, doit rester éteinte et dissimulée : symbole du passage vers un monde surnaturel dans de nombreuses croyances populaires, elle relie en effet le monde des vivants et des morts et l’on doit empêcher le retour du défunt. Les deux sœurs, Constantia et Josephine, se livrent ainsi à un rituel tout aussi social que personnel ou affectif, et la blancheur, symbole de deuil, qui effraie tant Constantia, rappelle la chapelle blanche de la tradition celtique : dressée dans la maison du défunt, elle formait une alcôve où l’on déposait le corps, sorte d’anti-chambre vers l’au-delà.20
Alors que ce rituel est accompli, que le corps du père repose déjà dans un cimetière, les deux sœurs ne peuvent toutefois empêcher la réapparition spectrale de ce corps dans la matérialité des objets qui lui ont appartenu. Si le rituel vise à vider la chambre et certains de ses objets à la fois de leur fonctionnalité (là où le père dormait), et de leur portée symbolique (la pièce où il était interdit d’entrer le matin et qui incarne la présence vivante du père), les vêtements du colonel résistent et sont réinvestis par un nouveau récit, non celui du souvenir d’un père mort mais celui de la présence d’un père toujours vivant :
How could Josephine explain that father was in the chest of drawers? He was in the top drawer with his handkerchiefs and neckties, or in the next with his shirts and pyjamas, or in the lowest of all with his suits. He was watching there, hidden away–just behind the door-handle–ready to spring. (271)
Nulle compensation, nulle consolation (Turgeon 2007) dans cet investissement des objets par la mémoire : les vêtements du père, encore habités par lui, répliquent et fragmentent un corps tout à la fois dessiné en creux et pourvu du don d’ubiquité. Tapi dans chaque tiroir de la commode, il semble prêt à bondir sur ses filles pour exercer à nouveau sa tyrannie. C’est d’ailleurs tout le sens de la nouvelle : l’impossibilité, non de surmonter le deuil, mais d’enterrer réellement le père une fois pour toutes. Pour Josephine, le père est toujours inscrit dans le présent et le futur : « What would father say when he found out ? For he was bound to find out sooner or later. He always did. “Buried. You two girls had me buried” » (268-69). C’est cette même superposition des temps qui s’exprime dans le titre (« The Late Colonel’s Daughters ») qui enferme les deux vieilles filles dans une relation syntaxique et symbolique au père et dont elles ne pourront se défaire : « Father will never forgive us for this–never! » (269). Le surinvestissement symbolique des vêtements du père par l’imagination fait de la commode et de l’armoire des cercueils de substitution, et les mouchoirs, chemises et costumes, par leur pouvoir métonymique, deviennent à la fois des reliques et des fétiches auxquels elles attribuent des propriétés surnaturelles malfaisantes.
Toutefois, face à cet excès d’objets qui réactivent la présence du père, le texte évoque une présence fantomatique à peine visible dont le souvenir ne trouve un ancrage matériel dans aucun objet, si ce n’est une photographie. La fin de la nouvelle évoque ainsi la figure de la mère, morte trente-cinq plus tôt, et à peine visible sur une photographie surplombant le piano : « so little remained of mother, except the ear-rings shaped like tiny pagodas and a black feather boa. Why did the photograph of dead people always fade so? wondered Josephine. As soon as a person was dead their photograph died too » (282-83). Si la photographie est bien là pour dire, pour reprendre les mots de Barthes dans La chambre claire, « ça a été » (Barthes 180), elle fait du sujet un objet quasi irréel et l’illusion de l’immortalité offerte par la photographie se heurte à la matérialité d’un support fragile. Lorsque Constantia regarde la photographie de leur mère (que l’on peut estimer datant des années 1880), elle superpose des morts symboliques et réelles : dès la prise de la photographie, cette femme n’est déjà plus celle qui continue de vivre « à côté », « On dirait que la photographie emporte toujours son référent avec elle, tous deux frappés de la même immobilité amoureuse ou funèbre, au sein d’un monde en mouvement » (Barthes La Chambre claire 17). Lorsque la mort survient, elle redouble la force du « ça a été » qui contamine l’objet même, la feuille de papier, sur lequel s’efface non seulement le sujet mais l’objet qui y est représenté, repris dans le « mouvement du monde » auquel la photographie semblait échapper. La présence de la mère est effacée : seuls les boucles d’oreille et le boa – ou leur impression sur le papier – semblent encadrer un visage depuis longtemps disparu et que seule la mémoire de Constancia peut reconstituer.21 Le contraste est saisissant entre ces impressions d’objets à peine visibles et les vêtements du père, un corps maternel fantomatique et un corps paternel menaçant. La photographie atteste difficilement de la réalité de la mère et elle convoque moins le souvenir de celle-ci (« ça a été ») que le regret de ce qui n’a pas été, de ce qui aurait pu être si elle avait vécu plus longtemps (« If mother had lived, might they have married ? » [283]). Le pouvoir du conditionnel hypothétique échoue toutefois à remplir le vide. Dans la nouvelle, les objets sont investis d’une multiplicité de valeurs dans leur lien avec le processus mémoriel – ontologique, narratif et symbolique – mais qui contribuent toutes à dire le vide et l’absence. Le texte se termine par un constat d’impuissance et d’immobilité alors que Josephine murmure, les yeux fixés sur un nuage qui a pris la place du soleil : « I’ve forgotten too » (285). Pareils au cadran de la montre, à la structure de la nouvelle, la mémoire et la vie des deux sœurs semblent tourner à vide, les enfermer dans un espace et un temps immobiles.
Les sœurs de la nouvelle de (Katherine) Mansfield, comme la vieille servante de The Years, attribuent aux objets une valeur qui en fait des fétiches investis d’une relation obsessionnelle du sujet à l’objet. Dans « The Escape », nouvelle de Mansfield publiée dans Bliss en 1920, le personnage féminin est enfermé dans une relation régressive aux objets où le désir de l’objet conduit à l’aliénation : « “My parasol. It’s gone. The parasol that belonged to my mother. The parasol that I prized more than–more than…” She was simply beside herself» (200). Souvenir de la mère disparue, l’ombrelle se trouve investie d’une signification mémorielle qui disparaît dans la syntaxe brisée de la phrase : la conscience du personnage est dé-placée vers l’objet qu’elle investit, « hors d’elle-même » et vidée de sa substance. La vacuité du personnage est également symbolisée par les objets qu’elle transporte dans son sac et dont elle fait un prolongement d’elle-même. Plus son sac se remplit, plus le personnage se vide de tout contenu, de toute épaisseur ontologique : « [Her husband] could see her powder-puff, her rouge-stick, a bundle of letters, a phial of tiny black pills like seeds, a broken cigarette, a mirror, white ivory tablets with lists on them that had been heavily scored through. He thought: “In Egypt she would be buried with these things” » (198).
La collection d’objets que constitue le personnage devient pour son mari comme une commémoration anticipée, et sont déjà des « souvenirs ». Reflétée syntaxiquement par la longue énumération au sein de la phrase, la collection met en relief la mort symbolique de la femme, déjà enterrée, ensevelie sous le poids d’objets qui n’ont eux-mêmes plus d’autre fonctionnalité ou de fonction que de dire cette mort ritualisée.
Texte mémoire et mémoire du texte
(Katherine) Mansfield et (Virginia) Woolf sont toutes deux des écrivaines de la mémoire et l’on peut considérer que « Prelude » et « At the Bay » pour la première et To the Lighthouse pour la seconde sont des textes tombeaux. Si le terme tombeau désigne à partir du XVIIème siècle « une pièce funèbre instrumentale destinée à saluer la mémoire d’un personnage, généralement important » (Mussat 133), il apparaît toutefois au siècle précédent pour désigner un texte, un recueil de vers à la mémoire d’un personnage illustre. Le genre musical renaît au XXe (avec Debussy et son hommage à Rameau, Ravel et son Tombeau de Couperin) et l’analogie que nous pouvons voir avec les œuvres de Woolf et de Mansfield repose sur cette note répétitive symbolisant la mort que l’on retrouve dans les pièces musicales et qui, chez les deux auteurs, peutêtre représentée par des objets-leitmotivs qui assurent à la fois une fonction narrative et structurelle, et une fonction symbolique. Dans The Years, l’essuie-plume offert par Martin à sa mère est un objet trivial qui assure pourtant une fonction mémorielle et vient ponctuer le texte à des moments essentiels (la mort de la mère, l’abandon de la maison, la fin du roman). Comme nous avons pu le voir, l’objet assume une charge symbolique très forte fondée notamment sur la perception22 mais constitue également la mémoire du texte. Un autre objet revient ponctuer le texte : une bouilloire démodée dont le dessin de roses s’efface peu à peu (« almost obliterated » [10] ; « faintly engraved with a design of roses » [117]). Martin a toujours détesté ce symbole d’une époque victorienne révolue, d’une époque où sa mère n’en finissait pas de mourir et qu’il cristallise sur l’objet (« It’s time Miss Eleanor got a new kettle » [117]). La bouilloire revient dans la mémoire de sa sœur Rose deux ans plus tard, mais sous forme de résidu mémoriel : « a detail that she had not thought of for years came back to her–how Milly used to take her hairpin and fray the wick of the kettle » (128). La présence matérielle de la bouilloire a disparu, elle n’est plus qu’une mèche effilochée mais a constitué un système d’échos dans le texte et en devient la mémoire – un souvenir réactivé par le lecteur.
Le lecteur de (Katherine) Mansfield est lui aussi sollicité lorsque les nouvelles tissent entre elles un réseau d’images qui constituent la mémoire de son œuvre :
A piece of loose iron banged forlornly. (« Prelude » 15)
It is only the wind […] banging a piece of iron on the roof. (« The Wind Blows » 106)
The wind rattled the window frame; a piece of iron banged. (« Revelations » 195)
Ce morceau de fer agité par le vent que l’on ne fait qu’entendre, fait naître un écho, vaguement inquiétant, dans l’œuvre de Mansfield qu’il semble parcourir depuis le souvenir d’enfance attaché à la Nouvelle-Zélande et que Mansfield fait revivre dans « Prelude ». C’est également un écho textuel et sonore que l’on entend dans Mrs Dalloway (1925) où Big Ben vient sonner les heures tout au long du texte : « Out it boomed. First a warning, musical; then the hour, irrevocable. The leaden circles dissolved in the air » (4). L’image de la cloche emblématique de Londres – au son si particulier dû à une fêlure à sa surface – est concentrée dans la perception sonore qu’en ont les personnages et joue un rôle symbolique multiple : quand elle résonne, les verbes utilisés (« boom » et « strike ») renvoient au fracas de la guerre achevée quelques années plus tôt mais rappellent aussi l’avancée irrévocable du temps et font des cercles de plomb un memento mori. Image synesthésique, les cercles de plomb qui se dissolvent dans l’air tracent également des cercles dans le texte où ils ne cessent de résonner pour rappeler la fuite du temps :
Big Ben striking the half-hour. (The leaden circles dissolved in the air.) (41)
Twelve o’clock struck […] (The leaden circles dissolved in the air.) (80)
Big Ben was beginning to strike, first the warning, musical; then the hour irrevocable. (99)
Les parenthèses inscrivent graphiquement sur la surface du texte les ondes sonores qui se propagent dans l’air, excepté à la dernière occurrence, ou résonnance, qui revient au point de départ, referme les cercles comme les parenthèses, et ne fait plus entendre les cercles de plomb, cette fois à jamais dissous dans l’air alors que la journée unique du roman touche irrévocablement à sa fin, tout comme la vie de Clarissa Dalloway.
Conclusion
Le questionnement moderniste sur la fonction esthétique et narrative des objets se situe à un moment charnière du XXe siècle. Au-delà de la simple polarité entre une authentique subjectivité et un réalisme objectif faux ou artificiel (Finn 107), le modernisme ne cesse de construire une esthétique de l’objet dans une interrogation permanente qui, comme nous l’avons vu chez Mansfield et chez Woolf, s’accompagne souvent d’un regard ironique où la sensation l’emporte sur l’investissement imaginaire. Le lien entre objets et mémoire offre peut-être cependant une forme de réponse à la question de la relation entre subjectif et objectif : la matérialité de l’objet – bien plus que sa fonction référentielle – devient le support de la mémoire. Parce que les textes que nous avons choisis ici sont des textes de l’entre-deux-guerres, la question de la mémoire ne peut être indépendante de celle du deuil et du traumatisme de la guerre. Toutefois, ce travail de la mémoire scelle aussi l’avènement d’un monde nouveau et l’adieu à une Grande-Bretagne victorienne.
Une dernière image emblématique de la place de l’objet et de sa fonction mémorielle serait ici celle du châle de Mrs Ramsay qui recouvre et cache le crâne de sanglier dans To the Lighthouse : le temps défait peu à peu le châle dans cette vanité qui s’anime et révèle l’objet dans toute sa matérialité. Le crâne, qui n’a jamais cessé d’être là, tapi sous l’étoffe, ressurgit pour dire la force du réel ; c’est d’ailleurs ce réel qui ironiquement rattrape ce même objet dont la valeur symbolique est annulée par sa matérialité : comme tous les autres objets, le crâne, moisi, commence à disparaître (112).
Symboles, reliques, fétiches, objets d’art : les objets participent à une écriture mémorielle qui, au moment de l’industrialisation de l’objet dans la société, ne cesse d’en réaffirmer à la fois la matérialité et la singularité. Investis d’un nouveau récit, ce sont eux qui incarnent ce travail de la mémoire dont l’ultime réceptacle est le livre que le lecteur tient entre ses mains et dont il doit déplier les plis pour que ce récit puisse se faire entendre.23
Notes
- 1Plus encore qu’au sens freudien de partie « phallicisée » du corps de la mère et par là même, de la femme (voir Martin-Mattera, Lévy et Saïet, 2014), le terme « fétiche » est utilisé ici au sens sociologique ou ethnographique, d’objet investi d’un pouvoir magique ou surnaturel.
- 2« En un mot, la fracture du monde est impossible : il suffit d’un regard – le nôtre – pour que le monde soit éternellement plein » (Barthes « Les planches » 105, au sujet du théâtre de Ionesco).
- 3Woolf To the Lighthouse, 22.
- 4En 2020, Marta Caraion publie Comment la littérature pense les objets - Théorie littéraire de la culture matérielle : l’ouvrage, consacré à la littérature française du XIXème siècle, explore ce sujet via différents champs – sociologique, ontologique, littéraire – et montre combien la question de la matérialité de l’objet occupe une place centrale.
- 5La tension entre objectivité et subjectivité s’exprime de façon similaire chez Virginia Woolf et Katherine Mansfield dans leur rejet du réalisme, comme le montre leur critique respective du roman de Dorothy Richardson, The Tunnel (1919) : si, comme le rappelle Howard Finn dans « Dorothy Richardson and the Nouveau Roman », elles admirent la façon dont Richardson reproduit l’impression d’une réalité objective sur une conscience subjective, Woolf lui reproche de rester à la surface de cette réalité et Mansfield de donner la même importance signifiante à tous les détails de cette réalité objective et donc de leur enlever par là toute importance (Finn 119-20). Ce que soulignent les deux écrivaines, c’est ainsi le manque d’esthétique formelle.
- 6Mao reprend le fil de sa réflexion sur objet et objet d’art dans « Objectionable Objects » (Modernist Objects 2020) pour conclure que la valeur des objets tient toujours dans la relation qu’ils entretiennent entre eux et avec les êtres.
- 7Barthes évoque ainsi « les connotations existentielles de l’objet » : « L’objet prend à nos yeux l’apparence ou l’existence d’une chose qui est inhumaine et qui s’entête à exister, un peu contre l’homme ». À cette première catégorie de connotations il ajoute les connotations « technologiques » : « L’objet se définit alors comme ce qui est fabriqué ; c’est de la matière finie, standardisée, formée et normalisée » (66).
- 8Interrogé sur les travaux de son père par la peintre Lily Briscoe, Andrew répond : « Subject and object and the nature of reality […]. Think of a kitchen table when you’re not there » (22).
- 9Jean Alexander dans The Venture of Form in the Novels of Virginia Woolf, fait écho aux mots de Woolf et évoque un esprit abstrait (« an abstract mind ») pour décrire la voix ou la présence qui témoigne de cette réalité objectale d’où semble évacuée toute présence humaine.
- 10C’est moi qui souligne.
- 11En 1977, le manuscrit original de Woolf sera publié sous le titre The Pargiters et sous-titré The Novel-Essay portion of The Years.
- 12Voir également sur l’écriture du deuil et l’expérience de la guerre : Vialle 2011.
- 13Caraion rappelle le rôle que jouera plus tard la pensée du sociologue Henri Lefebvre (par exemple dans Critique de la vie quotidienne en 1947) sur des écrivains de l’objet et du quotidien comme Perec (Caraion 14).
- 14Je souligne.
- 15« […] in collecting one “discovers” a relationship to objects which does not emphasize their functional, utilitarian value—that is, their usefulness—but studies and loves them, as the scene, the stage of their fate » (Mao Solid Objects 5).
- 16« La verticalité est assurée par la polarité de la cave et du grenier. [O]n peut opposer la rationalité du toit à l’irrationnalité de la cave » (La poétique de l’espace 35). La maison est pour Bachelard ce coffre où l’on entasse ses souvenirs, qu’ils soient négatifs ou positifs. Cette verticalité est également illustrée dans The Years par le passage de Crosby d’une chambre en sous-sol à Abercorne Terrace à une chambre tout en haut d’un immeuble. Lorsqu’Eleanor Pargiter envisage la vente de la maison, elle l’associe au départ de la vieille servante (« When I’ve pensioned Crosby off » [164]).
- 17Laurent Lepaludier analyse de la même façon la position esthétique et poétique de Woolf dans son chapitre consacré à « Solid Objects » : « Virginia Woolf se distancie des projections de subjectivité par la recherche de l’immédiateté de la sensation. Entre la sensation et l’imagination, les deux pôles de la perception, elle choisit le premier et instrumentalise le second » (186).
- 18« Portes d’accès à la mémoire collective ou intime, les objets sont des témoins, aussi bien traces du passé que déclencheurs du récit, et l’articulation des deux fonctions est essentielle. Pour cette raison la triade objet – mémoire – histoire est naturellement matière littéraire » (Caraion 137).
- 19Je souligne. Dans Mrs Dalloway de Woolf, la tangente que prend l’esprit de Clarissa au tout début du roman est provoquée par un objet et un son : les portes qui doivent être dégondées pour sa soirée appellent le crissement des portes-fenêtres de Bourton, l’année de ses dix-huit ans (3).
- 20Sur les rites funéraires en Bretagne et en Irlande, voir Giraudon 1991 (https://danielgiraudon.weebly.com/uploads/3/1/6/3/3163761/veilles_funraires_bretagne_et_irlande.pdf).
- 21On retrouve une image très similaire dans The Years où le tableau de la mère au-dessus de la cheminée est encrassé, et où la fleur dans l’herbe a disparu : « but now there was nothing but dirty brown paint » (15). Le tableau a perdu son sujet, et ainsi son pouvoir mémoriel pour n’être plus, pour Martin, qu’une œuvre d’art, désinvesti de tout affect : « In the course of the past few years it had ceased to be his mother ; it had become a work of art. » (15)
- 22Eleanor met en avant la perception visuelle (« the ink-corroded walrus ») et tactile (le métal des pièces qu’elle tient dans la main font surgir la mémoire de l’objet en métal).
- 23Dans Temps et Récit II, Ricoeur analyse ainsi le va-et-vient entre passé et présent dans le roman de Woolf, ainsi que la multiplicité des focalisations : « ces procédés, caractéristiques de la configuration temporelle, servent à susciter le partage, entre le narrateur et le lecteur, d’une expérience temporelle ou plutôt d’une gamme d’expériences temporelles, donc à refigurer dans la lecture le temps lui-même » (Ricoeur 199).
Bibliographie
- Alexander, Jean. The Venture of Form in the Novels of Virginia Woolf. Kennikat Press, 1974.
- Bachelard, Gaston. La Poétique de l’espace. PUF, 1957.
- Barthes, Roland. La Chambre claire. Gallimard, 1980.
- Barthes, Roland. « Les planches de l’Encyclopédie ». 1964. Nouveaux essais critiques. Seuil/Points, 1972.
- Barthes, Roland. « Sémantique de l’objet ». Œuvres complètes Tome II. Seuil, 1994, pp. 65-73.
- Bowen, Elizabeth. The House in Paris. 1927. Penguin Modern Classics, 1976.
- Caraion, Martha. Comment la littérature pense les objets. Théorie littéraire de la culturematérielle. Champvallon, 2020.
- Cuertas, Pablo. « Les objets de la mémoire ou la ruine au quotidien ». Sociétés n°120 – 2103/2.
- Finn, Howard. « Objects of Modernist Description: Dorothy Richardson and the Nouveau Roman ». Paragraph, vol. 25, n°1, mars 2002, pp. 107-24.
- Flaubert, Gustave. « Un cœur simple ». Trois contes. 1877. Folio classique, 2022.
- Lepaludier, Laurent. L’objet et le récit de fiction. Presses Universitaires de Rennes, 2004.
- Mansfield, Katherine. Collected Stories. Penguin Modern Classics, 1987.
- Mao, Douglas. Solid Objects: Modernism and the Test of Production. Princeton University Press, 1998.
- Mao, Douglas. « Objectionable Objects ». Modernist Objects, dirigé par Noëlle Cuny et Xavier Kalck, Clemson University Press, 2020.
- Martin-Mattera, Patrick, alexandre Lévy et Mathilde Saïet. « Le fétiche comme condition de la perversion. Tout sujet pervers est-il fétichiste ? Exemples cliniques ». Cliniques méditerranéennes. La clinique dans tous ses états, n°89, 2014, pp. 227-241.
- Mussat, Marie-Claire. « Le tombeau dans la musique du XXe siècle ». Tombeaux et monuments, dirigé par Michèle Touret et Jacques Dugast, Presses Universitaires de Rennes, 1993, pp. 133-44.
- Perec, Georges. Espèces d’espaces. Galilée, 1974.
- Ricoeur, Paul. Temps et récit II. Seuil, 1984.
- Turgeon, Laurier. « La mémoire de la culture matérielle et la culture matérielle de la mémoire ». Objets et mémoires, dirigé par Octave Debary et Laurier Turgeon, Éditions de la Maison des Sciences de l’Homme, 2007.
- Vialle, Elisabeth. « “A purplish stain upon the bland surface” : écrire le singulier et le collectif ou le péril de l’expérience dans To the Lighthouse de Virginia Woolf ». Expérience II. Houdiard, 2011, pp. 103-16.
- Woolf, Virginia. « Solid Objects ». The Complete Shorter Fiction. Grafton, 1991.
- Woolf, Virginia. Mrs Dalloway. 1925. Oxford World’s Classics, 2009.
- Woolf, Virginia. To the Lighthouse. 1927. Oxford World’s Classics, 2006.
- Woolf, Virginia. The Years. 1937. Grafton, 1990.
- Woolf, Virginia. « Three Guineas. » The Collected Essays of Virginia Woolf. Benediction Classics, 2009.
- Woolf, Virginia. A Writer’s Diary, edited by Leonard Woolf, Hogarth, 1952.
About the author(s)
Biographie : Elisabeth Lamy-Vialle est maîtresse de conférences en littérature britannique à l’université de Paris-Est Créteil. Après une thèse sur Les objets dans la littérature britannique de l’entre-deux-guerres, elle a publié des articles plus particulièrement sur Virginia Woolf et sur Katherine Mansfield (notamment autour de la question de la langue et de la voix, de même que de de l’expérience de la guerre). Elle est également traductrice de nouvelles de Katherine Mansfield.
Biography: Elisabeth Lamy-Vialle is a lecturer in British literature at the University of Paris-Est Créteil. After a dissertation on Les objets dans la littérature britannique de l’entre-deux-guerres, she published articles focusing on Virginia Woolf and Katherine Mansfield (notably on the question of language and voice, and the experience of war). She is also a translator of some short stories by Katherine Mansfield.