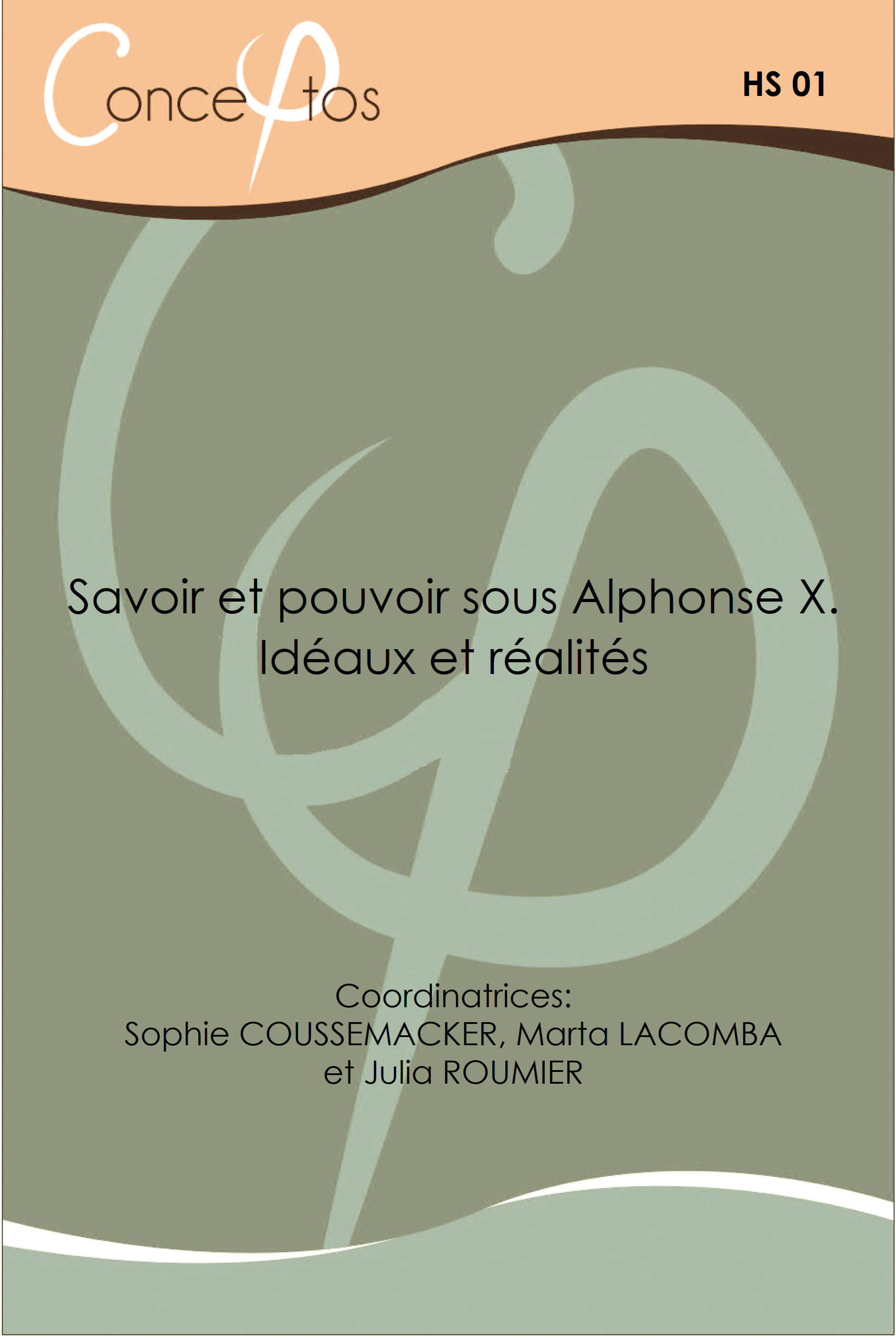Aux origines de la notion juridico-politique de debdo.La force textuelle des Partidas d’Alphonse X
Dans un précédent travail (Heusch, 2018), j’ai voulu, à la suite de Georges Martin, mettre en évidence l’une des constructions terminologiques majeures d’Alphonse X et ses collaborateurs dans les Partidas. Alors que l’Occident médiéval du XIIIe siècle ne jure plus que par la notion de « nature » dans bien des domaines (le Droit, la Politique, la Philosophie morale, la physiologie…), Alphonse X va certes reprendre à son compte cette obsession « naturaliste » mais on lui joignant une autre notion à laquelle il va donner un sens tout à fait nouveau. Ainsi fait-il une distinction entre natura, terme hautement polysémique qui va de l’œuvre de Dieu – ce qui inclut le monde et toutes les terres – jusqu’aux propriétés intrinsèques liées à la naissance, et la naturaleza dont il limite le sens, pour ainsi dire, à une seule acception qui est, d’ailleurs éminemment politique. La naturaleza selon Alphonse – que nous traduisons en français, avec Georges Martin (2008), par « naturalité » est un lien de dépendance qui existe entre au moins deux êtres, dont au moins un bienfaiteur et un bénéficiaire. D’après les Partidas il existe dix « manières » qui sont surtout dix « circonstances » dans lesquelles un tel lien de dépendance lié à un bienfait reçu se crée. Le texte est certes célèbre mais on ne résiste pas à la tentation de le citer ici :
Diez maneras pusieron los sabios antiguos de naturaleza. La primera, e la mejor, es la que han los omes a su señor natural, porque tan bien ellos como aquellos de cuyo linaje descienden nascieron e fueron raygados e son en la tierra onde es el señor. La segunda es la que aviene por vasallaje. La tercera, por criança. La quarta, por cavallería. La quinta, por casamiento. La sexta, por heredamiento. La setena, por sacarlo de captivo o por librarlo de muerte o deshonra. La octava, por aforramiento de que non rescibe precio el que lo aforra. La novena, por tornarlo christiano. La dezena, por morança de diez años que faga en la tierra maguer sea natural de otra (Partidas, 4.24.21).
On constate que grand nombre de ces naturalezas sont des liens politiques (celui avec le seigneur naturel, la vassalité, la chevalerie, la résidence effective…), d’autres sont en relation avec la maisonnée (l’éducation, le mariage), d’autres, enfin, résultent d’un bénéfice économique (héritage) ou religieux (conversion) ou même une forme de libération (aforamiento). Alphonse part du principe que le bienfait reçu rend le bénéficiaire redevable envers le bienfaiteur créant ainsi une forme d’obligation, de dette pour ainsi dire à vie et, par conséquent, une forme de dépendance. J’avais insisté dans mon étude de 2018 sur le fait que l’une des grandes nouveautés du discours politique d’Alphonse se trouvait dans cette re-sémantisation du terme naturaleza qui est à la base d’une nouvelle conception de la dépendance, voire de la subordination politique au souverain.
Je voudrais approfondir cette question en me centrant non pas sur la notion de naturaleza mais sur ce que cette naturaleza est en elle-même, c’est-à-dire sur ce lien de dépendance conçu comme une obligation, comme une dette contractée à l’endroit d’un bienfaiteur réel ou potentiel. Cette dette est justement ce qu’Alphonse, dans les Partidas, appelle debdo. La première loi du titre 24 sur la naturalité le dit très explicitement : « Naturaleza tanto quiere dezir como debdo que han los omes unos con otros por alguna derecha razón en se amar e en se querer bien » (4.24.1.). Il nous faudrait insister d’ores et déjà sur l’amour et la benevolentia qui accompagnent le debdo car ils en sont, en grande partie, la clé. Mais commençons par cette ideée première et fondamentale que la naturaleza est donc un debdo, un des multiples debdos dont parlent les Partidas. C’est déjà cette très grande présence de la notion de debdo dans les Partidas qui serait en soi une justification de notre intérêt pour elle. Mais c’est aussi et surtout sa polysémie. Or, justement, le debdo (qu’on pourrait traduire à la Maurice Molho par le mot médiéval français debte) n’est pas, à l’origine, un terme ni politique, ni moral, ni juridique, mais uniquement économique. C’est tout simplement une dette monétaire. Il devient tout cela, dans les Partidas à la suite d’un nouveau travail de re-sémantisation et de focalisation très intéressant qui fait du debdo une notion à la fois ductile et efficace dont vont se servir à foison les collaborateurs d’Alphonse, dans les Partidas mais aussi dans les autres grands textes comme la General Estoria ou l’Estoria de España. Essayons de retracer ces glissements sémantiques de debdo dans les Partidas.
De debitum à debdo
Les Partidas sont à plusieurs titres un texte inaugural. Il ne s’agit pas de compiler des lois, de rassembler l’existant ; il s’agit, comme le suggère Jesús R. Velasco (2021) d’inventer une forme nouvelle de droit qui passe par tout un processus de codification légale. Celle-ci exige, à son tour, un encodage terminologique qui se fait selon les critères linguistiques et sémiotiques propres à Alphonse : fuir le néologisme ; re-sémantiser des termes reconnus par l’usage et qui correspondent très souvent à des termes patrimoniales2, des mots qui font partie de la langue castillane et ont, par conséquent un signifiant immédiatement reconnaissable. On pourrait dire, en paraphrasant Baudelaire, qu’Alphonse va au fond du signifiant connu pour trouver des signifiés nouveaux. Or, l’une des grandes difficultés de ce re-encodage terminologique est que l’on ne nous livre pas forcément une définition de ces termes qui, dans les Partidas, ne sont pas utilisés dans leur sens habituel. On l’a vu avec la naturaleza alphonsine qui ne saurait être comprise à partir des usages antérieurs de la langue médiévale castillane. C’est aussi le cas du mot debdo dont nous allons nous occuper.
Qu’est-ce que le debdo avant Alphonse X ? Dans les textes légaux antérieurs, notamment les fueros, le debdo est la romanisation du mot latin debitum – c’est d’ailleurs le pluriel de ce neutre qui donne la forme féminine debda puis deuda. Le debdo dans ces textes, c’est donc exclusivement la dette monétaire, une somme d’argent que l’on est tenu de payer. Les textes légaux castillans vont ainsi romaniser des notions du droit économique latin, comme le debitum et l’obligatio et nous trouvons des références à des letras de debdo ou letras de obligación. Ce sens de « dette » est, pour ainsi dire, la seule acception possible de debdo dans les fueros et même dans le Fuero real d’Alphonse X.
Trouve-t-on ce sens économique dans les Partidas ? Tout à fait, d’où parfois notre difficulté pour appréhender cette notion. Il faudra toujours suivre le contexte pour savoir si on est ou pas dans le domaine de la dette économique. C’est par exemple ce que l’on trouve dans 1.11.2 et dans 1.11.3, sur le fait de savoir si on peut accorder la protection de l’Église à quelqu’un qui est poursuivi en raison de ses dettes3. Force est de constater, toutefois, que dans l’acception économique, les Partidas ont plutôt recours à la forme féminine – debda – qui est, d’ailleurs, celle qui va rester dans la langue, contrairement à debdo qui finira, quant à lui, par perdre tout sens économique pour n’avoir qu’un sens parental4 tout à fait en lien, me semble-t-il, avec le processus de resémantisation alphonsin (puisque l’obligation d’affectus entre des parents est un debdo dans les Partidas). La fluctuation entre le féminin et le masculin dans les Partidas concerne même le nouveau sens du terme que les Partidas mettent en place. Dans une loi sur la possibilité ou non de se desnaturar on trouve l’expression debda de natura (4.24.5), là où l’on s’attendrait à debdo. Est à noter qu’aussi bien Montalvo que Gregorio López maintiennent le féminin dans cette loi. Mais il faudrait sans doute regarder d’autres témoignages anciens.
Les premières occurrences : du Cid au Libro de buenos proverbios
D’où vient le passage de la dette économique au lien de dépendance entre les personnes ? Les « alphonsins » avaient certes à leur disposition des textes où la dette économique a déjà évolué vers une forme d’obligation, notamment morale ou bien à la suite d’un engagement vassalique. Les occurrences de debdo dans ce sens dans le Cantar de mio Cid5 peuvent nous conduire à penser, avec Alberto Montaner (2007, note 895), que debdo a pu appartenir, aux xiie et xiiie siècles, en tant que traduction de debitum, au lexique de la féodalité. Mais de quelle obligation s’agit-il exactement dans le Cantar de mio Cid ? Il est clair que le debdo du Cantar est un debdo vasallático entre le Cid et ses mesnies. L’interprétation de cette obligation l’est un peu moins. Dans la plupart des occurrences le mot debdo signifie la nécessité, l’obligation dans laquelle se trouvent les vassaux du Cid d’obéir aux ordres de leur seigneur. Le terme est presque systématiquement lié à des actions concrètes de nature épique ou chevaleresque qui ont été explicitement sollicités par le seigneur (« el debdo que les mandó so señor »). Tel est le debdo des mesnies cidiennes : réaliser ce qui a été demandé par le Cid. Cela correspondrait donc à ce que les Partidas appellent « servir loyalement » le seigneur. Le debdo cidien prend donc place à l’intérieur du système de relation personnelle consensuelle qui est le propre de la relation féodale dans une nécessaire réciprocité service / récompense entre le vassal et son suzerain. Le vassal « doit » (d’où le debdo car il est dette avec le seigneur) servir loyalement en échange du bien fecho du seigneur. Il n’est donc pas du tout exclu que les Partidas aient directement recours au debdo de la féodalité du Mio Cid parce qu’elles évoquent bien le « debdo de vasallaje » en des termes qui rappellent la plupart6 des occurrences de la chanson et que, par ailleurs, le Cantar est un texte dont se servent les ateliers alphonsins pour l’Estoria de España. Mais, justement, la grande nouveauté des Partidas va être de déplacer les sens d’obligation politique que renferme le debdo féodal, volontairement contracté de manière personnelle entre le vassal et son suzerain, vers une nouvelle forme de debdo politique qui va être absolument nécessaire et incontournable, sans le moindre pacte personnel. Et ce debdo va justement s’appeler, dans les Partidas, debdo de naturaleza et sera souvent opposé au debdo de vasallaje7. Par manque de temps, je dois laisser de côté les occurrences de debdo dans les poèmes du métier de clergie où l’on trouve des usages proches de ceux du Cid8
Certains textes plus proches des Partidas dans le temps et dans le contexte de production se servent aussi de debdo dans le sens de l’obligation. Leur dénominateur commun est qu’ils sont tous des traductions de textes arabes. Tel est le cas du Libro de buenos proverbios dont certains passages où se trouvent justement des occurrences de debdo ont été repris dans la version conservée à l’Escurial (ms. L.III.2) du Poridad de poridades, traduction du Sirr al-Asrar que l’on date de circa 12509 :
E rrecudiol la madre de Alexandre e dixo: «Dios te dé buen gualardón por estas palabras nobles que diste segunt es el bien e la nobleza que en ellas ha, ca dixiste buena razón conplida e en tu castigar e en tu fablar e en tu comendar e en tu solazar e en tu tremenbrar que dixiste, segunt te era debdo de decir; e demás con la tu buena sapiençia e con el to buen entendimiento.
L’expression « te era debdo de decir » indique non seulement une nette évolution du concept vers l’idée d’obligation mais surtout elle présuppose une ductilité morpho-syntactique qui est ici totalement novatrice et que les Partidas, comme on va le voir, reprendront à leur compte. Debdo est ici déjà entré dans une forme de lexie qui sert à exprimer la nécessité, l’obligation. Cette ductilité se trouve dans une loi des Partidas où l’on va trouver une expression semblable « haber debdo de los fazer bien » :
Ca maguer natural cosa es de aver los omes miedo de la muerte, pero pues que saben que por ella han de pasar, ante deven querer morir faziendo lealtad e derecho e dar a los omes razón verdadera de los loar después de su fin, mucho más que quando eran vivos; e dexar otrosí a su linaje buen prez e buena fama e carrera abierta, por que los señores con quien bivieren ayan debdo de los fazer bien e honrra e de fiar siempre en ellos (2.18.12).
Comme dans Buenos proverbios, debdo sert ici à indiquer la nécessité de faire quelque chose : « parler » dans un cas, « récompenser » le lignage dans l’autre. C’est quelque chose comme « seraient enclins à… », « seraient poussés à… », « seraient obligés de… ». L’apparition de l’expression ser ou haber debdo de pourrait donc bien arriver jusqu’aux alphonsins suscitée par une interférence positive de l’arabe. N’étant pas arabisant, je m’en tiens aux jugements d’Alberto Montaner et d’Olivier Brisville que j’ai contactés à ce sujet. Le passage cité se trouve dans le paragraphe 43 de la version arabe du Libro de buenos proverbios. Dans la translittération (faite lors de ma consultation par Alberto Montaner) le texte dit : « fa-la-qad qumta bi-mā yaǧiba ‘alay-ka ». Cela pourrait être traduit, avec l’aide d’Alberto Montaner, par « certes, tu t’es levée pour dire ce qui était ton devoir de dire » (« dixiste, segunt te era debdo de decir »).
Mais les liens entre le debdo de Buenos proverbios (ou Poridat de l’Escurial) et les Partidas ne s’arrêtent pas là. C’est encore la mère d’Alexandre qui parle ; cette fois elle se sert de debdo pour évoquer justement le lien politique, le debdo envers le seigneur :
E recudió la madre de Alexandre e dixo: « Dios te dé buen gualardón e mucho de bien commo a sabio que cumplió debdo de so señor en dolerse de su muerte e cunplió su debdo en conortar el bivo y en mandarle que sea sufrido ».
On croirait entendre les Partidas qui évoquent, comme on l’a vu précédemment l’une des formes de naturaleza comme étant un debdo entre les hommes et leur señor natural. À plusieurs reprises, les Partidas vont comparer, comme on l’a dit plus haut, le debdode naturaleza et le debdode vasallaje, tel est le cas, par exemple, du titre 18 de la 2ePartida. Il y a donc assurément, aussi bien dans la féodalité que dans la monarchie naturelle d’Alphonse, une dépendance entre le seigneur et ses hommes qui ne porte qu’un nom, dans tous les cas et c’est ce même debdo de Buenos proverbios, par « naturalité » dans un cas, par vassalité de l’autre.
Le Calila e Dimna, œuvre « alphonsisée »
Il est assez singulier que l’autre texte qui se sert de debdo dans des acceptions très proches de celles des Partidas soit, à nouveau, une traduction de l’arabe et réalisée, de surcroît, sous la houlette d’Alphonse alors qu’il était encore prince. Il s’agit, justement, du Calila e Dimna, traduction du Kalila wa Dimna d’Ibn al Muqaffa. Il y a cinq occurrences de debdo dans le Calila et aucune d’elles n’a le moindre sens économique. La première n’est pas des plus claires. C’est la souris, au chapitre III, qui dit au pigeon à collier (paloma collarada), lorsque celui-ci lui dit de ronger d’abord les liens des autres pigeons : « Semeja que non as duelo nin piadad de ti, nin debdo con tu alma » (Calila e Dimna, 205). Quelle est cette relation que devrait avoir le pigeon avec son âme ? Le fait est que, dans ce passage très précisément, il y a une variante dans l’autre témoin conservé du texte qui peut orienter notre interprétation de manière très intéressante. Le manuscrit B dit : « Semeja que non as piadat de ti, nin eres amiga de tu alma » (Dölha, 2007 : 282). Comme on sait, la version pré-alphonsine de 1251 est perdue et nous ne disposons que de deux manuscrits bien postérieurs, tous deux du xve siècle, le manuscrit A du début et le B de 1467. Nous ne pouvons donc pas savoir si c’est bien debdo qu’avaient traduits les traducteurs supposément commandités par le prince Alphonse. Quoi qu’il en soit, la lecture de B semble ici bien plus vraisemblable : c’est un manque d’amitié, voire d’amour, entre le pigeon et son âme que la souris lui reproche. On peut donc penser qu’à l’origine il y avait un terme qui évoquait l’affection entre le pigeon et son âme et il faudrait aller voir quel est le terme employé ici en arabe par ibn al Muqaffa. Mais, justement, dans les Partidas, le debdo de naturaleza est, précisément, une obligation d’amour, une dette d’amour, en quelque sorte. Par conséquent, la lecture de A n’est pas en soi fausse, elle est juste difficilement imaginable avant le travail de re-sémantisation de debdo opéré par les collaborateurs d’Alphonse X. Si l’on suit le raisonnement de Hans-Jörg Döhla, dès lors qu’il y a une variante nette dans un même passage, on peut être sûr que l’un des deux termes n’est pas celui de l’Urtext de 1251. Cela nous mettrait sur la piste d’une révision postérieure de ce passage qui aurait impliqué le choix du terme debdo à la place d’amor.
La deuxième occurrence fait à nouveau apparaître un problème de transmission textuelle. Le manuscrit A dit : « quatro cosas [non] deve omne desdeñar, [que] por lo poco dellas se puede pujar a lo mucho; et son: el fuego et la enfermedad et el enemigo et el debdo » (Döhla, 2007: 347-348). Là encore, on peut se demander quel est le sens de debdo ici ? Le contexte est clairement insuffisant pour trancher. Or dans la version B il y a bien aussi quatre choses qu’il convient de ne point mépriser, mais à la place du debdo on a autre chose, on a ce qu’on pourrait appeler des biens mal acquis : « el fuego e la enfernedat e el algo con usura e el enemigo » (Döhla, 2007: 347-348). Force est de constater que, comme dans l’exemple précédent, la version de B, sans debdo, est plus vraisemblable : des biens obtenus par usure, ça correspond bien à la prémisse de cette espèce d’aphorisme. À nouveau ce debdo si alphonsin semble être un rajout ultérieur et, en l’occurrence, pas très heureux.
La troisième occurrence ne pose pas de problème de variance textuelle, ce qui, selon Döhla indiquerait que le terme se trouvait déjà dans la version originelle commanditée par Alphonse X. Dans les deux témoins, il est question du « debdo qu’el omne ha con la muger » (Calila e Dimna, 255). Le Calila serait-il donc déjà en train d’évoquer la cinquième forme de naturaleza selon les Partidas, à savoir le debdo « por casamiento », qu’évoque le texte cité dont est partie notre réflexion ? Peut-on imaginer un sens si précis de debdo, si empreint non seulement de parentalité, mais comme étant une obligation d’amour entre les époux ? Cela me paraît peu probable et même si le terme est commun aux deux témoins, je pense que nous pouvons avoir affaire, encore une fois, à une révision post-alphonsine du texte.
La quatrième occurrence mériterait des analyses ecdotiques qu’il ne m’est pas possible de faire ici. Certes, le terme debdo se retrouve aussi dans les deux témoins, la difficulté se trouve dans ce qui suit.
A B Maguer que es grant debdo de guardar omne los amigos et de amarlos, mayor derecho ha de guardar a sí mesmo (Calila e Dimna, 345) Maguer que es gran debdo de amar onbre a las mugeres [e] amigos e de guardarlas, mayor derecho es de guardar syenpre onbre a sy mesmo (Döhla, 479)
Difficile de trancher pour savoir laquelle des deux versions pourrait se rapprocher du texte originel. La version B est, certes, problématique et les éditeurs sont obligés d’intervenir en ajoutant, comme le suggèrent Keller et Linker (apud Döhla, 479), une conjonction de coordination. Mais pour ce qui nous intéresse ici aujourd’hui, il faut bien constater à quel point ce terme de debdo fait écho aux debdos alphonsins des Partidas où l’on trouve non seulement le debdo de l’amour conjugal, comme on l’a vu dans l’exemple précédent, mais également le debdo de l’amitié qui fera l’objet d’un très long développement dans la 4ePartida, c’est le sujet exclusif de la totalité du titre 27, appelé justement « del debdo que han los omes entre sí por razon de amistad ». D’autres passages des Partidas (comme 1.17.4 sur la simonie ou 2.21.16 sur le debdo du chevalier avec son parrain) insistent sur l’importance des obligations mutuelles en raison de l’amitié à un point tel que l’on perçoit aisément l’analogie juridique que le législateur suggère entre la parenté et l’amitié. Ainsi, dans bien des circonstances, parenté et amitié constituent une même cause juridique : « por razón de parentesco o de amistad » (1.17.4). Or, l’analogie de ces deux debdos, présente de manière si récurrente dans les Partidas – qui est aussi, ne l’oublions pas, une analogie des affects –, est ce qui, à mon avis, justifie les complexités ecdotiques de la version B. Dans cette version l’on a tenu à mettre ensemble l’amour pour les femmes et pour les amis et à faire passer au deuxième plan la conservation de ce lien. Cette fois l’œil alphonsin semble plus présent dans la version B.
C’est bien cet œil alphonsin de B qui explique à mon avis une cinquième et dernière occurrence de debdo, moins facile à repérer car elle se trouve uniquement dans B, alors que Cacho Blecua et Lacarra ont choisi A comme codex optimus. On ne peut donc la repérer qu’en consultant la thèse déjà citée de Döhla. À nouveau la présentation en tableau permet une meilleure approche des deux textes :
A B … ca he miedo que serás tu conpreso por razón de mí e por el amor e por el parentesco e la amistad (fol. 37v) que avíamos en uno… … que he gran miedo que serás tú preso por amor de mí, por el gran debdo que en uno avemos…
La version de B a tout à fait l’air d’être une révision qui va condenser et intensifier une version originelle sans doute plus diffuse, version qui n’est pas forcément celle de A mais qui peut être proche de celle de A, notamment dans l’énumération « parentesco e la amistad ». Il est tout à fait frappant que ces deux éléments, les liens affectifs de parenté et d’amitié, dans la version B soient exprimés par un seul terme qui est précisément celui de debdo, totalement absent de ce passage dans la version de A. Encore une fois, il me semble qu’une telle intervention sur un texte originel de 1251 que, encore une fois, nous ne connaissons pas, est, au vu de ce qu’est le debdo avant les Partidas difficilement envisageable.
Conclusion
Ces exemples du Calila à partir des cinq occurrences du mot debdo jettent une lumière nouvelle sur l’état du texte tel qu’on le connaît. On peut difficilement continuer à penser que le Calila est une œuvre pré-alphonsine. Les interventions recourant au concept de debdo sont un exemple de l’importance qu’ont pu avoir les Partidas dans l’établissement final du texte. On dispose, hélas, de trop peu d’éléments matériels pour pouvoir arriver à des conclusions définitives, mais le fait que le début du Calila e Dimna ait été inclus dans la General Estoria, certes dans une version qui ne correspond à aucune de celles qui ont été transmises par les deux manuscrits conservés, est un puissant indice pour suggérer que la première traduction a bien pu être réécrite dans les ateliers alphonsins qui travaillaient aux différentes rédactions d’autres œuvres comme les Partidas ou la General Estoria. Il semblerait donc qu’il y ait eu des étapes de révision de cette traduction où l’on a voulu « sur-alphonsiser » la traduction, comme si la version supposée de 1251 devait nécessairement être amendée, après tout le travail linguistique et sémantique d’un opus magnum comme les Partidas, pour revoir le texte initial à la lumière de tout ce processus de re-sémantisation présent dans la codification alphonsine. Les variantes entre A et B sembleraient indiquer que nous avons affaire à deux moments différents de révision ; mais en même temps, ces deux moments sont tous deux « alphonsins » ou, en tout cas, partent de notions dont les Partidas se sont emparées. Je donnerai un exemple supplémentaire qui nous intéresse ici aussi car il concerne, on l’a déjà dit, l’un des concepts politiques clé des Partidas à savoir la naturalité. Dans le chapitre cité avant, la souris fait l’éloge des amis, thème fort rebattu dans la tradition didactique des xiiie et xive siècles. La version B dit « Que el puro amigo deve de amar a su amigo más que a sý mesmo nin a sus parientes nin a su aver ». La version A dit à peu près la même chose, mais à la fin de cette phrase elle ajoute quelque chose qui ne figure pas du tout dans la version B : « ca es leal por naturaleza » (Döhla, 345). On aurait pu penser, avant cette étude que je suis en train de conclure et qui est, cependant, appelée à être poursuivie, que naturaleza est à prendre dans le sens antérieur aux Partidas, à savoir qu’il est dans la nature de l’ami d’être loyal. Or, en réalité, cette interprétation n’aurait pas beaucoup de sens, car l’ami n’a pas en tant que tel de « nature » particulière. L’amitié n’est pas une nature… les Partidas nous le disent bien, l’amitié est un debdo et donc, en quelque sorte aussi, une naturalité, une naturaleza. Ce ne peut donc être que dans l’acception des Partidas que l’ami est loyal « por naturaleza », parce qu’il retire des bienfaits de la relation d’amitié. Ici, comme dans les Partidas, natura et naturaleza ne sont pas du tout synonymes. Donc, dans ce passage c’est A qui ajoute son grain de sable alphonsin à la lumière des Partidas. Inversement, ces exemples nous renseignent sur des notions re-encodées par les Partidas qui ont pu être considérées, peu après, comme fondamentales ou, tout du moins, particulièrement novatrices ou efficaces. Tel est le cas, me semble-t-il de la re-sémantisation de la notion de debdo, plus englobante encore que la notion de naturaleza qui est un sous-ensemble du debdo.
Dans un autre travail, actuellement sous presse (Heusch, 2022), j’évoque l’efficacité sémantique de la notion de debdo dans certaines lois des Partidas. Je voudrais finir, pour conclure, sur cette idée d’une dimension centrale du debdo, à partir des Partidas, qui expliquerait son utilisation dans d’autres œuvres capitales d’Alphonse X a priori éloignées du Droit – mais peut-on vraiment s’éloigner du Droit, chez Alphonse X ?, nous rétorquerait Jesús Velasco (2021) : tout relève du Droit chez le Roi Savant –, des œuvres comme l’Estoria de España et, surtout la General Estoria, où le debdo est une notion étonnamment récurrente, mais qui est utilisée uniquement dans le sens forgé par les Partidas. En effet, le debdo des Partidas devient la notion clé pour évoquer toutes les formes d’interrelations humaines, de dépendances mutuelles, de passions autant concupiscibles qu’irascibles… Il incarne cet espace mitoyen où le moral effleure et caresse même le politique.