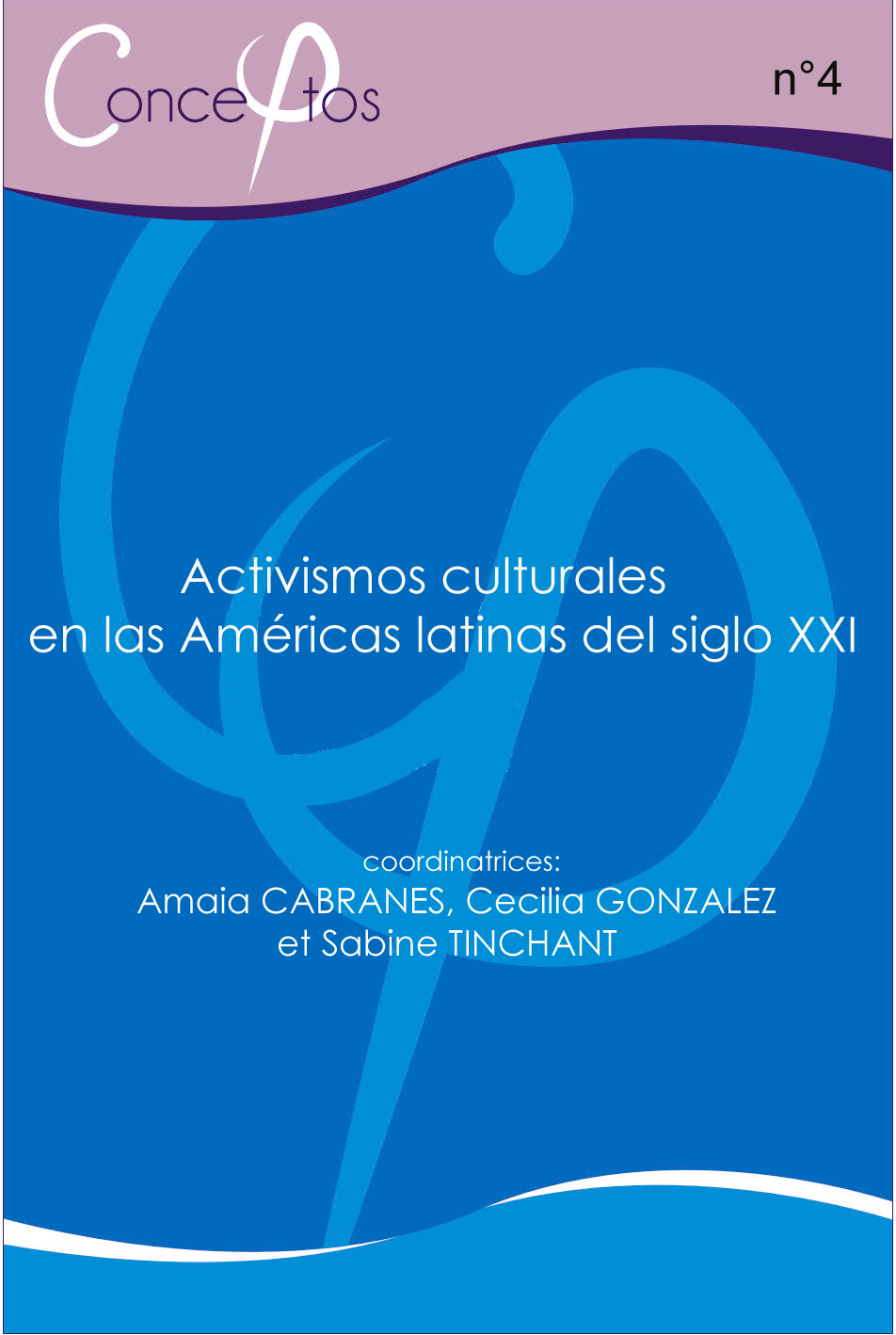La « viveza criolla » ou l’équatorianité
De la « viveza criolla »
Toute recherche au sujet des traits caractérisant notre comportement trouvera inévitablement pour réponse la paresse, le manquement aux engagements, l’improvisation et la « viveza criolla », entre autres choses. Il serait injuste d’attribuer la paresse aux seuls Équatoriens, et même aux seuls Latino-américains : dans le monde entier, on la situe indistinctement dans le « Sud », on la considère volontiers comme un facteur biologique plutôt que culturel, et, dans un certain élan de générosité, on l’attribue à la chaleur des tropiques : l’image la plus répandue du Mexique, à l’étranger, est celle de l’indien, coiffé d’un immense chapeau, piquant un somme au pied d’un agave ou contre une porte ; en Europe, on considère que c’est le patrimoine des peuples latins, exception faite de la France, mais Italie incluse : le personnage typique du surréalisme cinématographique italien n’est-il pas le jeune adulte qui passe ses journées au lit, la tête souvent bandée en signe de mal de crâne, et qui ne se lève que pour aller manger ? N’est-ce pas typique de cela, quoiqu’injuste, le dicton qui veut que « l’homme qui travaille perd un temps précieux », que l’on attribue aux Espagnols ? Il me semble que ce prestige revient, de façon générale, à ceux qui ne sont pas Allemands, Suédois ou Japonais —ces derniers ne jouissaient pas, jusqu’à quelques années en arrière, de congés payés— et qui, d’après l’exagération bien connue, sont les seuls à faire la sieste et à tout remettre à « demain », mot bien trop employé dans la langue espagnole dans tout dictionnaire de dernière catégorie et de préférence par la secrétaire de monsieur Toutlemonde : à celui qui se présente à l’improviste, « revenez demain » lui oppose-t-elle, ce qui rappelle l’époque où —car la population du pays d’alors équivalait à celle d’une grande ville d’aujourd’hui, ou parce que sa situation économique lui permettait de vivre convenablement, ou parce que les activités agricoles étaient encore rentables— les mendiants avaient coutume de demander la charité une fois par semaine, et aux gens pressés ou étourdis elle leur dit « revenez samedi », et par le débiteur, et par l’obscur individu qui doit apposer quelque signature ou quelque cachet sur un document : il s’agit alors d’un défi contre l’acharnement, non pas seulement contre la patience, contre l’obstination, non pas seulement contre le caprice, l’entêtement, non pas seulement contre le droit, pour savoir qui tiendra le plus longtemps, comme une joute dont seul l’un des deux sortira vainqueur. (Et, en général, toi, individu du commun des mortels, qui as un minimum de respect envers toi-même, tu en sors vaincu précisément pour cela : tu ne peux pas tenir si longtemps, résister si longuement est dénigrant). Et par un racisme plus prononcé encore, y compris dans nos pays pluriethniques, et qui a quelque chose à voir avec la paille et la poutre dans l’œil, nous attribuons tout particulièrement la paresse aux personnes noires et la fainéantise aux indiens et aux cholos, les métis.
Manquer à ses engagements, tout particulièrement en matière de travail, pourrait être un privilège des Latino-américains et, par voie de fait, le nôtre : je ne connais personne qui, ici, n’ait pas été contraint de se rendre dans les bureaux de Quito trois, sinon quatre fois, voire plus, pour quémander un document ou réclamer des pouvoirs publics qu’ils agissent, qu’importe s’il vient de province,—les recteurs des universités ne passent-ils d’ailleurs pas plus de temps au ministère des Finances à demander le déblocage des fonds dont ils ont besoin pour « former les hommes de demain » ?—, plus encore s’il s’est refusé à la corruption retorse ou effrontée du fonctionnaire de service ; ou la réparation confiée à un artisan, qu’il s’agisse de vêtements ou de voitures, de chaussures ou d’appareils électroménagers. (Dans ce domaine, mon technicien radio s’est révélé exemplaire : tous les vendredis, il m’annonçait qu’il me livrerait mon poste de radio réparé « lundi après-midi » et, tous les mardis, « vendredi à treize heures trente », ce qui m’obligeait à patienter, et grâce à lui j’ai pu beaucoup avancer dans la lecture d’un livre, car l’attente aura duré dix-huit mois, au bout desquels il me l’a rendu tel que je le lui avais confié, à l’exception de l’antenne et de l’anse qui s’étaient cassées « lors de la réparation »). Il convient d’ajouter également ce que l’on apparente à de l’informalité, à savoir la ponctualité relative de l’ « heure équatorienne », mais on rappellera, à notre décharge, qu’il existe une heure vénézuélienne et une heure cubaine, en sus d’autres tout à fait semblables, ce qui pourrait résulter de la paresse et du manquement aux engagements tout à la fois. Néanmoins, malgré une certaine oisiveté mentale et physique qui empêche de voir et de faire les choses comme il se doit, nous devrions, pour compenser, rappeler l’adresse de nos artisans, leur initiative dans la réparation de dégâts et de pannes diverses et variées et leur inventivité pour fabriquer pièces et rechanges que l’on ne trouve pas toujours sur le marché.
Et si la paresse conduit à moins se donner de la peine, à fuir les efforts et le sacrifice, à se contenter de peu, à ne rien ou peu s’exiger de soi-même, nous établissons, ainsi —comme le disait Monseigneur Alberto Luna Tobar, lors du lancement du présent ouvrage à Quito— « une mesure en deçà de zéro, qui n’atteint même pas l’unité », en vertu de quoi ce que l’on considère ici comme « grand » n’est que moyen, au mieux, ailleurs, et ce qui est « moyen » ici est minuscule là-bas. Ne peut-on voir de cela un exemple dans les quelques amateurs de littérature, prétendument affublés d’un don qui les transforme en écrivains du jour au lendemain et non en débutants conscients du long et douloureux cheminement intellectuel qui les attend, les dramaturges et les acteurs et, d’abord et avant tout, le public lui-même qui avait coutume de dire : « Ce n’est pas si mal pour une œuvre équatorienne » comme d’aucuns disaient : « Ce n’est pas si mal pour une œuvre d’une femme » ? D’un autre côté, le manquement aux engagements, qui laisse entrevoir un manque absolu de respect envers autrui, au temps d’autrui, aux besoins d’autrui, et la malhonnêteté aussi, font que, à quelques exceptions près que j’aimerais bien connaître, personne ne considère que son poste de travail est voué au service aux autres, qu’il est payé pour cela, mais également formé à cet exercice. Il est vrai que dans la lutte désespérée pour la survie, on est prêt à exercer tout travail, à condition de savoir comment le faire : il est des comptables qui, provisoirement, deviennent « collaboratrices du foyer » —il s’agit, en langage politiquement correct, d’employées domestiques, terme que le féminisme militant a trouvé, de jour au lendemain, péjoratif—, d’économistes fraîchement diplômés qui se dédient à la vente en porte à porte, d’étudiants qui font office de chauffeurs de taxi. Mais parmi ces gens il en est qui glissent avec facilité vers l’irresponsabilité : c’est précisément le cas de ce chauffeur, par exemple. Ou d’employés inutiles dévoués à la maintenance des rues et du tout-à-l’égout et même de « spécialistes » en chirurgie esthétique ou en gynécologie, qui voient mourir leur belle qui se voulait plus belle encore ou celle qui refusait d’enfanter… N’avons-nous pas vu se succéder, dans un même régime, différents ministres de l’Énergie, ayant une conception de la « politique énergétique du gouvernement » différente, dont l’un a avoué dans un élan d’honnêteté, quoique de manière impudique, « ne rien y connaître au pétrole » ? (J’ai moi-même été le témoin de cette conversation, dont j’ai fait une caricature afin de souligner cet aspect de la « façon d’être » équatorienne : quelqu’un s’était présenté au ministère de l’Éducation, qui avait publié une offre d’emploi pour un conseiller juridique. Le ministre avait expliqué au candidat que ce poste avait été pourvu, et qu’il avait plutôt besoin, à ce moment-là, d’un dentiste scolaire ; « Offrez-moi ce poste » avait proposé le juriste. Et, sans exagération aucune, cinq pour cent des personnes ayant présenté leur candidature à la nomination des magistrats de la Cour Suprême n’avaient même pas de diplôme en droit). C’est devenu une pratique (et elle s’aggrave plus encore aujourd’hui) que de distribuer les emplois selon des critères de clientélisme politique ou de népotisme domestique à des fainéants, des bureaucrates payés à ne rien faire, des pistonneurs, que ce soit parce qu’il s’agit d’un coreligionnaire qui a « travaillé pour la campagne », ou du fils du cacique, ou d’un ami à qui l’on doit des faveurs, ou d’un proche, ou de quelqu’un qui est « recommandé » —il y a tant de postes de travail qui les attendent aux douanes qui ont remplacé, comme « source de travail », les tristement célèbres Estancos d’hier, monopole d’État sur les boissons alcoolisées— sans que l’on ne prête la moindre attention aux conséquences qu’une telle façon de procéder peut avoir sur la vie publique.
À la première marche de l’improvisation se trouvent les enseignants d’école non diplômés, qui n’ont jamais été formés à l’enseignement, qui n’ont même pas toujours leur baccalauréat —l’un d’entre eux n’a-t-il pas écrit un jour une lettre ouverte au ministre de l’Éducation pour demander que soit interdite de circulation l’Encyclopédie Planeta en Équateur en raison de « l’outrage et l’ignorance » qui s’y trouvait, car on y signalait que Cuenca était une ville d’Espagne ?— et à qui il serait illusoire de fournir une instruction basée, comme le voulait Vasconcelos, sur « la langue, le sang, le peuple ». Sur les innombrables autres marches se trouvent presque tous ceux qui occupent un poste, public ou privé, obtenu par l’intercession d’ « influences », de « parrains », de « pistons » et non par mérite. Et comme l’improvisation frise l’irresponsabilité, c’est là que trouve son origine la méfiance envers les institutions, le discrédit croissant dont elles font l’objet, dont réchappent, selon certaines enquêtes d’opinion, l’Église et les Forces Armées : les nominations, y compris celles qui sont directes, se font à l’image de la désignation des députés (à qui l’on adjoindra des conseillers d’une mentalité provinciale ou villageoise similaire, trouvés par ces derniers et payés par l’État), ou des conseillers municipaux, ou encore la désignation des gouverneurs, des dirigeants de la police, des juges. Et de même que pour les pots-de-vin, l’irresponsabilité est le fait des deux parties impliquées. Aussi, lorsque l’on parle des lynchages qui se produisent régulièrement dans nos campagnes, presque toujours à la suite de délits, supposés ou vérifiés, de vol de bétail, l’infraction est celle des malheureux qui n’ont jamais entendu parler de la loi de Lynch, mais l’origine, proche s’il en est, se trouve dans l’inefficacité et la corruption de l’agent de police, du commissaire, de l’avocat, du juge, dont ils sont tout à la fois victimes et témoins. Une faute et une origine semblables, mêlées à des attitudes de « macho » et même de « viveza », m’a-t-il semblé observer, à plus d’une reprise, dans la province de Manabi —quand elle était ou ressemblait à un « État dans l’État »—, dans le comportement de qui ne croit ni au droit, ni à la justice, ni à la réhabilitation du délinquant et qui, en compagnie de ses amis justiciers, attaque la prison pour en extraire celui qui a violé sa sœur afin de s’assurer qu’il ait ce qu’il mérite.
De façon universelle, et c’est un axiome juridique, ma liberté s’achève là où commence celle d’autrui. Ici, par escamotage tacite, partagé, diffus, la liberté d’autrui s’achève là où je décide, selon mon bon vouloir, que la mienne commence. Et ainsi considéré, il s’avère que ma liberté n’a aucune limite.
Comme dans le cas du timide qui, sous l’effet libérateur de l’alcool, surmonte sa peur à tel point qu’il atteint la hardiesse, il semblerait que la seule façon de surmonter le sentiment généralisé d’infériorité est d’atteindre l’autre extrême : celui d’une curieuse supériorité que chacun s’arroge, sans raison et sans fondement, et qui autorise prétendument le recours à l’agression pour exercer la méconnaissance des droits d’autrui. Ce sont des gestes et des actes de tous les jours, si courants qu’ils ne suscitent parfois pas même la moindre indignation, car, exécutés en compensation de la rancœur de qui se refuse à s’admettre tel qu’il est, ils se heurtent à l’indolence et à l’intolérance de qui n’exerce pas non plus ses droits : ainsi, l’offensé redevient complice. Il s’agit, pour qui les commet, d’actes justifiés par un statut social, qu’il soit inné ou acquis : à franchement parler, en fonction de la couleur de peau ou de la taille du portefeuille, contre celui qui « courbe l’échine » ou celui qui « n’ose pas ». La tromperie, la canaillerie ou la picardía, la roublardise, commise en tant que viveza, frise la lâcheté quand elle est exercée contre les minorités : l’enfant, la femme, l’indien, le subalterne, le noir, l’étranger, en somme quiconque vit, en quelque sorte, « à part ». Et, en matière de roublardise, les individus et l’État sont égaux, il n’est nul besoin d’y voir pour explication la classe sociale, le besoin ou les circonstances « impondérables ». Est-ce un trait caractéristique équatorien ? Probablement pas, pas uniquement équatorien.
Si la « viveza criolla » est typique de l’Équateur, ce n’est pas en raison de l’adjectif par lequel on souhaite la distinguer des autres endroits, mais parce que le premier signe de « viveza » est de désigner par là tout ce qui n’est que de la roublardise. Le dictionnaire définit très exactement ainsi le terme : « picardía. (De pícaro, espiègle). f. Action vile, mesquinerie, bassesse, tromperie ou méchanceté. 2. Friponnerie, ruse ou combine pour exprimer quelque chose. 3. Espièglerie enfantine, tour ou raillerie innocente. 4. Intention ou action malhonnête ou impudique. » Mais ce que nous, nous appelons ainsi, c’est l’espièglerie ou picardía, en essayant, à la sauce locale, en criollo, de suggérer la « viveza » (pour vif, rapide, alerte). « f. Promptitude ou célérité dans les actions, agilité d’exécution. 2. Bravoure ou énergie des mots. 3. Acuité ou perspicacité ingénieuse. 4. Dicton subtil, fin ou ingénieux. 5. Propriété ou similarité dans la reproduction de quelque chose. 6. Splendeur et éclat de certaines choses, notamment les couleurs. 7. Grâce particulière et activité spéciale des yeux dans la façon de regarder et de bouger. » Il s’agirait donc d’un synonyme de la seule acception 8 : « Action peu respectueuse ». (Plus transparentes que les définitions abstraites sont les images bien visibles : il y a de la viveza dans le joueur de football qui profite avec ruse, l’espace d’une seconde, de tous les facteurs, pour marquer un but, et de la picardía dans celui qui lui fait un croche-pied, suspendu à l’espoir que l’arbitre ne le sanctionnera pas).
À mon sens, deux semblent être les caractéristiques qui rendent « criolla », typiquement nôtre, la picardía : son universalité et son abolition du futur. Universalité car elle est individuelle, collective et même institutionnelle : si après chaque accident de la route qui se solde par la mort de nombreuses personnes, sauf la sienne, « le chauffeur a pris la fuite » —le code pénal prévoit sa mise en détention provisoire le temps de l’enquête préliminaire—, par picardía, et de mèche avec d’autres dirigeants, le président de la République, le vice-président, les députés, les ministres, les inspecteurs des douanes, les propriétaires d’agences immobilières ou de sociétés de construction de routes, de bâtiments, de centres de traitement de l’eau potable, les auteurs de quelque malversation, escroquerie ou corruption prennent eux aussi la fuite, sans que personne ne les retrouve ni ne les sanctionne. Heureusement que, à l’inverse de ce qu’il s’est toujours produit, selon la nouvelle constitution en vigueur, ces délits ne prescrivent plus. Le comportement du juge qui « agit selon sa conscience » (et quel est le prix sa conscience ?) pour libérer des trafiquants de drogue ou des braqueurs de banque est semblable à celui de l’employé du greffe dont les actes sont soumis à un tarif préétabli ; à celui de l’agent de la circulation qui invente de toutes pièces une infraction et ne peut la prouver qu’en faisant payer le conducteur (est entendu exclu de cette catégorie l’agent qui, certain qu’un automobiliste n’avait pas de permis de conduire, lui dit, après avoir vérifié la validité du permis en question : « c’est pas de chance ! vous avez le permis et moi rien à me mettre sous la dent ») ; à celui de l’employé ou du propriétaire d’hôtel, de restaurant, de taxi, de bateau ou de boutique qui profite de l’ignorance des touristes en visite dans le pays, de la langue, des prix du marché, pour essayer de les arnaquer, sans penser que c’est grâce à ces clients qu’il a du travail et un salaire : en fin de compte, le prestige du pays à l’étranger n’est pas son affaire, mais celle du ministère du Tourisme, ce n’est pas non plus l’affaire du braqueur ou du violeur de l’étrangère prise au dépourvu. Collective, et même criminelle, est la « viveza » des banquiers qui constituent des « sociétés fantômes » —parfois simplement avec la secrétaire et le concierge de l’avocat qui en fait le montage, qui souscrivent auprès de la banque des « crédits affectés » qu’ils ne remboursent jamais et sur lesquels ils ne paient jamais ni intérêts ni impôt, et quand ils ne disposent pas des « liquidités » pour rendre aux épargnants et titulaires de comptes courants leur argent ainsi détourné, ils ferment leurs portes et implorent l’aide de l’État car « c’est la faute du gouvernement qui ne s’occupe pas assez des provinces ». Collective, la « viveza » des entreprises du spectacle qui survendent des billets d’entrée sans se préoccuper du risque que cela entraîne pour le public, avec des blessés légers ou graves, et même des morts. (On m’a dit, mais je me refuse à y croire, qu’il existe d’une Association des revendeurs de billets). Ou de ceux qui, avec une « viveza » infinie, s’adonnent à la fraude au fisc avec une double comptabilité rendue valable par l’inspecteur mal payé mais bien soudoyé. Ou de ceux encore qui délivrent diplômes et grades professionnels aux médiocres, aux crétins ou aux fainéants qui les obtiennent en payant ou en les menaçant.
Institutionnelle également, car la roublardise locale, équatorienne, pour alimenter proches ou coreligionnaires, consiste à exiger un acte de naissance « mis à jour » —notamment à cause de cette autre viveza qui fait que les morts peuvent voter ou toucher une pension— comme si un tel document pouvait cesser d’être valide quand il est exigé, disons, pour accéder aux prestations de retraite. (Voilà un autre exemple fini de corruption : il m’a été rapporté plus d’un cas où un acte « avait été perdu » —un mensonge gros comme une maison car les naissances étaient transcrites, à la main, sur un registre fort volumineux— et que la seule solution consistait en une déclaration sous serment devant deux témoins fournis par le fonctionnaire en échange d’une somme d’argent qui variait en fonction du nom de famille et de l’apparence de l’usager. Or, après avoir payé la formalité et une fois venu le jour de la déclaration, l’acte avait « refait surface »). Il y a une certaine similarité avec la demande de « certificat de vie » délivré par un notaire ou un avocat, que, chaque année, doivent présenter les retraités pour toucher leur pension et qui, avant l’exigence de cette formalité, accréditaient qu’ils étaient en vie par leur seule présence ; équatorianissime est l’aberration que représente cette autorisation militaire de quitter le territoire exigée à tout le monde et non pas seulement à ceux qui, pour de troubles raisons, sont sous le coup d’une « interdiction de sortie du territoire ». (Cette autorisation avait une validité de 24 heures ; toutefois, dans un éclair de logique inusité, l’administration en a étendu la validité à un an. Puis un jour quelqu’un a décidé de revenir au vieux système, en la rallongeant à 72 heures. La première explication d’un fonctionnaire, la plus sotte soit dit en passant, de la Direction de l’immigration, fut qu’ « il est plus facile de falsifier un passeport en un an qu’en 72 heures », ce qui n’avait rien à voir avec l’autorisation de sortie, concédée sur présentation du passeport. Devant le rejet suscité par cette mesure, il passa aux aveux : « le but est d’engranger davantage de recettes »). Unique au monde est la viveza, la roublardise des services postaux qui contraignent le destinataire à payer pour recevoir un colis dont l’affranchissement a déjà été payé par l’expéditeur ; et cette mesure est d’une discrétion telle que la taxe est calculée par la préposée « à vue d’œil » qui, en fonction de la capacité de persuasion de l’intéressé, concède une remise sur la taxe et remet parfois même le colis sans exiger de paiement. Canaillerie encore, picardía, qui atteint le paroxysme en dénaturant sa finalité, est celle de l’organisme chargé de protéger les droits d’auteur qui fait payer la concession d’un « permis de diffusion en public » de musique piratée. (À l’autre bout de cette taxe sur un service non fourni se trouve l’invention, le plus souvent dans les petites villes, d’habiles procédés destinés à fausser la consommation réelle des compteurs d’électricité ou, à Guayaquil, de se « connecter » au réseau électrique d’éclairage public). Peut-on qualifier d’escroquerie, confondue avec « viveza », ce supposé conflit de la classe moyenne entre sa tendance naturelle à la justice et son besoin d’opportunisme pour vivre ? Et, avant tout, s’agit-il vraiment d’une tendance naturelle ? S’agit-il vraiment d’un besoin ?
Carlos Carrión a dressé une brève ébauche des pratiques de la viveza criolla : « Dans un quintal de cumin, certains producteurs de condiments y versent une arrobe de maïs grillé. Les commerçants, dans un quintal de petits pois, versent au moins une demi-arrobe de gravier. Dans la pâte des biscuits, un peu de terre des chemins. Dans le fromage, un tiers de pomme de terre ou de maïs moulu. Dans le beurre de cacao pour soulager l’irritation des lèvres, un peu de cire pour faire des cierges à la Vierge. Dans les tablettes de chocolat, de la margarine. Et ne parlons pas des poids pour les balances, où l’on trouve des creux secrets pour les alourdir de quatre onces ou d’une demi-livre. Ni de l’or pour faire des dents, où l’on trouve du bronze pour statues. D’un autre côté, il est des médecins qui procèdent à des opérations chirurgicales contraintes ou imaginaires. Des ouvriers du bâtiment qui, le propriétaire à peine parti, emportent ciment, barres de fer et briques. Et des docteurs […] qui vendent du bois frais en le faisant passer pour du parquet bien sec. Des avocats qui se mettent dans la poche la propriété immobilière qu’ils défendent. Des enfants qui arnaquent leurs propres parents et les jettent à la rue. Et des amis qui demandent des garants pour des sommes astronomiques qu’ils ne remboursent jamais. Tout cela parce que ni dans les maisons, ni dans les écoles, ni dans les lycées et ni dans les églises il n’a été prêché la moindre larme de morale dans nos cœurs. Ou alors, c’était des larmes de crocodiles : ils avaient la tête ailleurs. Car personne ne pense à autre chose qu’à l’argent —plus il a été obtenu de façon malhonnête, mieux c’est— qui sera laissé en héritage à ses enfants » (Mais toi, le courageux au volant, toi qui as l’insulte sur le bout de la langue dès qu’on te met face à tes erreurs ou tes mauvaises actions, tu ne protestes pas, tu as peur, tu t’es résigné, tu n’exiges pas, ni dans la boutique du coin ni au ministère, que tes droits les plus élémentaires de citoyen élémentaire soient respectés, peut-être parce que dans un recoin de ta conscience tu sais que tu as agis ainsi toi aussi. Tu as encore beaucoup à faire avant de prendre conscience de la défense des droits de l’Homme, sans parler des droits économiques, sociaux et culturels, qui appartiennent à la deuxième génération. C’est Alexis Ponce, de l’Assemblée permanente pour les droits de l’Homme, qui a fait observer l’absence de culture d’exigence, ce qui, à son avis, est lié à « l’absence de citoyenneté » en Équateur. « La victime n’a pas de nom, de visage, d’identité, de parole… qu’il s’agisse d’une femme au foyer, d’un petit gamin d’école publique, d’un passager de transport en commun, d’un locataire à la recherche d’une chambre à louer, d’un retraité au guichet de la sécurité sociale, d’une jeune élève de l’école du soir qui attend le bus à 22h30 à « La Marín », quartier coupe-gorge, d’un homme noir de peau à l’attitude suspecte —à toute heure du jour et de la nuit—, d’un travesti au rez-de-chaussée à gauche du centre de détention provisoire, d’un indigène dans un commissariat ou un tribunal de métis, d’un étudiant fraîchement diplômé de l’Universidad Central qui remet son dossier à des agences d’emploi privées, d’un pauvre arrêté pour « investigations », d’un acquéreur d’une livre de viande s’il prend une demi-livre d’os dans les boucheries du pays ou d’un litre de lait s’il prend du pain dans les boulangeries du pays, etc. ».
Un autre type de « viveza », tout aussi fréquent, n’implique pas de dol, de mauvaise foi, d’escroquerie, de corruption ou de vol, mais suppose de tromper, de piétiner l’autre et d’agir comme si le monde, un monde sans société, sans coutumes ni lois, vous appartenait : je parle de celui qui « répare » une voiture, prétendument en panne, sur une avenue où il est interdit de se garer, jusqu’à ce que le propriétaire de la voiture ou un proche aille retirer de l’argent dans un distributeur automatique ; de celui qui, sous prétexte qu’il propose des doubles de clés ou vend des pièces d’artisanat quelconque, installe des pierres ou des caisses en bois face à la porte de son taudis ou de son kiosque pour interdire aux gens de se garer devant ; de celui qui « chipe » la place de parking à quelqu’un qui allait s’y garer avant ; de celui qui —parmi toutes les agressions sonores possibles— installe sur le trottoir un haut-parleur et diffuse à plein volume de la musique ou ce qui lui passe par la tête, parce qu’il vend CD et cassettes, ou sur une terrasse pour attirer les clients, parce qu’il est à la tête d’un petit restaurant désolé ; de celui qui, parce qu’il est propriétaire du mur qui donne sur la rue, s’octroie le droit d’y peindre des panneaux ridicules, au mépris de l’orthographe, et même des silhouettes monstrueuses dans le cas des bars et des discothèques ; de celui qui conduit à contresens ou fait fi des feux de signalisation histoire de gagner quelques minutes pour se rendre à un endroit où, selon un visiteur étranger, « on ne peut rien faire qui ne puisse attendre trois mois », et, si ce faisant il accroche ta voiture, il t’insultera violemment, c’est là sa façon de solutionner tous les problèmes ; de celui qui (ou plutôt celle) qui laisse, au bout de la file d’attente à la caisse du supermarché, son chariot, pour continuer de faire ses courses, et exige qu’on respecte sa place dans la file (si auparavant c’était des gens qui faisaient la queue et non pas des chariots abandonnés, il me semble que dernièrement il y a de plus en plus d’enfants qui sont calés entre le céleri et les rouleaux de papier toilette) ; de ceux qui transforment la rue en terrain de football —je sais bien qu’ils doivent sûrement manquer de tout, qu’ils n’ont pas d’autre endroit pour jouer et que c’est dans ces conditions que se sont formées certaines grandes stars de ce sport— ce qui entraîne des déviations pour les usagers de la route, y compris les transports en commun ; de ceux qui, le soir du 31 décembre, bloquent la route, avec une corde tendue d’un trottoir à l’autre, à tout véhicule, tant que leurs occupants ne leur auront pas donné d’argent (certains étudiants s’y adonnent n’importe quel jour de l’année, lors de leurs manifestations, pour acheter de l’essence afin de brûler des pneus, ce qui semble être leur seule posture idéologique) ; de celui qui, à l’aéroport, pour affirmer fièrement sa nationalité, « passe » devant tout le monde au contrôle des passeports, bafouant les Équatoriens moins roublards et les étrangers dépourvus de notre roublardise… J’ai lu, dans un journal, l’histoire d’une fausse alerte qu’un passager avait lancée par téléphone, réussissant ainsi à retarder le départ d’un vol qu’il craignait de rater.
Mais n’êtes-vous pas émerveillé aussi par l’intelligence que suppose cette viveza criolla ? m’avait demandé la personne qui présentait une émission de télévision sur nos us et coutumes. Cela se pourrait, à condition de ne pas en être la victime, quoique… Il y a quelques années, à Guayaquil, j’ai croisé une jolie petite fille noire qui pleurait, assise sur le bord du trottoir, à côté d’une bouteille de lait cassée. Elle avait peur, disait-elle, de rentrer chez elle où elle serait battue à coup sûr. Je lui ai donné de l’argent, bien plus qu’il ne fallait. Quelques jours plus tard je l’ai retrouvée dans une autre rue, à côté d’une bouteille de lait cassée. L’intelligence, chez cette gamine, pouvait résider tout d’abord dans le calcul des probabilités : j’ai sans doute été le seul à l’avoir recroisée, alors que les gens compatissants étaient de plus en plus nombreux. Ensuite, dans l’exploitation des matériaux : je suis certain, avec le recul, que les morceaux de verre de la bouteille lui ont servi plus d’une fois. Je pense également qu’en matière de roublardise, le niveau socio-économique, l’importance de l’individu ou du poste qu’il occupe ou son niveau d’éducation n’a pas d’importance, et l’âge non plus : je me trouverais bien déçu si l’on m’apprenait que ses parents ou d’autres adultes lui avaient appris cela.